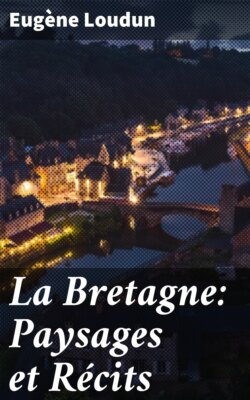Читать книгу La Bretagne: Paysages et Récits - Eugène Loudun - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Saint-Thégonec. — Les cimetières. — Les calvaires. — Cast.
ОглавлениеTable des matières
Il n'est pas besoin de parcourir toute la Bretagne pour avoir une idée de ces œuvres de l'architecture embellie par la foi : dans un petit bourg, à Saint-Thégonec, entre Morlaix et Landerneau, église, chapelle funéraire, sculptures, crypte, calvaire, tous les types de l'art chrétien de Bretagne, se sont comme donné rendez-vous.
Les cimetières bretons se ressemblent tous ; presque partout ils entourent l'église ; ceints d'un petit mur bas, souvent ils n'ont pas même de portes ; une grille de fer, posée à plat sur un petit fossé, suffit pour interdire aux bestiaux l'accès de la demeure des morts[1]. Une croix, un calvaire où sont représentées des scènes de la Passion, quelquefois la statue agenouillée d'un pasteur regretté, image vénérée qui rappelle ses vertus à ses fidèles paroissiens (à Goueznou), voilà les seuls monuments de ces cimetières des villages bretons ; les tombes sont marquées par de petits tas de terre, serrés l'un contre l'autre avec une croix dessus. Une pierre recouvre quelques-unes de ces tombes, et, dans la pierre, on a creusé comme une petite coupe où s'amasse l'eau du ciel, et dont la mère, le fils, l'ami, aspergent la tombe lorsqu'ils viennent s'agenouiller et prier pour celui qui est couché dans la terre[2]. Ces cimetières, placés au milieu des bourgs et des villages, ont peu d'étendue, il faut un petit nombre d'années pour que ces champs de la mort soient comblés des corps des générations éteintes ; les morts bientôt sont exhumés pour faire place aux nouveaux venus : dans quelques villages alors, à Plouha, les fils, après avoir déterré les os de leurs pères, ont dressé, le long de la façade de l'église, les pierres des tombes, pierres debout qui ne recouvrent plus aucun corps, froids témoignages d'un souvenir qui de jour en jour va s'effaçant. Ailleurs, et le plus souvent, on a construit, à côté de l'église, une chapelle funéraire, et là on a recueilli les os des morts exhumés : si l'on jette un regard à travers l'étroite ogive qui s'ouvre sur ce charnier sombre, on aperçoit un énorme amas d'ossements, entassés et mêlés comme des brins de paille ; ce sont les hommes qui ont marché sur terre, solitaires et délaissés jusqu'au jour de la résurrection éternelle.
[Note 1 : A Goueznou, à Plabennec, etc.]
[Note 2 : On voit aussi, en Algérie, de petites coupes creusées dans les pierres sépulcrales des musulmans ; mais cette eau ne sert qu'à désaltérer les oiseaux ou à arroser les fleurs qui ornent la tombe.]
Mais, à Saint-Thégonec, un sentiment plus respectueux ou plus tendre a voulu du moins conserver intacte une partie de ces corps arrachés à la terre. Avant d'entrer dans l'église, on est frappé d'un spectacle inattendu : à toutes les saillies du bâtiment, sous les porches, sur la corniche antérieure, sont alignées, accrochées, suspendues l'une à l'autre, une multitude de petites boites comme un chapelet ; ces petites boîtes, surmontées d'une croix, sont des cercueils, elles renferment le crâne des ancêtres, la tête, ou, selon le mot expressif de la vieille langue, le chef, ce qu'il y a de plus noble en l'homme et qui semble le résumer. Une inscription indique la date et le nom :
Ci gît le chef de...
On le voit par une petite ouverture en forme de cœur, autre symbole touchant. Ce sont les archives funèbres des familles, non renfermées dans la maison où l'habitude les eût fait oublier, mais à l'ombre de l'église, devant lesquelles les générations nouvelles passent et se découvrent, le dimanche en venant prier[1].
[Note 1 : A Locmariaker, ce ne sont pas seulement des cercueils à têtes, mais des petits cercueils en miniature qui contiennent tous les os, et qui sont empilés l'un sur l'autre dans l'ossuaire, comme des ballots.]
Çà et là, sur la corniche, exposés à l'air, gisent quelques crânes de morts qui n'ont pas eu de famille et à qui l'on n'a pas donné de cercueil, verdis, les yeux pleins de gravier, à travers lesquels pointent des brins d'herbe, souvent penchés l'un vers l'autre, celui-là appuyé peut-être sur celui qui fut son ennemi en ce monde.
Après avoir passé entre ces deux rangs de cercueils suspendus, on entre dans l'église, et cette église est comme un résumé de toutes les églises bretonnes : tout s'y trouve, élégant bénitier, boiseries sculptées, chaire en bois, d'un travail merveilleux, chef-d'œuvre de la fin de la Renaissance, une des plus belles chaires de Bretagne ; tableaux en bois, à fermoirs peints, pyramide de patriarches, de rois et de prophètes de l'Ancien Testament, montant de la terre au ciel, jusqu'à la sainte Vierge ; voûte d'or et d'azur au fond tout étincelant ; le chœur, l'autel et les chapelles latérales, chargés de statues, colonnes torses, têtes d'anges, fleurs, guirlandes, dorées et peintes de toutes couleurs, un ruissellement d'or, de verdure, de rouge éclatant et d'azur.
De cet ensemble reluisant et vivant, une porte seule, sur le côté, se détache haute et nue ; pas de sculptures, pas d'ornement ; les pierres suintent l'humidité ; les assises qui ont pris une teinte noire, séparées par un ciment blanc, ont un aspect lugubre ; c'est comme un grand voile de deuil tendu dans un coin ; et, en effet, c'est la porte des morts. Vous l'ouvrez, et vous vous arrêtez ébloui : c'est là le cimetière, et, dans le cimetière, devant vous, à droite, à gauche, une réunion inattendue de monuments : sous le porche où vous êtes, des deux côtés, les statues alignées des douze Apôtres ; en face, une large porte à trois arcs, d'un style imposant, la porte du cimetière, et l'on dirait d'une arche triomphale, comme si ces Bretons avaient voulu marquer que celui qui passe sous cette porte, couché dans le cercueil, entre non dans la terre, mais dans la vie éternelle, le séjour de la joie et de la gloire ; à droite, une chapelle funéraire, du même temps que le Louvre de Henri IV, décorée, sculptée du bas en haut, comme une châsse immense taillée en granit ; enfin, à gauche, monument capital entre tous ces monuments, le Calvaire, un de ces calvaires compliqués, tels qu'on n'en trouve qu'en Bretagne, un peuple de statues, quatre-vingts ou cent personnages en pierre, dans les attitudes les plus naturelles et les plus naïves, disciples, prophètes, saintes femmes, larrons sur leurs gibets, gardes sur leurs chevaux, et, dominant toute cette foule, l'arbre de la croix, colossal, à plusieurs étages, croix sur croix, aux branches chargées de statues, la Vierge, saint Jean, les gardes, et, tout au faîte, le Christ, les bras étendus sur le monde et les yeux au ciel ; et les anges, suspendus dans les airs, recueillant dans des coupes le sang précieux de ses mains[1].
[Note 1 : Les calvaires de Plougastel et de Pleyben, bourgs si remarquables du reste par leur belle église, sont plus compliqués et plus grands, mais non d'un effet plus saisissant.]
Et ce n'est pas tout : entrez dans la crypte de la chapelle funéraire ; et là, vous vous trouverez en face d'un autre chef-d'œuvre, l'ensevelissement du Christ, exécuté dans des proportions colossales, cette scène qui a inspiré de tout temps les plus grands artistes. Ces statues sont peintes, et ici la peinture, au lieu de diminuer l'impression, la complète, en donnant à ces personnages si vivement émus l'apparence même de la vie : vous les entendez crier, vous voyez leurs larmes sur leurs visages pâlis ; la Vierge, les lèvres pressées sur les pieds livides de son divin Fils, la Madeleine bouleversée par la douleur, belle encore au milieu des pleurs qui inondent son visage : vous devenez acteur en cette scène passionnée, vous êtes saisi, pour ainsi dire, par la réalité, le coup de leurs souffrances vous frappe au cœur, et, ébranlé jusqu'au plus profond de l'âme, vous êtes étonné de sentir des larmes qui coulent de vos yeux.
Et quand on songe que ces œuvres d'art religieuses sont répandues avec la même profusion dans toute la Bretagne ; que, dans les bourgs les plus éloignés de toute route et de tout centre, à Saint-Herbot, dans les montagnes Noires, dans un pays de landes, à Saint-Fiacre, qui n'est qu'un petit village voisin du Faouet, moins même qu'un village, un misérable hameau de cinq ou six maisons, dans la chapelle de Rozegrand, près de Quimperlé ; modeste manoir qui mérite à peine, le nom de château, on rencontre des jubés de bois sculpté, peints, dorés, chargés de centaines de personnages, et dont s'enorgueilliraient les plus riches églises, œuvres admirables qui reproduisent avec une abondance infinie l'histoire, les prodiges et les mystères de la religion, et conservent chez le peuple et raniment et accroissent l'ardeur de la foi, on ne peut s'empêcher de se demander : Quelle est donc la cause de cette multitude d'ouvrages d'art qui ont surgi sur toute la surface de ce sol, et quelle force a donné aux auteurs de ces œuvres tant de qualités si rares : fécondité d'invention, vérité du geste, expression de la physionomie, sentiment vrai et profond de ces scènes divines ? Dans tous ces monuments du moyen âge, c'est la même vérité, la même puissance d'imagination ; jamais l'artiste ne se répète, il ne se lasse pas, il ne semble pas avoir cherché, comme un musicien qui a une multitude d'airs dans la tête ne s'arrête sur un motif que le temps de l'exprimer avec une vivacité rapide, et passe à un autre et vous entraîne dans sa course inspirée.
Il y a une cause, en effet, à cette puissance de création : cette société, comme un homme qui est parvenu à sa maturité, avait accompli tous les travaux nécessaires au but qu'elle devait atteindre. Les premiers siècles l'avaient préparée, elle s'était dégagée des langes de l'antiquité, sa langue était faite, ses idées religieuses arrêtées ; la république chrétienne est logiquement constituée, elle a son unité. Ce peuple, alors, est dans la complète possession de sa force ; il ne lutte pas pour créer ; il n'est pas tiré en sens divers par plusieurs penchants contraires ; il n'est pas emporté par ce souffle capricieux et déréglé que l'on ne dirige pas, mais qui vous pousse, qui naît du désordre des idées et que notre temps a justement appelé d'un nom nouveau, la fantaisie. Les âges précédents ont cherché, amassé, rapproché ; tous les matériaux sont prêts sous sa main ; il n'a plus qu'à les prendre : c'est le génie même de l'époque qui, libre et aisé, produit et se joue en mille formes, et, comme un vase rempli, n'a qu'à s'épancher pour faire déborder ses trésors. Alors l'imagination partout éclate, vive et colorée ; un même esprit, dans les monuments d'art comme dans la littérature, crée les ornements variés des églises, invente les fabliaux et les contes, trouve à chaque instant des images nouvelles pour représenter les opinions, les idées et les mœurs ; et cette imagination, loin de se fatiguer, féconde ; car ce n'est pas une production factice de serre chaude, c'est la floraison naturelle d'un arbre en son printemps, toute une suite de siècles qui se couronnent dans le dernier. Et voilà pourquoi les artistes, auteurs de toutes ces œuvres, sont inconnus. Ces œuvres ne sont pas d'eux, elles sont du peuple entier ; ce n'est pas leur pensée qu'ils ont rendue, mais la pensée de tous, de leurs pères et de leurs ancêtres, avec laquelle ils sont nés, ils ont été élevés et ont vécu, qui a pénétré tout leur être, et est devenue comme une partie même de leur âme. Ainsi, ils ont senti, compris, exprimé sans effort, et ces monuments de l'art sont, non la marque de leur talent et de leur passage sur terre, mais le témoignage de leur piété et de leur foi, de la piété et de la foi de tout un peuple.
La même foi des anciens jours persiste encore dans la Bretagne : si l'on en doutait, que signifient ces signes multipliés d'une piété qui ne s'affaiblit pas, ces écharpes de cachemire, dons des femmes de l'aristocratie, qui couvrent les autels de la cathédrale de Tréguier, et ces offrandes du pauvre, ces faisceaux de béquilles appendues au Folgoat par les infirmes guéris ? et ces pèlerinages de milliers d'hommes qui, chaque année, viennent, comme une armée, entourer de leurs longues lignes aux cent replis l'église de Sainte-Anne d'Auray ? et ces tableaux miraculeux qui tapissent du haut en bas l'église de la mère de la Vierge, trop petite pour ce musée chrétien incessamment renouvelé ? A chaque pas s'élèvent des chapelles et des églises neuves : à Saint-Brieuc, on en construit plusieurs à la fois ; Lorient, ville toute peuplée de marins et de soldats, vient d'élever à ses portes une église dans le goût du XIVe siècle ; Vitré donne à son église un clocher neuf et une chaire sculptée ; les petits villages dressent, dans leur cimetière, des calvaires à personnages comme au moyen âge ; le calvaire de Ploezal, entre Tréguier et Guingamp, est daté de 1856 ; Dinan restaure et agrandit sa belle église de Saint-Malo ; Quimper lance dans les airs deux flèches hardies sur les tours de sa cathédrale ; la chapelle de Saint-Ilan, modèle de grâce et d'élégance, s'élève toute blanche, au bord de la mer, au milieu des toits calmes de sa colonie pieuse ; Nantes, en même temps qu'elle bâtit plusieurs églises nouvelles, achève son immense cathédrale, dôme de Cologne de la Bretagne, auquel tous les siècles ont mis la main, et construit cette église Saint-Nicolas, reproduction presque parfaite de l'art religieux au temps de saint Louis, œuvre digne des plus beaux temps de l'art religieux, et qu'a suffi à accomplir en moins de dix ans le zèle de son pasteur et la piété de ses enfants, avec le produit de leurs aumônes et de leurs dons. Il y a quelques années, à Guingamp, on dédia à la sainte Vierge une chapelle placée à l'extérieur de l'église : statues peintes des douze Apôtres, autel resplendissant, voûte azurée aux étoiles d'or, nulle dépense ne fut épargnée, nulle décoration ne parut trop splendide pour orner le sanctuaire de la Vierge ; il s'y trouva cinquante mille personnes le jour de l'inauguration. Ce sont là les fêtes nationales des Bretons ; ailleurs, les peuples se pressent au passage des princes ou aux anniversaires de révolutions qui se succèdent ; eux accourent de toutes les parties de la Bretagne pour assister au couronnement de la Reine du ciel.
Et quelle piété, quel recueillement, quelle gravité dans le maintien de ces hommes et de ces femmes agenouillés sur le pavé des églises ! Ce n'est qu'à la Trappe que j'ai vu une absorption aussi complète de l'être humain dans une pensée qui le remplit : il semble que toutes les fonctions de leur vie soient anéanties ; immobiles dans leur prière, ils demeurent en cette contemplation absolue où l'on se représente les saints, envahis par un sentiment de vénération, de soumission et d'humilité, où l'homme disparaît et où il ne reste plus que le chrétien. Voilà ce qui est plus expressif que tous les monuments ; ces actes journaliers d'une dévotion toujours égale montrent l'état habituel de l'âme.
Traversez, un jour de marché, la place de quelque ville ou bourg du Finistère : l'aspect en est varié et animé ; ce marché, c'est une file de petites voitures, et sur toutes ces petites voitures, toutes sortes de marchandises, des rubans de velours et des boucles pour les chapeaux d'hommes, des ornements de laine tressés sur des roseaux pour les chaussures des femmes, des épingles bariolées, à dessins enroulés avec des perles de verre, des porte-pipes de bois, de petites pipes microscopiques, de petits instruments pour allumer la pipe, etc. Sous les tentes de ces petits magasins roulants, une foule d'hommes et de femmes, les femmes avec leurs coiffures de diverses formes, leurs grands fichus blancs arrondis sur le dos et finissant en deux pointes sur la poitrine ; les hommes avec leurs braies étroitement serrées, tombant très-bas et attachées sur les hanches, de manière à laisser passer la chemise entre la braie et la veste, le chapeau aux grands bords recouvrant leurs longs cheveux souvent relevés dessous et le bâton à la main, ne se pressant pas, marchant à pas comptés, faisant leurs marchés sans hâte. Mais voilà midi : de la haute tour du clocher de l'église voisine, tombe le coup retentissant de midi ; les douze coups lentement résonnent ; aussitôt, à ce dernier coup, tout mouvement cesse, tout le monde s'arrête, tout se tait, un grand silence plane sur la place ; tous ces hommes, d'un même mouvement, ôtent leurs grands chapeaux, leurs longs cheveux tombent sur leurs épaules, et tous se mettent à genoux, se signent et murmurent à voix basse l'Angelus. L'étranger, au milieu de cette foule prosternée, s'étonne lui-même de rester debout, et s'incline comme involontairement. Puis la prière de la Vierge finie, ils se relèvent, le mouvement recommence, et l'on entend sur la place ce bruit sourd qui ressemble au murmure de la mer éloignée.
Il me semble les voir encore dans l'église de Cast (Finistère). C'était un dimanche, à l'heure des vêpres ; la cloche sonnait dans le clocher à jour, et, sur la route, devant l'église, était amassée une grande foule, hommes et femmes, causant par groupes, doucement et sans bruit. La cloche cessa de sonner ; les groupes se rompirent aussitôt, se séparant en deux bandes, d'un côté les femmes, de l'autre les hommes, se dirigeant vers l'église. Les femmes entrèrent les premières ; en un moment, la nef en fut remplie ; au milieu, les jeunes filles de la confrérie de la Vierge, toutes en blanc, mais toutes les vêtements ornés de broderies d'or et d'argent, des rubans d'or serrant le bras, des ceintures d'argent et d'or ceignant la taille et retombant en quatre bandes par derrière sur la jupe plissée, le cœur d'or et la croix sur la poitrine ; dans les contre-allées, les femmes et les mères, en costume plus varié, et vivement coloré, des coiffes à fonds bleus et jaunes, des rubans bleus lamés d'argent sur le casaquin brun, des jupes rouges, des bas à coins brodés d'or. Toutes étaient à genoux sur le pavé, la tête inclinée, le chapelet entre les mains, dans un silence recueilli.
Puis, quand les femmes furent placées, une autre porte s'ouvrit par un côté de l'église, c'était le tour des hommes ; ils entrèrent, à la file, d'un pas grave et lent, et c'était un spectacle étrange et imposant. Autant les femmes, dans leur costume bariolé, étaient scintillantes de vives couleurs, autant celui des hommes était simple et sévère, ce qui saisissait l'attention, ce n'étaient pas leurs vêtements presque uniformes, leurs longues vestes brunes, seulement bordées d'un galon rouge, leurs larges braies bouffantes ; c'était leur tête carrée, les longs traits de leur physionomie, ces grands cheveux plats, couvrant entièrement leurs fronts comme une toison épaisse, et descendant en longues nappes sur leurs épaules et sur leur dos jusqu'au milieu des reins. Tous, enfants et hommes faits, portaient le même costume, tous leurs longs cheveux noirs qui, à l'air, prennent une teinte d'un roux sombre, et sous ces longs cheveux tombant sur les sourcils épais, leurs yeux avaient une expression énergique et je ne sais quelle fermeté dure. On eût dit que ce n'étaient point des hommes de notre pays et de notre temps ; ces visages graves et immobiles, les regards brillants qu'ils attachaient sur l'étranger, comme pour pénétrer sa pensée, ces chevelures incultes qui chargent leurs gosses têtes comme des crinières de bêtes fauves, donnaient l'idée d'un peuple à part ; on pensait à ces tribus des déserts de l'Amérique qui errent encore sur les frontières, des races modernes, et qui, avec leur parole brève et sentencieuse, leurs gestes rares, leur démarche solennelle, semblent garder le mystérieux secret des premiers jours du vieux monde.
Ils défilèrent un à un, s'inclinant profondément devant l'autel, et s'agenouillèrent à leur tour sur la pierre, entourant entièrement la grille du chœur. C'était là, la vraie assemblée des fidèles ; les hommes, comme une forte milice, en avant ; les femmes derrière, foule plus humble ; tous ayant oublié tout le reste, ne vivant plus que d'une pensée, tout à Dieu. Car Dieu n'est pas pour ces barbares ce qu'il est pour nous ; nous, habitants civilisés des villes, nous cherchons à expliquer Dieu ; même à genoux dans ses temples, nous l'analysons, nous commentons ses actes, nous doutons peut-être s'il existe. Ils n'ont point, eux, ces vaines pensées, méditations stériles : pour eux Dieu est, ils le savent, ils le croient ; il a fait le ciel sur leurs têtes, la terre qui produit leurs moissons, il les a faits eux-mêmes, il les conserve ou les reprend ; c'est l'Invisible qui peut tout, au fond des cieux et partout à la fois, et, sous ce Tout-Puissant, ils se voient bien petits, ils se prosternent et ils adorent.
La prière, a-t-on dit, semblable aux battements du cœur, entretient la vie. Le peuple breton croit et prie ; une force est au dedans de lui, la religion, source de sa virtualité, qui atteste que non-seulement il existe, mais qu'il vit.