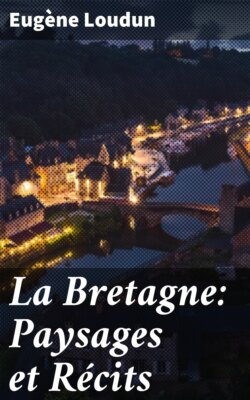Читать книгу La Bretagne: Paysages et Récits - Eugène Loudun - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Le Morbihan. — La presqu'île de Rhuis. — Locmariaker. — Plouharnel. — Carnac.
ОглавлениеTable des matières
Le Morbihan n'a conservé ni la langue, ni l'ancien costume breton ; au premier aspect, il ressemble au reste de la France ; mais ce n'est là que la surface ; pour les mœurs, le respect des traditions, le culte de la famille, la piété et la foi inébranlable, il ne le cède à nulle autre partie de la Bretagne. Nulle part le sentiment royaliste ne se montra plus vif au moment de la révolution ; c'est dans le Morbihan que la guerre des chouans se perpétua avec une ardeur toujours renaissante ; ce furent ses côtes que choisirent les émigrés pour y débarquer et y recommencer la lutte ; c'est à Quiberon qu'ils combattirent, à Auray qu'ils succombèrent, à la Chartreuse que sont entassés leurs os, et, pour tout dire en un mot, le nom du Morbihan ne se sépare pas du nom de Cadoudal.
De même aussi, c'est à sainte Anne d'Auray que se fait le grand pèlerinage de Bretagne : sainte Anne est la patronne de la Bretagne, comme saint Yves le patron ; mais saint Yves n'a que le respect des peuples, sainte Anne en a l'amour ; ils donnent à sainte Anne une part presque égale de l'affection tendre et pour ainsi dire filiale qu'ils ont vouée à la sainte Vierge. Le pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray n'attire pas seulement des habitants du Morbihan ; durant plus de quatre mois, des points les plus éloignés de la Bretagne, par tous les chemins, on voit arriver des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont quitté leurs champs, leurs maisons, leurs travaux, pour vénérer en sa chapelle préférée la mère de celle qui enfanta le Sauveur. Et quelle piété ! quelle dévotion ! Dès que, de loin, dans la lande où ils marchent par groupes, le chapelet à la main, ils aperçoivent le clocher de l'église, tous aussitôt se prosternent à genoux, le front courbé, murmurant une prière à voix basse ; puis ils se relèvent, s'alignent sur deux rangs, et, la tête découverte, à pas mesurés, s'avancent vers Sainte-Anne, où leurs cantiques, qui emplissent la campagne, annoncent l'arrivée de nouveaux pèlerins.
Là, l'on rencontre alors tous les costumes, on entend tous les dialectes de Bretagne ; le centre de la Bretagne, ce n'est ni Rennes, ni Nantes, ni même Quimper : c'est ce petit village du Morbihan, Sainte-Anne d'Auray.
Le sol même a un caractère particulier : il n'y a pas un étranger qui n'en soit frappé ; c'est la vraie terre celtique. A chaque pas, des menhirs, des dolmens, des carneillous, des tumulus ; les champs sont entourés de quartiers de roc, débris de dolmens renversés ; dans la lande, parmi les verts ajoncs, surgit le cône gris d'un menhir isolé ; sur le bord du chemin est affaissée, semblable à un grand animal pétrifié, une pierre branlante, masse énorme, qu'un enfant, en la poussant du doigt, met en mouvement ; partout la terre porte les indestructibles marques de son antiquité.
Et la configuration du pays est d'accord avec ce caractère si déterminé. Le golfe du Morbihan, qui donne son nom à cette partie de la Bretagne, ne communique avec l'Océan que par une passe étroite ; s'avançant longuement dans les terres où il découpe de profondes anses, semé d'îles que l'on compte par centaines, qui s'élèvent blanches et sans arbres, au-dessus de ses flots calmes, et entre lesquelles passent et disparaissent les barques de pêche, c'est un lac presque fermé, une mer intérieure, la mer de Bretagne. Au fond, la vieille ville de Vannes qui armait de grandes flottes pour défendre l'indépendance gauloise contre les Romains, et, de chaque côté, s'étendant comme des bras, la longue presqu'île de Rhuis et la langue de terre au bout de laquelle est assis, regardant la mer, Locmariaker, qui déjà existait au siècle de César.
Autour de ce vaste bassin du Morbihan, convergent et se sont comme donné rendez-vous les monuments des vieux temps. Ici, dans la presqu'île de Rhuis, d'abord le château à quatre faces de Sucinio, tout ruiné à l'intérieur, les portes et les fenêtres ouvertes au vent, mais au dehors solide et presque entier ; gris, triste et inébranlable, il est resté debout comme une sentinelle qui garderait l'entrée de la presqu'île. Plus loin, le couvent de Saint-Gildas, au bord de l'Océan, où vécut quelque temps Abailard ; puis, tout au bout, un haut monticule au milieu de la campagne plate, le tumulus de Tumiac, amas immense de couches de terres et de pierres alternées : de son sommet, vous dominez deux mers, le Morbihan aux côtes dentelées, et le vaste Océan, et dans l'Océan, les îles autrefois détachées de la terre, Hédic, Houat, Dumet, Belle-Isle, qui ferment au loin l'horizon. Dans l'intérieur de la pyramide armoricaine, sous vos pieds, sont les chambres sépulcrales où ont été ensevelis les chefs des peuples.
Tel est le côté de la presqu'île de Rhuis ; sur l'autre rivage, relié à celui-ci par quelques pierres druidiques jetées çà et là dans les îles du golfe, vous apercevez tout à la fois plusieurs hauts tumulus comme celui de Tumiac ; les dolmens et les grottes se succèdent, et les menhirs ne se comptent pas. Tout autour de Locmariaker[1], dont le nom si parfaitement breton étonne l'étranger, sont dispersés une quantité de monuments qui attestent l'existence d'une cité puissante. C'est parmi ces monuments que se trouvent la Table de César et le Grand Menhir. La voilà, dans une lande, cette fameuse table, dressée encore sur ses piliers qui, depuis deux mille ans, n'ont pas bougé ; épaisse et large tranche de roc qu'on dirait coupée dans une montagne, elle est élevée en équilibre plus haut que la taille d'un homme, et elle a paru si gigantesque aux peuples qu'ils n'ont pas cru qu'elle pût porter un autre nom que celui de César, du géant qui les avait vaincus.
[Note 1 : Le village du Loc consacré à Marie.]
Faites quelques pas encore dans la lande, à travers les ajoncs épineux, vous êtes arrêté par une masse immense étendue sur le sol. C'est le Grand Menhir, le plus grand que l'on connaisse : de la pointe à la base, il a soixante-quatre pieds de long ; obélisque colossal, il s'élevait jadis dans la vaste solitude de ces champs, au-dessus de tous les menhirs d'alentour. Depuis des siècles, il gît renversé à terre, et tel était son poids, qu'en tombant il s'est brisé en quatre morceaux ; ils sont là, à la suite l'un de l'autre, à l'endroit où ils sont tombés ; on dirait des tronçons d'un formidable serpent antédiluvien. Nul n'a songé à les changer de place. Comme soudés au sol, ils dureront autant que le sol même.
Trois ou quatre lieues au delà, vous rencontrez les grottes de Plouharnel. En revenant de la presqu'île de Quiberon, au moment où l'on jette un regard derrière soi pour regarder encore la mer, la mer qui tout à l'heure ne se verra plus, on aperçoit, dans un champ, de grosses pierres peu élevées au-dessus du sol ; de loin, on les prendrait pour des dolmens renversés et on est près de les dédaigner ; mais entrez dans le champ, et le rocher qui vous semblait couché à terre, vous reconnaîtrez que c'est le toit d'un édifice enfoui dans le sol. Il faut, en effet, descendre de plusieurs pieds pour pénétrer dans l'intérieur : alors vous avez devant vous une allée droite, formée de larges rochers plantés en terre, comme une muraille ; au bout de cette allée, une chambre arrondie, et, sur le côté, une petite chambre communiquant avec la grande et qui en est comme le cabinet[1].
[Note 1 : L'allée est large de trois pieds, la chambre longue de dix et le cabinet de six. Ces grottes ont été découvertes il y a peu d'années.]
Le tout est recouvert des rochers que vous voyiez de loin, et qui, semblables à des dalles monstrueuses, scellent ces sépulcres vides. Trois grottes s'alignent à côté l'une de l'autre, parallèles et de même longueur, sépultures familiales où, près de la dernière demeure des parents, avait été réservée la tombe du petit enfant.
Mais voici Carnac, et ses célèbres et indéchiffrables alignements : à mesure qu'on approche de Carnac, à droite et à gauche, se dressent, dans les champs, de hautes pierres par groupes de douze ou quinze ; l'un de ces groupes, le plus considérable et composé des plus gros blocs, s'appelle le Camp de César ; car c'est toujours ce vainqueur que l'on rencontre en notre France, comme Alexandre et Sésostris en Asie, comme Napoléon en Égypte, en Syrie, dans l'Europe entière : l'homme ne créant pas, ce sont les destructeurs d'hommes qui saisissent le plus l'imagination des nations et dont elles consacrent le nom.
Ces groupes de rocs isolés sont comme les avant-postes d'une armée. Bientôt on se trouve au milieu de l'armée elle-même. Tout d'abord, on n'éprouve pas cette stupeur dont parlent les voyageurs. C'est que là, comme en toutes les recherches de sa vie, l'homme, au milieu des choses où il aspirait, les possédant et les tenant en sa main, n'a qu'un étonnement, c'est qu'elles soient si peu ; dans les montagnes, touchant les pics que coupent en deux les nuages, il se demande si ce sont là les Pyrénées ou les Alpes. De même ici : entre ces milliers de rocs, vous ne saisissez pas leur énormité et leur multitude. Mais si, du haut d'un de ces blocs couchés à terre comme un monstrueux animal des premiers temps du monde, vous regardez devant vous, vous voyez s'allonger jusqu'à l'horizon, immobiles et muettes, les longues rangées de pierres levées sans nombre.
Elles s'étendent, en effet, en lignes droites, régulières, également séparées l'une de l'autre comme si le commandement d'un général eût écarté largement les rangs pour en passer la revue ; dans ces rangs, chaque soldat est un roc roide, le pied profondément enfoui dans le sol, les plus petits au bas des files comme à la queue de l'armée, les plus grands en tête ; l'homme de nos jours qui les mesure, debout à côté de ces colosses, atteint à peine leurs genoux. Pas une marque d'ailleurs, pas une inscription ; blocs informes, recouverts d'une teinte grise, ternes et sombres, ils semblent refléter les images mornes d'un éternel ciel de décembre.
La lande où ils sont plantés, sèche, âpre, s'étend à l'entour déserte et silencieuse. Ici, savants et ignorants admirent et interrogent. Qui a fait cela ? comment l'a-t-on fait ? dans quel but l'a-t-on fait ? Nul ne le sait, nul ne l'explique. Quel peuple, pour laisser une trace ineffaçable de son passage, a amassé, apporté ici ces lourdes masses et les a dressées vers le ciel, comme les bras pétrifiés de géants ensevelis ? Celtes ? Gaulois ? Kymris ? Nul ne répond : un peuple nombreux a été, on ignore même son nom ! Ce peuple connaissait-il les secrets d'une mécanique puissante pour avoir soulevé ces rochers grands comme les assises de Balbeck et de Memphis ? Ou si, à force de bras, il les a arrachés de la terre, amenés et plantés en rangs rigides, quelle pensée l'animait ? Est-ce un temple ? quelle foi ! Est-ce une sépulture ? quel symbole caché ! Une catastrophe sans précédents a-t-elle couché dans cette lande une race entière ? un choc soudain a-t-il ouvert la terre ? l'Océan, faisant un pas, a-t-il en un instant couvert une nation de sa nappe remuante, puis, en se retirant, tout emporté ? Et les peuples voisins auront marqué la place de ce peuple évanoui par ces rocs inébranlables, témoignage mystérieux d'un désastre qui ne sera jamais raconté !
Il y a quelques années, le savant, le poëte qui a recueilli, annoté et traduit les chants bretons, désira sauver de la destruction un dolmen qu'une route nouvelle allait renverser, et obtint l'autorisation de le transporter dans le parc de la belle habitation qu'il occupe près de Quimperlé. L'entreprise semblait aisée. C'était un dolmen de moyenne grandeur, et la distance à parcourir était seulement de quatre lieues. Mais lorsque l'on se mit à l'œuvre, on vit surgir les obstacles : hommes et chevaux pouvaient à peine ébranler la table du dolmen, ce ne fut qu'en augmentant hors de toute prévision le nombre des uns et des autres qu'on parvint à la mettre en mouvement ; on y employa dix-huit hommes, cinquante chevaux et l'on mit dix-sept jours à l'amener à la place qui lui était destinée ; les treuils, les poulies, les leviers, les rouleaux, les levées de terre, les moyens dont dispose l'industrie moderne et ceux dont on suppose que se servaient les peuples celtiques, on usa de tout successivement, et il arriva plus d'une fois que l'on ne fît que cent pas dans une journée. Cette entreprise, si nouvelle dans cette vieille contrée qui avait perdu les traditions des ancêtres, émut toutes les populations des environs ; on accourait de plusieurs lieues, on faisait haie le long des routes pour voir marcher la grande pierre ; beaucoup doutaient qu'elle fût jamais rétablie sur ses piliers, et, quand elle s'enfonçait lentement dans les chemins rompus, il semblait qu'elle y dût toujours demeurer. Elle arriva enfin à la porte du parc ; ce fut un jour de fête, elle entra comme en triomphe, un enfant était monté dessus, portant des fleurs dans ses mains, la foule poussait des acclamations ; ce peuple célébrait le succès d'avoir remué une pierre, lui dont les aïeux dressaient et alignaient les rocs par milliers.