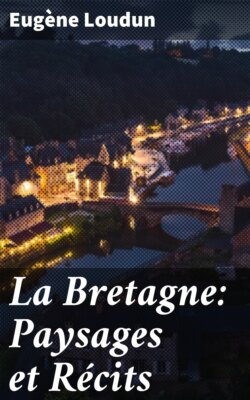Читать книгу La Bretagne: Paysages et Récits - Eugène Loudun - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Le Grand-Bé. — Les croix. — Les églises. — Les clochers.
ОглавлениеTable des matières
La baie de Saint-Malo est toute parsemée de rochers sur lesquels on a construit des forts qui protégent la ville de leurs feux croisés ; le Grand-Bé est un de ces îlots ; naguère il était armé de canons ; aujourd'hui, le fort abandonné tombe en ruines, et, à l'extrémité de son cap, de loin on aperçoit une croix se dessinant sur l'azur du ciel. Cette croix attire tous les regards, et c'est vers cette croix, dès que la mer basse laisse à découvert la grève de sable et de granit, que tendent les pas des voyageurs.
Après avoir monté une pente raide et âpre, on atteint un plateau nu, aride, où quelques moutons trouvent à peine à brouter une herbe rare ; on tourne à travers un défilé de rochers, et, sur la pointe la plus escarpée, tout à coup on se trouve devant une pierre et une croix de granit. C'est le tombeau de Chateaubriand.
Il n'est pas de plus poétique tombeau : adossé au vieux monde, il regarde le nouveau ; il a sous lui l'immense mer, et les vaisseaux passent à ses pieds ; point de fleurs, point d'herbe alentour, pas d'autre bruit que le bruit de la mer incessamment remuante, qui, dans les tempêtes, couvre cette pierre nue de l'écume de ses flots.
Là, il avait choisi sa dernière place, là, les discours s'échangent : on se demande quelle pensée l'inspira quand il déclara ne vouloir même pas que son nom fût inscrit sur sa tombe. Ceux-ci y voient un sentiment d'humilité, ceux-là d'orgueil ; il y a, ce me semble, l'un et l'autre, et cette humilité et cet orgueil ont une même source, un grand désenchantement. Cet homme qui avait vu tant de projets avortés, tant d'ambitions déçues ; ce voyageur qui avait parcouru l'univers, visité l'Orient, berceau de l'ancien monde, et les déserts de l'Amérique où naît le monde nouveau ; ce poëte qui pouvait compter les cycles de sa vie par les révolutions, était envahi, à la fin de ses jours, par une tristesse sans repos. Lui qui, dans sa jeunesse, avait préludé par des Considérations sur les révolutions, il se complut, en ses dernières années, à écrire la Vie du réformateur de la Trappe ; le silence et la solitude du cloître étaient en harmonie avec la tristesse de son âme. Après avoir été chargé des plus importantes missions, avoir rempli les plus hauts emplois, vu à l'œuvre les hommes les plus habiles et les plus puissants, une fois retiré du cercle tournoyant du monde, il avait été pénétré d'une accablante vérité : combien peu vaut l'homme, combien peu il fait, combien moins encore il réussit en ce qu'il tente. Ce qui cause la joie, l'orgueil, l'enivrement du monde, le faisait sourire ; il avait pour tous les hommes un égal dédain, et ce dédain il ne s'en exceptait pas lui-même ; il savait, selon le mot d'un ancien, qu'il y a peu de différence d'un homme à un autre homme[1].
[Note 1 : Thucydide.]
Par humilité donc, il ne veut pas sur son tombeau d'inscription, pas de nom : qu'importe qui lira son nom ! les hommes sont petits, et il est l'un d'eux ! — Mais, par orgueil aussi, il veut une pierre nue : cette pierre, elle sera visitée des voyageurs de toutes contrées ; ils viendront la regarder, et diront : Chateaubriand ! Ce nom, il sera prononcé sur les flots par ceux qui arrivent et par ceux qui partent pour les régions lointaines ; il prétend obliger les hommes à savoir qui il est.
Ainsi, ô instabilité continue de l'âme humaine ! en lui s'unissent les sentiments les plus contraires, le désenchantement de la gloire, et la croyance en l'immortalité d'un nom ; le dédain du scepticisme, et la soif des applaudissements ; une impression d'humilité de chrétien, et un instinct de souverain orgueil.
La vérité, pourtant, est là : cette croix, signe de l'éternité sur cette pierre marque de la mort, est l'immuable témoignage de l'inanité de l'orgueil humain. Mais elle a aussi une autre signification : Chateaubriand ne voulut sur son tombeau qu'une croix, de même que Lamennais, son compatriote, ordonna qu'elle ne fût pas plantée sur le sien, tous deux obéissant à la même préoccupation, dans la négation comme dans la foi. La croix, dominant la tombe où repose le poëte breton, est le symbole du génie de sa patrie, de la catholique Bretagne.
La foi, en Bretagne, a un caractère particulier, elle s'allie à une poésie propre au génie breton : les objets matériels parlent en ce pays, les pierres s'animent, les campagnes ont une voix qui révèle l'âme de l'homme conversant avec Dieu. Ce n'est pas une imagination, personne ne s'y peut tromper : dès que l'on entre en Bretagne, la physionomie du pays change, et le signe de ce changement est la croix. Sur les chemins, à tous les carrefours, s'élève une croix. Il y en a de toutes les époques ; depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe ; il y en a de toutes les formes ; là, simples croix de granit exhaussées de quelques marches ; ici, croix portant sur leurs deux faces l'image du Christ et de la Vierge, sculptures grossières, mais toujours empreintes d'un sentiment sincère. La sainte Vierge, les Bretons ne comprennent pas seulement sa tendresse, ils sentent sa douleur, ils la partagent, ils l'expriment avec une énergique vérité. Voyez ce tableau de la Vierge tenant son fils mort sur ses genoux, dans l'église de Saint-Michel, à Quimperlé ; c'est une peinture primitive, par une main inhabile qui ignorait les ressources de l'art ; le dessin en est incorrect ; mais quelle expression de douleur ! Le peintre voulait rendre la vive souffrance de la mère : la bouche est tordue, les yeux sont fixes, la prunelle est presque seule indiquée ; cette fixité du regard est saisissante, elle vous arrête, on reste là à regarder, on oublie que c'est une représentation, on voit la Vierge elle-même, immobile dans sa douleur, ne pouvant plus exprimer sa plainte, comme pétrifiée, et pourtant vivante.
A côté, appuyée contre le mur, est placée une statue de la Vierge, conçue au contraire dans un sentiment délicat et tendre : elle a cette attitude penchée, cette tête inclinée, ce doux regard de la mère qui appelle à soi le pécheur. Sa robe tombe sur ses pieds en plis nombreux, le manteau l'enveloppe avec une grâce harmonieuse ; car ce n'est plus la Vierge de douleur, c'est la consolatrice du genre humain, tenant son fils entre ses bras, qu'elle présente à la terre pour la bénir, Notre-Dame de Bot scao, la Vierge de Bonne-Nouvelle.
On connaît la foi des marins à la sainte Vierge, des marins bretons particulièrement. A Brest, on cherche en vain un musée de tableaux : Brest n'est pas une ville d'art ; on y respire comme un souffle de guerre ; le port rempli de grands vaisseaux, l'arsenal et ses canons, ses boulets, ses ancres gigantesques, les forts dressés sur les rochers, le mouvement animé des rues où vont et viennent des soldats de toutes armes, des matelots arrivant de tous les points du monde, tout a le caractère précis, positif et puissant de la réalité du moment : l'homme a enfoncé dans le roc les pieds de granit de sa demeure, on dirait qu'il y est inébranlablement fixé.
Mais, montez un des escaliers qui mènent de la ville basse à la ville haute, et, sous une voûte, vous trouverez quatre tableaux appendus à la muraille ; c'est là le musée de Brest, des tableaux de marine dédiés à la sainte Vierge : le départ du navire ; les femmes et les enfants sur la grève, à genoux, pendant la tempête ; le vaisseau ballotté par les orages, et les bras des matelots tendus vers le ciel ; et, au retour, les marins sauvés s'acheminant, un cierge à la main, vers la chapelle de Notre-Dame. Et, au-dessous, des légendes touchantes, cris de l'âme qui implore, s'humilie ou rend grâces : Sainte Vierge, secourez-nous ! — Sainte Vierge, secourez ceux qui sont en mer ! Voilà l'homme avec sa faiblesse, son aspiration et son espérance, l'homme vrai : le reste n'était qu'apparence.
Ils saisissent toutes les occasions, ils se servent de tous les prétextes pour témoigner de leur foi : à Saint-Aubin d'Aubigné, entre Rennes et Saint-Malo, vous longez une haie touffue, ils ont taillé une croix dans une épine, une croix qui verdit au printemps, parmi les églantines et les roses[1]. Vous revenez de visiter la lande de Carnac, cette lande pâle et désolée où les pierres debout s'alignent par milliers à perte de vue, sphinx gigantesques et silencieux qui gardent depuis vingt siècles leur impénétrable secret ; quelle est cette croix qui s'élève sur une éminence ? C'est une croix qu'ils ont plantée sur un dolmen isolé dans la lande, la croix sur un autel druidique, en avant de cette armée de pierres qui marquent peut-être le cimetière d'un grand peuple.
[Note 1 : On voit aussi, à Saint-Vincent-lès-Redon, un arbre taillé en forme de croix.]
Ailleurs, au carrefour d'une route, près de Beauport, une source jaillit et s'écoule entre les rochers, à la fois fontaine et lavoir : sur les pierres amoncelées, une niche dessine son arcade enserrant une Vierge couronnée de fleurs : alentour, les liserons des champs, les pervenches et les églantiers ont poussé dans la mousse et les herbes, et enlacent la rustique chapelle de leurs festons fleuris qui retombent sur l'enfant Jésus. Vis-à-vis, s'étendent les champs d'ajoncs verts ; par-dessus leurs longues tiges raides apparaissent les murs à demi détruits d'une vieille abbaye, sans toit, ouverte au ciel, silencieuse, et, par ces ogives noircies, on aperçoit la mer bleue qui s'enfonce à l'horizon, et dont on entend la rumeur prolongée, incessante, qui emplit les champs et les airs.
Dans ce pays catholique par excellence, toutes les églises sont remarquables : il n'est si petit village dont l'église n'ait quelque partie intéressante, ou une de ces chaires extérieures, devenues si rares, et que l'on voit encore à Guérande et à Vitré, engagées dans la muraille, et d'où le prêtre, dans les temps de mission, en certaines circonstances extraordinaires, parlait aux peuples assemblés sur la place ; ou une voûte entièrement peinte, comme à Carnac et à Kernascleden ; ou des médaillons de pierre et de bois encadrant l'autel de naïves sculptures dorées, à Roscoff, à Crozon, etc. ; ou un tabernacle composé comme un monument architectural, une sorte de palais en miniature avec ses corps de logis, ses pavillons, ses colonnes, ses dômes, ses galeries, ses statues (à Rosporden) ; un confessionnal antique (dans une petite chapelle près de Châteaulin) ; un baldaquin sculpté en bois ou même en cristal (à Landivisiau) ; ou bien quelque objet particulier, tel que cet ornement bizarre qui n'existe plus que dans une seule église, la roue de bonne fortune, de Notre-Dame de Comfort, sur la route du bec du Raz. C'est une grande roue suspendue à la voûte de l'église et tout entourée de clochettes ; aux jours de fêtes solennelles, pour les noces ou les baptêmes, on fait tourner la roue, et toutes ces clochettes agitées forment un bruyant carillon qui règle la marche de la procession, et accompagne de son timbre argentin et joyeux la voix des jeunes filles, chantant des cantiques à la sainte Vierge. Ou bien, enfin, c'est un de ces troncs, grossiers piliers équarris, ais de chêne bardés de larges bandes de fer, placés au milieu de l'église, à côté du catafalque de bois noir semé de larmes blanches ; le tronc et le cercueil, qui rendent sensibles à tous les yeux à la fois la fragilité de la vie, et le principe chrétien par excellence, la charité.
Les églises des villes ont parfois de véritables chefs-d'œuvre, les cloîtres de Tréguier et de Pont-l'Abbé, par exemple, dont les arcades sont si sveltes et si finement découpées ; ou les bas-reliefs intérieurs du portail de Sainte-Croix à Quimperlé, vaste page de pierre sculptée avec cette délicatesse et cette richesse d'invention, qualités charmantes de la jeunesse, qui furent celles de la Renaissance. Puis, dans toutes les églises, près de l'autel, vous apercevez tout d'abord la statue peinte du saint de la paroisse, un de ces saints bretons que l'on ne trouve pas ailleurs : saint Cornély, saint Guénolé, saint Thromeur, saint Yves surtout. Saint Yves a le privilége d'être représenté dans presque toutes les églises, même celles dont il n'est pas le patron ; le souvenir de ce grand homme de bien, de ce savant prêtre, de ce juge incorruptible est resté vivant dans le cœur des Bretons. Partout vous le voyez en robe de juge, la toque sur la tête, entre deux plaideurs, le seigneur richement vêtu, en habit de velours rouge, tout doré, avec la grande perruque, les bas de soie et l'épée, et le pauvre paysan, tout déguenillé, des trous aux coudes et aux genoux, et pieds nus dans ses sabots. Le grand seigneur, l'air fier, suffisant, le chapeau sur la tête, présente au saint une bourse d'or ; le paysan, le regard et l'attitude timides, la tête basse, le bonnet à la main, attend humblement la sentence. Il n'a rien à donner, mais la justice ne lui fera pas défaut. Saint Yves se tourne vers lui avec un bon sourire, et lui tendant l'arrêt écrit sur un parchemin, lui donne gain de cause. C'est toute l'histoire du moyen âge, les trois ordres vis-à-vis l'un de l'autre : l'Église protégeant le paysan, le faible, contre le noble et le puissant.
Quant aux monuments proprement dits, nulle part on ne rencontre davantage de ces belles églises du moyen âge, témoignage de la piété, de la science et du goût de cette forte époque. Ici la cathédrale de Dol, du meilleur temps de l'art gothique, du XIIIe siècle, imposante par sa masse, sa grandeur, la noble simplicité de ses ornements, l'harmonie de ses proportions ; le granit de ses tours a pris, par la suite des siècles, à l'air de la mer, une couleur de rouille, on les dirait bâties de fer ; là, Tréguier et ses boiseries exquises, bancs, autels, stalles, lutrin en chêne noir et brillant, découpés d'un dessin net et fin, avec une inépuisable variété ; pas un balustre qui se ressemble ; il y a de quoi fournir des modèles à tous les sculpteurs de notre temps ; plus loin, Saint-Pol de Léon et sa flèche de granit, audacieuse et svelte, prodige d'équilibre, inébranlable, ceinte de galeries à jour comme de gracieuses couronnes, élançant au ciel ses clochetons aux pointes aiguës, toute découpée, aérienne, un des joyaux de la Bretagne, et que les Bretons nomment avec un légitime orgueil ; et le Folgoat, un petit village inconnu, au nord de Brest, perdu à l'extrémité de la presqu'île, il faut se détourner de toute route pour le trouver ; mais dans ce pauvre village, deux princes bretons, le duc Jean III et la duchesse Anne, ont construit une église royale, y accumulant tout ce que l'art gothique en sa floraison la plus riche, uni aux caprices les plus ingénieux de la Renaissance, a imaginé de plus délicat et de plus éclatant : portraits sculptés, statues d'un beau style, où déjà se reflète l'antiquité, chœur ogival tout ciselé, et un jubé (on sait combien sont devenus rares ces gracieux et originaux monuments du catholicisme), un jubé de dentelle, où trèfles, rosaces, rinceaux, sont taillés du ciseau le plus ferme dans un granit bleu indestructible. Le marteau de la Révolution n'a détaché que des fragments insignifiants de ces belles pierres si purement travaillées. Après avoir résisté aux folles passions des hommes, elles semblent pouvoir défier le temps.
Il faudrait dire aussi les clochers de formes si variées, les clochers à pans coupés de la Renaissance, de la Roche-Maurice-lès-Landerneau, de Landivisiau, de Ploaré, de Pontcroix, de Roscoff, accostés de petits et légers clochetons et ornés de balustrades à deux étages, comme les minarets de l'Orient ; les flèches élevées le long des côtes, celle de Tréguier, par exemple, percée à jour pour laisser passer les grands vents de la mer, constellée de croix, de roses, de petites fenêtres, de croisillons, d'étoiles, comme un chapeau de magicien. Puis, les bénitiers exprimant toujours le caractère de l'époque : à Dinan, dans une église du XIIe siècle, une cuve massive, énorme, que quatre chevaliers armés de toutes pièces supportent de leurs larges gantelets de fer ; car le XIIe siècle est le temps des croisades, de la chevalerie au service du Christ[1]. Dans une église du XVe siècle, au contraire, à Quimper, une élégante petite colonnette, autour de laquelle s'enroule une fine guirlande de pampres, et au-dessus, un ange qui ploie ses ailes comme s'il descendait du ciel et se venait poser au bord de la coupe d'eau consacrée. Ou bien, et inspirés par un sentiment plus chrétien encore, les bénitiers extérieurs, si communs dans toute la Bretagne, et dont les plus remarquables sont à Landivisiau, à Morlaix, à Quimperlé ; le bénitier intérieur n'est qu'un accessoire ; le bénitier extérieur, isolé en avant de la porte, a une signification plus précise : il dit où l'on va entrer, il sollicite un premier mouvement de l'âme : le chrétien, en avançant la main vers le vase bénit, s'arrête, son cœur se recueille et se prépare. Les architectes bretons ont bien compris cette grave pensée de la religion : les bénitiers extérieurs sont de véritables monuments, des sortes de petites chaires, le bassin décoré d'emblèmes, de symboles, de têtes d'anges enveloppées de leurs ailes ; le dais élancé, ciselé, d'où pendent les pointes effilées d'une broderie de granit, et, sous le dais, debout, toujours la Vierge souriante, qui semble inviter le fidèle à entrer dans la maison de la prière.
[Note 1 : Il y a un bénitier semblable à Corseul.]