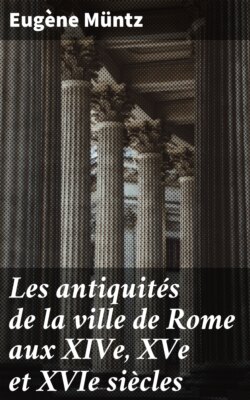Читать книгу Les antiquités de la ville de Rome aux XIVe, XVe et XVIe siècles - Eugène Müntz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеAu XVe siècle, la Ville éternelle devient le centre d’un mouvement qui n’allait pas tarder à transformer la civilisation italienne et qui, en ce qui concerne le point de vue spécial où nous nous sommes placés, devait exercer une influence salutaire. Le but poursuivi par les novateurs qui s’étaient donné rendez-vous sur les bords du Tibre était multiple. Les artistes, Brunellesco, Donatello, Ghiberti, L. B. Alberti, Giuliano da San Gallo, Francesco di Giorgio Martini, recherchaient avant tout des modèles. Les questions de topographie ne les intéressaient qu’indirectement. L. B. Alberti, le plus lettré de tous, a cependant composé une Descriptio Urbis Romæ, dont M. de Rossi a publié le texte, jusqu’ici inédit, d’après un manuscrit de la Marcienne. Nous pouvons dire, à ce sujet, que les services rendus par Alberti à la topographie romaine n’ont pas été assez appréciés jusqu’ici. L’étude des précieux commentaires de Bernard Rucellai sur le traité de Publius Victor nous prouve que l’historien florentin a eu Alberti pour compagnon de ses excursions, et presque pour collaborateur. Nous apprenons par les mêmes commentaires que Rucellai avait fait dessiner un certain nombre de monuments antiques de Rome.
Les érudits se mirent à l’œuvre en même temps que les artistes, ou même plus tôt, si nous tenons compte des efforts, bien isolés il est vrai, de Cola di Rienzo. Dès le premier tiers du XVe siècle, le Pogge publia, dans son De varietate fortunæ, une dissertation d’un intérêt capital pour la topographie de Rome antique. Puis vinrent les travaux de Cyriaque d’Ancône, de Flavio Biondo, de Pomponio Leto, de Bernard Ruccellai, etc.
Les encouragements des amateurs vinrent en aide à cette renaissance des études topographiques. L’essor pris par la géographie ne devait pas tarder à profiter également à la topographie. Il n’y eut bientôt plus de cabinet de curiosités qui ne renfermât des mappemondes, des cartes de France ou d’Italie, des vues de villes. A Florence, Niccolô Niccoli possédait un «bellissimo universale dove erano tutti i siti della terra; aveva Italia e Spagna tutte di pittura». On remarquait également des mappemondes dans la collection du roi René. Philippe de Bourgogne en fit peindre une par Jean Van Eyck. A la cour de Mantoue, François Mantegna se vit confier, en1494, un travail analogue. Pie II entretenait un artiste spécialement chargé d’exécuter pour lui une mappemonde à laquelle on travailla pendant plusieurs années: c’était un Vénitien, nommé messire Girolamo Bellavista. En 1462, le même pape acquit une autre mappemonde. On ne pouvait moins attendre de l’auteur de la Cosmographia. L’inventaire, encore inédit, dressé à la mort de Laurent le Magnifique (1492), nous montre que les collections des Médicis étaient surtout riches en documents de ce genre. J’y vois figurer: «una carta dipintavi Italia;–una altra carta dipintovi il chastel di Milano; una dipintoviel mappomondo; una dipintavi terra santa; uno colmo di br. 41/2dipintovi l’universo (estimé50florins); uno quadro dipintavi una Italia (25florins); uno quadro di legno dipintavi la Spagna» (12florins). Je signalerai notamment comme rentrant dans le cadre du travail de M. de Rossi, les deux articles suivants: Una carta dentrovi Roma, et uno colmo di br. 11/2 dipintavi una Roma, fior. 20.
En thèse générale, les vues peintes de Rome étaient plus fréquentes à cette époque qu’on ne l’admet d’ordinaire. En examinant avec soin les fresques monumentales du XVe siècle, on découvrirait à coup sûr plus d’un document topographique curieux. C’est ainsi que Vasari, dans un passage qui n’a pas été relevé jusqu’ici, nous parle d’une composition de Jean Bellin représentant au fond la Ville Eternelle: «Qui ritrasse Giovanni Roma in prospettiva alquanto lontana, gran numero di cavalli, infiniti pedoni, molte bandiere ed altri segni d’allegrezza sopra castel sant’ Agnolo.» Cette vue, qui faisait partie de l’Entrée à Rome du pape Alexandre, de l’Empereur et du Doge, ornait autrefois le palais ducal de Venise; elle périt dans un incendie, en1577.
Dans un autre passage, le biographe nous entretient des vues exécutées par Pinturicchio dans le palais du Vatican, sous Innocent VIII, vues qui malheureusement sont détruites depuis longtemps: «E non molto dopo, cioè l’anno1484, Innocenzio VIII, genovese, gli fece [fare] alcune sale e loggie nel palazzo di Belvedere; dove fra l’altre cose, siccome volle esso papa, dipinse una loggia tutti di paesi: e vi ritrasse Roma, Milano, Genova, Fiorenza, Venezia, Napoli, alla maniera de’ Fiamminghi; che come cosa insino allora non più usata piacquero assai.»
Dans les plans, plus ou moins fantaisistes, composés par les peintres, c’est le château Saint-Ange qui occupe d’ordinaire la place d’honneur. Nous en trouvons notamment une reproduction, d’ailleurs aussi inexacte qu’informe, dans le tableau de Carpaccio représentant l’Arrivée de sainte Ursule à Rome (Académie de Venise), et dans la fresque de Sodoma à Monte Oliveto Maggiore, le Départ de Saint-Benoit. Je dois ajouter que ces deux compositions appartiennent déjà aux premières années du XVIe siècle.
Pour le XVe siècle, la moisson de M. de Rossi a été fort riche. Il nous donne d’abord deux plans, tous deux insérés dans des manuscrits de Ptolémée; l’un (Cod. Urb. 277a) appartient à l’année1472; l’autre (Bib. Nat. de Paris, fonds lat. 4802) est postérieur de quelques années. M. de Rossi établit par des arguments d’un grand poids que l’un et l’autre se rattachent à un original exécuté entre1455et1464. Par la netteté des reproductions, ces deux plans sont supérieurs au plan d’Alexandre Strozzi (1474), que M. de Rossi publie d’après un manuscrit de la Laurentienne. Mais celui-ci l’emporte par la richesse des renseignements et surtout par la sûreté de la critique. L’auteur a mis à profit les travaux de ses prédécesseurs; les dénominations surannées ont disparu; nous avons enfin un plan réellement scientifique de Rome.
Les deux derniers plans de M. de Rossi n’ont pas tous deux la même importance. Le premier en date fait partie de la fameuse chronique imprimée à Nuremberg, en1493; le texte de cet ouvrage, comme on sait, a pour auteur le docteur Schedel, les gra vures sont l’œuvre de Michel Wolgemut et de W. Pleydenwurff. L’exécution en est grossière et barbare; le cadre en est incomplet; des régions entières de Rome y manquent. C’est de tout point un produit digne, de cette compilation informe dans laquelle le même cliché sert à représenter jusqu’à trois ou quatre villes différentes.
On sait d’ailleurs aujourd’hui, grâce aux recherches de M. Frédéric Lippmann, directeur du Cabinet des Estampes de Berlin, que le plan de Schedel procède du plan publié en1490dans le Supplementum chronicarum.
L’autre plan, publié par M. de Rossi, n’est autre qu’une peinture sur toile, transportée en1868au musée de Mantoue. Cette peinture ne saurait être postérieure à l’année1538. En effet, la statue équestre de Marc-Aurèle, transportée cette même année au Capitole, y figure encore dans le voisinage du Latran. Elle ne saurait, d’autre part, être antérieure à1534; ce qui le prouve, c’est la présence sur le pont Saint-Ange de deux statues que nous savons de source certaine avoir été installées en cet endroit en1534seulement. Tout d’ailleurs, sauf cette interpolation, nous ramène au XVe siècle: au Vatican, nulle trace des gigantesques travaux entrepris par Jules II; au Borgo, on voit encore la pyramide détruite en1499par ordre d’Alexandre VI. Ici encore nous avons affaire à deux copies, plus ou moins remaniées, dérivant d’un original commun. Cet original, d’après M. de Rossi, appartiendrait à l’école de L. B. Alberti. Le savant archéologue romain ne se prononce toutefois pas sur sa date précise. Des documents, encore inédits à l’époque à laquelle M. de Rossi a publié son ouvrage, mais imprimés depuis dans le second volume de mon travail sur Les arts à la cour des Papes, me permettent d’introduire dans le débat des arguments nouveaux. M. de Rossi, après avoir constaté la présence dans les deux plans d’un portique attenant à la basilique de Saint-Pierre, s’est fondé sur des documents publiés dans mon premier volume pour identifier ce portique avec la loge de la bénédiction construite par Pie 11, en 1464. Sur ce point il a raison. Mais ce que l’on ignorait à cette époque, c’est que cette loge, ce portique laissé inachevé par Pie II a été continué par son successeur Paul II. C’est celui-ci, selon toute vraisemblance, qui l’a élevé à la hauteur du premier étage. Après la mort de Paul II, les travaux ont été longtemps interrompus; ils ont été repris par Alexandre VI, et enfin terminés par Jules II. Or, dans le plan de Schedel comme dans celui de Mantoue, le portique n’a qu’un seul ordre de colonnes, tandis que dans un dessin de Grimaldi, publié dans mon second volume, on l’aperçoit tout entier avec ses trois étages, tel qu’il était à l’époque où il fut démoli. N’est-ce pas une preuve que les deux plans en question sont postérieurs à Paul II (†1471) et antérieurs à Alexandre V1?
Une série d’autres observations, mises en lumière par M. de Rossi avec une rare sagacité, nous amène à circonscrire encore davantage la période pendant laquelle a dû prendre naissance le prototype des deux plans. Notons d’abord la présence, dans le tableau de Mantoue, du gigantesque palais de Saint-Marc. Cet édifice, commencé par le cardinal Pierre Barbo, a été continué par le même personnage devenu le pape Paul II (1464-1471), et achevé, du moins dans quelques-unes de ses parties, par son neveu le cardinal Marc Barbo. En second lieu, il faut signaler la présence, dans les deux plans, du pont Sixte, construit en 1475. Une troisième date nous est fournie par l’église Saint-Augustin, presque entièrement reconstruite, vers la fin du règne de Sixte IV, par le cardinal Guillaume d’Estouteville, archevêque de Rouen.
A propos de cette dernière construction, je serais disposé à émettre un avis quelque peu différent de celui de M. de Rossi. Reprenant la thèse déjà soutenue par le savant M. Portioli, auquel on doit la découverte du tableau de Mantoue, M. de Rossi affirme que l’état dans lequel se trouve la toiture de l’église prouve que l’édifice était précisément en voie de construction à l’époque. à laquelle le plan primitif a été exécuté; il adopte pour ce travail la date de1483. A ce système j’objecterai: 1o que la toiture a aujourd’hui à peu près le même aspect que dans le tableau de Mantoue (ce que M. Portioli a pris pour des échafaudages, ce sont simplement les contre-forts, aujourd’hui encore parfaitement visibles); 2o que la toiture était très certainement déjà achevée à l’époque à laquelle les deux savants italiens placent l’exécution du plan primitif. Ce qui me permet de l’affirmer, c’est que je vois représentée dans le plan de Mantoue l’imposante coupole dont Guillaume d’Estouteville orna l’église. Or cette coupole, d’après un document que j’ai copié dans les archives romaines, était terminée vers la fin de l’année1482. L’achèvement de la toiture a nécessairement suivi de près, si même il n’a pas précédé.
Cette difficulté écartée, rien ne s’oppose à ce que nous placions l’exécution du plan en question sous le pontificat d’Innocent VIII (1484-1492). C’est une opinion qui a déjà été préconisée par M. Gregorovius. L’auteur allemand se fondait sur la représentation, dans les deux plans, d’un édifice dans lequel il reconnaissait le Belvedère construit par Innocent VIII, vers 1490. M. de Rossi, au contraire, considère cet édifice comme le Belvédère de Nicolas V. Quel que soit mon respect pour l’illustre archéologue romain, je suis tenté de donner raison, sur ce point, à son contradicteur. Je vais plus loin encore: selon toute vraisemblance, le palais représenté à côté de Saint-Pierre est le palais construit par le même Innocent VIII. La date du plan qui a servi de base à la gravure du Supplementum Chronicarum et de la Chronique de Schedel ainsi qu’à la peinture de Mantoue me paraît donc circonscrite entre les dernières années du règne d’Innocent VIII et les premières du règne d’Alexandre VI. En adoptant comme terme moyen l’année1490, on ne sera très certainement pas loin de la vérité.
Je ne puis m’empêcher, à cette occasion, de faire un rapprochement qui se présente presque spontanément à l’esprit. Sous Innocent VIII (1488), le grand peintre de Mantoue André Mantègne, travaille, à Rome, à la décoration, du Vatican. Quelques années plus tard, en1494, son fils François peint à Mantoue la mappemonde destinée aux Gonzague. C’est à Mantoue encore que l’on découvre la toile représentant la vue de Rome. N’y aurait-il pas quelque corrélation entre ces trois faits?
Le plan de Mantoue offre une importance capitale pour l’étude des nombreux monuments antiques détruits depuis le XVe siècle (on est à la fois étonné et navré en y constatant l’étendue des ravages faits depuis la Renaissance). Les dénominations qu’il emploie ne sont pas encore toutes exemptes de superstition. Je signalerai notamment la torre dove stette gran tempo il spirito di Nerone. Mais les reproductions témoignent en général d’un grand soin. Il est seulement à regretter qu’en passant du papier sur la toile, le dessin ait perdu en précision. On n’en doit pas moins remercier M. de Rossi d’avoir livré à la publicité cet instrument de travail si précieux qui restera, avec le plan de Bufalini, publié il y a quelques années, la base de la topographie monumentale de Rome antique à l’époque de la Renaissance.