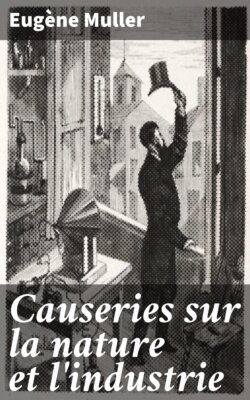Читать книгу Causeries sur la nature et l'industrie - Eugène Muller - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE PAIN
ОглавлениеTable des matières
Le méfait d’un écolier. — Les idées de mon grand-père sur le pain. — Opinion des campagnards. — Le labour. — les semailles. —La moisson. — Le battage. - Le travail du meunier et du boulanger. — Histoire du pain. — Les mangeurs de bouillie. — Plante ournant la meule. — Un heureux trait d’avarice.
Tantôt, dans la rue, j’ai aperçu par terre, s’imbibant de l’eau fangeuse du ruisseau, une petite tranche de pain blanc: quelque tartine dont un écolier, sans doute, s’était débarrassé avant de rentier en classe. Or, voici qui vous paraîtra peut-être singulier: ce morceau de pain pouvait avoir une valeur de deux ou trois centimes au plus, et pourtant j’ai été peiné de le voir se perdre, autant que s’il se fût agi de quelque objet d’un prix inestimable.
D’où me vient cela? Cela me vient de mon grand-père, qui professait une sorte de vénération, je pourrais presque dire de culte pour le pain, et qui avait trop souvent manifesté ce sentiment devant moi, pour que je n’en aie pas gardé au moins le respectueux souvenir.
«Le pain, — nous disait-il, — le pain, voyez-vous, mes enfants, est le premier, le plus précieux, le plus magnifique présent que nous ayons reçu du ciel. Vit-on jamais personne ressentir seulement le moindre malaise, pour avoir mangé du pain? Tous les jours on mange du pain, et, loin de s’en dégoûter, comme on ferait de tout autre aliment, on l’aime toujours autant, sinon de plus en plus. Seul, il est savoureux, et se marie convenablement à tous les mets, dont il ne fait jamais que relever la saveur. Ne désespérez pas du malade qui trouve encore le pain bon, et tenez pour sauvé celui à qui le goût en revient. Que dit-on de quelqu’un qui a le meilleur des caractères? — Qu’il est bon comme le bon pain. Qu’est-ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous commande de demander dans cette belle prière qu’il a dictée lui-même? — Notre pain quotidien. — Et quand il voulut prendre un symbole pour la communion, ce fut le pain qu’il choisit. Respectez le pain, enfants, le pain qui est le plus pur produit du travail de l’homme. Souhaitez du pain à tous, donnez-en, quand vous pourrez, le plus que vous pourrez, mais ne le jetez jamais: malheur à celui qui aura jeté le pain, car, de même que celui qui aura détruit le nid de l’hirondelle errera un jour sans abri, de même celui qui aura jeté le pain que Dieu lui avait donné par le travail dira plus tard en pleurant: «Ah! si j’avais le pain que j’ai jeté !»
Ainsi parlait mon grand-père, que je vois encore, à la fin des repas, happer, du bout de son doigt, jusqu’aux dernières miettes tombées sur la nappe, pour n’avoir pas à se reprocher d’avoir perdu par sa faute l’équivalent d’un grain de blé.
Votre aïeul, mes enfants, ne faisait, au reste, que traduire une opinion reçue dans le monde rustique où il était né et où il avait longtemps vécu. A la campagne, en effet, il est de croyance générale que celui qui jette le pain en sera plus tard privé. Ah! c’est que les paysans, les travailleurs par excellence, semblent avoir instinctivement besoin que leur tâche revête une sorte de caractère moral très élevé.
Je ne voudrais pas affirmer que Dieu — en qui j’aime à voir la source de toute miséricorde — ratifie toujours rigoureusement la sentence portée par les hommes contre des coupables, qui, le plus souvent, n’ont péché que par étourderie, mais, pour ce qui est du respect que leur inspire le pain, je suis tout à fait en communauté d’idées avec les campagnards.
Au reste, il se pourrait bien que ce sentiment né chez moi, en quelque sorte d’une manière irréfléchie, de mon respect pour la mémoire paternelle, eût été fortifié plus tard par mes propres réflexions.
Avez-vous quelquefois songé à tout ce qu’il faut d’efforts, de soins, de travaux pour amener sur nos tables le morceau de pain que vous mangez? Non, n’est-ce pas. Voulez-vous alors que nous tâchions d’en prendre une idée sommaire?
— Oui.
— Eh bien, allons. Nous sommes en octobre, les pluies d’automne ont pénétré et ramolli la terre qu’avaient durcie les chaleurs de l’été. Le paysan a fait sortir de l’étable les grands bœufs qu’il accouple sous le joug, et qui s’acheminent dociles vers les champs à labourer. Ils traînent derrière eux, sur une claie, la charrue dont le fer doit fouiller le sol. C’est une rude besogne qu’ils vont faire là ; rude aussi pour le laboureur qui les guidera. Si vous avez vu quelquefois labourer, il a pu vous sembler que l’homme qui marchait derrière les bœufs n’avait qu’à tenir machinalement une main sur le manche de la charrue, tandis que de l’autre il aiguillonne de temps en temps ses bêtes, à l’aide du grand bâton pointu dont il est armé : erreur. Pendant que les bœufs tirent de toute leur force sur le soc, c’est au laboureur à soulever l’instrument pour qu’il morde plus ou moins, à l’obliquer de droite, de gauche, pour faire égal le sillon; et le soc ne fend pas la terre sans éprouver des chocs que les bras du laboureur ressentent aussi bien que le front des bœufs. Rude corvée, dure pour les uns et pour les autres; rude et longue, car il faut bien des heures pour qu’un champ soit remué par tranches successives. Que d’allées et de venues! Très souvent le laboureur chante, et ce chant n’est pour vous qu’un indice de gaieté ; taudis que, pour lui, ce chant est comme une obligation du métier. Remarquez que c’est toujours une chanson lente, traînante, qu’il dit, ou plutôt qu’il envoie à pleins poumons à l’oreille de ses bœufs: car, vous ne vous en doutez pas, c’est à l’intention de ses bœufs qu’il répète sa chanson. Savoir Lien chanteraux bœufs est un talent fort apprécié chez un laboureur. Les bœufs à qui l’on chante avec la cadence, avec le rythme convenables, travaillent d’autant mieux, et paraissent d’autant moins se fatiguer. «La chanson vaut l’aiguillon,» affirme un proverbe que mon grand-père répétait. C’est pourquoi la chanson du laboureur a ce caractère de lenteur et de longue baleine, qui s’accorde avec le pas mesuré des bœufs et avec la puissante continuité de leurs efforts.
Le Labourage.
Enfin, la charrue a passé partout; il n’est pas dans le champ un espace grand comme la main qu’elle n’ait fouillé, retourné, pour que l’air pénètre autant que possible la couche végétale (car l’air est aussi nécessaire à la végétation que la terre et l’engrais). Quelquefois ce labour se répète, ou plutôt n’est qu’une répétition de celui qui a été déjà donné après l’enlèvement de la précédente récolte.
Il faut semer, c’est-à- dire confier à la terre le grain dont elle doit opérer la multiplication. On lui donnera un boisseau de blé, ce sera pour en avoir dix, ou quinze, ou vingt, selon son plus ou moins de fertilité.
Le paysan s’est attaché autour du corps un drap, formant devant lui une poche qu’il tient ouverte du bras gauche, et dans laquelle il puise à pleine main le grain qu’il répand en marchant systématiquement, à pas comptés. Là, peu de fatigue, mais, en revanche, ce n’est pas affaire au premier venu de savoir rendre bien régulier le jet de la semence. Si grossier qu’il vous paraisse, il fait preuve d’une singulière adresse, le semeur qui, en ayant l’air d’éparpiller le grain au hasard, agit de telle sorte que partout il en tombe une quantité à peu près égale.
Les Semailles.
Le grain répandu, il faut herser, ou, si vous aimez mieux, faire en grand ce que le jardinier fait en petit avec son râteau. La herse, espèce de claie armée de longues dents, n’est qu’un grand et lourd râteau. Les bœufs encore la promènent, et les dents qui ouvrent ou rebroussent légèrement la terre couvrent le grain qui ne tarde pas à germer.
Et l’on en a fini des travaux d’automne.
Au printemps, quand la terre, qui s’est reposée l’hiver, se reprend à travailler, il faut sarcler, échardonner, c’est-à-dire enlever, une à une, du champ qu’elles envahissent, les herbes étrangères; le chardon surtout, espèce de glouton toujours prêt à s’approprier les sucs dont le blé a besoin.
En juillet, c’est la moisson. Le soleil darde alors ses plus ardents rayons. Il faut du courage, de l’énergie, croyez-le bien, pour aller, la faucille à la main, abattre poignée par poignée ces forêts de tiges qui portent les épis. Pendant que nous cherchons l’ombre, en nous lamentant même du malaise que nous cause la chaleur, on peut voir les moissonneurs courbés du matin au soir sur les sillons brûlants, où ils couchent les javelles dont ils feront ensuite des gerbes.
Ces gerbes bien séchées par le soleil, on les transporte à l’aire. L’aire est un espace de terrain plan et dur sur lequel on délie et étale les gerbes pour les battre, c’est-à-dire pour frapper dessus à tour de bras avec un instrument qu’on nomme fléau. Si l’on frappe ainsi, — et Dieu sait combien ce travail est fatigant, — c’est pour faire sortir les grains des alvéoles de l’épi. Puis on vanne le blé, en le secouant dans de grandes corbeilles plates, ou en le jetant au vent pour le séparer de la balle et de fétus auxquels il est encore mêlé.
Le Battage.
Et l’œuvre du paysan est finie. Mais remarquez que je n’ai tenu compte que de ses travaux matériels, sans faire entrer en ligne les ennuis, les préoccupations, les déboires qui sans cesse viennent l’assaillir. Que, pendant l’hiver trop rude, de fortes gelées succèdent à des pluies, et la terre, en se serrant sous l’effort du froid, coupera les fines tiges du blé, et labour et semence seront perdus: que le printemps ou l’été soient trop humides, et il ne poussera que de la paille; trop secs, le grain sera pauvre et rare. Qu’un orage éclate alors que le champ est couvert d’une récolte aussi lourde que drue, et les trombes d’eau coucheront le blé qui ne saurait plus mûrir. La grêle aussi peut passer, qui hachera tout. Puis la carie, affreuse maladie causée par d’invisibles champignons noirs, peut s’attaquer au grain qu’elle rougira. Puis, au lieu des grandes chaleurs utiles aux moissons, il arrivera peut-être une suite de jours pluvieux, qui empêcheront d’enlever les gerbes et qui feront germer le grain sur la terre mouillée. Ou encore, c’est un vent brûlant qui desséchera et égrènera les épis avant qu’on ait le temps de les cueillir... Que sais-je? j’en passe, et des pires. Les années ne sont que trop fréquentes où le pauvre cultivateur qui a tant travaillé, tant espéré, voit tout d’un coup lui échapper le fruit si bien mérité de son labeur et de ses soins.
Mais je veux supposer que la récolte a été abondante. Du blé au pain, la distance est encore grande. Des mains du batteur et du vanneur, le grain passe aux mains du meunier.
Celui-là a chez lui une machine que met en mouvement l’eau, le vent ou la vapeur, et qui est composée de deux larges meules de pierre, l’une tournant sur l’autre. Par un trou pratiqué au centre de celle qui tourne, passe le grain que les meules écrasent et qui tombe par le côté, réduit eu farine; mais la farine est encore mélangée au son. On opère la séparation à l’aide de grands tamis tournant au-dessous des meules.
Enfin, l’on porte les sacs de farine blanche au boulanger.
Celui-là en emplit une auge où il verse de l’eau, où il met un peu de levain. Puis il pétrit le tout ensemble, et Dieu sait encore si la besogne est rude! Vous avez certainement entendu les pénibles gémissements que poussent les ouvriers boulangers. - Tant geignent-ils même, pour s’aider dans leurs efforts, que le nom de geindres leur est resté.
Quand la pâte est suffisamment levée, ils la coupent, la divisant en pains, qu’ils placent sur de grandes pelles plates pour les introduire dans le four. Une heure de séjour environ dans cette chambre suffit à cuire le pain, à former tout autour de la mie spongieuse cette croûte brune, dorée, qui est la partie la plus savoureuse du pain.
Enfin, le boulanger nous vend cet aliment aussi sain que substantiel qui figure avec le même honneur sur la table des rois et aux repas du pauvre.
Je vous ai dit à peu près l’histoire d’un morceau de pain: puisse-t-elle vous avoir paru justifier les sentiments dont je vous entretenais en commençant. Quant à l’histoire du pain, proprement dite, je vais peut-être vous étonner en vous affirmant que l’industrie du meunier et celle du boulanger, aussi simples qu’elles puissent vous sembler, ne furent cependant pas de celles qui arrivèrent le plus tôt à un état de perfection relative.
Au commencement (et, soit dit en passant, bien des peuples en sont encore à ce commencement), on se bornait à faire légèrement griller les épis, qu’on cueillait avant leur entière maturité. On les passait sur le feu, et, en les frottant ensuite entre les mains, on détachait les grains dont on se régalait sans plus de cérémonie.
Un peu plus tard, on fit cuire, ou on laissa se ramollir les grains dans l’eau, et on obtint des bouillies. Les Romains, dans les premiers temps de la République, ne s’alimentaient pas autrement: ce qui leur avait valu le nom quelque peu ironique de mangeurs de bouillies.
Un beau jour, cependant, — c’est du moins un respectable philosophe qui le raconte, — on remarqua que les grains, d’abord roussillés, étaient ensuite broyés par les dents, puis que leur substance, délayée par la salive et remuée par la langue, descendait dans l’estomac, où elle recevait le degré de cuisson qui la rendait propre à être convertie en nourriture. On imita donc, — c’est toujours notre vieux sage qui parle, — l’action des dents, en broyant les grains entre deux pierres, on mêla ensuite la farine avec de l’eau, et, en remuant, en pétrissant ce mélange, on obtint une pâte, qu’on fit cuire sous la cendre chaude ou de quelque autre manière. Toujours est-il, qu’ayant reconnu l’opportunité de pulvériser les grains pour en faire des pâtes, on dut s’ingénier à la recherche des moyens pratiques à remplir ce but. Aux deux pierres manœuvrées à la main, succédèrent les pilons, puis aux pilons les moulins; mais les meules étaient à l’origine de véritables ustensiles de ménage. Dans chaque maison s’opérait à bras la mouture du blé nécessaire à l’alimentation de la famille, absolument comme aujourd’hui chacun moud son café.
Peu à peu cependant les meules, d’abord d’un poids modéré, se firent de plus en plus lourdes, parce qu’on voulut avoir de la farine plus fine. Et alors tourner la meule devint une terrible besogne que l’on faisait accomplir par les esclaves ou par les citoyens les plus nécessiteux. Samson, le fameux guerrier d’Israël, par exemple, devenu prisonnier des Philistins, tournait chez eux la meule. Un des écrivains dramatiques les plus célèbres de Rome, Plaute, ruiné dans des entreprises commerciales, tournait la meule pour les uns et pour les autres, afin de gagner de quoi vivre et de quoi se libérer envers ses créanciers. Cléanthe, un illustre philosophe grec, tournait la meule la nuit, pour avoir la faculté de s’appliquer à l’étude et à la pratique de la sagesse, sans être obligé de demander rien à personne. On raconte même qu’un de ses disciples, s’étonnant de le retrouver après plusieurs années, faisant encore ce métier: «Puisque ce métier m’assure l’indépendance et la dignité, lui répliqua le philosophe, pourquoi cesserais-je de le faire?» Tourner la meule pour le compte de l’État fut aussi un supplice auquel étaient condamnés les malfaiteurs et les vagabonds. Petit à petit, les meules de forme ronde furent remplacées, chez les Romains, par l’assemblage d’un tronc de cône plein et d’un tronc de cône évidé. La moulure s’opérait entre la surface extérieure du premier et la surface intérieure du second; ce nouveau moyen leur permit de se faire aider par les animaux.
Plaute tournant la meule.
Le moulin à blé chez les Romains.
Ce fut seulement vers la fin de l’empire romain, c’est-à-dire trois cents ans environ après Jésus-Christ, que l’on connut les premiers moulins à eau. Quant aux moulins à vent, on croit qu’ils ne furent employés en Europe qu’après les croisades. Ce qu’il y a de certain, c’est que, pendant bien des siècles, on consomma la farine telle qu’elle sortait du pilon ou du moulin, c’est-à-dire sans la séparer du son. Quand on s’en avisa, on ne tarda pas à voir des industriels qui, un sas ou tamis sur l’épaule, s’en allaient par les rues, criant: «Farine à tamiser! voilà le tamisier!» Et les ménagères faisaient entrer chez elles l’homme au tamis qui, moyennant salaire, se chargeait d’opérer la séparation du son et de la farine moulus dans la maison.
Ce ne fut, pour ainsi dire, qu’aux temps les plus rapprochés de nous que l’idée vint d’adapter au mécanisme qui fait mouvoir les meules, des espèces de cages rondes garnies de canevas, dans lesquelles la farine tombe, aussitôt produite, et qui la tamisent en tournant.
Mais, tantôt, quand je vous donnais un aperçu des travaux du boulanger, n’ai-je pas prononcé certain mot de levain, de pâte levée, dont la signification vous a échappé ?
— C’est que, sans levain, il n’y a pas de boulangerie possible.
Or, qu’est-ce que le levain?..... Je vous dirai plus loin comment il s’est fait qu’un petit paresseux ait perfectionné, sans y penser, la machine à vapeur; vous allez voir que l’avarice peut, elle aussi, être, d’aventure, bonne à quelque chose.
C’était, il y a bien longtemps, très longtemps, à l’époque des patriarches, je crois. On savait alors broyer, moudre le grain; on en obtenait de la farine qu’on délayait avec de l’eau, qu’on pétrissait soigneusement, qu’on faisait déjà cuire dans des espèces de fours; et le produit de cette opération, qui portait aussi le nom de pain, était déjà un aliment très estimé, très répandu; mais ce pain devait ressembler à notre pain d’aujourd’hui à peu près comme le jus bourbeux et douceâtre d’une grappe de raisin écrasée au fond d’un verre ressemblerait à du vin clair et capiteux; en d’autres termes, au lieu d’avoir l’aspect léger, troué, et la saveur particulière de notre pain actuel, ce pain d’autrefois devait être massif, compacte, et singulièrement fade, si on n’avait eu soin d’épicer ou de sucrer au préalable la pâte, puis encore, au lieu que ce fût l’aliment digestif par excellence que vous savez, cette espèce de tourteau serré devait peser singulièrement sur l’estomac.
Le pétrissage de la pâte du pain et l’enfournage.
Or voilà que, certain jour, l’avare en question ayant par hasard oublié un peu de pâle dans le coin de sa huche (c’est l’auge où l’on pétrit le pain) la retrouva plusieurs jours après, lorsqu’il voulut pétrir de nouveau. Tout autre se fût hâté de jeter au loin ce méchant résidu qui flairait l’aigre et même un peu le moisi; car il ne faut pas longtemps pour qu’un commencement de putréfaction se manifeste dans de la farine délayée, et l’on devait déjà savoir que les aliments corrompus peuvent être nuisibles à la santé : «Ah! bah! fit pourtant notre homme, dans la quantité ça ne paraîtra pas: et au moins il n’y aura rien de perdu!» Sans plus délibérer, il mélangea donc la pâte ancienne à la pâte nouvelle, pétrit son pain comme si de rien n’était, le mit au four... et, merveille des merveilles! Dans quel profond étonnement fut jeté ce ladre aventureux quand il reconnut que, par l’adjonction d’un morceau de pâle au quart corrompue, sou lourd, fade et indigeste tourteau coutumier s’était métamorphosé en un mets aussi léger que savoureux, aussi appétissant que facile à digérer.
Bref, une grande découverte était faite, car la véritable boulangerie date seulement du jour où il fut reconnu que l’on ne pouvait obtenir du pain sain et délicat, qu’en provoquant dans la pâte fraîche une légère fermentation à l’aide d’un peu de pâle vieillie.
Et comme celte fermentation produit un boursouflement dans la masse pétrie, on a donné le nom de levain au morceau de pâte aigrie, qui la fait s’établir.
Ce principe trouvé, les anciens surent, paraît-il, le mettre singulièrement à profit, car nous voyons, par exemple, dans les auteurs latins, que les boulangers de Rome fabriquaient toutes espèces de pains plus savoureux les uns que les autres, à tel point qu’un satirique pouvait avec raison dire à certain gourmand, qui faisait trop essentiellement un dieu de son ventre:
«Si tu avais consacré à l’acquisition de la science et de la philosophie la dixième partie des soins et de l’argent que tu as dépensés pour que ton boulanger te fît de bon pain, depuis longtemps tu serais homme de bien.»
Quelque considération que je puisse avoir pour le pain, voilà un gaillard que pourtant je ne conseille pas d’imiter.
Les vendanges en Alsace.