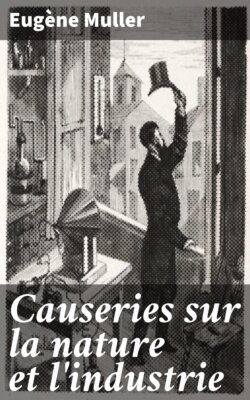Читать книгу Causeries sur la nature et l'industrie - Eugène Muller - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE VIN
ОглавлениеTable des matières
Un titre assez mal justifié. — Le principe de l’animal raisonnable. —La cause des invasions. — La fermentation. — La vache au lait et la vache au café. — Le vin rouge et le vin blanc. — Les dérivés du vin et ses suppléants. — Une boisson nationale. — Un livre à faire. — Noé. — Bacchus. — Les Ilotes. — Les femmes romaines. —Alexandre et Clitus. — Domitien et les vignes. — L’éducation d’un sultan. — Le dernier tableau de Miéris. — Le coup de l’étrier. —Deux histoires de tonneau. — Une statistique.
Quand l’homme fait la revue des êtres qui peuplent la terre, il est obligé, bon gré, mal gré, de su ranger lui même au nombre des animaux.
Cela étant, vous avouerez que, pour tel membre du genre humain dont on admirera la beauté, l’esprit, le génie, il sera on ne peut moins agréable d’entendre un naturaliste argumenter de façon à démontrer que ce monsieur, qui fait les délices ou l’étonnement de la société, est un simple animal, absolument comme le baudet, connu par son entêtement stupide et la haute puissance de son organe vocal, ou comme cet autre individu, fort peu soigneux de sa personne, que la vieille légende a donné pour compagnon à saint Antoine, le patron des charcutiers.
«Eh bien, soit! dira l’homme, qui n’est jamais à court d’expédients, quand son amour-propre est en jeu, animal, j’y consens; mais animal raisonnable.»
C’est le titre qu’il prend, qu’il se donne, en même temps que celui de roi de la création.
Or, il arrive souvent que ce soi-disant animal raisonnable se distingue des autres animaux, selon lui privés de raison, en agissant de telle sorte que sa raison l’abandonne tout à fait, et que le roi de la création devient le plus insensé, le plus extravagant, pour ne pas dire le plus abject, de tous les êtres.
La cause de cette singulière inconséquence est bien simple: c’est qu’au lieu de boire dans le but unique d’apaiser sa soif, comme font généralement ses confrères de la grande famille animale, l’homme s’avise souvent de boire pour le seul plaisir de boire. A vrai dire, si, comme les autres animaux, il s’en était tenu à la saine et économique liqueur que la nature lui offre partout, il est probable qu’à l’exemple des autres animaux il ne boirait encore que lorsque la soif l’y engagerait. Mais l’eau, ce breuvage par excellence, qui suffit à désaltérer tous les êtres non raisonnables, l’eau lui a semblé trop fade, trop innocente; et Dieu sait ce qu’il a imaginé pour n’être pas réduit à la boisson qu’on pourrait appeler naturelle, et surtout pour donner à ses diverses préparations la vertu de lui déranger l’esprit, de lui ôter la raison. Il obtient ce résultat par l’usage des boissons fermentées, qui ont pour effet, quand elles sont prises à trop forte dose, d’activer outre mesure le mouvement du sang et de troubler les fonctions du cerveau. Il tombe alors dans cet état de vertige qu’on est convenu d’appeler l’ivresse, véritable accès de folie volontaire qu’aucun autre animal ne connaît ni ne recherche: et c’est là, soit dit en passant, un privilège auquel l’homme aurait dû renoncer depuis longtemps, dans l’intérêt des autres en général et dans son propre intérêt en particulier; car il n’est guère de malheurs que l’ivresse n’ait attirés, aussi bien sur l’être qui s’y abandonne que sur ceux qui vivent ou dans son entourage ou sous sa dépendance.
Le vin, produit de la vigne, est en même temps la plus ancienne et la plus estimée de toutes les buissons fermentées connues. Son rôle est grand dans l’histoire des peuples. On va jusqu’à croire que nos ancêtres, les Gaulois, qui, de leur temps, donnèrent de terribles préoccupations aux fameux Romains, ne furent attirés en Italie que par le désir d’habiter le pays où croissait la vigne. On raconte que quelques-uns d’entre eux, qui par hasard étaient allés au midi et avaient bu du vin, employèrent, pour convier leurs compatriotes à la conquête des contrées méridionales, une singulière espèce d’exhortation. Ils leur envoyèrent pour tout message des cruches de vin. On ajoute qu’aussitôt des troupes innombrables de Gaulois, qui habitaient alors les forêts de l’Auvergne, du Berry, de la Bourgogne, où ils se nourrissaient de glands et s’abreuvaient d’eau claire, se mirent en marche dans la direction indiquée par les messagers porteurs des cruches de vin. Nous savons qu’ils ne s’arrêtèrent qu’après avoir saccagé Rome; qu’ils furent enfin mis en déroute et périrent en grand nombre. Toutefois, ceux qui revinrent acclimatèrent dans leur pays le précieux arbrisseau qui avait été le motif premier de l’expédition. Ce fut l’origine de nos célèbres vignobles actuels. On dit aussi que de même que la vigne, ou plutôt le vin, avait attire les Gaulois en Italie, de même les Francs qui habitaient les bois de la Germanie, ou Allemagne, furent amenés en Gaule par l’envie de se désaltérer avec le jus vermeil qui se récoltait sur les coteaux gaulois. Enfin, l’on a encore remarqué que, depuis l’époque où la vigne a été naturalisée partout où le climat rend la chose possible, les peuples de l’Europe, contents de leur sort, ont cessé d’accomplir ces migrations, ces invasions qui causèrent tant de bouleversements, tant de sanglants désastres.
Les petits Vendangeurs.
Mais j’ai rangé le vin au premier rang parmi les boissons fermentées. Qu’est-ce donc qu’on entend par boisson fermentée?
Le vin, vous le savez, est fait avec le raisin; or, il vous est bien certainement arrivé d’écraser un jour quelques grains de raisin dans un verre et de reconnaître, en dégustant l’espèce de bourbe douceâtre que vous avez alors obtenue, que cela n’avait ni l’aspect, ni la saveur, ni le montant, ni la chaleur qui distinguent le vin proprement dit. C’est qu’il manquait à ce liquide d’avoir été en quelque sorte transformé par la fermentation. Si, au lieu d’en juger par l’état primitif, vous l’eussiez laissé livré à lui-même pendant quelque temps, vous auriez pu voir au bout d’un certain nombre d’heures ou de jours, selon la qualité du raisin, une véritable ébullition s’établir peu à peu dans ce jus, qui aurait alors perdu sa douceur et contracté l’âpreté particulière que vous trouvez ordinairement dans le vin qui vient sur nos tables. Si, pendant que durait l’ébullition, ou plutôt la fermentation, vous vous étiez penché sur le vase qui contenait le raisin écrasé, vous auriez senti qu’il s’en exhalait une vapeur légèrement suffocante. Voici ce qui se passait: la fermentation établie faisait que le sucre du raisin, par une opération chimique naturelle dont nous n’avons qu’imparfaitement le secret, se changeait en alcool, tandis que dans l’air se dégageait ce gaz qui fait mousser le vin de Champagne, quand on a eu le soin d’emprisonner ce vin avant que le gaz ait pu s’évaporer.
Le pressoir.
Ce gaz est si abondant que, dans les endroits clos, où le vin fermente en grande quantité au moment des vendanges, il arrive très souvent que des vignerons qui travaillent à remuer le vin dans les cuves s’en trouvent asphyxiés, absolument comme si on les enfermait dans une chambre où brûleraient plusieurs réchauds de charbon; car le gaz qui s’échappe du jus de raisin en fermentation, et qui d’ailleurs porte le nom de gaz carbonique (ou du charbon), est identique à celui qui émane des réchauds.
On conte qu’une fois certain petit garçon, qui voyait paître dans un pré une vache noire à côté d’une vache blanche, s’avisa d’affirmer que ces deux braves bêtes contribuaient, chacune pour une part bien distincte, à la fourniture de son déjeuner: la vache blanche donnait le lait et la noire le café. Sans vouloir vous prêter une pareille naïveté de raisonnement, je crois que je ne m’aventurerais pas beaucoup en vous attribuant cette supposition que la couleur du vin dépend immédiatement de la couleur du raisin. Et pourtant si, un jour de cet automne, vous voulez bien écraser dans un verre quelques grains de raisin blanc et dans un autre verre quelques grains de raisin noir ou rouge, il vous sera facile d’acquérir la preuve que les deux liquides sont tous deux de la même teinte, c’est-à-dire d’un blanc verdâtre ou jaunâtre. Comment donc s’établit la différence? De la plus simple manière. Le vin rouge doit, en effet, sa couleur à celle du raisin qui le produit; mais cette couleur n’étant inhérente qu’à la peau des grains et non à la pulpe juteuse qui y est renfermée, il faut qu’après que le raisin a été écrasé, on laisse le moût (c’est le nom qu’on donne au jus de raisin) en contact avec la peau des grains pendant le temps de la fermentation pour qu’il en prenne la couleur. Si, au lieu de faire ainsi, on séparait le jus de la peau colorée, le vin resterait blanc. Aussi voyons-nous que, dans beaucoup de vignobles qui sont exclusivement renommés pour leurs vins blancs, on ne récolte guère que des raisins noirs.
La vendange faite, on porte immédiatement les grappes sous le pressoir, grande machine qui est destinée à serrer la masse des raisins jusqu’à ce que tout le jus en soit extrait; et l’on recueille ce jus que l’on fait cuver (fermenter) quand on veut obtenir du vin blanc sec (qui n’est pas doux), ou que l’on met presque aussitôt en bouteilles (après quelques préparations toutefois) si l’on vise à produire du vin doux et mousseux.
«Le vin, dit un grand médecin, serait une sorte de remède universel, si on en usait avec modération. Il est sans conteste le plus excellent fortifiant que la nature nous ait donné ; mais toutes ces bonnes qualités se pervertissent par l’abus, car le vin pris avec excès échauffe beaucoup; outre l’ivresse, qui fait moralement tomber si bas la plus intelligente des créatures, il produit plusieurs maladies fâcheuses: l’hydropisie, l’apoplexie, etc.
C’est à l’alcool qu’il contient que le vin doit ses principales qualités: bienfaisantes, si on sait en user raisonnablement; pernicieuses, si on fait la sottise d’en abuser. L’alcool s’obtient par la distillation: opération qui consiste à faire bouillir le vin dans un vase clos et à recueillir, à l’issue d’un tuyau qui correspond à ce vase, la vapeur que produit cette ébullition, et qui s’est condensée en se refroidissant.
Tout d’abord, on n’a pour résultat que la liqueur connue ordinairement sous le nom d’eau-de-vie, que les sauvages appellent eau de feu, et qui est l’alcool uni à plus ou moins d’eau; si l’on veut avoir l’alcool très pur, il faut distiller à plusieurs reprises; à chaque ébullition, le liquide, en se débarrassant de l’eau à laquelle il est mêlé, acquiert une force plus grande.
Le vin, par l’effet d’une seconde fermentation, acquiert une saveur acide qui le change en vinaigre (vin aigre), et, sous cette forme, il est encore d’une utilité incontestable. On s’en sert pour beaucoup d’assaisonnements; mais on peut, en outre, en l’étendant d’eau, en composer une des boissons les plus saines, surtout à l’époque des chaleurs. Les soldats romains se désaltéraient ordinairement avec la pasca, qui n’était autre chose qu’un mélange d’eau et de vinaigre. Ainsi s’explique que, lorsque Jésus-Christ, agonisant sur la croix, demanda à boire, un des gardes lui ait présenté au bout d’une lance une éponge imbibée de vinaigre.
Dans nos contrées, le vin est d’un usage à peu près général, mais la vigne ne pouvant prospérer et produire ses fruits que sous des latitudes tempérées, il s’en est suivi que bien des peuples placés sous un ciel trop ardent ou trop rigoureux, et désireux cependant d’avoir à bon compte une boisson fermentée, ont demandé à d’autres végétaux des suppléants du vin. La liste de ces diverses compositions serait infinie, car il n’est guère de nation qui n’ait trouvé quelque breuvage capable de réconforter et d’enivrer.
La bière obtenue par la fermentation de l’orge et de la fleur du houblon, est une boisson saine et nourrissante.
Fleurs de houblon.
Tour à piler les pommes et pressoir à cidre.
On fait d’abord germer l’orge et, lorsque les germes ont la longueur des grains, on les fait griller, puis on les écrase et on les met bouillir avec les fleurs de houblon.
Lorsque ce mélange est bien cuit, on le laisse refroidir, ensuite on le clarifie, et, après quelques jours, on peut le mettre dans des fûts, que l’on place à la cave.
Peu après, on peut consommer la bière, qui sera alors fraîche, limpide, d’un beau jaune, donnant une belle mousse blanche.
Si elle était prise avec excès, la bière aurait les mêmes inconvénients que le vin, elle enivrerait!
Le cidre, tiré de la pomme, est une boisson d’un usage journalier en Normandie.
Pour l’obtenir, on cultive des espèces spéciales de pommes, que l’on ne pourrait manger à cause de leur âcreté.
Lorsqu’on a récolté les pommes, on les expose au soleil pendant plusieurs jours pour en acheter la maturité, on les écrase ensuite sous une meule verticale en bois tournant dans une auge ronde.
Quand les pommes sont écrasées, on les met immédiatement en presse à la manière du raisin; aussitôt que le jus extrait de la pulpe par le pressoir est bien limpide et d’un beau jaune ambré, on le met en tonneau, et le cidre est alors bon à boire, seulement il est doux; ce n’est que plus tard qu’il prend sa saveur acide et amère.
Avec la poire, on fait comme avec la pomme, et par les mêmes procédés, une liqueur que l’on nomme poiré.
Elle n’est pas d’un usage aussi répandu que le cidre et contient beaucoup plus d’alcool que ce dernier.
Il y a beaucoup d’autres liqueurs faites avec des baies et des fruits, avec du lait, du miel, le suc de quelques arbustes; mais le vin, la bière et le cidre, sont les plus connues de toutes ces boissons; il en est une cependant qui, pour ne jouir que d’une célébrité fort restreinte, me semble mériter cependant une attention toute spéciale, non pas peut-être en tant que finesse de goût — dont je n’ai jamais été à même de juger, — mais au moins en tant que procédé de fabrication:
«Dans l’Amérique espagnole, dit un écrivain digne de toute créance, la graine du maïs sert à la préparation d’une boisson enivrante appelée chicha. Après avoir été grillée et réduite en farine grossière, elle est confiée aux membres de la famille et aux amis du consommateur, lesquels la lui rendent après l’avoir mâchée et réduite en bouillie. Cette pâte insalivée, nommée mastiga, est ajoutée à une décoction de maïs que l’on soumet à une nouvelle ébullition, et qu’on laisse ensuite fermenter pendant trois jours; et l’on a enfin le chicha, qui constitue la boisson nationale du pays.»
Ce n’est pas plus difficile que cela. — Eh bien, nationale on non, savoureuse ou insipide, voilà, je le déclare, une boisson qui me ferait difficilement oublier le clair breuvage que le bon Dieu fait sourdre pour tous du sein de la terre, et je crois qu’on trouverait, au moins en France, beaucoup de gens de mon avis.
Qu’en pensez-vous?...
Un de mes amis, grand compulscur de vieux écrits, me disait un jour:
«J’imagine qu’on ferait un livre aussi intéressant que volumineux, si l’on voulait recueillir seulement les principaux faits qui se rattachent à l’histoire du vin en particulier et des boissons spiritueuses en général. On trouverait dans ce recueil force détails de mœurs singuliers, pittoresques, et les sombres récits y contrasteraient à tout moment avec les aventures les plus drôlatiques. » — Et, pour me montrer qu’il n’avançait rien qu’il ne fût à même d’appuyer par de bonnes preuves, mon ami continua de la sorte:
«On y verrait d’abord qu’à l’origine de tous les peuples qui connurent l’usage du vin, l’invention de cette liqueur fut généralement regardée comme un haut titre de gloire pour le personnage à qui on l’attribua. Voici en première ligne Noé, le patriarche biblique que l’impérissable lignée des buveurs a célébré sur tous les tons. A vrai dire, pourtant, Noé fit un assez triste apprentissage des vertus du vin, puisqu’après en avoir goûté, il tomba dans l’abrutissement de l’ivresse, ce qui fut cause qu’un de ses fils se moqua de lui, et ce qui fut cause aussi qu’à son réveil il s’emporta jusqu’à maudire la postérité de ce fils irrévérencieux, en déclarant que la descendance de Cham (et il faut entendre par là la race noire) serait perpétuellement asservie à la descendance de ses frères (qui devaient être les souches des diverses races blanches). Malheureusement, bien des siècles passèrent, pendant lesquels les hommes blancs, qui y trouvaient le plus barbare intérêt, s’autorisèrent de cette vieille tradition pour opprimer, en toute tranquillité de conscience, les pauvres faces noires, qui expiaient ainsi, sans miséricorde, une faute, que le moindre sentiment d’humanité aurait dû regarder depuis bien longtemps comme surabondamment rachetée.
Vient ensuite, sinon en même temps (car on a souvent supposé que les deux personnages pouvaient bien n’en former qu’un), le fameux Bacchus, dont les païens firent un dieu, et dont les exploits, en tant que conquérant des Indes, et le mérite, comme inventeur du vin, ont fourni riche matière à la verve des poètes de toutes les époques. Le culte de Bacchus fut un des plus répandus dans l’antiquité. Les Scythes pourtant le rejetèrent en disant qu’ils trouvaient ridicule d’adorer un dieu qui rendait les hommes insensés et furieux. Comme il était de coutume, dans les cérémonies religieuses anciennes, d’immoler des animaux sur les autels des dieux pour leur être agréable, le bouc, qui aime à brouter les ceps, fut choisi pour victime ordinaire dans les sacrifices à Bacchus; et toutefois — voyez combien sont souvent irréfléchis les actes les plus sérieux — on prétend que, si la vigne nous donne aujourd’hui du vin, c’est à un bouc que nous le devons. Et voici de quelle façon. Quand elle croissait en liberté, à l’état sauvage, la vigne, qui s’épuisait à nourrir ses longs rameaux, ne produisait que quelques grappes misérables, aussi âpres que chétives. Mais un bouc ayant brouté un cep, on remarqua que la saison d’ensuite ce cep porta d’excellents fruits, en grand nombre; on eut l’heureuse idée de répéter l’expérience indiquée par l’animal. Et ainsi se trouva inventée la taille, qui est l’opération capitale sur laquelle repose la culture de la vigne.
Ce fait des Spartiates est demeuré célèbre: pour inspirer à leurs enfants l’horreur de l’ivrognerie, ils forçaient les Ilotes, leurs esclaves, à boire avec excès, el les menaient, quand ils étaient ivres, dans les salles où mangeaient les jeunes gens.
Chacun peut savoir aussi, qu’aux premiers temps de la république romaine, il était défendu, sous les peines les plus sévères, aux femmes de boire du vin; comme elles auraient pu enfreindre la défense sans qu’on s’eu aperçût la coutume s’était établie que, lorsque le père ou le mari rentraient chez eux, ils embrassassent leurs femmes ou leurs filles sur la bouche, afin de reconnaître à leur haleine si elles n’avaient pas mérité le châtiment qu’ils étaient en droit de leur infliger.
On sait encore que le grand Alexandre n’estimait pas qu’il fût indigne de lui de défier les plus intrépides buveurs, et qu’il lui arrivait fort souvent de pousser ses exploits en ce genre jusqu’à en perdre totalement la raison. Ce fut même pendant une de ces fréquentes orgies qu’il s’emporta au point de tuer du sa propre main Clitus, le plus fidèle de ses amis, le meilleur de ses officiers, qui, excité comme lui par le vin, lui reprochait de s’enorgueillir trop de son mérite guerrier.
Si nous revenons à Rome, nous y voyons que l’empereur Domitien, un des tyrans les plus odieux dont l’histoire ait enregistré le nom, ordonna un jour qu’on arrachât toutes les vignes. Le motif qui lui avait inspiré cette mesure était au fond assez raisonnable; car une terrible disette ayant désolé l’empire, il en avait conclu que la culture de la vigne faisait négliger celle du blé. Et pourtant Suétone nous apprend qu’on fit courir dans le public des vers qui disaient à ce monarque détesté :
Va, coupe tous les ceps, tu n’empêcheras pas
Qu’il reste assez de vin pour boire à ton trépas?
Puisque nous sommes sur le compte des tyrans, ouvrons les annales de Turquie, au règne d’Amurat IV, et voyons comment il arriva que ce Domitien d’un autre âge (1622-1640) fut initié à la honteuse passion qui déshonora Alexandre. Notons d’abord que, dans la religion mahométane professée dans le pays où régnait Amurat, l’usage du vin est rigoureusement interdit. Or, un soir, le Sultan — c’est le nom qu’on donne là-bas aux empereurs — se promenant sur la place publique. en habits communs pour n’être pas reconnu, rencontra un pauvre diable nommé Béri-Mustapha qui était ivre et qui, voyant Amurat le regarder curieusement, lui ordonna de passer son chemin.
Amurat et Béri-Mustapha.
Amurat, peu accoutumé à s’entendre parler ainsi, n’eut rien de plus pressé que de répliquer à l’ivrogne qu’il pourrait bien le faire repentir de ses paroles.
— Ah! Ah! fit l’autre en riant, et comment, s’il te plaît?
— Sais-tu bien, misérable, que je suis le Sultan?»
Et notre Amurat de croire que cette révélation va frapper l’homme aux impérieux propos. Mais celui-ci, du ton le plus calme: «Et toi, qui es le Sultan, sais-tu que je suis Béri-Mustapha? Et que, si tu veux me vendre Constantinople, je suis homme à te l’acheter.
— Insensé, avec quoi payerais-tu? dit le Sultan en haussant les épaules.
— Ne raisonne pas, reprit fièrement l’ivrogne, ou je t’achète aussi. Tu seras alors mon esclave. Tu t’a-pelleras, parce que je l’aurai ordonné, Béri-Mustapha. Et moi je serai le Sultan.
Cette singulière audace, loin de continuer à irriter Amurat, ne fit que lui causer une profonde surprise. Pour avoir le cœur net de l’état dans lequel il voyait cet homme, il ordonna qu’on l’emmenât ou plutôt qu’on l’emportât au palais, car, tout en causant avec l’empereur, Béri-Mustapha s’était couché par terre et s’était endormi.
Au réveil, le lendemain, Béri-Mustapha s’étant informé de l’endroit où il se trouvait, ne douta pas qu’il eût un compte fort désagréable à régler avec le souverain dont il connaissait, par ouï-dire, le caractère fort peu accommodant. Quand on vint le chercher pour paraître devant l’empereur, il demanda en grâce qu’on lui procurât une bouteille de vin afin de s’empêcher de défaillir en se rendant à cette redoutable entrevue. On fit selon son désir. Il but une gorgée du cordial breuvage, et cacha la bouteille sous son manteau.
Dès qu’il fut arrivé en présence d’Amurat, celui-ci lui dit qu’il eût à lui payer aussitôt le prix dont ils étaient convenus la veille pour l’acquisition de Constantinople. Alors Béri, montrant sa bouteille: «0 empereur, dit-il, voilà ce qui pouvait hier me donner le pouvoir d’acheter Constantinople, car si vous possédiez les richesses dont je jouissais alors, vous les croiriez bien préférables même à la monarchie de l’univers entier.
— Tu m’étonnes... fit l’empereur, et je serais curieux...
— Tenez, puissant Sultan, se hâta de reprendre Béri, en tendant son flacon, buvez de cette liqueur, et vous jugerez par vous-même si je vous ai menti.»
L’empereur avala quelques gorgées, dont l’effet ne tarda pas à se produire sur un cerveau qui n’avait jamais senti les vapeurs du vin. Bientôt il éprouva tant de joie, tant de ravissement qu’il déclara que les charmes de la couronne étaient en effet de beaucoup surpassés par ceux de sa situation... Et, désireux d’augmenter encore ses délices, il acheva bravement la bouteille.
Le voilà tout à fait ivre; il s’endort, et, quand il s’éveille après un lourd et long sommeil, il se sent pris d’un violent mal de tête.
Il fait aussitôt appeler Béri, et, avec la mauvaise humeur d’un homme qui souffre de la plus affreuse migraine, il lui reproche de l’avoir rendu malade.
Mais Béri qui l’attendait là sans doute: «Calmez-vous, puissant Sultan, j’ai le remède tout prêt.
— Donne alors, donne vile.»
Et Béri lui tend de nouveau une bouteille.
Tout d’abord le Sultan s’étonna, mais sur les instances de Béri, il but une seconde fois; et comme il se sentit soudain soulagé, il jura que désormais il n’aurait pas d’autre breuvage, ni d’autre remède contre ses maux. A dater de ce jour, en effet, le sultan Amurat s’enivra quotidiennement en compagnie de Béri-Mustapha, qu’il avait élevé par reconnaissance au poste de conseiller intime, et Dieu sait quelles belles décisions ces deux ivrognes devaient prendre touchant les destinées de l’empire, quand ils s’étaient mis de concert en l’état que nous savons.
Lorsque Béri mourut, Amurat, pour honorer dignement sa mémoire, le fit enterrer, dit-on, dans une cave, sous les tonneaux.
Peut-être n’est-ce là qu’une légende, qu’un apologue comme les orientaux savent les faire; mais, authentique ou inventée, cette anecdote porte avec elle l’utile enseignement du danger qu’on court quand on ne sait pas résister énergiquement aux occasions de contracter cet horrible défaut qu’on nomme l’ivrognerie. C’est qu’en effet, il en arrive presque toujours ainsi: on boit par fantaisie ou désœuvrement, et, quand on voudrait ne plus boire, le pli est pris, on s’est créé un besoin nouveau qui demande impérieusement à être satisfait. Et combien de belles, de grandes intelligences, qui, même en dépit des plus grands efforts, des plus vifs regrets, ne purent résister à cette ardente tentation! N’en citons qu’un exemple entre mille.
François Miéris — il vivait au dix-septième siècle-fut un peintre hollandais qui, jeune encore, s’était acquis, par un magnifique talent, la plus belle et la plus fructueuse renommée. Riche, considéré, marié à une très aimable femme, père de deux fils qui montraient les plus brillantes facultés artistiques, Miéris n’avait donc, comme on dit, qu’à se laisser vivre pour arriver heureusement au bout de son honorable carrière. Mais Miéris, qui était le plus simple et le meilleur homme du monde, fit un jour la connaissance d’un certain Jean Stein, peintre comme lui, excellent peintre même, mais encore plus habile diseur d’anecdotes et de bons mots, et, en outre, grand habitué du cabaret, dans les débauches duquel il avait coutume d’aller chercher un excitant pour sa verve comique.
Les récits de Stein avaient tout d’abord singulièrement plu à Miéris, il l’avait, une fois, accompagné au cabaret, pour l’entendre dans les meilleures conditions d’inspiration, et il en était revenu charmé par ce fol esprit faisant diversion à la gravité un peu monotone de sa vie laborieuse. Il était retourné avec Stein le lendemain et, tout en se pâmant d’aise aux lazzis du jovial compère, il avait machinalement trinqué avec lui: puis il avait franchi une troisième fois le seuil de la taverne, puis une quatrième... tant enfin qu’un soir il en sortit, les jambes vacillantes... et que, quand il pensa à se mettre en garde contre la funeste habitude à laquelle il déplorait que son ami fût livré, lui aussi avait bel et bien contracté celte habitude.
Et, dès ce jour, le grand artiste n’exista plus que pour ruiner son corps et son intelligence au cabaret, ou pour se livrer, dans des heures de maladive retraite du foyer domestique, au cruel remords que lui causait sa triste inconduite. Il ne travaillait plus, sa fortune était partie, les dettes étaient venues. Ses créanciers l’emprisonnèrent. La leçon sembla lui avoir profité, car, rendu à la liberté, il reprit ses pinceaux, retrouva sa veine de talent, enfanta encore de beaux ouvrages. L’aisance renaissait pour lui; il pouvait se croire alors complètement guéri, et rendu pour toujours à sa paisible existence; il professait même une telle horreur pour le vice dont il avait été le malheureux esclave, qu’il n’hésita pas à retirer son fils de l’atelier d’un maître chez lequel il l’avait placé, parce qu’il soupçonna ce maître de faire parfois quelques légers excès de boisson.
Il n’avait pas cru cependant devoir pousser la rigueur jusqu’à rompre avec Stein, qu’il jugeait plus malheureux que coupable, et dont le plaisant esprit avait toujours le privilège de le mettre en belle humeur; Stein venait chez lui, et, quand il sortait, Miéris le reconduisait. Certain soir Miéris poussa, tout en écoulant son ami, jusqu’à la porte d’un cabaret, dans lequel Stein voulut absolument prendre un verre, un seul verre de vin. Miéris pénétra avec lui dans le lieu abhorré, mais sans autre but que d’empêcher son ami de boire plus qu’il ne devait. On entre donc, on s’assied, on cause, l’on trinque, Stein fait merveille par ses récits, et Miéris de rire et de boire presque sans y songer... Et cela dure jusqu’au milieu de la nuit. Quand il doit regagner sa maison, Miéris est incapable de suivre la droite ligne. Arrivé au bout de la rue, il va rouler la tête la première dans une fosse bourbeuse que des maçons ont ouverte pour les fondations d’un bâtiment. Meurtri, empêtré dans ce cloaque, l’esprit troublé par l’ivresse, il essaye en vain de se relever, d’appeler; et sans aucun doute il fût resté dans cette étrange situation jusqu’à ce que mort s’ensuivît, si un pauvre savetier et sa femme, qui travaillaient dans une échoppe voisine, n’eussent entendu ses gémissements. Ces braves gens viennent, le tirent à grand’peine de la fange, l’emportent chez eux, le lavent, le mettent dans un lit chaud, lui administrent un breuvage calmant... Il s’endort, sans avoir conscience de sa position.
Le lendemain, aussitôt éveillé, comblé de honte, il s’échappe en hâte de cette maison hospitalière, sans se donner presque le temps de remercier ceux à qui il doit peut-être la vie: il court chez lui; s’enferme dans son atelier, que, pendant une semaine, il ne quitte que pour prendre quelques aliments. Il est malade, une fièvre ardente l’agite; mais il travaille pourtant, sans le moindre relâche, à l’achèvement d’un tableau qui sera peut-être un de ses meilleurs ouvrages... Ce tableau terminé, il le met sous son bras; il prend le chemin de l’échoppe, et, arrivé en présence du savetier et de sa femme qui ouvrent de grands yeux:
«Tenez, leur dit-il, c’est de la part d’un homme que vous avez tiré une nuit d’un fort mauvais pas. Si par hasard vous avez besoin d’argent, portez cela à M. Paats (un riche amateur, qui avait coutume d’acheter à poids d’or les moindres tableaux de Miéris), il vous en donnera, je pense, un certain prix.» Et il s’en va.
Ce tableau, que le savetier vendit 800 florins (quelque trois mille francs), fut, dit-on, le dernier que peignit Miéris, qui, à peine âgé de quarante-six ans, mourut peu de temps après des suites de son accident nocturne.
Et combien d’autres qui, à toutes les époques, dans tous les pays, expièrent leur faiblesse par les plus malheureuses destinées. Il est vrai qu’à côté de ces tristes vaincus de l’ivrognerie, l’histoire nous en signale, si l’ou peut ainsi dire, les triomphateurs. C’est, par exemple, le célèbre Bassompierre, qui, le jour où les députés de la république helvétique, auprès de laquelle il était ambassadeur du roi de France, lui proposèrent de boire avant son départ le coup dit de l’étrier, tira sa grande botte, la fit remplir du meilleur vin, la vida à moitié et fit circuler le reste; action d’éclat qui le mit en grand honneur chez les Suisses, lesquels sont proverbialement renommés comme d’intrépides buveurs. C’est encore le duc de Clarence, qui, condamné au dernier supplice, mais laissé libre de choisir le genre de mort qui lui agréerait le mieux, demanda à finir ses jours dans une tonne de malvoisie (vin liquoreux récolté dans les îles de la Grèce). Avouez que l’idée est bien digne d’un Anglais excentrique; et cet Anglais et son tonneau me rappellent un autre Anglais et un autre tonneau... C’était après la terrible bataille navale de Trafalgar, où l’amiral Nelson paya de la vie la satisfaction de détruire la flotte française. L’illustre marin, avant de rendre le dernier soupir, avait recommandé que son corps fût rapporté en Angleterre. Or, comme on était sur les côtes d’Afrique, où les chirurgiens de la flotte n’eussent sans doute pu trouver les drogues nécessaires à un embaumement régulier du cadavre, ils ne virent rien de mieux, pour se conformer aux volontés du défunt, que d’enfermer sa dépouille dans une tonne pleine d’eau-de-vie (l’alcool ayant, comme vous le savez, la propriété de conserver les substances qu’on y maintient plongées). Le corps de l’amiral étant ainsi préparé, la frégate qui le porte prend tranquillement le chemin des îles Britanniques. Pendant le trajet, d’ailleurs assez long, les marins de l’équipage montent à tour de rôle la garde d’honneur, dans la cabine où sont déposés les restes de leur ancien chef. On arrive, et tout aussitôt on se met en mesure de donner aux restes du grand homme un cercueil plus convenable; la barrique est ouverte non sans un pieux sentiment de respect; mais alors, ô surprise! ô prodige! que voit-on? — Le corps de l’amiral complètement à sec dans la futaille, qu’on a pourtant la certitude d’avoir remplie jusqu’à la bonde, et aux parois de laquelle aucune fuite n’a. dû se déclarer pendant la traversée, puisqu’il n’est pas tombé une seule goutte de liquide sur le plancher où elle repose. — Grand émoi, comme vous le pensez bien. Les chirurgiens sourient en regardant du côté des matelots qui ont tour à tour veillé auprès du précieux dépôt et qui se mordent les lèvres d’un air quelque peu embarrassé ; le commandant du vaisseau va faire un éclat, mais un vieux loup de mer le prévient; s’adressant bravement au médecin en chef, comme pour le faire juge entre lui et ses camarades:
La botte de Bassompierre.
— N’est-ce pas, major, que c’est toujours ainsi que ça arrive? ils ne veulent pas le croire, eux.
— Et quoi donc, mon brave?
— Que les choses qu’on met en conserve dans l’eau-de-vie la boivent, s’en emplissent... et que c’est même par ce moyen que ça les conserve... N’est-ce pas, major?
— Mais, oui... certainement...»
Alors le vieux marin, se retournant vers ses camarades: «Eh! je savais bien, moi; je disais bien que c’était l’amiral.»
Et les autres de répéter en chœur à mi-voix: «Oui, c’est l’amiral.»
Le commandant osa d’autant moins se fâcher que l’amiral était arrivé dans un état de parfaite conservation.
Voilà comment le corps du fameux Nelson fut bénévolement convaincu d’avoir absorbé en quelques semaines jusqu’à la dernière goutte d’une énorme barrique d’eau-de-vie. Et toutefois le soir, à terre, on pouvait entendre le vieux marin qui trinquait avec les compagnons dire discrètement en élevant à sa bouche un verre de l’ardente liqueur: «C’est égal, j’aime autant celle-là ; l’autre avait tout de même un petit goût.»
Les paludiers et saulniers bretons.