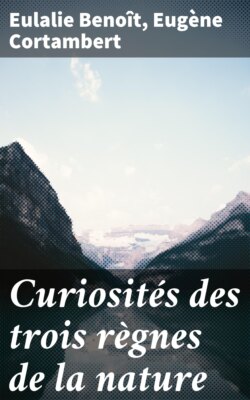Читать книгу Curiosités des trois règnes de la nature - Eulalie Benoit - Страница 6
DES PIERRES ET DES TERRES.
ОглавлениеCe sont les pierres et les terres qui composent les plus grandes masses minérales du globe; nous les voyons partout répandues en abondance autour de nous, et servir à chaque instant à nos usages les plus ordinaires. Examinons les principales de ces matières.
Le calcaire est une des pierres les plus communes et les plus utiles: lorsqu’on le chauffe fortement, il s’en dégage un gaz qu’on appelle acide carbonique, et il ne reste plus alors que ce qu’on nomme la chaux vive. Si l’on verse de l’eau sur cette chaux, il se produit un phénomène intéressant: comme l’eau se combine très facilement avec la chaux, elle devient solide dans cette combinaison, et abandonne par conséquent beaucoup de chaleur; cette chaleur agit sur une autre partie de l’eau, et la convertit en vapeur: celle-ci s’échappe en faisant entendre une espèce de sifflement, et en brisant les morceaux de chaux dans lesquels elle se forme. Réduite en pâte, la chaux devient extrêmement utile pour unir et solidifier les matériaux des édifices.
C’est le calcaire qui forme ces belles colonnes de stalactites et de stalagmites qui décorent si magnifiquement plusieurs grottes; et c’est dans les stalactites et les stalagmites qu’on trouve l’albâtre calcaire. Cet albâtre n’est pas blanc comme l’albâtre ordinaire, mais agréablement nuancé de couleurs jaunâtres et rougeâtres. Il y en a qu’on nomme albâtre oriental et qui est d’un blanc jaunâtre, avec des veines d’un blanc laiteux; une autre sorte s’appelle albâtre veiné ou marbre-agate, et il est composé de couches parallèles bien distinctes. Le plus estimé est jaune de miel, et offre des bandes ondulées de couleurs diverses et vivement tranchées. On en fait de fort beaux vases et des objets de curiosité et d’ornement.
Souvent le calcaire roulé par les eaux enveloppe différents corps organiques, tels que des branches, des feuilles, des fruits, et, s’y attachant avec force, il en conserve exactement les formes. Il existe un grand nombre de sources qui jouissent ainsi de la propriété de donner l’apparence de pierre aux objets qu’on expose à l’action de leurs eaux. La fontaine de Saint-Allyre, à Clermont-Ferrand, est une des plus célèbres: si l’on y place un petit panier de châtaignes, de noisettes, de raisins, un nid garni d’œufs, etc., on les trouve, au bout de peu de jours, couverts d’une couche fort dure de calcaire. Ce calcaire s’appelle incrustant ou concrétionné.
Le marbre statuaire blanc, qui a la blancheur et l’apparence du sucre, et les marbres colorés, si abondamment répandus, et dont l’usage est si fréquent, appartiennent aussi aux pierres calcaires. Il faut encore y comprendre la pierre lithographique, qui se polit parfaitement, et sur laquelle on trace, avec un crayon gras, des dessins qu’on multiplie ensuite par l’impression. Enfin on trouve également dans les calcaires la craie, cette matière ordinairement blanche, qui, triturée et délayée avec de l’eau, fournit la pâte appelée blanc d’Espagne ou blanc de Troyes. On s’en sert, comme on sait, pour en faire des espèces de crayons avec lesquels on dessine sur les tableaux noirs ou sur du papier de couleur; on l’emploie à nettoyer et à polir les métaux, etc.
C’est dans les matières pierreuses que l’on place le sel, nommé plus exactement muriate de soude, sel marin ou sel de cuisine, pour le distinguer d’une grande quantité d’autres sels qu’on trouve dans la nature ou qu’on obtient par la combinaison artificielle de diverses substances. Le sel ordinaire se rencontre ou dans le sol, sous la forme de véritables rochers, ou bien dans les eaux de la mer et dans celles de certaines sources, d’où on l’extrait par l’évaporation.
Lorsqu’il s’agit du sel de la mer, on a ordinairement des marais salants, espèces de bassins qui reçoivent les eaux salées quand les marées sont hautes, ou dans lesquels on l’introduit au moyen de pompes; là , la chaleur fait évaporer l’eau, et permet au sel de se cristalliser. Dans le nord de l’Europe, on profite du froid pour retirer le sel des eaux de la mer, comme on se sert de la chaleur dans le midi: on introduit de l’eau marine dans les bassins; il s’y forme une couche de glace qui n’est pas salée; on a soin de l’enlever tous les jours; de sorte que ce n’est réellement que de l’eau qu’on enlève, et le sel reste. Lorsque l’eau a été ainsi congelée plusieurs fois, on achève l’évaporation dans des chaudières.
Quand ce sont des sources qui fournissent cette matière, on fait descendre l’eau salée du haut de grands édifices: elle tombe en pluie à travers des branchages et des épines qui en retardent la chute, et l’air la fait évaporer pendant ce trajet. De là on la porte dans des chaudières, où l’évaporation s’achève. Dans plusieurs pays, et principalement dans la Normandie, on traite l’eau de mer, pour en extraire le sel, de la même manière que l’eau des sources salées.
Le sel qui se trouve en roches dans le sol se nomme sel gemme. Nous en avons quelques mines dans l’Est de la France, surtout dans le département de la Meurthe; mais la plus grande de l’Europe est certainement celle de Wieliczka, dans la Galicie. Elle est à l’immense profondeur de 247 mètres au-dessous de la ville; la partie exploitée a 367 mètres de large et environ 2,233 de longueur. C’est un vaste souterrain, avec de grandes chambres voûtées, supportées par des colonnes de sel. Il renferme une population de 600 habitants, avec les logements nécessaires à chacun, et des écuries pour 80 chevaux. On y tient toujours allumées un grand nombre de lumières, dont la flamme, réfléchie de toutes parts sur la mine, la fait paraître tantôt claire et brillante comme le cristal, tantôt teinte des plus belles couleurs: ce qui présente un coup d’œil enchanteur. On y voit de vastes édifices pour l’administration, des chapelles et des autels dont les ornements sont en sel, plusieurs galeries plus élevées et plus larges que des églises, enfin des lacs dont la grandeur exige des bateaux pour les visiter. Plusieurs centaines de mineurs et leurs familles y naissent et y finissent leurs jours.
Il est heureux que le sel soit une des matières les plus répandues dans la nature, car c’est aussi l’une des plus utiles. Il sert d’assaisonnement à nos mets frais, il préserve de la putréfaction les chairs que nous mettons en réserve pour nous nourrir; on l’emploie pour l’amendement des terres; on en consomme une grande quantité pour fabriquer l’acide hydrochlorique et la soude artificielle; on en fait le vernis de certaines poteries; on en donne souvent aux bestiaux, qui en sont très avides, et auxquels il est salutaire.
Cependant l’usage du sel est inconnu chez quelques peuples; il est un objet de luxe chez d’autres, comme dans l’intérieur de l’Afrique: là les seules familles riches en ont la jouissance, et un enfant suce un morceau de sel comme si c’était du sucre. Cette matière sert même de monnaie dans plusieurs pays: chez les Mandingues, un morceau de sel, long de 85 centimètres, large d’environ 45 centimètres et épais de 9 centimètres, vaut de 25 à 50 fr., et il est des contrées où le sel est échangé contre un poids égal d’or.
Le muriate d’ammoniaque, ou le sel ammoniac, est employé pour nettoyer les vases de cuivre qu’on veut étamer, et pour en retirer l’ammoniaque (ou alcali volatil), substance d’une odeur très forte et très pénétrante, propre à enlever les taches, etc. Il est ordinairement le produit de l’art, et s’obtient par la distillation des animaux morts. Cependant on le rencontre aussi dans la nature, au milieu des matières lancées par les volcans. Autrefois tout celui qu’on employait dans les arts et la médecine était envoyé de l’oasis d’Ammon, en Afrique, où on le retirait de la fiente des chameaux; et c’est de ce pays qu’il a pris son nom.
Le salpêtre est une autre sorte de sel qu’on retire des platras des vieilles murailles ou de la terre qui forme le sol des caves, des étables, etc. On l’emploie dans la fabrication de la poudre en le mêlant au soufre et au charbon; il sert à préparer l’acide nitrique (eau forte) et l’acide sulfurique (huile de vitriol); quelquefois il peut être usité comme le sel pour conserver la viande, et la pharmacie le fait entrer dans la composition de plusieurs remèdes.
Le gypse ou sulfate de chaux, qu’on appelle vulgairement pierre à plâtre, est une pierre naturellement brillante, mais qui, soumise au feu, perd l’eau qu’elle contenait, et devient blanche et terne: c’est ce qu’on appelle alors du plâtre. On bat cette matière, on la passe à travers une claie pour séparer les morceaux qui ne sont pas cuits, et on la tamise; le plus fin et le plus blanc est employé pour les objets de sculpture; le plâtre grossier, susceptible de plus de dureté, sert à sceller les ferrures dans la pierre, à enduire l’extérieur des maisons, à faire les plafonds. On le répand avec succès sur les prairies artificielles pour les amender. Benjamin Franklin, savant Américain, voulant démontrer combien le plâtre était bon comme engrais, fit ensemencer un vaste champ, et traça avec du plâtre, en lettres gigantesques, les mots suivants: Ceci a été mis à l’engrais avec du plâtre. La végétation devint si forte et si serrée aux endroits figurant des lettres, qu’il fut facile à tous les concitoyens du grand homme de lire ce précepte.
C’est encore le gypse qui donne cet albâtre d’un beau blanc de lait, qu’il ne faut pas confondre avec l’albâtre calcaire, et qui sert, comme celui-ci, à la confection d’une foule d’ornements.
Le quartz est remarquable par son extrême abondance, et par les usages multipliés auxquels il se prêle. On calcule qu’il forme presque un tiers de la masse totale de la croûte solide du globe.
Il comprend, parmi ses plus jolies pierres, le cristal de roche, qui a la limpidité de l’eau la plus pure. Le cristal de roche violet prend le nom d’améthyste: c’est une charmante pierre, susceptible d’un beau poli, et fréquemment employée dans la bijouterie; on la place presque toujours à l’anneau pastoral des évêques: aussi l’appelle-t-on souvent pierre d’évêque. Les anciens attribuaient à l’améthyste la propriété de préserver de l’ivresse; c’est pourquoi ils s’en mettaient aux doigts, ou s’en suspendaient au cou, lorsqu’ils faisaient de trop abondantes libations. Les améthystes les plus estimées viennent du Brésil et de la Sibérie. Le cristal de roche rose s’appelle rubis de Bohême.
La variété du quartz la plus répandue est le sable siliceux, composé de petits graine, tantôt agrégés; dans le premier cas, c’est le sable proprement, qui forme les dunes mouvantes des bords de la mer, le fond du lit d’un grand nombre de rivières, et le sol de la plupart des plaines arides, par exemple des déserts de l’Afrique; c’est là le sable qu’on emploie pour la fabrication du verre, en le fondant avec de la soude ou de la potasse; en le mêlant avec de la chaux, on en compose les mortiers propres à solidifier les constructions de maçonnerie; son aridité même le rend utile pour l’agrément de nos jardins, où, répandu dans les allées et dans les autres lieux destinés à la promenade, il forme une sorte de pavé doux, et s’oppose à la croissance des mauvaises plantes. Lorsque les grains de sable sont agrégés et fortement unis entre eux, ils composent des grès dont on fait des pierres de taille, des pavés, des meules à aiguiser, des plaques minces pour filtrer les eaux.
L’agate est une sorte de quartz qu’on trouve dans certaines roches sous la forme d’amande. On distingue les agates fines et les agates grossières: les premières ont des couleurs vives et diverses; elles comprennent les calcédoines, qui varient du blanc laiteux au blanc roussâtre ou bleuâtre, et dont les plus belles, dites orientales, présentent des ondes ou de petits nuages pommelés qui font un assez bel effet. Elles comprennent aussi les cornalines, beaucoup plus estimées que les calcédoines. Les cornalines viennent généralement de l’Asie, et sont particulièrement employées pour la gravure et la sculpture: les Grecs et les Romains ont beaucoup gravé sur cette pierre. Il faut encore distinguer les agates-onyx, ou agates-ongles, qui présentent plusieurs couleurs différentes, disposées en bandes, et ressemblant un peu quelquefois à celles qu’on observe sur les ongles de l’homme. Enfin on recherche certaines agates qui montrent dans leur intérieur des dessins noirs ou rouges représentant de petits arbres, des mousses ou d’autres plantes: on les appelle agates arborisées ou herborisées.
Les agates grossières sont les silex: tel est le silex pyromaque, ou la pierre à fusil, qui, frappée avec l’acier, donne lien à de vives étincelles. La seule carrière de France où l’on exploite en grand cette matière est celle du canton de Saint-Aignan (Loir-et-Cher): on y prépare environ 40 millions de pierres à fusil par an.
Il faut aussi connaître le silex molaire ou la pierre meulière, criblée de cavités, et qu’on emploie pour faire des meules de moulins et les pierres de maçonnerie nommées moellons.
Le quartz comprend encore le jaspe, qui est tout-à-fait opaque, mais doué de couleurs vives très variées, et susceptible d’un beau poli.
L’opale est un quartz assez fragile, d’un éclat résineux: l’opale irisée et l’opale de feu sont fort belles.
Le feldspath est à peu près aussi dur que le quartz. Ses plus intéressantes variétés sont le feldspath pétunzé et le feldspath décomposé ou le kaolin: tous deux sont blancs, mais le kaolin est friable, tandis que le pétunzé se trouve en lames et en cristaux. Le kaolin a la propriété de résister à un feu très vif, et l’autre est fusible; en les mélangeant, et en faisant une pâte qu’on triture et qu’on bat, on obtient cette matière précieuse qui se nomme porcelaine.
Le mica forme des lames minces et élastiques; quelquefois il compose de grandes feuilles transparentes qui peuvent remplacer le verre à vitre. Les Russes l’emploient beaucoup pour vitrer les vaisseaux de guerre, car il a l’avantage de ne pas se briser par l’explosion de l’artillerie; ils s’en servent aussi pour garnir les lanternes, et souvent même pour les croisées des maisons; on en exploite en Sibérie d’immenses quantités. Le mica lamelliforme ou pulvérulent se divise en petites paillettes brillantes qui ont la couleur de l’argent ou de l’or; la poudre qu’on répand sur l’écriture pour la sécher est souvent de la poudre de mica.
La magnésie ou magnésite est une terre blanche, légère, douce au toucher: l’écume de mer, avec laquelle on fait les belles pipes blanches du Levant, est une sorte de magnésie.
Le talc offre, comme le mica, des feuillets faciles à détacher; mais ils sont mous et non élastiques. Un des talcs les plus utiles est la craie de Briançon, qui est la base des crayons de pastel, et qui, réduite en poudre fine, s’emploie pour la préparation du fard destiné à la toilette des dames, pour diminuer le frottement des machines, pour faciliter l’introduction des pieds dans les bottes, etc. Une autre sorte de talc est la pierre de lard, qui peut se couper comme du savon, et dont les tailleurs se servent pour tracer les coupes sur le drap.
L’asbeste ou amiante est une pierre fort singulière composée de filaments minces et flexibles qui peuvent se filer comme le chanvre ou le coton. On en fait des tissus qui ont la précieuse propriété d’être incombustibles. Les Chinois en fabriquent des pièces entières d’étoffe; on en obtient aussi du papier, et il existe, dans la bibliothèque de l’Institut, un ouvrage imprimé sur cette matière. On en fait des mèches incombustibles, et qui n’ont conséquemment pas besoin d’être mouchées. En Corse, les potiers mêlent l’amiante à l’argile pour en fabriquer des poteries légères, fort solides, et qui résistent à l’action d’un grand feu.
Dès la plus haute antiquité on employait les tissus d’amiante à brûler les corps, ce qui rendait facile la conservation des cendres des morts; mais les riches seuls pouvaient s’en servir, parce que ces tissus étaient d’un prix excessif. Son usage actuel le plus vulgaire s’applique aux briquets: on met de l’amiante dans une petite bouteille, et on l’imbibe d’acide sulfurique; il suffit alors, pour avoir du feu, de frotter contre cette amiante des allumettes oxygénées, c’est-à-dire des allumettes dont le bout est empâté avec une petite boulette de chlorate de potasse et de soufre.
Le tripoli est une matière d’une teinte rose ou blanche, qui, réduite en poudre, sert à polir les métaux.
Les schistes sont des roches qui se divisent en feuillets minces: un des plus précieux est l’ardoise, dont les feuillets sont solides, droits et sonores; généralement elle est grise: cependant on en trouve aussi de verdâtre, de rougeâtre et de violette. En France, les plus importantes ardoisières (carrières d’ardoise) sont celles d’Angers et des Ardennes. L’ardoise sert à couvrir les maisons, à faire des tablettes pour écrire, et des crayons pour tracer les caractères sur ces mêmes tablettes; quelques variétés font de bonnes pierres à aiguiser, surtout des pierres à rasoir.
On nomme argiles des substances terreuses, tendres et douces, qui ont été généralement charriées, broyées et réduites en limon par les eaux; elles jouissent de la propriété de se délayer dans l’eau et d’y faire une pâte onctueuse, tenace, susceptible de se mouler et d’acquérir au feu une grande dureté. Celles qu’on appelle argile plastique et argile figuline ou terre glaise sont les plus intéressantes par leurs usages variés et importants: on en fait les poteries communes, les faïences, les briques, les tuiles. La nature a répandu avec profusion ces matières si utiles.
L’argile smectique, ou terre à foulon, a une pâte fine et savonneuse, employée pour enlever aux draps les parties huileuses mêlées à la laine.
L’argile calcarifère, qui se nomme aussi marne, est extrêmement commune. Elle est souvent employée à faire des vases et des briques; la marne verdâtre de Montmartre est une bonne pierre à détacher; mais l’un des usages les plus importants de la marne, c’est de pouvoir être mêlée aux terres pour les amender.
Nommons encore l’argile ferrugineuse, dont une variété colorante, appelée ocre, sert à faire les crayons rouges.
Le granité est une pierre composée de grains de feldspath, de quartz et de mica, étroitement unis et entrelacés. Généralement le granite est grisâtre; cependant il y en a de rouge, de rose, etc.; un des plus beaux est le granité rouge d’Egypte, dont on a fait des obélisques et d’autres monuments célèbres: l’obélisque de Louqsor, qu’on voit sur la place de la Concorde à Paris, est une seule pierre de granité. Cette matière est très dure, et constitue le noyau de la plupart des principales chaînes de montagnes; elle forme, en quelque sorte, les vieux ossements du monde. Cependant elle ne présente pas dans les constructions autant de solidité qu’on pourrait le penser, parce qu’elle se décompose facilement à l’air, c’est-à-dire que ses grains se détachent les uns des autres et tombent.
La syénite, qui tire son nom de la ville de Syène, en Egypte, s’appelle encore granite noir antique ou basalte oriental: c’est une belle pierre, avec laquelle les Egyptiens ont fait des statues et de petits obélisques.
La ponce est une substance lancée jadis par les volcans, très poreuse et fort légère; elle est âpre au toucher, et raie des corps très durs, quoiqu’elle soit elle-même assez facile à briser: aussi l’emploie-t-on pour donner le poli à différents corps. On la tire des îles de Ponce et de Lipari, dans la mer Tyrrhénienne.
L’obsidienne est une matière également volcanique et qui ressemble à du verre; elle est ordinairement noire. Les peuples de l’antiquité et les Péruviens en ont fait des miroirs et des instruments tranchants.
Le porphyre se compose d’un mélange de feldspath et de quartz; il est généralement fort dur, orné de couleurs variées, et peut recevoir un beau poli. On distingue le porphyre rouge antique, souvent employé par les Egyptiens pour faire des sépulcres, des statues, des obélisques; il y a aussi le porphyre noir, le porphyre vert.
La serpentine est une sorte de roche dans la composition de laquelle il entre beaucoup de talc; elle est tendre et douce au toucher, et la surface en est souvent veinée de vert, de jaunâtre ou de rougeâtre: on a comparé ces taches à celles que présente la peau des serpents, et c’est de là que vient le nom de cette pierre. Avec la serpentine noble on fait divers ornements. Dans plusieurs pays, la serpentine commune sert à la fabrication de certaines poteries: on l’appelle alors pierre ollaire .
Le basalte est un ancien produit volcanique, qui abonde en Auvergne et dans les autres pays où se trouvent des volcans éteints. Nous avons déjà parlé des admirables colonnades naturelles qu’il forme en beaucoup d’endroits. Il est fort dur, et on l’emploie pour la construction des maisons, pour l’empierrement des routes, pour divers objets d’ornement. Les anciens s’en sont servis dans un grand nombre de monuments; les Egyptiens en ont fait des statues, des vases et une foule d’autres ouvrages intéressants dont nous décorons nos musées.
La pouzzolane est une espèce de sable volcanique, précieux dans l’art de bâtir: en le mêlant à la chaux, on en fait un excellent ciment hydraulique, c’est-à-dire un ciment propre aux ouvrages qui doivent rester sous l’eau.
Nous avons vu dans les quartz quelques pierres précieuses, c’est-à-dire de ces pierres que le lapidaire taille comme objets de parure, mais qui sont, dans le fait, moins précieuses que beaucoup d’autres; il y a encore plusieurs pierres qui portent ce nom: les principales sont la topaze, la turquoise, le spath-fluor, l’émeraude, le zircon, le corindon, le spinelle. On y place communément aussi le diamant; mais, dans la réalité , il n’est pas une pierre, comme nous le verrons par la suite.
La topaze est fort dure, ordinairement jaune; souvent cependant elle est d’un bleu céleste, et quelquefois elle est incolore et limpide; on en trouve fréquemment au Brésil. La Saxe et la Sibérie sont les autres contrées où l’on rencontre le plus de topazes.
Les turquoises sont opaques et compactes, d’un bleu céleste ou d’un vert pâle; les plus estimées sont les turquoises orientales, qui viennent de l’Asie, et particulièrement de la Perse.
Le spath-fluor offre des cristaux ornés de teintes très diverses; une des variétés les plus recherchées est celle que l’on trouve en Angleterre, et qui est composée de couches successives, alternativement blanches et violettes; on en fait des vases et des plaques d’ornement.
L’émeraude comprend plusieurs variétés intéressantes; l’émeraude proprement dite est d’un vert pur; on la trouve dans la Colombie et en Egypte. Il y a des émeraudes d’un bleu verdâtre, avec la teinte de l’eau de mer; on les appelle aigues-marines; c’est surtout en Sibérie qu’on les rencontre. — Les jaunes et les incolores se nomment bérils; celles-ci sont assez communes; et l’on en trouve près de Limoges.
Les grenats sont ordinairement transparents et d’un beau rouge; cependant il y en a de verts, de bruns et de noirs. Ce sont des pierres peu rares, par conséquent de peu de valeur dans la bijouterie; on estime toutefois les grenats d’un rouge violet ou pourpré qu’on nomme grenats syriens, et ceux d’un rouge orangé qu’on appelle vermeilles.
Le lapis ou lapis-lazuli est une pierre opaque d’un bleu d’azur; lorsqu’il offre un bleu très vif et qu’il est exempt de taches, les artistes le recherchent beaucoup et le travaillent en forme de plaques. Mais le principal usage du lapis est de fournir à la peinture cette belle couleur bleue, presque inaltérable, connue sous le nom d’outremer.
Le zircon est fort dur, et c’est la plus pesante des pierres précieuses: tantôt il est orangé brun âtre, et se nomme alors hyacinthe; tantôt il est incolore ou jaune verdâtre, et on lui donne, dans ce cas, le nom de jargon.
Le corindon est le minéral le plus dur après le diamant. La variété la plus précieuse de cette pierre est le corindon hyalin, dont les couleurs sont vives et variées, et que sa dureté et l’intensité de son éclat font estimer quelquefois presque à l’égal du diamant lui-même. Le rouge cramoisi s’appelle rubis oriental: le jaune pur est la topaze orientale; le bleu d’azur, le saphir; le violet pur, l’améthyste orientale, enfin le vert est l’émeraude orientale. C’est principalement dans l’Inde que se trouve le corindon hyalin; on en a découvert en France dans le ruisseau d’Expailly (Haute-Loire) et au Mont-Dor (Puy-de-Dôme).
Quelquefois le corindon se présente mélangé de fer, et sa couleur est alors brune, gris bleuâtre ou rougeâtre; dans cet état, il n’a rien qui flatte la vue, rien qui le fasse rechercher comme objet de luxe; mais il a l’avantage d’être réellement utile: sous le nom d’émeril, il sert, réduit en poudre, à polir les métaux, les glaces, etc. On en trouve particulièrement en Saxe et dans l’île de Naxos.
Les spinelles sont presque aussi durs que les corindons, et leur vif éclat les place parmi les pierres les plus recherchées. Leur couleur générale est rouge, et on leur donne aussi le nom de rubis. Le spiuelle rouge ponceau se nomme rubis-spinelle; celui dont le rouge approche du rose intense ou du violâtre est le rubis-balais. C’est l’Asie, ce pays si riche en autres pierres précieuses, qui fournit aussi les plus beaux spinelles.