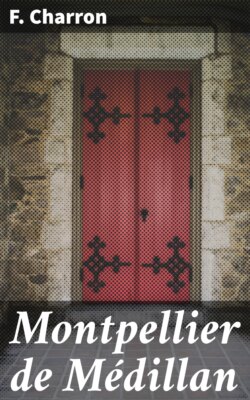Читать книгу Montpellier de Médillan - F. Charron - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
Table des matières
LA POPULATION
Vers quelle époque l’homme a-t-il fait son apparition dans la localité ?
C’est une question à laquelle nous n’avons pas la prétention de répondre, d’autant plus qu’à Montpellier il n’y a point de station préhistorique. On trouve cependant deci, delà, quelques silex taillés ou polis, des flèches, des pointes, des haches, qui témoigneraient de la présence de homme à l’époque où il n’avait encore que ces armes et outils à sa disposition.
Puis les grandes invasions barbares sont venues; les peuples primitifs ont été chassés et remplacés par d’autres, jusqu’au jour où les Gallo-Romains s’établirent définitivement dans le pays. C’est de ces derniers que descend toute la population de la Saintonge.
D’après le recensement de 1911, la population de la commune comprend 628 habitants et 210 ménages ou feux, ce qui fait une moyenne de 3 personnes par feu.
Or, en 1705, la paroisse de Montpellier comptait 180 feux et si, pour ne rien exagérer, pour rester même au-dessous de la réalité, nous estimons qu’il y avait 4 personnes par feu, cela nous donne une population de 720 habitants.
Et en prenant la même base pour les années qui vont suivre, nous avons:
1706 — 190 feux et 760 habitants.
1710 — 258 feux et 1032 habitants.
Dans son Dictionnaire géographique, l’abbé Expilly donne en 1770, 245 feux pour le bourg de Montpellier, ce qui, d’après notre base, aurait fait une population de 980 habitants.
Lorsque la Révolution éclata en 1789, le bourg comptait 220 feux et par conséquent 880 habitants.
Les registres de l’état civil coûtaient en 1706, trois livres et dix sols.
En 1710, la somme à payer pour les registres de l’état civil se décomposait ainsi:
Actuellement ces mêmes registres coûtent 45 fr. par an.
Professions
Table des matières
Au point de vue professionnel, les 628 habitants de la commune de Montpellier se décomposent ainsi:
Sexe
Table des matières
État civil
Table des matières
Densité de la population
Table des matières
43 habitants par kilomètre carré
Hygiène.
Table des matières
Peu à peu les règles de l’hygiène pénètrent nos mœurs campagnardes; et les diverses influences provenant des milieux dans lesquels l’homme évolue sont mieux appréciées.
C’est ainsi que la propreté va prédominant de plus en plus; le régime alimentaire s’améliore de jour en jour; l’eau, principal véhicule de bien des maladies, est employée avec plus de circonspection; les fumiers sont placés de manière à ne pas contaminer les puits et quantité d’ustensiles de cuisine malsains disparaissent peu à peu.
Dans les maladies, de nombreuses mesures prophylactiques sont prises.
Les conseils du médecin sont écoutés avec déférence, si ce n’est sous le rapport de l’enfance, où il y a encore beaucoup à faire.
Disons enfin que la stabulation est aussi en progrès et que les animaux sont mieux logés qu’autrefois.
Alimentation.
Table des matières
Si le régime alimentaire de nos grands-pères n’était point aussi varié que le nôtre, il était aussi bien plus sain.
Du pain de méture, de la bouillie de maïs, les légumes du jardin, le lait de la vache ou de la chèvre, les produits de basse-cour et la viande du porc, voilà quel était leur menu.
Si nous ajoutons qu’ils avaient du vin d’où étaient exclus le soufre et le sulfate de cuivre, l’on ne sera plus étonné de la robustesse de leur tempérament et de leur résistance aux maladies qui nous assaillent et qui leur étaient inconnues.
Actuellement, la campagne, comme la ville, est inondée de produits manufacturés, conserves et denrées, véritables produits chimiques qui délabrent nos estomacs et ruinent nos santés.
Vêtements.
Table des matières
Nos vieillards, qui ne subissaient pas comme nous les caprices de la mode, trouvaient aux villages tous les éléments nécessaires à leur toilette. Non seulement la laine de leurs moutons leur fournissait bas, chaussettes et gilets, mais encore une étoffe appelée cadis et qui servait à confectionner les habillements d’hiver; quant aux costumes d’été, ils étaient pris dans la pièce de toile du tisserand.
Il y avait aussi une étoffe appelée dreuillet et avec laquelle on faisait des robes.
Aujourd’hui le contact des villes a amené toute une transformation: les vêtements de cadis ont été remplacés par des étoffes plus nouvelles avec une coupe plus seyante; les jolis bonnets de nos paysannes ont fait place à des chapeaux multiformes et la chaussure fine a fait disparaître les souliers ferrés d’autrefois.
Il est cependant un long manteau de drap noir, à capuchon et appelé cape, que les femmes portent encore aux champs, l’hiver, pendant le deuil, aux enterrements et aux services funèbres et qui résiste aux assauts de la mode.
Citons aussi le devanteau (tablier) et la kisnotte (coiffure d’été).
Eclairage.
Table des matières
Pour s’éclairer, nos ancêtres avaient une lampe à huile appelée chareuil ou chaleuil, mais plus souvent des chandelles de résine faites par la ménagère et supportées par une yoube placée dans la cheminée.
Cependant on se servait aussi de chandelles de suif faites avec le suif des moutons tués pendant les vendanges. Mais, vu leur petit nombre, on ne les employait que le plus rarement possible, pour que la provision dure longtemps, afin d’en acheter peu, car elles coûtaient de 1 fr. à 1 fr. 20 la livre.
Tout cela a disparu pour faire place à nos actuels moyens d’éclairage, plus dispendieux il est vrai, mais combien plus propres et plus éclairants!
Émigration et Immigration.
Table des matières
Ces mouvements de la population sont plus importants qu’on ne se l’imagine tout d’abord. Sans doute, ils procèdent lentement, par petites quantités, ne portent que sur quelques sujets, chaque année; mais, à la longue, ils absorbent toute une agglomération de gens et finissent par modifier profondément la population d’une localité.
Du moins, c’est ce qui se passe à Montpellier, où nous pouvons dire que, tous les 50 ans environ, plus des trois quarts de la population sont changés.
Un cas de longévité.
Table des matières
Mercier Rose, née à Montpellier le 6 mars 1810, y est décédée le 13 mars 1908, à l’âge de 98 ans et 7 jours.
Années de grande mortalité.
Table des matières
1779
Année signalée par le curé Bertry (Voir Registres paroissiaux).
58 décès: 27 hommes, 31 femmes.
Mois de septembre: 13 décès, dont 8 enfants de moins de cinq ans.
Mois d’octobre: 16 décès, dont 11 enfants de moins de cinq ans.
1785
40 décès: 23 hommes, 17 femmes.
Les décès portent surtout sur les enfants de moins d’un an: 13 décès, et sur les personnes de 60 à 80 ans: 10 décès.
1800
30 décès: 20 hommes, 10 femmes.
Fructidor: 14 décès.
Personnes de 60 à 80 ans: 12 décès.
1805
36 décès: 15 hommes, 21 femmes.
Pas de mois chargés.
Personnes de 60 à 80 ans: 12 décès.
Etude comparative.
Table des matières
Période quinquennale.
1676-1677-1678-1679-1680.
Naissances, 115.
Mariages, 24.
Décès, 85.
Moyenne de la vie: 28 ans.
Période quinquennale.
1876-1877-1878-1879-1880.
Naissances, 87.
Mariages, 27.
Décès, 79.
Moyenne de la vie: 47 ans.
Période quinquennale.
1806-1807-1808-1809-1810.
Naissances, 127.
Mariages, 30.
Décès, 85.
Moyenne de la vie: 36 ans.
Période quinquennale.
1906-1907-1908-1909-1910.
Naissances, 33.
Mariages, 26.
Décès, 49.
Moyenne de la vie: 58 ans.