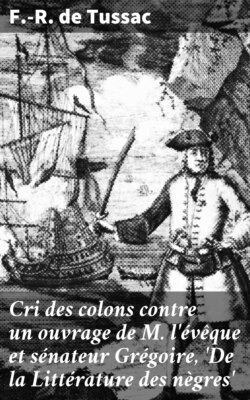Читать книгу Cri des colons contre un ouvrage de M. l'évêque et sénateur Grégoire, 'De la Littérature des nègres' - F.-R. de Tussac - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
ОглавлениеTable des matières
Ce qu'on entend par le mot nègre. Disparité d'opinion sur leur origine. Unité du type primitif de la race humaine.
Si nous avons admiré dans la dédicace de l'ouvrage de l'évêque Grégoire, la prodigieuse mémoire dont la nature a doué ce prélat, nous ne sommes pas moins étonnés de l'immensité des recherches qu'il lui a fallu faire, pour nous apprendre les différens noms qu'ont portés, autrefois, les nègres. «Les Grecs les appeloient Éthiopiens, et cette assertion s'appuye sur des passages de la Bible des septante, d'Hérodote, de Théophraste, de Pausanias, d'Athenée, d'Héliodore, d'Eusèbe, de Flavius-Joseph, de Pline l'ancien et de Térence. A Rome, on les appeloit Africains, mais la dénomination d'Éthiopiens leur étoit donnée en Orient, parce qu'ils y arrivoient par l'Éthiopie.» Cela nous paroît concluant; cependant l'auteur nous apprend que la dénomination d'Africain prévaut actuellement, malgré qu'il y ait des noirs asiatiques; plus loin, il nous parle de nègres pasteurs; ce seront donc des noirs, si l'on veut; des nègres, si on l'aime mieux; des Éthiopiens, si on le préfère; des Africains, selon d'autres; des maures, même, selon quelques-uns; mais l'auteur ne nous dit pas à laquelle de ces dénominations il s'est fixé; quoique cela importe fort peu pour ce qui semble être l'objet de son ouvrage, nous eussions été bien aises de le savoir, afin de ne pas nous servir de dénominations choquantes. Dans le principe de la révolution de S.-Domingue, les Africains ne vouloient plus qu'on les appelât nègres, mais noirs; ensuite ils se donnèrent entr'eux les noms de Monsieur, Madame et Mademoiselle; et ils donnoient aux blancs celui de Citoyen et Citoyenne; ils prétendoient n'être plus ni nègres ni noirs. Ils ne croyoient pas, à cette époque, que la couleur noire étoit la couleur primitive. Cependant, Sonthonax leur avoit déjà dit: «Cette couleur noire étant, selon l'auteur, le caractère le plus marqué qui sépare des blancs une partie de l'espèce humaine, on a été moins attentif aux différences de conformation, qui, entre les noirs eux-mêmes, établissent des variétés.» Il existe donc, d'après M. Grégoire, des variétés parmi les nègres? Mais, n'y auroit-il pas plus loin d'un blanc à un nègre, que d'un nègre à un autre nègre? et s'il existe plusieurs variétés dans l'espèce d'hommes, ne peut-il pas exister plusieurs espèces dans le genre? Les Asiatiques que l'auteur appelle noirs, n'ont autre chose, qui les distingue des blancs, que la couleur; tandis que les Africains qu'il nomme nègres, ont les os des joues proéminens, l'os nazal si court, qu'il est presque oblitéré, le coccis très-allongé, de la laine sur la tête, au lieu de cheveux: si, comme le pensait l'illustre Buffon, la couleur noire étoit l'effet du climat, on pourroit croire que les Asiatiques étoient originairement blancs; mais la différence de conformation dans une grande partie des Africains, ne laisse pas, selon nous, de doute, qu'ils ne soient une espèce particulière d'hommes qui diffèrent autant des Asiatiques que des Européens. Au reste, que les nègres soient une espèce, une variété, ou une race identique avec la blanche, nous les avons toujours reconnus, quoi qu'en disent les négrophiles, pour de véritables hommes, et la majeure partie de nous les traitoit en conséquence, soit par humanité, soit par intérêt; car, quand nous les eussions mis au rang des bêtes de somme, peu d'hommes sont assez insensés pour acheter des boeufs ou des chevaux, et ne pas les nourrir, les assommer du matin au soir, et les faire mettre tout vivans dans un four; ces sortes de fantaisies coûtent trop cher. Mais cette digression nous éloigne de notre sujet, et nous attendons avec impatience les chefs-d'oeuvres de littérature que l'évêque Grégoire nous a annoncés, qui doivent prouver, sans réplique, que l'on ne doit pas juger des facultés intellectuelles d'un homme par sa couleur, ni par sa conformation. Il y auroit, comme le dit l'auteur, de quoi rire. Cependant, que ferons-nous de la doctrine du docteur Gall, qu'il cite avec vénération? Ce docteur fameux, ne nous a-t-il pas démontré que chaque faculté intellectuelle avoit sa bosse particulière (ch. I, p. 6,)? «Le caractère spécifique des peuples est permanent, tant que ce peuple est isolé, il s'affoiblit et disparoît par le mélange; cela est incontestable.» Ici, l'auteur paroît avoir oublié qu'il n'admettoit pas d'espèce dans le genre homme: c'est donc le caractère national, et non le spécifique qui change; il dit, un peu plus bas, très-éloquemment, «que les caractères nationaux sont presque méconnoissables au physique et au moral, depuis que les peuples de notre continent sont transvasés les uns dans les autres.» L'expression de transvaser est riche, elle n'est cependant pas neuve. Nous nous rappelons que, dans notre enfance, qui, pour plusieurs de nous, date de très-loin, nos bonnes nous disoient que si l'on pouvoit faire une bouteille assez grande, on pourroit y transvaser Paris; si cela arrivoit, et qu'avec les Parisiens on transvasât tous les étrangers que les conquêtes de la France amènent à Paris, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Russes, des Autrichiens, il n'y a pas de doute que la physionomie nationale ne changeât; les Parisiens moins François tiendroient un peu de l'Allemand, un peu de l'Espagnol, un peu de l'Italien, un peu du Portugais, un peu de l'Autrichien, un peu du Russe. Oh, pour le coup, il y auroit de quoi rire de la bigarure des caractères physionomiques! Les cheveux plats des Espagnols, le teint jaune des Portugais, les grands nez à la romaine des Italiens, l'air sérieux des Allemands; quels charmans composés que ces minois gallo, hispanico, lusitanico, italico germaniques! Que les Chinois sont sages! ils n'ont jamais voulu laisser transvaser aucun peuple étranger dans leur bouteille nationale! aussi ont-ils conservé sans altération leurs grands fronts majestueux, leurs petits yeux ovales, enfin tous leurs traits physionomiques primitifs; et ce qu'il y a de plus précieux, leurs lois et leurs moeurs.
Avant d'aborder la littérature des nègres, monseigneur Grégoire pense qu'il est nécessaire que nous apprenions «que (ch. I, p. 7) les Grecs avoient des esclaves nègres, qu'un de ces nègres étoit employé au service des bains; mais on ne sait pas son nom (ce qui eût été d'un très-grand intérêt), que Visconti et Caylus ont publié plusieurs figures de ces esclaves. Il nous apprend encore que les Hébreux achetoient des esclaves noirs et eunuques, malgré que la loi mosaïque défendît de mutiler les hommes. Ruit in vetitum nefas gens hebraïca.» Tout cela n'est pas encore bien concluant en faveur de la littérature nègre; mais ce qui le devient, c'est que Blumenbach, le plus fameux des crânomanes, et qui possède la plus belle collection de crânes humains, qui soit au monde, sans en excepter celle du docteur Gall (ch. I, pag. 11), «prétend que la figure du nègre se trouve dans la figure du sphinx; on peut s'en convaincre en examinant les sphinx dessinés dans Caylus, dans Norden, dans Niehbur et Cassas. Volney et Olivier, qui ont aussi examiné le sphinx sur les lieux, trouvent une ressemblance frappante avec le nègre; preuve incontestable que c'est à la race noire, aujourd'hui esclave, que nous devons les arts, les sciences, et jusqu'à l'art de la parole.» Salut aux premiers artistes, aux premiers savans qui montrèrent aux humains à attacher des idées aux différentes modifications de l'air: Ce n'est pas tout: sans doute c'est à eux
Que nous devons encor cet art ingénieux
De peindre la parole et de parler aux yeux.
Volney, qui nous assure que les nègres nous ont appris à parler, auroit bien dû nous dire quelle espèce de langue ils nous ont montrée; car les savans blancs qui ont succédé aux nègres, ne sont point d'accord entr'eux, quand il s'agit de décider quelle a été la langue primitive: mais pourquoi, les nègres qui sont si savans dans l'art de la parole, n'ont-ils pas montré à parler aux singes, qui, selon eux, sont des petits hommes fort adroits, mais fort paresseux, qui ne veulent pas apprendre à parler, pour qu'on ne les fasse pas travailler? Les nègres de Saint-Domingue, qui ont oublié leur langue primitive, disent, dans leur idiome d'aujourd'hui, singes, ça ptit monde, qui malouc trop, ïo pas vle palé, pou que ïo pa fair travail.
Mais, si les nègres ont été si savans, si grands littérateurs, comment ne reste-t-il d'eux aucun ouvrage qui puisse nous tirer de l'incertitude où nous sommes sur leur origine, sur la nature des grands événemens, qui, de la première nation du monde, en ont fait la dernière?
Déplorable Africain qu'as-tu fait de ta gloire?
. . . . . . . . . . . de ton antique grandeur,
il ne nous reste, hélas! que la triste mémoire!
Mais M. Grégoire vous console, en vous présageant les plus hautes destinées (chap. IX, pag. 283.) «Peut-être, dit-il un jour, cette vieille et orgueilleuse Europe deviendra une colonie de l'Amérique, et alors, et alors:» Quelle heureuse prédiction pour les Européens!
Ce qui prouve encore, selon M. Grégoire, que les sciences nous ont été transmises par les nègres, c'est que, même dans l'hypothèse où elles nous seroient venues de l'Inde, en Europe, elles auroient traversé l'Égypte; donc que les nègres ou Éthiopiens qui étoient alors en Égypte les ont prises au passage pour nous les transmettre; donc qu'ils ont été nos pères dans les sciences; cette vérité démontrée, augmente encore le désir que l'auteur a fait naître en nous d'admirer les chefs-d'oeuvres de ces illustres nègres; mais ce n'est pas encore le moment, Monseigneur Grégoire veut essayer de nous apprendre pourquoi ces Africains sont noirs; seroit-ce l'effet du climat? seroit-ce parce qu'ils ont la membrane réticulaire noire? seroit-ce, enfin, parce que la couleur primitive de l'homme étoit noire? adhuc sub judice lis est. La question n'est pas facile à résoudre. Le climat peut, sans doute, changer la couleur de la peau jusqu'à un certain point; mais les blancs qui sont établis en Afrique, de temps immémorial, y sont devenus bruns, basanés, mais, non pas noirs; leur membrane réticulaire est restée blanche, et les noirs, qui, depuis plusieurs générations, ont habité l'Europe, n'y sont pas devenus blancs, et leur membrane réticulaire est toujours restée la même, c'est-à-dire, très-noire. Monseigneur Grégoire ne pourroit-il pas nous dire s'il existe d'autre différence que la couleur entre la peau d'un nègre et celle d'un blanc? lui qui a vu, manié et observé tant de différentes peaux humaines, chez l'amateur Bonn; mais il ne les a observées qu'après avoir été tannées; il eût fallu aller chez l'écorcheur avant d'aller chez l'amateur..... Dans une peau tannée le système cutané est dénaturé, la membrane réticulaire, noire chez les nègres, et blanche chez les Européens, n'offre plus, dans l'une et dans l'autre peau, que les mêmes résultats. Il étoit donc indispensable, comme nous avons eu l'honneur de le dire à Monseigneur Grégoire, de se transporter chez l'écorcheur; là, il eût été possible d'observer les différens systèmes organiques qui composent le corps d'un blanc et celui d'un nègre; il eût pu voir si ces systèmes sont égaux en nombre, si l'harmonie, la concordance qui règnent entr'eux est la même; car c'est de cette harmonie, plus ou moins parfaite, que provient la différence qui existe entre les animaux; différence qui, selon le docteur Gall, est toujours annoncée par des disparités dans le» organes apparens. Mais si les peaux n'ont pu fournir à l'auteur Grégoire des caractères assez tranchans, que de bosses, ou protubérances, il a dû observer sur les crânes africains, chez Blumenbach, qui a la plus belle collection de crânes qui soit au monde (si, toutefois, on en excepte l'ancien charnier des Innocens)! Si chaque qualité morale que M. Grégoire donne aux nègres, et chaque défaut que leur attribue Valmont de Bomare (Voyez Valmont de Bomare, Dictionnaire d'histoire naturelle, article Nègre, édition in-4º.), ont leurs bosses particulières, quelques-uns de ces crânes ne doivent pas mal ressembler à une pomme de pin, d'autant qu'il y en a quelques-uns d'un peu pointus, à la Caraïbe; d'autres, plus arrondis, doivent avoir l'air de melons cantalous qui, comme on le sait, sont tout couverts de protubérances de différentes grosseurs. Les jardiniers nomment ces espèces de melons, melons de race, melons de qualité, sans doute par ce que toutes les bosses dont ils sont couverts sont des indices de qualités: ce n'est pas la seule analogie qui se trouve entre le règne animal et le végétal.
Pour mettre nos lecteurs à même de se faire une idée de la grande quantité de protubérances bonnes ou mauvaises qui doivent couvrir les crânes des nègres, nous allons exposer, sous leurs yeux, deux tableaux fortement coloriés par deux grands maîtres: l'évêque Grégoire et Valmont de Bomare. Ces deux tableaux, opposés dans leur intention, sont un exemple frappant que, s'il faut de l'élévation pour porter l'imagination d'un peintre à la hauteur de son sujet, l'exaltation le porte toujours au-delà des bornes de la vraisemblance.
L'abbé Grégoire, après avoir accordé aux nègres les qualités morales les plus éminentes, passe à l'énumération de leurs qualités physiques, d'après des voyageurs, impartiaux sans doute, et très dans le cas d'en juger. (Chap. I, p. 29.) Il parle de la beauté sans égale des négresses de Juida, d'après Bauman (surnommé, à Nantes, Baumenteur, et qui avoit épousé une princesse noire en Afrique, non pour sa beauté, mais pour favoriser sa traite d'esclaves.) Il cite les négresses Jaloses d'après Leydar et Lucas, comme des modèles de perfection pour les formes. Lobo vante par-dessus tout la beauté des Abyssins: Adanson, celle des négresses du Sénégal: Cossigny n'a rien vu de beau comme les nègres et négresses de Gorée. Ligon s'est extasié devant une négresse de S. Yago, qui réunissoit la beauté et la majesté, à un point, qu'il n'avoit jamais vu rien de comparable. Robert Chasle, dans le Voyage du Journal de l'amiral Duquesne, n'a rien vu de beau comme les négresses des îles du cap Vert. Legnat, Ulloa et Izert assurent qu'ils n'ont rien vu de comparable en beauté aux négresses de Batavia, de l'Amérique et de Guinée. Osez donc encore, fiers Européens, vous enorgueillir du caractère de beauté et de supériorité que vous supposez imprimé sur vos fronts blancs. Faites un voyage en Afrique et en Amérique, et vous direz, avec tous les voyageurs que nous venons de citer, en voyant une de ces beautés africaines sans pareille, nigra es, sed formosissima; ideo..... Voici donc la couleur noire reconnue pour type de la vraie beauté. Tremblez! tremblez! jeunes européennes, que la prédiction de l'abbé Grégoire ne s'accomplisse, et que l'Europe, devenant une colonie d'Afrique, les négresses, fières de leur beauté originale, ne viennent vous ravir vos jeunes époux et vos tendres amans, afin de régénérer la race blanche, et de lui rendre sa primitive beauté. Que je vous plains! génération présente! que je vous plains! vous ne verrez pas s'opérer cette heureuse métamorphose! M. Grégoire nous apprend qu'il faut cinq générations de race croisées, et qu'il se passera cent vingt-cinq ans avant l'époque heureuse où les enfans des Européens n'auront plus à rougir d'avoir reçu de leurs pères une preuve incontestable de leur dégénération, la couleur blanche; et alors, pour que l'harmonie soit complète, on fera venir de la Guinée, des chiens noirs, des chats noirs, des moutons noirs, des boeufs noirs, des chevaux noirs, des cochons noirs, des singes noirs, toutes sortes d'oiseaux noirs; surtout des cygnes, des perroquets noirs, auxquels on apprendra à dire aux perroquets verts des autres pays, fi donc! fi donc! vilain vert-vert. Nous oublions des poules noires; c'est, dit-on, un trésor qu'une poule noire? Heureuse Guinée, pays digne d'envie, où tous les animaux raisonnables et autres ont conservé sans tache la couleur primitive qu'ils tiennent immédiatement du Créateur.
Nous venons d'exposer le tableau de la race nègre par l'abbé Grégoire; nous allons exposer, ci-dessous son pendant, par Valmont de Bomare (article nègre, Dict. d'Hist. Nat., par Valmont de Bomare, édit. in-4º. t. V, p. 267).
«La laideur et l'irrégularité de la figure caractérisent l'extérieur du nègre; les négresses ont les reins écrasés et une croupe monstrueuse, ce qui donne à leur dos la forme d'une selle de cheval. Les vices les plus marqués semblent être l'apanage de cette race; la paresse, la perfidie, la vengeance, la cruauté, l'impudence, le vol, le mensonge, l'irréligion, le libertinage, la malpropreté et l'intempérance, semblent avoir étouffé chez eux tous les principes de la loi naturelle, et les remords de la conscience; les sentimens de compassion leur sont presque inconnus; seroient-ils un exemple terrible de la corruption de l'homme abandonné à lui-même? l'on peut, jusqu'à un certain point, regarder les races des nègres comme des nations barbares, dégénérées ou avilies: leurs usages sont quelquefois si bizarres, si extravagans, et si déraisonnables, que leur conduite, jointe à leur couleur, a fait douter, pendant long-temps, s'ils étoient véritablement des hommes issus du premier homme comme nous, tant leur férocité et leur animalité les fait, en certaines circonstances, ressembler aux bêtes les plus sauvages. On a vu de ces peuples se nourrir de leurs frères, et dévorer leurs propres enfans.» Quel contraste avec le tableau de l'abbé Grégoire! lequel des deux peintres a le plus approché de la vérité? ni l'un ni l'autre; chacun d'eux pouvoit s'appliquer le vers d'Horace:
Cur nescire, pudens prave, quam discere malo?
Le savant professeur de Goettingue, attribuant la couleur des nègres au climat, avance (chap. I, p. 16) que «dans la Guinée, les hommes, les chiens, les chevaux, les boeufs, les oiseaux, et surtout les gallinacées, sont de couleur noire». Cette assertion est absolument fausse, excepté pour les hommes, encore y a-t-il quelques familles d'hommes blancs établies, de temps immémorial en Guinée; quant aux quadrupèdes, il n'y en a pas plus de noirs et moins que dans d'autres climats, car les poils noirs exposés à l'ardeur du soleil, deviennent roux; cela arrive aux chevaux noirs qu'on transporte d'Europe dans les Antilles. Les oiseaux, en Guinée sont parés, comme dans presque tous les pays chauds, des couleurs les plus variées, les plus vives et les plus brillantes: on peut se convaincre de cette vérité, en observant la belle collection de perroquets et autres oiseaux d'Afrique, qui se trouve au muséum d'histoire naturelle à Paris. Il existe, à la vérité, parmi les gallinacées, une variété de poules dont la peau et les os sont noirs; mais la majeure partie des autres poules est semblable à celles d'Europe; nous pouvons le certifier, ayant observé les volailles que portoient les capitaines négriers qui venoient de Guinée. «La couleur noire étant donc, selon Knigt, l'attribut de la race primitive dans tous les animaux, il est évident, selon lui, que le nègre est le type original de l'espèce humaine.» Il y a un instant nous recherchions la cause de la couleur noire des nègres; il nous faut, actuellement chercher à découvrir comment des nègres ont produit des blancs:
Felix qui potuit rerum cognoscere causas!
quant à nous, nous baissons pavillon; la physiologie n'est pas de notre compétence. Salut à la race privilégiée, dont la couleur noire de la peau est une preuve incontestable de sa céleste origine; nous doutons, cependant que le docteur Knigt puisse parvenir à persuader à nos jolies européennes, qu'une peau noire et opaque doive l'emporter sur leur peau blanche et fine dont le tissu, délicat et transparent, laisse apercevoir les roses de la pudeur et ses nuances variées à l'infini, dont chacune, peignant un sentiment de l'ame, fait de leur physionomie un tableau magique et enchanteur.
Il nous semble qu'après avoir cité l'autorité de Knigt, l'auteur tient davantage à l'opinion de Buffon, de Camper, de Bonn, de Zimmermann, de Blumenbach, de Chardel, de Sommering, qui attribuent la couleur des nègres aux effets du climat. D'après cela, nous lui demanderons, si c'est dans le temps que les Africains étoient blancs, qu'ils étoient nos maîtres dans les sciences et dans les arts, ou si c'est depuis qu'ils sont devenus noirs? D'après Demanet et Imlay, les descendans des Portugais établis au Congo sont devenus noirs, mais ils ne nous disent pas si c'est l'effet du climat, ou de leurs alliances avec les négresses, (ce qui est plus que vraisemblable). Un Portugais aura épousé une Congo, il en sera provenu des mulâtres, qui, en se mariant à une négresse, auront fait des griffes, lesquels griffes, se mariant encore à une négresse, pour lors, les enfans, qu'on nomme marabous, sont si noirs qu'il faut être très-habitué dans le pays pour les distinguer d'avec les nègres: voilà comme les blancs peuvent devenir noirs, et les noirs, devenir blancs; en épousant des blanches, et en en faisant épouser à leurs enfans et petits-enfans.
Selon un auteur que cite M. Grégoire, il faut quatre mille ans pour qu'un nègre devienne blanc par l'effet du climat, et six cents ans seulement pour un Indien: ceci nous paroît un peu problématique. Quant à ce qu'il avance, que les changemens s'opèrent plus vite chez les nègres, dans l'état de domesticité, pour le moral, cela est vrai; mais pour la couleur, mieux un nègre est nourri et à l'aise, plus il est noir; s'il est maigre, ou qu'il ait du chagrin, ou qu'il ne se porte pas bien, il devient couleur de bistre; nous pensons aussi que c'est à un certain état de maladie qu'il faut attribuer la couleur, non pas noire, mais très-brune, que prend la peau de certaines femmes pendant leur grossesse, ce qu'on appelle le masque. Nous ne conviendrons pas, pour cela, avec Hunter, que la race blanche soit une race dégénérée, au moins quant à la couleur (chap. I. p. 20). Il est vrai, comme l'assure le chimiste Beddoés, «qu'on peut blanchir la peau d'un nègre, avec de l'acide muriatique oxigéné.» Il n'est pas même besoin de cette dernière condition, tous les acides concentrés ont la propriété, en se combinant avec les corps gras, d'en altérer la nature et la couleur; le feu et les caustiques produisent le même effet sur la peau des nègres: ainsi, la compagnie de blanchisseurs qu'un journaliste, grand ricaneur, (dit l'évêque Grégoire, chap. I, p. 20) veut envoyer en Afrique, pourra employer plus d'un moyen; mais, si la race blanche, comme le pensent quelques-uns des savans que cite M. Grégoire, est une race dégénérée, abatardie, ne désirera-t-elle pas aussi une compagnie de noircisseurs? Nous pensons que cette dernière compagnie sera beaucoup plus facile à compléter que la première. La chimie, pendant la révolution, a fait des découvertes si importantes pour les teintures en noir, qu'on ne sera embarrassé que du choix des sujets; quant au chef de la compagnie, cette place sera dévolue de droit à ****; personne ne peut ni ne veut la lui contester: nous revenons à Monseigneur Grégoire; nous lui ferons une question à laquelle il ne sera sans doute pas embarrassé de répondre. Adam et Eve étoient-ils noirs, ou blancs? L'opinion de l'auteur semble être prononcée en faveur de la couleur noire, puisqu'il cite l'autorité de Knight (chap. I, p. 16), qui pense que le nègre est le type original de l'espèce humaine. N'eût-il pas été plus exact de dire du genre humain, puisque l'auteur Grégoire ne suppose point d'espèce dans le genre homme? Plus loin, (chap. II, p. 18) il cite une autre autorité, T. Williams, qui dit que, pour amener les noirs à la couleur blanche, sans croisement de races, et, par la seule action du climat, il faut quatre mille ans. Nous ferons, d'après cela, une petite objection à M. Grégoire. A l'époque où vivoit Moïse, il n'y avoit que deux mille cinq cents ans que le monde étoit créé; Moïse et tous ceux qui existoient alors étoient donc nègres, et il n'a dû paroître d'hommes blancs que quinze cents ans après; Credat judaeus Appella! Dans un autre endroit (chap. I, p. 7), l'évêque Grégoire cite l'autorité de Jahn, qui, dans son Archéologie biblique, assure que les rois des Hébreux achetoient des autres nations, des eunuques, et spécialement des noirs: il y avoit donc, à l'époque de Moïse, des hommes blancs et des hommes noirs: qu'en conclure? Ou qu'il ne faut pas quatre mille ans, pour blanchir un nègre, ou que la race primitive n'étoit pas noire, ou qu'il s'est passé quatre mille ans avant le déluge, ce qui feroit un anachronisme dans notre cosmogonie chrétienne. Fiat lux.
L'évêque Grégoire cite (chap. I, p. 26) Sommering, qui, tout en disant: «qu'il n'ose décider si la race primitive de l'homme, en quelque coin de la terre que l'on place son berceau, s'est perfectionnée en Europe, ou altérée en Nigritie, affirme que pour la force et l'adresse, la conformation des nègres est aussi accomplie et, peut-être plus que celle des Européens». Voyez le Dictionnaire d'Histoire naturelle de Valmont de Bomare, article Nègre, édition in-quarto, t. V. p. 257, il vous donnera une idée de la belle conformation et des qualités éminentes des nègres d'Afrique. L'évêque Grégoire ne connoît pas sans doute cet ouvrage; il n'eût pas oublié de donner au tableau qu'il a fait des colons, un dernier coup de pinceau d'après le grand maître Valmont de Bomare; «Les colons font (selon lui) deux où trois fois par an des visites dans les hôpitaux de leurs habitations, (des hôpitaux dans les habitations? les négrophiles pourront-ils le croire?) N'allez pas vous imaginer, (dit Bomare) que ce soit pour y porter les secours que l'humanité et même leur intérêt exigeroient; ces barbares y vont avec des pistolets, et tuent tous les nègres qui, par vieillesse ou par des infirmités incurables, sont hors d'état de rendre service à l'habitation.» Eh bien, Monseigneur! cela vaut bien les nègres cuisiniers jetés dans des fours, pour avoir manqué des plats de pâtisserie? Admirez donc notre bonhomie et notre bonne-foi, vous aviez oublié, dans notre examen général, ce gros péché, nous le rappelons nous-mêmes à votre souvenir, mais aussi, nous espérons que d'après cette confession sincère; nous obtiendrons de Votre Excellence, indulgence plénière et absolution finale. Nous venons de faire un grand pas vers le ciel, s'il est vrai, comme on nous l'a appris dans notre jeunesse, qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, qu'à un chameau de passer par le chas d'une aiguille. Nous avons le plus grand espoir, il ne reste plus rien à la majeure partie de nous, et les François nos frères, ont trop à coeur notre salut, pour chercher à nous remettre dans la voie de la perdition.
Revenons à votre peuple chéri. «Les nègres, dites vous, sont plus forts et plus adroits que les Européens;» nous vous l'accorderons, si cela vous fait plaisir; mais le boeuf est aussi plus fort que l'homme, et le singe est plus adroit; qu'en concluerez-vous? «Les nègres, dites-vous, surpassent les blancs par la finesse exquise de leurs sens, surtout de l'odorat (chap. I, pag. 16).» Prenez bien garde, Monseigneur, les animaux les plus sauvages, les plus éloignés de l'état de domesticité, sont ceux que la nature favorise le plus du côté de la finesse des sens; il semble que cette bonne mère, aimant également tous ses enfans, a voulu dédommager, sous quelques rapports, ceux auxquels elle a moins accordé sous d'autres. Vous citez les nègres marrons de la Jamaïque, «comme des êtres doués d'un sens exquis, avec une taille droite, une contenance fière, et une vigueur qui indiquent leur supériorité.» Nous oserons vous dire, Monseigneur, que vous les avez vus, avec votre lorgnette de cabinet, dont les verres, en grossissant trop les objets, les dénaturent totalement.
Le tableau que nous allons faire de ces nègres est d'après nature; nous l'avons fait sur les lieux même, dans les montagnes Bleues de la Jamaïque.
Qu'on se figure des hommes, dont les corps plus jaunes que noirs, décharnés, et couverts à demi de haillons, que les nègres esclaves n'oseroient pas porter, laissant leurs femmes, leurs enfans, leurs vieillards dans la misère la plus crapuleuse, parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour cultiver les terres que le gouvernement anglois leur a accordées. Ils sont avilis, au point de livrer, pour quelques pièces de monnoie, les nègres esclaves qui viennent chez eux se réfugier, ou qu'ils vont chercher dans les bois, quand les Colons les font avertir qu'un d'eux a déserté. Leur moyen de vivre consiste principalement dans la chasse et la pêche; mais quand par le mauvais temps, cette ressource leur manque, ils sont forcés de descendre dans les plaines, se louer à la journée parmi les esclaves. Voilà les hommes dont vous préconisez la supériorité. Nous les avons vus dans leurs huttes, car ils n'ont pas eu même le courage ni l'adresse de se construire des logemens qui méritent le nom de cases. «Pourrez-vous nous dire que ces nègres de la Montagne Bleue ne peuvent s'organiser politiquement, parce que les arts de la paix ne peuvent être cultivés par une troupe fugitive, toujours cachée dans les forêts, toujours occupée à se nourrir et à se défendre contre ses oppresseurs?» Mais les nègres dont nous parlons ne sont point dans cette hypothèse; le gouvernement est en pleine paix avec eux; ils ont des terres qu'ils peuvent cultiver tranquillement; ils n'ont pas besoin de se défendre contre des oppresseurs; ils sont indépendans: pourquoi donc ne s'organisent-ils pas en corps politique, et ne sont-ils qu'une association de lâches, de paresseux, qui deviendroit très-dangereuse, si la crapule honteuse dans laquelle ils vivent, n'étoient un obstacle à l'augmentation de leur population. Vous donnez encore pour preuve de leur supériorité, la manière dont ils communiquent entr'eux à des distances considérables par le moyen d'une corne. A vous entendre, nos télégraphes ne sont rien en comparaison. Vous ignorez que dans la partie de S. Domingue, qui a été cédée à la France par les Espagnols, tous les pâtres font revenir leurs troupeaux par le moyen d'une corne, ou plus souvent un coquillage qu'on nomme lomby, dans lequel, en produisant certains sons plus ou moins forts, ou différemment modifiés, ils appellent ou leurs cochons, ou leurs chevaux, ou leurs troupeaux de chèvres, et jamais un troupeau ne vient dans la place d'un autre; d'après cela, quelle merveille que les nègres soient convenus entr'eux, que lorsqu'ils sonneront d'une certaine manière, ce sera tel ou tel nègre qu'ils voudront désigner. D'après ce que nous venons de vous dire des nègres de la Montagne Bleue de la Jamaïque, ne les citez pas comme exemple de la prééminence de la race nègre sur la blanche; vous prêteriez à rire à tous ceux qui les connoissent. Nous ne disconviendrons cependant pas qu'il n'y ait des nègres (non parmi eux) qui ont des qualités morales; nous dirons même, à la honte de la couleur blanche, que si beaucoup de nègres de S. Domingue n'avoient pas été meilleurs que les blancs de France, qui sont venus les révolutionner, il n'eût pas resté un seul colon pour répondre aux calomnies des négrophiles, et confondre leurs raisonnemens absurdes. Un savant respectable, que vous avez désigné par son nom, pour avoir méconnu des qualités morales dans les nègres, et les avoir assimilés aux singes, nous autorise à vous dire que vous avez dénaturé totalement ce qu'il a dit des nègres. Mais, tout en convenant qu'ils sont des hommes, nous ne conviendrons pas pour cela qu'ils soient des hommes comme nous. La civilisation et l'éducation, qui en est la suite, ont mis entr'eux et nous, une distance immense, qu'ils ne pourront franchir que peu à peu, par la succession des temps, et des circonstances favorables, qui, malheureusement pour eux, sont bien plus éloignés que vous le pensez.