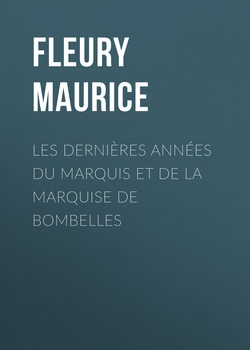Читать книгу Les Dernières Années du Marquis et de la Marquise de Bombelles - Fleury Maurice - Страница 2
CHAPITRE II
ОглавлениеContinuation du Journal. – La députation de Bretagne et le Roi. – Les ambassadeurs de Tippoo-Saheb à Trianon. – Chute de Loménie de Brienne. – Facéties des Parisiens à ce sujet. – Les dessous de la disgrâce. – La duchesse de Polignac. – Disgrâce de Lamoignon. – Emeute à ce sujet. – Le Parlement et la Cour. – Prodrômes d'événements graves. – Tristesse de Louis XVI.
Le Journal continue, entremêlant assez agréablement pour le lecteur faits politiques et nouvelles de Cour.
Une députation de Bretagne est venue réclamer la liberté de ceux qui les avaient précédés et en même temps le rétablissement du Parlement breton. Le Roi a reçu les députés des commissions intermédiaires et leur a fait une réponse «qui, souligne Bombelles, n'est approuvée que par les coopérateurs de la besogne présente».
«J'ai lu le mémoire que vous m'avez remis; j'avais lu ceux qui l'avaient précédé; vous n'auriez pas dû me les rappeler. J'écouterai toujours les représentations qui me seront faites dans les formes prescrites.
«L'assemblée qui a député douze gentilshommes n'était point autorisée; aucune permission ne m'avait été demandée. Ils ont eux-mêmes convoqué à Paris la plus irrégulière des assemblées: j'ai dû les punir. Le moyen de mériter ma clémence est de ne pas perpétuer en Bretagne, par de pareilles assemblées, la cause de mon mécontentement. Les commissions qui vous ont chargés de me demander le rétablissement de mon Parlement de Bretagne ne pouvaient pas prévoir la conduite qu'il vient de tenir. Elles n'auraient pas sollicité pour lui une marque de confiance lorsqu'il me porte à lui en donner de mon animadversion.
«Mais ces punitions personnelles que le bon ordre et le maintien de mon autorité exigent, n'altèrent en rien mon affection pour la province de Bretagne. Vos États seront assemblés dans le mois d'octobre. C'est par eux que doit me parvenir le vœu de la province. J'entendrai leur représentation et j'y aurai l'égard qu'elles pourront mériter.
«Vos privilèges seront conservés. En me témoignant fidélité et soumission, on peut tout espérer de ma bonté, et le plus grand tort que mes sujets puissent avoir auprès de moi, c'est de me forcer à des actes de rigueur et de sévérité; mon intention est que vous retourniez demain à vos fonctions.»
Laissons les députés de Bretagne préparer leur troisième mémoire. Refusons-nous à de trop longues considérations sur ces résistances des assemblées provinciales désireuses de reprendre leur ancienne influence; par prudence, ne prenons pas parti dans un différend où le Roi défend son pouvoir absolu – ce qui est son droit – et où les représentants des classes privilégiées défendent en même temps leurs privilèges et les revendications du peuple, – toutes les classes alors s'unissant contre le Gouvernement; – notons seulement ces murmures et ces revendications plus ou moins âpres suivant les provinces, étonnons-nous moins, en résumé, en écoutant les bruits de 1788, des clameurs que nous entendrons l'année suivante.
Le marquis continue à marquer sur son Journal les visites intéressantes qu'il ne cesse de faire. Il n'a pas oublié la princesse de Vaudémont36: «Je l'ai trouvée non dans un boudoir de jolie femme, mais dans un cabinet de livres; elle a su mettre à profit de longues et extraordinaires maladies pour se donner par une belle instruction un genre de ressources qui ne nous manquent jamais.»
Chez la duchesse de la Vauguyon, il a conduit le 3 août le chevalier d'Alméida et un autre Portugais de marque, don Fernando de Lima. «Sa fille mariée au petit prince de Listenois, beaucoup plus jeune qu'elle, est jolie, agréable, et moins gesticulante que sa mère dont elle a la charmante physionomie et la belle taille. J'ai renouvelé connaissance avec le prince de Bauffremont qui, autrefois connu sous le nom de chevalier de Listenois, faisait les délices de la Cour de Lunéville, du temps où le bon, l'aimable Roi Stanislas fixait autour de lui tout ce qui ne se trouve plus auprès des plus grands monarques, c'est-à-dire nombre de gens de mérite et beaucoup d'un bon esprit37.»
Tout ce qui touche le baron de Breteuil a le don d'inspirer notre narrateur. Aussi s'étend-il volontiers sur les marches et contre-marches de son protecteur. Nous n'ignorons rien de ses projets comme de ses faits et gestes. Avant de partir pour Dangu il a mis de l'ordre dans sa maison, réformé les dépenses extraordinaires. Il n'a gardé positivement que les gens qu'il lui fallait, mais il s'est occupé en père de famille à placer tous les autres. Son chef de cuisine entrait dans son premier plan de réforme. Il avait été sur le point de le renvoyer à Vienne à cause de son excessive cherté. «Ce cuisinier s'était corrigé quant à la partie économique, et lorsque M. le baron a voulu se séparer de lui, il a dit à son maître: «C'est chez vous, c'est par vous que j'ai gagné tout ce que je possède, je pourrais aujourd'hui vous servir pour rien, souffrez que je ne vous quitte pas, je connais vos goûts. Je les étudierai de plus en plus, et je vous serai, par mes soins, moins dispendieux que quiconque dirigerait votre cuisine.» M. le baron s'est trouvé sans défense contre ce langage touchant, et le sieur Chandelier, car il mérite qu'on le nomme, continuera à bien nourrir son maître et ses amis.» Voilà donc un cuisinier rare, qui, grâce à Bombelles, passe à la postérité… au moment où par un arrêt du Conseil le Roi suspendait la Cour plénière et convoquait les États généraux pour le 1er mai 178938.
Voici qu'un petit événement va distraire la Cour et la Ville et dissiper un moment les nuages qui assombrissent l'horizon: l'arrivée à Paris des ambassadeurs de Tippoo-Saheb, sultan Bahadour de Mysore, qui venaient réclamer notre appui contre les Anglais.
A la suite d'un long voyage coupé d'arrêts à l'Ile de France, au cap de Bonne-Espérance, à Malaga, ils sont débarqués à Toulon le 8 juillet. Après avoir excité la curiosité sur tout le parcours, à Marseille, à Lyon, à Fontainebleau, ils ont été magnifiquement reçus à Paris. On les attend à Versailles le 8 août, les dames de la Cour se sont mises en frais particuliers, la sage Mme de Bombelles a commandé à Mlle Bertin un «pouf» de haut goût, le marquis s'est rendu lui-même chez la fameuse modiste pour lui recommander d'être exacte à livrer la coiffure choisie…
«Tout Versailles a été occupé aujourd'hui, écrit M. de Bombelles le 9, de l'arrivée des ambassadeurs indiens à Trianon39, et un grand nombre de Parisiens sont arrivés pour voir demain l'audience qui sera donnée à ces ambassadeurs.
«Ils se sont fait longtemps attendre, ce qui a quelque peu impatienté les courtisans. Aucune recherche n'avait été négligée pour leur rendre encore plus agréable la plus belle, la plus magnifique des habitations. La grande salle était ornée d'un superbe tapis de la Savonnerie, de forme circulaire, autour duquel étaient des coussins de velours cramoisi avec galons, glands, riches franges d'or.»
Leurs Excellences ont été reçues dans cette espèce de divan. Une foule énorme demandait à entrer, et il fallut toute la fermeté des suisses du Roi pour maintenir l'ordre. Les officiers des Gardes Françaises, de garde à Versailles, demandèrent à voir les ambassadeurs. Après eux, M. de Bombelles fit entrer sa femme et ses enfants.
«Le troisième des ambassadeurs, nommé Mouchan Osman-Khan, a été fort aimable pour cette petite famille. Ce négociateur longtemps employé par Heydin Aly et, depuis, par Tippoo-Saheb, se distingue en toutes choses de ses collègues. Les deux autres, et particulièrement Mohamed Dervich Khan sont ombrageux, jaloux et mécontents. Ils ont tout fait changer dans les appartements qui leur étaient préparés et n'ont montré toute la soirée que de l'humeur. Non seulement ils n'ont remercié personne des soins pris pour les établir comme des souverains, mais encore ils n'ont parlé à qui que ce soit des remerciements dus à la bonté du Roi. Le fait est que ces gens sont gâtés depuis qu'ils ont perdu de vue leur pays, et que, de mieux en mieux; on les traite trop bien.»
Ils se plaignent de la nourriture aussi bien que du logement, et pourtant on avait respecté leurs rites apportant poissons et autres animaux tout vivants. Les officiers de la maison du roi finirent par les laisser grogner à leur aise, et ce n'a été que de ce moment qu'ils ont paru écouter les avis d'Osman Khan en devenant moins difficiles à contenter.
Le 10, les trois ambassadeurs sont partis à onze heures du matin de Trianon. Ils sont entrés dans la grande cour du palais de Versailles dans trois carrosses attelés chacun de six chevaux et à la livrée du Roi, ils ont passé entre deux haies de gardes formées des Gardes françaises et des Suisses, les tambours battant l'appel.
«Descendus de leurs voitures dans la cour des Princes, le sieur Delaunay, commissaire de la Marine, les a conduits par l'escalier des Princes et la salle des Cent Suisses qui étaient en haie, la hallebarde à la main, dans un appartement particulier, pour y attendre le moment où le roi serait prêt à les recevoir.»
L'audience qui devait avoir lieu à midi se trouva retardée par un caprice des ambassadeurs. Ils avaient émis la prétention d'être assis; il fallut un certain temps pour les faire renoncer à leur ridicule demande et leur citer tous les exemples d'audience solennelle, «où jamais les représentants de quelque souverain que ce fût n'avaient pu obtenir une distinction qui n'était pas accordée aux frères du Roi.
D'abord la Reine est entrée, arrivant par les appartements attenant au salon d'Hercule et a été prendre place longtemps avant que le Roi parût.
Il était midi trois quarts lorsque Sa Majesté, accompagnée de Monsieur, de Mgr le comte d'Artois, des ducs d'Angoulême, de Bourbon, d'Enghien, des princes de Condé et de Conti, s'est rendue dans la salle d'audience. Le trône qui sert à la cérémonie du Saint-Esprit était placé sur une estrade élevée de huit marches et adossé à la cheminée. L'on avait construit deux tribunes dans l'embrasure de la porte qui donne dans le salon de la chapelle et dans la fausse porte correspondante. Le reste du salon était garni de gradins pour les ambassadeurs et les seigneurs et les dames de la Cour. Ceux-là et celles-ci étaient placés non suivant leur rang, mais au fur et à mesure qu'ils arrivaient.»
«Un hasard heureux, continue Bombelles, avait placé le plus en vue les plus jeunes et les plus jolies femmes; un hasard plus heureux encore m'ayant fait rencontrer le duc de Polignac et ses enfants, il m'a permis de joindre les miens aux siens, et nous avons attrapé une embrasure de fenêtre où le petit peuple a vu aussi bien que possible.»
Dans la tribune de gauche se tient la Reine avec Madame, Madame fille du Roi et le duc de Normandie; dans la tribune de droite se placent la comtesse d'Artois, Madame Élisabeth et le duc de Berry. Les princes à droite et à gauche gardaient les avenues de ces tribunes resplendissantes de brocarts et de draperies d'or. Grands officiers présents et gentilshommes de la Chambre se tenaient derrière. Entre les cinq premières et les trois dernières marches étaient les ministres, les secrétaires d'État et le contrôleur général, M. Lambert.
Cependant l'archevêque de Sens avait monté d'un pas trop délibéré toutes les marches de l'estrade. Le maréchal de Duras dut le prier de redescendre à sa place en qualité de ministre, «parce que sa primatie ne lui vaut rien dans les cérémonies de la Cour, fût-il même premier ministre, au lieu de n'être que ministre principal».
Le Roi est monté sur son trône et donne l'ordre d'aller chercher les ambassadeurs indiens. Ceux-ci ont traversé tous les grands appartements remplis de spectateurs, entre deux haies de gardes du Corps. Les ambassadeurs s'avançaient sur la même ligne.
Il ne nous est fait grâce d'aucun détail.
«Les ambassadeurs sont conduits au salon d'Hercule. Alors Mohamed-Dervich-Khan a remis au Roi leur lettre de créance et tous les trois ont présenté à Sa Majesté, sur des mouchoirs, vingt et une pièces d'or, ce qui est, dans l'usage de l'Inde, l'hommage du plus profond respect.
«Sa Majesté a accepté une de ces pièces de chacun d'eux; ensuite Mohamed-Dervich-Khan a prononcé une harangue qui a été traduite et répétée par M. Rufin. J'étais à portée de l'entendre, si M. Rufin ne l'eût prononcée qu'à basse voix, parce qu'elle renfermait plusieurs phrases peu obligeantes pour les Anglais, et que les ambassadeurs des cours d'Europe avaient quitté leur place pour tâcher d'attraper le sens de la harangue de leurs confrères indiens.
«Après la réponse du Roi, les ambassadeurs firent leurs trois révérences, ils se sont arrêtés et demandèrent la permission de jouir un instant du spectacle imposant qu'offrait le salon d'Hercule. Enfin, en se retirant, ils ont salué une quatrième fois le Roi, qui a poussé la bonté jusqu'à permettre que la suite des ambassadeurs entrât dans la salle d'audience.»
Les ambassadeurs pensèrent-ils à saluer la Reine? Plusieurs personnes ont cru que leur quatrième salut avait été pour elle. Bombelles n'en est pas bien sûr. «Ces personnages fêtés outre mesure» ne lui disent rien qui vaille.
Au même moment une autre solennité se préparait à Suresnes où Mme la comtesse d'Artois devait couronner celle de trois rosières qui obtiendrait le premier prix de bonne conduite.
M. de Bombelles a été prié de se mettre aux ordres de la princesse qui est arrivée en grand cortège à Suresnes; il se trouve dans la seconde voiture avec Mmes de Montmorin, de Caulaincourt, de Montvel et de Coetlogon.
MM. de Vintimille, de Vérac et de Chabrillan étant absents, c'est le marquis qui donne la main à Mme la comtesse d'Artois pour la conduire de sa voiture à la tribune qui avait été ornée pour elle. «L'abbé Fauchet a fait un discours ampoulé pour célébrer la fête de la rosière. La plus laide des trois a obtenu la couronne… Nous mourrions de chaleur à l'église; un froid humide nous attendait dans le bois et, revenu à Saint-Cloud, j'étais transi…»
L'archevêque de Sens tient à faire acte de principal ministre et a convié, le 11, tout ce qui marque à Versailles à un grand festin donné en l'honneur des ambassadeurs indiens. «Rien n'était magnifique», remarque Bombelles, qui compare avec les dîners d'apparat offerts par le baron de Breteuil aux États de Languedoc et de Bretagne. Il étalait un tout autre luxe quoique tous ses appointements et les grâces du Roi réunis à sa fortune personnelle formassent un revenu bien inférieur à celui qui n'a jamais suffi à l'archevêque. «Ses gens sont mesquinement vêtus, ses chevaux sont laids, ses voitures vilaines; sa vaisselle est médiocre et sa table est très ordinairement servie. Il est bien rare qu'un homme qui ne se fait pas honneur de ce qu'il a et qui gère mal ses finances administre bien celles d'un grand État.»
En attendant de dire adieu définitif au funeste ministre dont les jours sont comptés, M. de Bombelles fait la courte oraison funèbre du maréchal de Richelieu qui vient de mourir. «Il était tout à fait tombé en enfance et vient de terminer une vie dont les circonstances variées, mais marquantes, pourront fournir une ample matière à l'éloge. Au milieu de bien des vices, il montra des talents de plus d'un genre; sa mère et celle de Voltaire eurent toutes deux le même amant: Voltaire et le maréchal naquirent de ces feux illicites. Mon frère aîné pensait avec un certain plaisir que sa mère moins fidèle et moins chaste que la mienne40 lui avait donné le jour dans le temps où le duc de Richelieu donnait du souci à mon père.»
Tandis que la marquise est de service auprès de Madame Élisabeth, M. de Bombelles est allé passer quelques jours à Dangu chez le baron de Breteuil. C'est là qu'entre autres nouvelles il apprend que la gêne sans cesse augmentante du Trésor a amené un arrêt du Conseil aux termes duquel les paiements de l'État étaient suspendus pendant six semaines et devaient être ensuite effectués partie en espèces, partie en papier, jusqu'au 31 décembre. L'édit41 ne s'explique pas sur la manière dont le traitement des ambassadeurs et ministres du roi sera payé. «Mais il y a bien à craindre que nous nous ressentions de la gêne générale et d'une gêne qui n'est que la suite de mauvaises opérations. Bien des gens crieront: «Tolle», je me rappellerai que le baron de Bezenval était à sa quinzième année d'ambassade à Varsovie sans avoir vu un denier de ses appointements. Je souffrirai sans me plaindre, je me restreindrai sur tout ce qui sera possible, et continuant à servir mon maître et l'État avec zèle, je ne désespérerai pas de survivre à des circonstances plus heureuses, et je ne croirai pas le bonheur de mes enfants perdu, quoique les moyens de le consolider semblent m'échapper au moment où je croyais les atteindre.»
A côté des ennuis privés, le cours forcé du papier est une calamité publique. «Si Mgr l'archevêque de Sens42 en est la cause par une suite de fausses mesures, il doit intérieurement se faire de cruels reproches; s'il croit au contraire qu'il n'a obéi qu'à des circonstances trop impérieuses pour les dominer il faut le plaindre et de l'événement et de l'erreur où il a été sur ses talents lorsqu'il s'est présenté comme le restaurateur des finances et d'une meilleure administration en France.» Bombelles est modéré dans ses appréciations; le jour approche où la chute de Loménie de Brienne serait saluée par le public comme une délivrance.
Le 25, la marquise d'Harcourt fait connaître de grand matin à ses amis de Dangu, «une grande nouvelle», celle qui a fait crier des «Vive le Roi» dans toutes les places, les rues et les carrefours, celle qui rend le Parisien ivre de joie, et qu'est-ce donc? «L'archevêque de Sens est renvoyé, M. Necker est rappelé, les banquiers de Paris ont, dit-on, fait sur-le-champ pour cent vingt millions de soumission.»
«Ce renvoi humiliant par la joie publique dont il est le signal prouve que la Reine, au moins en ce moment, n'a pas abandonné son protégé, et que, si le cri public l'a forcée de s'éloigner des affaires, il emportera dans sa retraite des preuves non équivoques de sa bienveillance43.» On a écrit à Rome pour faire au plus tôt un cardinal de cet archevêque44.
A son retour à Dangu, après une course à Rouen et aux environs, le marquis a trouvé des lettres donnant des nouvelles inquiétantes de ses enfants dont deux sont atteints de fièvre putride. Le 2 septembre, il est à Paris, trouve les deux malades hors de danger, et son Journal, un instant assombri par ses alarmes paternelles, se reprend à sourire pour conter les plaisanteries auxquelles s'est livrée la population parisienne. «Des mannequins représentant le principal ministre ont été brûlés en différentes places publiques. La procédure, l'instruction du procès, la rédaction de la sentence sont au dire des gens de loi des chefs-d'œuvre, et le libellé de ces tristes plaisanteries prouvent qu'elles ne sont pas uniquement imaginées par la canaille de Paris. La guérite de la sentinelle du guet qui garde ordinairement la statue de Henri IV a été brûlée; les cochers et les domestiques des voitures qui passaient devant étaient obligés de saluer cette statue.»
Le chevalier du Guet ayant voulu dissiper la foule, il y eut résistance de la foule, on attacha des pétards à la queue des chevaux; de là des accidents et un grand désordre. Les hommes du guet furent rossés, on incrimina leur chef d'avoir voulu corriger sérieusement des folies populaires, il fallut s'interposer militairement et donner des lettres de commandement au maréchal de Biron, mettre garnison d'invalides dans les hôtels de Brienne et de Lamoignon.
«Au milieu de l'ivresse et de la rage publique, il s'est passé de ces choses gaies qui appartiennent exclusivement à cette nation. On a fait une robe à l'archevêque pour le conduire au bûcher, dont les trois cinquièmes étaient en satin et les deux autres en papier. Un moment avant l'exécution en effigie, on a arrêté un ecclésiastique pour exhorter le patient. L'abbé s'est approché de la figure, a feint de lui parler à l'oreille et a dit ensuite à la multitude: «Vous pouvez faire de Monsieur ce que vous voudrez, il est très bien préparé et très bien résigné pour la circonstance. On a fort applaudi à la présence d'esprit du prétendu confesseur… Il y a une lettre du Pape au Roi, une autre de M. le prince de Guéménée à Sa Majesté, enfin une foule de pamphlets trouvés charmants et qui ne sont que diffus et charmants.»
Les ambassadeurs indiens s'occupèrent aussi, à leur façon, de la disgrâce de Brienne. Comme ils sortaient de l'Académie française, qui s'était crue obligée de donner une séance en leur honneur, on leur apprit la chute du grand vizir. Grimm assure qu'ils demandèrent avec beaucoup d'empressement s'ils ne pourraient pas voir sa tête (souvenir du système de leur gouvernement envers les ministres en disgrâce). «Oh! non, a répondu quelqu'un, car il n'en avait pas.» Et Grimm ajoute, non sans raison: «Quel est l'événement de notre histoire qui ne soit marqué par quelque calembour plus ou moins ridicule, plus ou moins plaisant?» Qu'aurait-il dit s'il avait vécu de nos jours?
Enfin, l'archevêque de Sens est parti le 3 septembre, mais il n'a pas osé traverser Paris. M. de Montmorin «s'est chargé de procurer des chevaux de louage qui ont conduit, avec mystère, de Jardi à la Croix de Berny, le prélat que la populace guettait. Il se propose d'aller dans peu à Pise, où peut-être il trouvera M. de Calonne, et alors ils riront, en se regardant, de la folie publique et de la leur. Peut-être M. de Loménie espère-t-il fortifier en Italie son excessive ambition et la nourrir de ces maximes insidieuses qui ramenèrent autrefois au timon des affaires le banni Mazarin.»
Le garde des sceaux, Lamoignon, se maintiendra-t-il au pouvoir? M. Foulon remplacera-t-il le comte de Brienne au département de la Guerre? Voilà les questions que se pose Bombelles, occupé d'ailleurs surtout comme tout le monde, de l'installation de Necker, du bien qu'il est disposé à faire, s'il lui est possible d'endiguer le torrent. La confiance du public en «cette idole de la France» est bien minime. Pourra-t-elle s'accroître?
Un gros événement, comme la chute de Brienne, comporte des dessous qu'à côté des données générales connues de tous il peut être intéressant d'apprendre. Bombelles a partagé la joie du public; devant le renvoi de l'archevêque, il a tenu à s'informer lui-même des causes finales qui avaient fait consentir la Reine à sacrifier un ministre, que, jusque-là, elle avait défendu envers et contre tout. Auprès de qui s'informer, si ce n'est auprès de la duchesse de Polignac, dont la main pouvait se deviner dans toute cette affaire.
«Après avoir dîné avec ma femme et mes enfants, j'ai mené mon aîné dans le parc de Versailles et, pendant qu'il s'y promenait avec son précepteur, j'ai été causer chez Mme la duchesse de Polignac, car elle s'est acquise de nouveaux droits à l'estime des honnêtes gens par la conduite qu'elle tient en ce moment. C'est elle qui s'est courageusement chargée d'ouvrir les yeux de la Reine sur le danger qu'il y avait pour elle à conserver en place Mgr l'Archevêque de Sens, Mme de Polignac a dit à Sa Majesté que ce n'était point d'une manière adroite et obscure qu'elle désirait le renvoi du principal ministre et qu'elle ne voulait point élever sur ses débris aucun de ses amis45, mais que ce qu'elle désirait uniquement c'était de débarrasser la Cour et la nation d'un homme qui, n'ayant jamais eu de plan arrêté, marchait à tâtons et au jour la journée depuis plus de six mois.
La Reine n'a pas su mauvais gré à Mme de Polignac de sa démarche; mais, en cédant à l'évidence des plus sages et des plus fortes observations il en a bien coûté à Sa Majesté46, pour vaincre l'ascendant que l'archevêque avait pris sur elle. En même temps que Mme de Polignac agissait, M. le comte d'Artois portait les grands coups chez le Roi47. Ce jeune prince gagne sensiblement sur lui-même et marche à grands pas vers les plus belles et les plus solides qualités. Il avait déjà toutes les brillantes. J'ai eu l'honneur de causer avec lui près d'une heure sur nos affaires au dehors; je ne lui ai pas dissimulé combien il serait nécessaire que nous suivissions d'autres maximes que celles qui nous gouvernent en ce moment.
M. le comte d'Artois est entré dans des détails qui font honneur à des connaissances que je ne lui supposais pas. Il m'a parlé de la position où se trouvaient la Pologne, la Russie et la Suède comme je voudrais qu'on en entretînt le Roi dans les débats de son conseil. Mais nos plaies intérieures comme effectivement les plus sensibles sont les seules dont nous sentions la douleur. M. Necker a eu une longue conférence avec le Roi avant le Conseil d'État: il veut le retour des Parlements à leurs fonctions.»
Qu'il y ait des mécontents dans la coterie de l'archevêque cela se conçoit. M. de Brienne jouit de son reste en disant que tout est perdu si on sape la besogne de son frère. Et tout fait espérer «qu'elle sera sapée cette mauvaise besogne, et l'on n'en laissera pas vestige malgré tout ce que fait la Reine pour donner encore quelque cours aux éléments de l'archevêque de Sens et pour soumettre notre administration aux fatales lubies d'un abbé de Vermond, ce prêtre audacieux et enragé de se voir arracher les rênes du Gouvernement qu'il tenait tout entières, tandis que le principal ministre siégeait à Versailles».
Bombelles n'est guère tendre pour l'influent Vermond. «Dans son courroux, ajoute-t-il, l'abbé n'épargne dans ses invectives ni le baron de Breteuil, ni Mme de Polignac, ni même la Reine. Il dit que Sa Majesté ne mérite plus d'être servie depuis qu'elle a souffert l'éloignement de l'archevêque. Cependant il continue à être exclusivement l'homme de confiance et le conseil de notre souverain.»
La question Lamoignon est plus que jamais à l'ordre du jour. On a répandu le bruit que le Garde des Sceaux était soutenu en même temps par les frères du Roi et par la duchesse de Polignac.
De Monsieur, on ne saurait guère parler, «car, opine très justement Bombelles, sa conduite variante (sic) ne permet pas de savoir bien au juste qui il protège, qui il abandonne; presqu'opposé au parti de la Cour, lors de l'Assemblée des Notables, ce prince est aujourd'hui fort bien avec la Reine et le Roi…» En apparence, devrait-on ajouter.
Quant au comte d'Artois, le marquis continue à être très bien disposé en sa faveur: «Moins entortillé dans sa marche, toujours bon et loyal Français, il n'applaudit pas à tous les partis dominants. Il aime son souverain, son pays, ses amis, sans tromper personne. Non seulement il n'a pas laissé M. de Lamoignon dans le doute de ses sentiments, mais il l'a même envoyé chercher pour lui dire que, vu la nécessité de rappeler les Parlements, il lui conseillait de donner sa démission et de ne pas s'exposer à une nouvelle explosion de la haine des Parlements. Le Garde des Sceaux lui a répondu: «Monseigneur va un peu vite en besogne», et M. le comte d'Artois lui a répliqué: «Que ce n'était pas son avis, qu'au reste il avait cru devoir lui dire franchement ce qu'il avait dit au Roi et ce qu'il lui répéterait si l'occasion s'en présentait.»
Lamoignon48 ne se tint guère pour satisfait; il éprouva même l'impérieux désir de se plaindre à la Reine, qui se montra irritée contre son beau-frère. La Reine ne voit pas la question avec justesse, pense Bombelles, car «un temps fort court apprendra à M. de Lamoignon que c'est en vain que l'on s'obstine à conserver une autorité que le public n'approuve pas». La démission volontaire pourrait lui valoir des grâces, telle que celle d'être fait duc, ce qu'il désire avant tout, mais si, par impossible, il conjurait l'orage actuel, les États généraux le foudroiraient. On parle de la création de Basville en duché, «il y aurait une sorte de justice d'ouvrir à la famille de M. de Lamoignon une carrière qui dédommageât ses enfants de celle qui leur sera irrévocablement fermée».
Quant à la duchesse de Polignac, Bombelles affirme qu'elle ne soutient nullement l'ambition de M. le Garde des Sceaux. «Il n'a dans la société de la Reine d'autre agent que le baron de Bezenval.»
Tandis que Lamoignon se fait fort de parler haut et ferme aux Parlements qui vont se réunir dans un bref délai, les Parlements sont tout à fait montés contre le Garde des Sceaux, ne parlent de rien moins que de le décréter de prise de corps ainsi que l'archevêque et tous les coopérateurs de leur besogne. Les lettres adressées à tous les membres du Parlement portaient que le Roi leur mandait de revenir à Paris pour y attendre les ordres en silence.
M. de Saint-Priest prendra-t-il le Ministère des Affaires étrangères? La duchesse de Polignac le fait espérer à Bombelles: de la sorte l'ambassade de la Porte deviendrait libre, et il échangerait le Portugal contre la Hollande. Notre diplomate en congé envisage sans enthousiasme cette conjecture: «Outre que ce poste ne donne que ce qu'il faut y dépenser, je ne pense pas que nous soyons toujours assez déterminés sur ce qu'il faudrait faire dans cette république, et si nous nous résolvions à suivre un parti qui y rétablît notre réputation et nos affaires, il amènerait d'abord une rupture pendant laquelle l'ambassadeur de France verrait ce qui ne convient pas à ma situation.»
Le 11, on s'est réjoui à Paris de la nouvelle que M. de Lamoignon avait donné sa démission. On disait au Palais-Royal que les sceaux lui étaient retirés jusqu'à nouvel ordre et que M. Joly de Fleury, ancien ministre des Finances, ou M. d'Ormesson49, servirait ad interim pour ce qui exigerait qu'un magistrat fît parvenir aux Parlements de la part du Roi.
C'était là faux bruit, car Lamoignon n'entend pas encore abandonner le gouvernail. «En attendant, continue Bombelles, les Parlements se montrent de plus en plus récalcitrants. M. le premier Président, mandé à Versailles pour concerter les arrangements du lit de justice, n'a pu être ébranlé par toutes les paroles de M. de Lamoignon, et quand celui-ci s'est avisé de lui dire qu'il cessait de lui parler comme Garde des Sceaux, M. le Président a sur-le-champ levé la séance en lui disant qu'il ne pouvait plus l'entendre qu'en vertu de l'autorité de sa place.»
Malgré cette sévérité, on assure que M. d'Aligre a déplu à la Compagnie lorsqu'il a dit qu'il avait vu M. de Lamoignon. «De tout temps ce magistrat fut mal vu de ses confrères, et lorsqu'il présidait la Chambre des Vacations, il avait inutilement un grand état de maison, sa table somptueuse manquait toujours de convives.»
Chez le marquis de Puysieux, Bombelles a appris une nouvelle qui l'a comblé de joie parce qu'elle fait le bonheur de son ami le comte de Bercheny50. «Du temps où M. le Maréchal, alors marquis de Ségur, commandait en chef en Franche-Comté, le comte de Bercheny fut l'y voir et s'y fit aimer, parce qu'il est impossible de le connaître sans l'aimer. Un M. Denèse, riche possesseur de belles terres dans cette province, n'ayant qu'un fils, l'a trouvé destiné à une assez grande fortune pour n'en pas chercher dans la femme qu'il lui donnerait, et en conséquence il a jeté les yeux sur la fille du comte de Bercheny.
«Celle-ci, âgée de neuf ans, vient d'être promise au jeune homme, qui en a seize; les articles ont été signés, et le comte de Bercheny ne donnera que mille écus de rente à la femme du petit Denèse qui en aura, dit-on, bien solidement plus de 80.000, et qui par sa naissance est susceptible des agréments de la Cour.»
Et Bombelles de conclure, suivant son habitude, en axiome: «On voit encore que l'honnêteté et la véritable bonhomie ne restent pas toujours sans récompense.»
Cependant M. de Lamoignon ne se décide pas à partir sans se faire longuement prier. «Il s'obstine, disent les uns, à paraître lundi au lit de justice qui enfin aura lieu ce jour-là. D'autres assurent qu'il ne tient à son poste que parce que l'archevêque, tout en ne pouvant souffrir le Garde des Sceaux a fait promettre à la Reine qu'elle le conserverait en place, et l'on ne veut pas avoir le dégoût de le sacrifier à l'humeur des Parlements. C'est cependant ce qui sera inévitable.»
Il est une autre intrigue qui occupe la Cour. Depuis longtemps on n'entendait plus guère parler de la duchesse de Gramont. Voici que la sœur de Choiseul51 se remuait de nouveau. «N'ayant pu amortir en elle la passion de dominer, elle se sert de son crédit ancien et ranimé pour que la Reine fasse M. le duc de Châtelet52 ministre principal. Celui-ci refuse le département de la Guerre, à moins qu'il ne soit joint au suprême pouvoir d'un ministre dirigeant les autres départements, et M. Necker qui voit que la cabale Choiseul jointe à celle de l'abbé de Vermond veut tout envahir, tout empêtrer et lui susciter des embarras, déclare qu'il donnera sa démission si M. le duc du Châtelet était appelé pour limiter ses pouvoirs comme ministre des Finances.»
Dans cet état de crise, la Reine se montre plus qu'agitée. «Elle est d'une humeur cruelle, confesse Bombelles, hier elle s'est emportée contre tous les ministres dans un comité où l'on agitait la manière de rendre le Parlement à ses fonctions… Le Roi, dont tous ces conflits énervent l'autorité, ne peut connaître à quel point ils lui sont fâcheux.»
Néanmoins Louis XVI s'est montré de belle humeur à son coucher. Il a dit des choses aimables à Bombelles et a fait des bons mots.
Le lit de justice contre lequel ont protesté la Chambre des Enquêtes et la Grande Chambre semblait destiné à faire éclater de violents orages… Soudain tout est décommandé en même temps qu'on apprend la démission définitive de Lamoignon. Plus de lit de justice, les Parlements reprendront leurs fonctions. «Il est très vrai, écrit M. de Bombelles le 15 septembre, que le Parlement a désiré que Mme la duchesse de Polignac fît passer à la Reine ses propositions, mais elle s'en est excusée en disant qu'elle devait répondre à la confiance qu'on lui marquait en avouant à la Cour que, sûre de l'estime de la Reine, se flattant encore de son amitié, elle n'avait plus le droit de lui parler d'affaires de cette importance, qu'en voulant s'en mêler, elle nuirait plus qu'elle ne servirait, attendu que M. l'abbé de Vermond gâterait et renverserait dans un quart d'heure tout ce qu'elle aurait pu obtenir de Sa Majesté.»
Mme de Polignac ne doute pas que cette réponse ne tarderait pas à venir aux oreilles de la Reine. Elle préfère donc lui dire mot pour mot ce qu'elle avait dit à l'émissaire du Parlement. «La Reine a rougi, a baissé les yeux et n'a rien répondu.»
M. de Lamoignon s'est décidé à partir pour Basville. C'est là nouvelle occasion de tapage pour la jeunesse bazochienne et la populace. Il y eut de gros désordres. Des bandes nombreuses se rassemblèrent sur la place Dauphine et sur le Pont-Neuf. On brûla aussi le mannequin de Lamoignon en simarre, après avoir ordonné qu'il serait sursis quarante jours à son exécution, par allusion à son ordonnance sur la jurisprudence criminelle. La place Dauphine ressembla à un champ de bataille par l'énorme quantité de fusées et de pétards que la foule y lançait chaque soir. Les gens paisibles évitaient ces rassemblements, mais on ne fut pas peu étonné de savoir que le duc d'Orléans s'y laissa entraîner; il ne craignit pas de se donner en spectacle à la populace qui, voyant en lui une victime de la Cour, le couvrit d'applaudissements.
Pour célébrer les funérailles de Lamoignon, de longues théories d'hommes portant des flambeaux partirent du Pont-Neuf et se dirigèrent vers l'hôtel du Garde des Sceaux situé rue de Grenelle, avec l'intention d'y mettre le feu. Quelques détachements des Invalides commandés par un officier déterminé réussirent à empêcher ces bandes d'exécuter leur projet: les enragés se jetèrent alors dans la rue Saint-Dominique pour y brûler l'hôtel de Brienne, ministre de la Guerre. Des Invalides arrivait aussitôt un autre détachement qui chargea la foule, tandis qu'un peloton des gardes françaises débouchait par le bout opposé de la rue: les émeutiers se trouvaient pris entre deux feux: il y eut une vingtaine de morts et un grand nombre de blessés… D'autres émeutes éclatèrent en d'autres coins de Paris, notamment rue Meslée où demeurait Dubois, le chevalier du Guet53.
On a reçu le 18 l'arrêt du Conseil qui annule celui54 dont l'explosion a fait sauter l'archevêque de Sens55, «on sait que les exilés sont mis en liberté, mais les opinions les plus diverses ont cours sur le nouveau ministre». «Tout ce que dit M. Necker en de belles et longues phrases, écrit M. Bombelles56, n'est pas propre à ramener entièrement la confiance; aussi les fonds ne haussent-ils pas. Bien des gens croient que le directeur général des finances ne connaissait pas toute la profondeur de l'abîme creusé par MM. de Calonne et de Brienne. La réplique de M. Necker au mémoire de M. de Calonne est depuis quelques jours dans les mains de tout le monde; les enthousiastes la mettent aux nues; les financiers la critiquent à force, les personnes sensées et impartiales suspendent leur jugement. M. Necker a voulu être éloquent et parfois plaisant dans cette réponse, et il n'a atteint aucun de ces mérites. Il s'est sans doute flatté que, dans un instant où il a de l'empire sur toutes les têtes, il pourrait aussi, en dictateur, nous faire adopter bien des mots qui ne sont pas français et qui n'ajoutent aucune clarté à ceux que nous possédons.»
«La déclaration du 23 septembre, qui fixait l'ouverture des États Généraux au 1er janvier 1789, allait de plus donner de nouvelles satisfactions au public et surtout aux Parlements et aux Cours souveraines rendus à leurs sièges. Dès le 24, les Cours étaient rassemblées par M. de Barentin, le nouveau Garde des Sceaux. Les membres du Parlement de Paris se présentaient au Palais et y reprenaient le cours de leurs séances interrompues depuis cinq mois. S'il faut en croire le libraire Hardy, ils eurent peine à fendre la multitude prodigieuse d'hommes de tous états venus pour les saluer de leurs applaudissements. Dès cette séance de rentrée on proposa la mise en accusation du Garde des Sceaux et du principal ministre précédents, on agita la question de la responsabilité des ministres. Un magistrat, Bodkin de Fitz Gerald, opina: «La Cour manquerait au Roi, à l'État, aux lois, à elle-même, si elle n'avisait aux moyens d'empêcher que la nation ne retombe par la suite dans une crise semblable à celle qui a été sur le point de la perdre57.»
La province ne se contenta pas d'imiter le mouvement de satisfaction donné par Paris, elle renchérit. A Dijon, on promena solennellement sur un char l'image de la Liberté; à Bordeaux, la voiture du premier Président fut dételée.
La joie des Parlements, ces manifestations bruyantes de «libéralisme», qui plaisaient à une partie du public, en effrayaient une autre, même des magistrats qui restaient interdits de voir exaucer si promptement des vœux qui n'avaient pas été sincères… Bombelles ne manque pas à l'annonce de tant de réformes qui lui font peur, de noter: «L'autorité de nos Rois ne fut jamais aussi cruellement compromise, ce qui réjouit fort les bourgeois enflés de l'orgueil de la magistrature, mais ce qui doit véritablement affliger les vrais serviteurs de l'État.»
Le marquis reprendra bientôt la trame des événements, qu'il suit en spectateur très averti. Dans l'intervalle, il note des anecdotes de Cour ou des réflexions intimes.
Il y a longtemps que son Journal ne nous a parlé de Madame Élisabeth. La petite Cour de Montreuil n'apporte guère d'échos saillants; Madame Élisabeth, en dehors des cérémonies auxquelles elle est obligée d'assister, partage la journée entre l'intimité de ses dames et les occupations dont nous la savons coutumière: promenades à cheval, visites à Saint-Cyr, études de botanique, sans oublier les pauvres dont elle continue à être la Providence. Depuis quelques mois, au fur et à mesure de la marche des événements, elle comptait une occupation de plus; elle lisait avidement brochures et libelles, cherchait, parmi ce fatras de la littérature politique, à se former une opinion. Elle rentre pour l'heure du souper à Versailles et se mêle alors pour quelques heures au mouvement de Cour. Elle écoute et elle observe, et son jugement mûri lui fait deviner bien des choses qu'on n'aurait jamais eu l'idée de lui confier. L'avenir lui paraissait sombre et menaçant, elle ne pouvait le cacher à ses amies; moins que quiconque, nous la verrons s'étonner de la précipitation des événements, mais son doux optimisme, le fond de gaieté de son caractère, lui feront toujours entrevoir le beau côté des choses.
Angélique est toujours la femme sérieuse et bien raisonnante que nous avons connue. Si nous ne pouvons l'entendre parler elle-même, du moins de temps à autre rencontrons-nous quelques traits dessinés par le mari dont ni le temps, ni l'air ambiant de la Cour, ni la présence continue n'ont pu attiédir les sentiments.
Tandis qu'on s'agite au Parlement, Mme de Bombelles s'attriste du départ de sa «petite» belle-sœur, Mme de Mackau, qui va rejoindre son mari, nommé ministre à Stuttgard. M. de Bombelles leur décerne à chacune la part d'éloges dont il les juge dignes: «Je les ai laissées jouir des derniers moments qui précèdent une absence bien cruelle pour toutes deux. Ces deux femmes sont deux anges sous tous les rapports; toutes deux n'ont et n'ont eu que les agréments de la jeunesse, presqu'en sortant de l'enfance. Elles ont été d'excellentes mères, des femmes prudentes, des amies solides. Jamais une ombre de coquetterie ne s'est glissée dans leur conduite, et plus elles se sont rendues respectables, plus on les voit être simples et faire strictement leur devoir.»
Le marquis a reçu ce 25 septembre un billet de M. de Montbel qui lui réitérait l'invitation déjà faite par la duchesse de Lorge d'aller dîner quand il le voudrait les lundis et jeudis à Saint-Cloud chez la comtesse d'Artois. Il se mettait aussitôt en route et arrive à trois heures chez la princesse. «J'ignorais qu'elle se mettait à table à deux heures. Le dessert était servi, Madame Élisabeth qui y dînait augmentait encore mon embarras de me présenter si tard. Mme la comtesse d'Artois n'a jamais voulu croire, ce que je m'efforçais de persuader, qui était que j'avais dîné. On m'a apporté de quoi nourrir un ogre, et j'ai mangé à la hâte une petite aile de poulet, une glace et un gâteau. J'étais d'une confusion dont Madame Élisabeth s'est complètement divertie; mais le café une fois pris, je me suis un peu évertué, et, en vérité, une particulière bien aimable ne le serait pas davantage que ne l'a été Mme la comtesse d'Artois pour dissiper l'inquiétude que j'avais eue de lui avoir déplu par ma légèreté.»
A Saint-Cloud, comme chez la princesse de Craon à Longchamps, où, en revenant, Bombelles s'est arrêté, on ne parle que de la séance tenue ce même jour au Parlement. «On sait d'avance qu'il doit y être fait des dénonciations, que toutes les résolutions prises porteront le caractère de l'animosité et de l'arrogance.» Chez la marquise de Rougé, le même soir, Bombelles entend des virtuoses, Viotti, Duport et d'autres, qui exécutent des quatuors, Mme de Montgeron qui a «touché» des morceaux très difficiles sur le clavecin, Rousseau qui a magistralement chanté des airs de Gluck et de Piccini. Des fâcheux sont venus troubler la soirée par des folies débitées sur la rentrée du Parlement. «A les entendre, la royauté de nos Bourbons touche à son terme…»
Et Bombelles conclut: «Il n'est malheureusement que trop vrai que l'extrême facilité du Roi et la lâcheté de ses ministres trahissent depuis longtemps la meilleure cause et les droits les plus sacrés; mais, Dieu aidant, il y aura des honnêtes gens plus sensés que tous les frondeurs de l'autorité, qui sentiront qu'un pays qui s'est élevé au premier rang des premières puissances doit réparer l'édifice, mais non le culbuter.»
Bombelles a rédigé pour la comtesse d'Artois le précis de ce qui s'est déclaré à la séance du Parlement le 25.
«Le Parlement persiste dans les sentiments exprimés dans l'arrêté du 3 mai, dans la déclaration et les protestations qui en ont été la suite.
«… Sans entendre néanmoins que le Parlement eût aucun besoin d'être rétabli, ses fonctions n'ayant cessé que par la force et la violence.
«… Sans entendre que les États Généraux puissent être convoqués dans une autre forme que celle de 164058.
«… Sans entendre que le procureur général puisse être empêché de poursuivre les délits commis depuis la cessation des fonctions, qu'il puisse y avoir d'autres juges que ceux qui auront prêté le serment au Parlement.
«… On suppliera le Roi de vouloir bien rendre la liberté à tous les magistrats et d'autres détenus dans les prisons d'État à l'occasion des derniers troubles et de rendre leurs emplois à ceux qui auraient cru devoir donner leur démission.
«Dénonciation de MM. de Brienne et de Lamoignon.
«… Dénonciation du chevalier Dubois et acceptation de sa démission.
«Le Parlement a envoyé de plus une injonction dans une forme peu honnête à M. le maréchal de Biron59, pour qu'il eût à venir rendre compte de sa conduite depuis que le roi l'a chargé de contenir le peuple de Paris par le régiment des Gardes. Le maréchal a répondu que depuis quatre ans il ne siégeait plus au Parlement, ni n'allait à Versailles faire sa cour; l'on n'a pas insisté pour le moment quoique les jeunes conseillers fussent portés à toutes les impertinences envers ce pair et maréchal de France.
«Le public le plus favorablement disposé en faveur du Parlement a trouvé qu'il avait infiniment outrepassé les bornes de son devoir.»
Le soir, Bombelles a soupé chez Mme de Roquefeuille. Là est venu le président de Rosambo60; il est du petit nombre des membres du Parlement qui sont affligés de la démence de leurs confrères… La bonté avec laquelle le Roi a parlé aujourd'hui au premier Président envoyé devers Sa Majesté doit apaiser l'effervescence des têtes; mais la faiblesse du Gouvernement donne furieusement de prise à tout ce qui se fait et se fera contre notre souverain.
Le lendemain le marquis conte cette anecdote qui semble avoir échappé aux nouvellistes, du moins dans la forme que lui donne Bombelles.
«Nos plus lestes fureteurs de cour ne parviennent pas à deviner tout ce qui se passe dans l'intérieur de la nôtre. Aujourd'hui, le Roi étant à la chasse y a reçu un paquet de lettres. Il s'est enfoncé dans un taillis pour les lire, et bientôt on l'a vu assis par terre ayant son visage dans ses mains et ses mains appuyées sur ses genoux; ses écuyers et d'autres personnes l'ayant entendu sangloter ont été chercher M. de Lambesq61; celui-ci s'est approché, le roi lui a dit brusquement de se retirer. Il a insisté; alors le Roi, lui montrant un visage baigné de larmes, lui a répété, mais d'un ton plein de bonté: «Laissez-moi.» Peu de temps après, Sa Majesté, pour remonter à cheval, a eu besoin qu'on l'y portât en quelque sorte; elle s'y est trouvée mal. On lui a amené une chaise où elle s'est trouvée mal une seconde fois; enfin elle est revenue à Versailles ayant repris ses sens.
«Cette aventure est tenue secrète, mais ce secret sera mal gardé, avec tant de personnes dans la confidence. Les motifs que l'on donne à la peine du Roi sont à ranger dans la classe d'une foule d'autres bruits populaires qui ne méritent aucune créance. Je rapporte un fait, un fait affligeant, mais j'en ignore complètement la cause.»
Libelles, calomnies, vilenies répandues sur la Reine et sur lui-même, menaces ou outrage, rien ne manquait qui ne pût motiver les larmes du Roi… Et pendant que peu à peu s'effritait la monarchie de plus en plus chancelante, la santé du Dauphin donnait de très grandes inquiétudes.
36
Née Montmorency, mariée à un prince lorrain. Femme d'esprit très cultivé et libéral qui devait compter des amis dans tous les partis. Après la Révolution, elle se lia avec Talleyrand, avec Mme de Custine, tint un salon très intéressant. Elle resta fidèle à Fouché, même après sa disgrâce.
37
M. Gaston Maugras vient de publier un agréable livre sur la Cour de Lunéville, Plon, 1904.
38
On n'y croyait pas encore, et bien que créé bruyamment dans Paris, l'arrêt ne fit pas le bruit que certains en attendaient. «Le public est dans une disposition contraire à la confiance.» Correspondance secrète, II, 279. Pour l'opinion contraire, voir Journal de Hardy, VIII.
39
Le 8, ils avaient visité le parc de Saint-Cloud, et les grandes eaux avaient joué en leur honneur. Asselin fit en 1789 de cette scène une jolie gouache, qui est au musée de Sèvres. En voir la reproduction dans le Palais de Saint-Cloud, par le comte Fleury, Laurens, 1901.
40
On se souvient que le comte de Bombelles, fils aîné, était né du premier mariage du lieutenant-général de Bombelles.
41
Arrêt du 16 août, celui qu'on appela l'édit de la banqueroute.
42
La malédiction publique fondit sur lui «comme un déluge». On crut, peut-être non sans raison, que s'il avait publié l'arrêt de convocation des États Généraux, c'était dans la pensée que l'arrêt de la banqueroute cousu à celui-là passerait plus facilement. Marmontel, t. IV. – Hardy, Journal manuscrit, t. VIII, La Fayette, Mémoires, t. II, p. 232. Cf. aussi l'Esprit révolutionnaire avant la Révolution, par M. Félix Rocquain.
43
Son neveu était nommé coadjuteur de Sens, sa nièce obtenait une place auprès de la Reine, et celle-ci envoyait au ministre disgracié son portrait enrichi de pierreries.
44
M. de Brienne partit en effet peu après pour recevoir des mains du Pape le chapeau que le faible Louis XVI avait demandé pour lui. Dans une gravure qui parut à l'époque, la France était représentée sous la figure d'une femme dans le sein de laquelle un prêtre enfonçait un poignard, et le sang qui en jaillissait formait à ce prêtre un chapeau de cardinal.
L'histoire est forcément très sévère pour Brienne; il faut dire, avec Mignet, à la décharge de ce ministre si décrié et sous lequel s'aggravèrent les périls de l'autorité royale «que la position dont il ne sut pas se tirer, il ne l'avait pas faite, il n'eut que la présomption de l'accepter. Il périt par les fautes de Calonne, comme Calonne avait profité, pour ses dilapidations, de la confiance inspirée par Necker. L'un avait détruit le crédit, et l'autre, en voulant le rétablir par la force, détruisit l'autorité». (Révolution française, t. I). M. de Brienne ne pouvait lutter à la fois contre la masse des Parlements et contre le défaut d'argent. Voilà surtout par où il périt, et les mains qui le précipitaient élevèrent Necker.
«Une chose à remarquer à la louange de la Reine, note Sénac de Meilhan, c'est sa constance à se refuser pendant seize ans aux suggestions qui lui furent faites en faveur de l'archevêque de Toulouse. Elle les rejeta tant qu'elle put croire qu'elles étaient dictées par l'ambition, concertées avec des intrigants. Mais lorsque la réputation de ce prélat universellement établie lui eut fait croire qu'il était l'homme le plus capable d'administrer les finances, lorsqu'elle crut enfin satisfaire le vœu général, elle s'empressa de favoriser l'élévation de l'archevêque de Toulouse et de lui procurer un crédit qui lui assurât ses opérations». (Du Gouvernement, des Mœurs, etc.)
45
Mme de Polignac, qui était tout à fait l'amie de Calonne, ne pouvait sentir Loménie de Brienne. A son immixtion dans l'affaire, il y a donc aussi cette raison dont elle ne lui parle pas, mais qui saute aux yeux, puisque la duchesse était la rivale de crédit et l'ennemi de l'archevêque.
46
«La Reine tout en pleurant» convint de la nécessité de renvoyer l'archevêque (Bezenval).
47
Cf. Mémoires de Bezenval. Le comte d'Artois était le protecteur de Calonne, – hélas! il le restera pendant l'émigration; rien d'étonnant à ce qu'il se montrât l'ennemi juré de Brienne, à cause de son amitié pour Calonne et non pour d'autres raisons.
48
Chrétien-François de Lamoignon (1735-1789) avait été Président à mortier du Parlement de Paris, en 1758, et partagea l'exil de cette compagnie en 1771. Il prit part à la Correspondance, sorte de satire contre le Parlement Maupeou. Nommé Garde des Sceaux en 1787, il avait dû se rallier à la Cour et, changeant forcément de rôle, il contribua à l'exil du Parlement de Troyes. Il s'associa d'abord à tous les actes de Loménie de Brienne, puis se brouilla avec lui. En 1789, on le trouva mort dans son parc de Basville, ayant près de lui un fusil déchargé.
49
Louis-François de Paule Le Fèvre, marquis d'Ormesson, neveu de d'Aguesseau, avocat général du Châtelet, en 1739, à vingt et un ans, président à mortier en 1755, premier Président du Parlement en 1788, membre de l'Académie des Inscriptions, servit souvent de médiateur entre la Cour et les Parlements. Mort le 26 janvier 1789.
50
Le second fils du maréchal, colonel après son frère du régiment de cavalerie hongroise, marié à la fille du marquis de Pange, trésorier de l'extraordinaire des guerres, puis à Thérèse de Santo Domingue. Il est question de Bercheny dans les Aventures de jeunesse de Valentin Esterhazy, récemment publiées par M. Ernest Daudet.
51
Béatrix de Choiseul-Stainville, mariée au duc de Gramont, dont elle vivait séparée, avait été la maîtresse de Louis XV; on sait son crédit sur son frère dont elle seconda énergiquement les vues. Morte sur l'échafaud en 1794.
52
Colonel des Gardes françaises, lieutenant-général, fils de la fameuse marquise du Châtelet, née Breteuil, amie de Voltaire; né en 1731, mort sur l'échafaud en 1794.
53
Bezenval, Mémoires; – Hardy, Journal, t. VIII; – Todières, Louis XVI, etc., t. II.
54
Parlant de l'arrêt du Conseil qui révoquait au nom du Roi celui du 16 août (l'arrêt de la banqueroute), Hardy prétend qu'on devrait le traduire ainsi: «Mon ministre Necker par la confiance qu'il inspire m'a enfin fait trouver de quoi attendre les Etats Généraux» (t. VIII, p. 87).
55
Voir Mémoires de Bezenval et Histoire parlementaire, t. I.
56
Bombelles est sévère pour la rentrée de Necker, dans ces difficiles circonstances, et il ne sera pas toujours juste pour son administration. On devra tenir compte au directeur des finances de ses intentions qui étaient bonnes, des tentatives faites pour enrayer le mal et empêcher la banqueroute en donnant des garanties personnelles et des acomptes aux créanciers, en assurant les services et en pourvoyant aux besoins ordinaires. Le désordre était si grand, les difficultés étaient telles que réussir dans l'effort tardif qu'il lui était permis de faire était chose hasardeuse, et d'ailleurs l'homme politique n'était pas à la hauteur du financier. Cependant, avant de porter un jugement définitif sur Necker, on devra relire ce passage bienveillant d'un livre de M. de Monthyon: «La banqueroute était inévitable, et cependant fut évitée sans beaucoup de force, sans emprunts, sans ces billets d'Etat si effrayants… Il n'est aucun temps de l'administration de M. Necker où il ait montré plus d'adresse, de sagacité et de talent. Ses industrieuses et justes combinaisons, et le succès qu'elles ont obtenu tiennent du prodige; et cependant ce n'est point l'époque de son administration qui a été l'objet des éloges de ses partisans, parce que les hommes sont plus touchés, plus reconnaissants du bien qu'on leur fait que des maux qu'on leur évite, lors même que le service est le plus grand.» (Particularités et observations sur les ministres des finances, p. 312.) Le contrôleur général doit être loué; autre chose du premier ministre. Quoiqu'ils en aient écrit lui et sa fille, Necker était-il capable, s'il avait pris le pouvoir quinze mois plus tôt, de sauver la situation? Il est permis d'en douter.
57
Hardy, VIII, 142.
58
Ce fut d'Éprémesnil qui demanda l'enregistrement de la déclaration avec la clause que les États seraient assemblés d'après la forme observée en 1614, au moment de la majorité de Louis XIII. Le souvenir des États réunis alors était cher à la magistrature, parce qu'elle avait exercé sur eux le plus grand ascendant, parce qu'ils avaient offert la composition la plus aristocratique et que le Tiers État humilié n'y avait rien obtenu. La majorité du Parlement croyant trouver son salut et celui de la noblesse dans la clause proposée s'empressa de l'adopter. Quand cette déclaration fut connue, il y eut des clameurs dans le public. La révolution dans les esprits fut rapide et la malédiction remplaçait l'enthousiasme. Un vide immense allait se faire en un instant autour du Parlement dont le peuple avait commencé par saluer le retour avec des transports de joie.
Toute la basoche, procureurs, avocats, jeunes clercs, officiers ministériels, qui avaient fait le succès de sa résistance, l'abandonnèrent aussitôt, se plaignant qu'il venait de dévoiler ses véritables sentiments. Brochures et pamphlets se chargèrent de dévoiler ce qu'avaient offert de ridicule et d'odieux les États de 1614, que le Parlement offrait pour modèle. Dès lors le signal était donné de la lutte entre le Tiers État et les privilégiés, de la lutte du peuple contre l'ancien régime, et l'on pouvait présager une lutte opiniâtre. (Voir Todière, op. cit., 167.) On se rappellera aussi ces remarques de Victor Cousin dans la Fin de la Fronde à Paris: «Au XVIIIe siècle, le Parlement s'énerve avec tout le reste, et comme tout le reste succombe sous ses fautes et s'abîme dans le naufrage universel… Rappelez-vous la fatale décision que les États Généraux seraient convoqués en leur forme accoutumée, c'est-à-dire en trois ordres différents, comme au moyen âge, tandis que le Roi, s'il n'eût pas été entraîné par la déclaration des Parlements, aurait pu, en réduisant les trois ordres à deux et en rendant les États Généraux périodiques, donner la monarchie constitutionnelle et éviter une révolution.»
59
Louis-Antoine de Gontaut (1700-1783), duc de Biron en 1740, après la mort de son neveu et la démission de Jean-Louis, abbé de Moissac, son second frère. Maréchal en 1757. Sans hoirs de Pauline de la Rochefoucauld-Roye, son titre passa à son neveu, le duc de Lauzun.
Sa comparution était motivée par ce fait que Dubois, le commandant du guet, s'était déclaré couvert par les ordres du maréchal (Corresp. secrète d'Ed. Lescure).
60
Le Peletier de Rosambo, gendre de Malesherbes, décapité en 1794.
61
Le prince de Lambesq de la maison de Lorraine, grand-écuyer. Son nom est resté célèbre par la charge de cavalerie faite par lui le 12 juillet 1789.