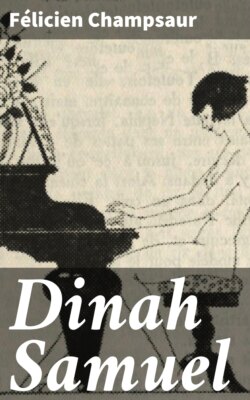Читать книгу Dinah Samuel - Félicien 1859-1934 Champsaur - Страница 7
II
SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE COLLÈGE
ОглавлениеDigne, chef-lieu pittoresque des Basses-Alpes, où Montclar avait pris, avec émotion, la première fois, un billet pour Paris, est assise, comme une bergère, sur le versant de Pied-Cocu, au milieu de contreforts des Alpes, entre trois autres montagnes escarpées, Saint-Vincent, vers le nord; Cousson, au sud, et Courbon, de l’autre côté de la Bléone, vis-à-vis de Pied-Cocu, dans un carrefour de vallées. Les gens y sont travailleurs, amassent avec peine et gardent avec soin, pour les vieux jours, le pécule accumulé. La ville s’étend, en amphithéâtre, au bas de Pied-Cocu. Deux torrents, le Mardaric, au nord-est, et les Eaux-Chaudes, au sud-est, l’embrassent, et se jettent, presque à sec, dans la Bléone, très grosse aux jours d’orage, qui baigne les dernières maisons de la rue Prête-à-Partir. Une partie de la ville est sur la hauteur, se cramponnant aux pentes de Pied-Cocu. C’est le Rochas. Là gîtent les paysans qui fatiguent, à la journée, sur la terre des autres. Presque tous, cependant, ils possèdent un étage de la maison vermoulue qui les abrite et un bout de champ.
Patrice, lorsqu’il avait une dizaine d’années, avait passé un jeudi dans le «bien» d’un de ces paysans, Galissian, un brave homme, qui avait été soldat, de1832à1838, tour à tour, jusqu’au moment de son congé, à Tours en Touraine, à Vesoul. Au régiment, Galissian animait la chambrée, par ses histoires. Après l’extinction des feux, on l’entendait chaque soir:
–Cric, crac, sabot, cuillère à pot, sous-pied de guêtres!...
Il amusa Patrice, ce jeudi, par des contes à n’en plus finir, où les fées aux cheveux d’or mariaient des princesses à des héros, où, durant les noces, les porcs rôtis défilaient, un couteau enfoncé dans l’échine, à travers les rues grouillantes de foule. Taillait des morceaux qui voulait. Montclar, monté sur l’âne de Galissian, par-dessus les besaces de sparterie au fond desquelles étaient fourrés deux paniers d’osier, écoutait les légendes éblouissantes, à mesure qu’elles tombaient lentement des lèvres du paysan. Le «bien» de Galissian était à Gaubert, autour d’un cabanon, dont le toit avait grande nécessité d’être réparé, car, pendant le déjeuner, un rayon de soleil arrivait du ciel, sur la table, par l’écartement de deux tuiles à gorge. Un bout de pré, à côté d’un carré de «pommes d’amour» et d’un carré de haricots, produisait assez de foin pour nourrir l’âne. Des courges, devant le bastidon, allongeaient sur le sol leurs tiges, étalaient leurs larges feuilles plissées en dessous et poilues, ouvraient leurs grandes fleurs jaunes. Patrice vit une abeille entrer dans l’une des fleurs, pour enduire ses pattes de sucs et se rouler au fond du calice. Doucement, il saisit les pétales entre ses doigts et rendit l’abeille captive. Elle bourdonnait, faisant, à l’intérieur de sa prison d’or, un froissement d’ailes, et frappait, irritée, contre le velours de la corolle. Le petit eut peur et lâcha tout, en reculant. L’abeille s’envola, dorée de pollen, par-dessus un pommier.–A la chute du crépuscule, le paysan laissa Patrice dans la rue de Provence, l’ancienne rue du portail de Gaubert, qui est au bas du Rochas. L’enfant, après être descendu seul de la croupe de l’âne, partit en courant, puis, quelques pas faits, il se retourna et cria: «Bonsoir, monsieur Galissian!»–«Adieu, petit.»
Le Rochas, sur la montagne de Pied-Cocu, avec ses rues mal percées, zigzaguantes et sales, entre autres la rue de la Juiverie, autrefois assignée à la postérité de Jacob, est le vieux quartier de la ville. Au sommet est, à côté de la prison, jadis château de l’évêque, la nouvelle cathédrale. L’ancienne, Notre-Dame-du-Bourg, située en face du soleil couchant, dans la vallée humide du Mardaric, où fut autrefois la cité des Blédonticiens, date du IXe siècle et surgit, en forme de croix latine, au milieu du cimetière plein de tombes où les herbes poussent mieux. Quatre marronniers, hauts comme l’église, l’entourent, et ces ancêtres la rajeunissent presque, en avril, dans la fraîcheur des feuilles. En cette vallée marécageuse la peste se déclara jadis, et les habitants qui survécurent, sans compter que les invasions sarrasines des IXe et Xe siècles avaient ruiné en partie la ville romaine, émigrèrent sur la colline prochaine; ils élevèvent, au Rochas, un amas de maisons coupées par des ruelles qu’on appelle «andrônes», si étroites qu’entre les faîtes, rapprochés encore par la perspective, bleuit à peine, les jours de soleil, un ruban d’azur. Les rues de la Traverse et de la Mère-de-Dieu, courant sur les deux versants de Pied-Cocu, furent, jusqu’à Louis XVIII et même Louis-Philippe, les plus larges voies de la ville. Là demeuraient alors, les notables, groupés autour de l’évêché, à l’arête de Pied-Cocu, où se joignent ces deux rues. Depuis, la ville s’est agrandie. A la rue de l’Ubac, abondante en épiciers, bouchers et autres commerçants, s’est ajouté, parallèlement, le Cours. (avec un s qu’on prononce). Sur le Cours, bordé tout le long, de hauts platanes, se trouvent les cafés comme il faut. Celui de Sube est fréquenté par les officiers et par les employés, et celui de Pachichois par les négociants et les hommes d’affaires. Au-dessus du café des Arts, tenu par Passeron, se réunit, dans un cercle qui a pour local une seule pièce, quotidiennement, après déjeuner et après dîner, pour jouer les consommations à l’écarté, l’aristocratie, à quelques mille francs de rente, en moyenne, de la rue des Fontainiers, tout à fait hors l’ancienne ville. Cette rue, la dernière construite, qui a presque toutes ses maisons entourées de jardins, entre le Mardaric et la Bléone, est, du mois de mai ou mois d’octobre, coquette dans la verdure des jasmins odorants. Parfois, on entrevoit, sous l’ombrage des saules aux pousses chevelues, ou des glycines de Chine, aux grappes bleues, des visages de jeunes filles. Deux acacias, plantés devant la porte de M. Testanière, le juge de paix, embaumaient l’air, au printemps,–lorsque la brise souffle, encore frileuse, et traîne dans la rue, sur les passants rares, le parfum, qui saisit, de leur floraison blanche.
Patrice Montclar avait grandi dans cette petite ville, en ayant sous les yeux la continuelle idylle des paysages traversés d’eau, idylle faite par l’été, tremblante du frissonnement, dans l’air remué qui flotte, des prés de trèfles violets, à feuilles ternées, et d’esparcette, des blés jaunis, parfois un peu courbés par l’orage, et, par intervalles, des oliviers et des amandiers sur les collines.
L’horizon, est restreint, sauf à l’ouest, par les montagnes, Montclar les escalada souvent, et, sans se priver jamais de contenter ses caprices pour l’école buissonnière, il fit ses études. Le collège, alors, était sis près du torrent des Eaux-Chaudes, en face de la route de Gaubert.–Plus d’un coup, dans le lit de ce torrent, Patrice, jusqu’à sa dixième année, avait usé des heures en pêches infructueuses, à la fourchette, avec une bande de gamins. Il s’agissait de prendre du fretin avec les becs de cet ustensile de table, ou bien encore de l’assommer avec de grosses pierres. Tous, le pantalon relevé jusqu’aux genoux, les pieds nus dans l’eau qui ne leur arrivait guère au-dessus de la cheville, pataugeaient avec précaution, quand, soudain, ils s’arrêtaient. Un d’entre eux avait aperçu un poisson menu, au dos gris, au ventre blanc, en train de dormir, à demi caché sous une pierre. Doucement, les camarades béats avec extase, Patrice avançait, les yeux fixes, le corps plié, les bras arrondis, serrant dans ses deux mains étroites une autre lourde pierre que, le but bien visé, il jetait de toutes ses forces. La victime devait être capturée avec les doigts glissés, étourdie par le choc; et les camarades, anxieux:
–Le poisson est encore dessous?
Le torrent est dit des Eaux-Chaudes parce qu’il reçoit les eaux thermales dont la source est à trois kilomètres de la ville. L’établissement de bains mérite le succès de Vichy, de Biarritz, par la vertu de ses eaux et le charme de son site. Aux premiers matins de mai, à cinq heures, dans le blanchissement de l’aube, Patrice allait à la source avec ses camarades. Pépin des Grillons, de la rue des Fontainiers, Gassendi, le fils du pharmacien et maire, Autric. La route côtoie le torrent, qui arrose les prairies de Barbejas, mais remontant le chemin de la vallée, elle s’élargit bientôt, peu à peu, sur un fourmillement de collines dont verdoient les buis et les chênes.
C’est délicieux.
Les chèvrefeuilles enchevêtrés rampent contre les roches, et les aubépines répandent leur senteur, à la fois douce et âcre, sur tout le renouveau. Entre les versants, non loin, une buée flotte, légère, et indique les méandres du torrent. Par ici, sur la colline de la Reine Jeanne, s’épanouissent les pervenches, les muguets, les violettes, les tulipes, pareilles à des évêques, les iris, que les dévotes mettent aux mains des saints Joseph, puis, les plants d’hysope, que, dans le pays, on nomme «poivre d’ail», les romarins, les thyms, les lavandes, les genêts; et, là-bas, le bois de Feston, derrière, étend la masse vert sombre du feuillage des hêtres, des cognassiers, des cytises, des tilleuls, des oliviers. Des culs-blancs, qui sont revenus, il y a quelques jours, des pays plus tièdes, en même temps que les rossignols, les hirondelles, les alouettes huppées, les queues-rousses, les bergeronnettes, sautillent sur de vieux murs bordant le clos de M. Magloire ou sur les cailloux ronds des Eaux-Chaudes. Sur le penchant des ravines, les églantiers et les prunelliers sont tout roses et tout blancs de fleurs.
Les roches jaunes, à pic, de la montagne de Saint-Pancrace, surplombent l’établissement des bains. A leur crête, au bord du précipice, une petite chapelle,–nid bâti sur la cime pour le bon Dieu, lorsque, au printemps, il vient de passage, accompagné par le vicaire et Nicodème Lampian, chef de la confrérie des pénitents gris,–apparaît dans la lumière qui argente le badigeon de chaux. Au-dessous, dans les crevasses des rochers, pointent des fougères, extrêmement découpées, fougères aux écailles de pollen jaune. Les garçons, et les hommes aussi, chaque année, le jour du pèlerinage, en mai, pour rapporter aux dames et aux demoiselles des bouquets de ces petites palmes dorées, des «feuilles de saint Pancrace,» descendent l’abîme et le remontent, en s’accrochant aux aspérités, en enfonçant les doigts dans les fissures, en se retenant à une branche de figuier sauvage. Par des sourires charmants et des caresses honnêtes, ils sont récompensés, lorsque, après le déjeuner, des rondes sont organisées sur la coudraie, autour de la chapelle, ou bien, au pied de la montagne, dans les prés de M. Magloire qui, devenant hôtelier pour la fête de saint-Pancrace, cloue un rameau de pin au-dessus de la porte de sa bastide. Une chanson accompagne toujours ces danses, marquant la cadence aux «chattes» et à leurs «calignaires». Après chaque refrain, la fille qu’on a fait entrer dans la ronde accorde un baiser, ou deux, à un des garçons.
C’est à une fête de saint Pancrace que Patrice s’énamoura de Rosalie Gontard, une petite ouvrière, la nièce de Galissian, et qu’ils s’embrassèrent sur les joues. Lui, reçut aux lèvres une impression fraîche de chair et de sang, et, comme il entourait, de son bras la taille de la belle, il sentit un sein jeune, pas encore tout à fait mûr, se gonfler sous la robe d’alpaga, dans la paume de sa main. En cet instant, où les deux amoureux n’entendaient rien, les danseurs, parmi lesquels Pépin des Grillons, chantaient:
–Dites! Quelle route mon amoureux a pris?
–Ma mignonne, il a pris la route pour Paris.
Pauvre petite Lalie! Elle avait seize ans et ce baiser était le premier où son instinct comprit, à demi, l’affinité mystérieuse et sensuelle qui lie l’homme et la femme. Pour Montclar, ce fut sa première caresse mâle. Tous les deux échangèrent, dans la même minute, un baiser par lequel fut connue de deux êtres la première joie d’amour. C’est le baiser jeune dont on se souvient entre tous les autres baisers voluptueux, car, dans son frissonnement agonisent les chastetés des baisers naïfs reçus ou donnés, alors qu’on est petit, alors qu’on est petites, et naissent les désirs vagues des enlacements intimes et des baisers lascifs. Dans la série des baisers, il est le plus doux, ce baiser intime, ignorant, baiser des adolescents. Des baisers on ne retient pas plus l’image qu’on ne trouverait la trace d’un papillon dans l’air. Dans les musées d’histoire naturelle, les papillons, de chaque variété, sont piqués en ordre, au fond de boîtes blanches avec des épingles? Est-ce qu’ils ne suggèrent pas l’idée fantaisiste d’une collection impossible de baisers défunts? Le baiser jeune serait représenté par un papillon bleu.
Patrice, souvent, parla de Lalie à ses amis, pendant leurs excursions aux bains, où, durant tout un mois de mai, ils allèrent, en promeneurs matineux. Vers sept heures, Montclar, Pépin des Grillons, Gassendi étaient de retour chez eux, et, à huit heures, ils arrivaient en classe, ayant déjà rendu visite à la Reine Jeanne, dans sa tour en ruines, sur la colline, et mouillé, par leurs ascensions, à travers les sentes sinueuses, leurs souliers garnis de clous, dans la rosée et le parfum de l’herbe.
Les environs de Digne sont exquis. En venant du côté des Sièyes, on n’aperçoit de la ville, sur l’autre rive de la Bléone, que le clocher pointant à travers des branchages. Les platanes du Cours, les acacias de la place du Tampinet, les peupliers, les saules pleureurs et les osiers, sur la digue, le long de la rivière, cachent, derrière la ramure, les maisons, et seulement, de-ci, de-là, quelques pignons saillent entre deux fouillis de verdure. Dans un voile tissu de printemps, d’automne et d’été, la nature enveloppe les maisons décrépites et les rues tortueuses. La ville n’est presque pas visible; un étranger disait:
–C’est pour cela qu’elle est jolie.
Malgré cette épigramme, le Cours,–avec uns, qu’on prononce, –ayant, du Grand-Pont à la Grande-Fontaine, une distance d’un kilomètre, est très ombreux, entre le double alignement des troncs épais des platanes, sous le dôme des feuilles. Les paysages sont ravissants.
Patrice se grisait de leur poésie, comme une grive de raisin. Un des préférés, parmi ces paysages, était le coucher du soleil au loin, derrière la montagne de Lurs.
A droite, au premier plan, sont les bâtiments de la gare, avec leurs toits de briques rouges, au bas des pentes d’une colline dont les oli viers s’estompent dans le commencement du crépuscule; à gauche, à l’extrémité d’un pré, au bord de la rivière, six peupliers, minces et hauts, profilent leurs troncs grêles et leur frondaison menue sur le soleil, qui perd sa lumière, et sur le ciel embrasé. A travers les fonds inégalement cendrés de la plaine, la rivière, la Bléone, très large, apparaît avec son lit de cailloux, en effet blanc, et s’effiloche au lointain, dans l’effacement des «îles» touffues de bouleaux et de trembles. Digne, a, du côté du soleil couchant, son horizon le plus large. Tandis que la brume, comme sortant des creux, s’étend sur les vallées, une immense traînée de clarté pourpre ensanglante les sommets resplendissants. Derrière la barre de Lurs, le soleil est tombé aux trois quarts, comme une braise incandescente, et, tout près, à une fenêtre de la gare, les vitres reluisent et envoient, dans l’ombre qui naît, le reflet des derniers rayons.
En octobre ou en novembre, le spectacle est plus beau encore. Alors, l’automne semble mourir en même temps que le soleil, et à la mélancolie d’une fin de jour se mêle la tristesse de la fin des fleurs et des verdures. Dans ce paysage du soir, les bouleaux et les trembles des «iscles» reculées, crépusculaires, ont des teintes de rouille, et le vent léger, courbant, tout près, les cimes des quelques peupliers, promène dans l’air qui fraîchit, sur le ciel rouge et or, leurs feuilles sèches.
Les parents de Montclar, dans cette ville alpestre, étaient de petits rentiers. Le père, longtemps militaire, était grand et solide, jeune encore à septante ans. Il s’était retiré à Digne, y était devenu presque paysan. La mère, une dévouée à son foyer, adorait les fleurs. M. Montclar avait acheté une maison, et, aux environs de la ville, deux champs, à Courbon et aux Sièyes. A l’aurore, en avril, en mai, en juin, en juillet, souvent il allait, à Courbon, visiter ses vignes. Il rencontra, plus d’un coup, dans le vallon, une couvée de perdreaux, venant boire, le matin, à une source qui sort du roc par un tuyau de sapin, avec un bruit enroué, et qui emplit, à l’ombre des branchages de deux prunelliers, un tronc creusé, dont les bords sont presque à ras de terre. Les perdreaux, apercevant le propriétaire, s’enfuyaient, le père et la mère à tire d’ailes, les petits se hâtant, s éparpillant, disparaissant dans les broussailles. Jean Montclar passait et il entendait la mère les rappeler. Bientôt les perdreaux rassurés pouvaient le voir, sa haute taille courbés, dans les allées, sur la côte, en train d’examiner les ceps. Parfois il était accompagné de son fils, il lui expliquait la nature, à mesure qu’on montait sur la colline couronnée d’un petit bois de noisetiers et d’airelles:
–Hein, les vignes sont belles! Quelques-unes, qui ont été gelées, ont repoussé en diable et n’ont fait que de la ramée. Pas un seul raisin!... Mais regarde comme ces souches que j’ai plantées, l’an dernier, ont bien pris! Une seule... celle-ci... a manqué. Tiens! ce plan, au-dessus, a neuf grappes, là... là... là... là... Je te montre les grappes du bout de ma canne, et je distingue les grains, moi qui suis vieux... Ce pied de vigne! Il a aussi une tapée de raisins; mais ils paraissent moins, parce qu’il y a plus de feuilles... Et les amandiers! Ils ne sont pas chargés pour cette récolte! et, pourtant, ils étaient blancs de fleurs, en mars. La pluie en a emporté les deux tiers. Va cueillir deux amandons à une branche basse. Ils doivent être formés... Ce n’est encore que de l’eau?
Patrice était fils unique. Les deux autres enfants étaient morts– Un soir, au dîner, son père, après lui avoir passé la salade de pissenlits, lui parla en ces termes:
–Aujourd hui, j’ai rencontré ton professeur de rhétorique. Il m’a dit que tu travaillais, et tu as raison, car tu as l’examen du baccalauréat à subir dans un mois. Tu es externe libre et nous te laissons étudier à ta guise... Mais souviens-toi que, tes études terminées, tu auras à te débrouiller tout seul. Tu as de l’instruction. Nous ne pourrons pas, malheureusement, te donner davantage, mon garçon...
Patrice avait réfléchi sur l’avenir. Il ne voulait entrer dans aucune administration. Paris apparaissait dans tous ses désirs, mais il les réservait par devers lui. En attendant, il lisait tous les livres de la bibliothèque de la ville, il composait des discours latins, (mieux, aurait valu d’apprendre l’anglais) en vagabondant dans la campagne; il faisait, en compagnie des camarades, avant et après les classes, de longues promenades dans les environs.
Il commençait, sentant peu à peu la puberté cuire dans ses reins, à parler aux filles et à leur conter fleurette, surtout à Rosalie, la nièce de Galissian. Elle venait parfois, avec Annette Simon, une des filles d’un employé de la préfecture, chez Gassendi, qui, plus âgé que Montclar. faisait son droit, prenant ses inscriptions à Aix, la Faculté voisine et écrivassait chez M. Ribe, l’avoué, pour apprendre la procédure. Il avait une chambre séparée, chez ses parents, au second étage, et, comme il était musicien, jouant de la clarinette à la musique de la ville, il accompagnait, sur son instrument, Rosalie Gontard et Annette Simon qui dansaient la scottish avec Montclar et Pépin des Grillons. C’était généralement, vers une heure, après le déjeuner. Ensuite, Rosalie et Annette s’en allaient à l’ouvrage, chez Paticlet, le tailleur qui a son magasin sur le Cours, (avec uns, qu’on prononce), en face du café Passeron.–Les deux filles occasionnèrent, une fois, une punition à Patrice Montclar et à Pépin des Grillons. Le premier amour fut cause du dernier pensum.
Une lettre de Montclar racontait, deux ans plus tard, ce souvenir:
«Pépin des Grillons,
«Te rappelles-tu notre dernier pensum? Il était une heure peut-être. Tu étais venu me prendre, après le déjeuner, à notre maison de la rue de Provence, et nous étions partis gaîment avec deux bouquins, Brutus, Elektra, du Cicéron et du Sophocle, dans la poche de notre veste, et quelques cahiers. Te le rappelles-tu encore? Ils étaient couverts de taches, de commentaires manuscrits, d’illustrations joviales. Antiques et vénérables, ils avaient servi à plusieurs générations, et rien qu’à les voir, on sentait comme une vague odeur rance de latin et de grec.
«Nous étions partis donc. Un bon soleil de juin répandait sur toute la campagne, à travers la verdure, sa lumière blanche. Déjà nous avions franchi le pont de bois qui traverse, devant le collège, le torrent des Eaux-Chaudes, et, en discutant, nous nous promenions sur la route de Gaubert.
«Je crois être encore à cette journée, et tout me revient à l’esprit. J’ai devant moi la ville qui, avec ses rues tortueuses et ses tuiles rouges, s’étend sur les pentes de la montagne et baigne ses pieds dans la Bléone; je revois la maison d’Isnard, le teinturier, avec ses longues pièces de drap vertes et jaunes flottant le long des murailles. Et puis, de l’autre côté du torrent, m’apparaît le pays bossué de collines et de montagnes au travers desquelles la Bléone va, chuchotante et capricieuse.
«Il faisait bon vivre, n’est-ce pas, ce jour? La classe ne commençait qu’à deux heures, et nous avions une bonne heure encore devant nous pour flâner dans les champs embaumés de mille senteurs.
«Et nous marchions joyeux et souriants.
«Nous causions de deux jolies filles. Qu’elle était charmante, Annette, avec sa blonde chevelure, son nez retroussé, sa robe bleue à volants! Je préférais l’autre, pourtant, la petite Alie, comme nous l’appelions. Elle était si gentille! Elle avait de fins cheveux noirs qui tombaient de chaque côté de son front et encadraient sa figure douce et pensive. Elle avait surtout des mains si mignonnes que je me faisais un vrai plaisir de les prendre toutes deux dans une main.
«Soudain, nous apercevons dans la montagne, du côté de Caramentran, comme deux fleurs, l’une blanche, l’autre bleue. Elles transparaissaient dans les chênes et scintillaient pour ainsi dire. Nous regardons. C’étaient Nanette et Rosalie. Elles agitaient leurs chapeaux de paille et nous faisaient signe.
«Un! deux! Nous prenons près de la maison de la mère Moyse, le sentier pierreux qui grimpe à la montagne, et nous voilà courant, ainsi que cabris, et, agitant, par intervalles, nos mouchoirs. Puis nous laissons les sentes et nous nous lançons à travers les fourrés. En dix minutes, nous étions près d’elles, dans une clairière.
«Elles se mirent à rire en nous voyant, et Rosalie nous dit, comme voulant s’excuser:
«–Le temps est si beau, aujourd’hui, et j’avais si grande envie d’escalader cette montagne! Tous les jours, je la vois de ma fenêtre et, tous les jours, je disais à Nanette qu’il nous faudrait venir ici cueillir un bouquet... Nous y sommes!
«Puis, voyant un coin de livre, Cicéron, saillir de ma poche, elle reprit:
«–Et le collège?
«–Nous avons encore une bonne demi-heure devant nous... Voyez, en bas, les petits qui jouent sur la route, en attendant la rentrée en classe.
«–C’est vrai. Je reconnais le fils de l’horloger... Il jette une pierre dans le pré du père Sicard, de l’autre côté des Eaux-Chaudes.
«Nous nous mîmes à jaser. Tu riais avec Nanette, que tu voulais embrasser, et qui ne le voulait pas. Vous couriez l’un après l’autre. Elle se cachait derrière les chênes, puis se montrait tout à coup.
«Je cherchais avec Lalie des fleurs dans l’herbe.
«Ensuite, assis à côté l’un de l’autre, sur une pierre moussue qui faisait banc, nous composâmes des guirlandes. Nous achevions la seconde, lorsque Nanette vint s’agenouiller devant nous.
«Elle souriait toujours, la blonde, et montrait ses dents blanches et ses lèvres roses. En riant aussi, tu vins t’agenouiller devant elle, les mains jointes. Tu disais:
«–Je vous salue, Nanette, pleine de grâce.
«Puis, prenant une des guirlandes, tu en attachas les deux bouts avec une herbe et en fis une couronne. Je t’imitai et j’entourai une guirlande autour du front de Lalie, pendant que tu ceignais les cheveux blonds de Nanette avec un nimbe de fleurs bleues. Là-dessus, nous demandons un baiser, et nous allions le prendre. Nos deux rusées se dressent, en éclatant de rire, et s’échappent.
«Juste à ce moment nous entendons monter un vague bruit. Ran, tan, plan... ran, plan, plan... C’était adouci, lointain, le tambour du collège qui annonçait la rentrée.
«Toutes deux, charmantes sous leurs couronnes bleues, nous crièrent:
«–Preste! en classe, rhétoriciens!
«Nous répondons, peu soucieux d’aller exprimer en langage français le nommé Cicero:
«–Oh! nous n’irons pas, ce vespre.
«Alie, un tantinet effrayée, car elle avait peur d’avoir été trop imprudente, dit alors, d’une gentille voix qui ordonnait et qui suppliait:
«–Si! je veux que vous y alliez.
«Nous vîmes dans son regard toutes ses pensées et ses terreurs naïves; et tu lui dis:
«–Oui... Seulement, un baiser avant de partir.
«Elles tendirent leurs joues blanches et roses commes des pommes d’api, et, lestes, s’enfuirent derrière les chênes.
«Nous voilà dévalant, au grandissime galop, la pente de la montagne, empoignant de la main, par instants, les troncs des chênes, afin de ralentir notre course emportée. Nous serions en retard, certainement. et le principal ne badinait pas avec l’exactitude. En avant! courage! zou! zou! Vite! vite!
«Enfin nous entrons essoufflés dans la cour du collège. Le principal était là, se promenant, sévère. Il nous fit signe, et tirant sa montre d’or qui marquait les secondes, il nous dit:
«–Vous êtes en retard de dix-sept minutes et demie. Vous me traduirez tous les deux, dans le second livre des odes d’Horace, l’ode à Postumus et celle à Licinius Varro Muraena.»
Ce premier baiser et ce dernier pensum furent les événements importants de la puberté, qui fermentait, de Patrice.–On vit len tement en province, même en Provence.
Montclar, reçu mi-bachelier au bout de sa «rhétorique». fit des études de philosophie adorables. Le professeur, M. Péluque, était un vieux bonhomme, un peu sourd. Il n’avait jamais plus de trois ou quatre élèves, et, certaines années, il n’en avait qu’un. Mont clar eut, pour seul copain de philosophie, Pépin des Grillons, drille joyeux, selon la doctrine épicurienne. Presque toujours une pipe aux dents, une pipe taillée dans le buis en forme de marmite à trois pieds, une fleur à la boutonnière, guilleret, il marchait par les rues ou les champs. Il croyait à la métempsycose, et, probablement, son âme, dans les transmigrations de la vie antérieure, avait été celle d’une cigale. Un soir, en classe, il demanda au professeur la permission d’aller voir, un moment, Mme Hermine Péluque. Comme Pépin des Grillons levait la main en montrant la porte, M. Péluque, n’entendant pas les paroles:
–Allez-y, mais dépêchez-vous!... Pendant ce temps, monsieur Montclar, je vais vous expliquer, de nouveau, la fameuse preuve de l’existence de Dieu trouvée par saint Anselme... Pourquoi riez-vous? Cette preuve ne vous satisfait pas? Pourtant, elle est des plus logiques et ne saurait être réfutée. Dieu est parfait. Or, l’état de perfection implique nécessairement toutes les qualités, parmi lesquelles la bonté infinie, la puissance infinie, la justice infinie. Une de ces vertus primordiales est, aussi, l’existence immortelle, c’est-à-dire n’ayant ni commencement ni terme, sans laquelle la perfection serait incomplète... Il est donc évident que Dieu existe... Mais, vous avez une objection à émettre?... Je vous écoute... Parlez plus haut!
Il faisait bien tout ce qu’il pouvait, M. Péluque, mais il ne pouvait pas beaucoup. Licencié ès lettres, il professait la seconde, les humanités, lorsqu’une maladie le saisit, à la suite d’un chaud et froid, et lui laissa une surdité qui ne fit que s’aggraver. On le chargea de la chaire de philosophie, laquelle chaire était une simple chaise qu’on avait cassée un jour et dont on avait remplacé deux barreaux. M. Péluque avait compulsé, alors, quelques philosophes à l’usage des potaches et avait rédigé un manuel de philosophie demeuré en manuscrit. Toutes les années, il dictait aux philosophes ses élèves, à chaque classe, quelques pages du cahier, pendant une heure, et, le reste du temps, il posait des questions sur la leçon précédente ou bien il élucidait, comme on l’a vu, un point difficile. Patrice Montclar et Pépin des Grillons, qui jamais ne consentirent à écrire sous la dictée du père Péluque, s’étaient procuré les cahiers de deux de leurs anciens camarades. Cela leur suffisait. Le professeur dictait, quand même, durant une heure, les paragraphes de son manuscrit. Patrice et Pépin suivaient, à mesure, sur leur texte, en ayant l’air d’écrire, et ne constataient jamais le changement d’un mot.
M. Péluque n’enseignait peut-être pas la philosophie à cause de sa science sur l’être et non-être, M. Péluque, mais à cause de ses visites, après avoir été atteint de surdité, à Mgr l’évêque, à M. le préfet, à cause d’influences qu’il avait fait agir près du Recteur, à Aix. Non pas un homme qui réfléchit, M. Péluque, mais un homme qui fléchit.
A Pâques, qui tombait en avril, Montclar et Pépin des Grillons. chacun lesté de cent francs (Oh! la belle et douce vie, vers1876, où la France ignorait la vie chère, et ne devait pas, comme en1925, quatre cents milliards!) pour un voyage à pied, allèrent à Turin et demeurèrent près de trois semaines par les chemins.–Lorsque vint le mois de juin, ce fut une autre aventure. M. Péluque, qui, de plus en plus, s’en tenait à la dictée inutile de son manuel, arriva souvent au collège sans y rencontrer ses élèves. Il envoyait, alors, un gamin chercher sa ligne et une boîte en fer-blanc, où il tenait les asticots, et il pêchait dans le torrent des Eaux-Chaudes, sans perdre de vue la porte du collège. Patrice Montclar et Pépin des Grillons auraient pu être en retard seulement, par hasard, en retard d’une heure, et dans ce cas, M. Péluque, laissant sa ligne chez le concierge et reprenant son cahier, serait avec eux monté en classe. Il aurait dicté deux ou trois pages, et les aurait ensuite commentées. Le fait arriva.– Oh! M. Péluque, furieux, laissant sa ligne chez le concierge!
Mais, en juin, Montclar dit à ses parents qu’il serait mieux à la campagne, pour travailler, qu’à la maison, où ses camarades venaient souvent le déranger, en l’appelant pour des promenades. Il s’installa au bastidon des Sièyes. Pépin des Grillons lui rendait visite tous les matins; et Montclar, levé dès l’aube, le voyait, lorsque les corolles des liserons, des volubilis commencent à pâlir et se rider, apparaître la pipe aux lèvres, coiffé d’un large chapeau de paille–un «petasus» comme il disait,–un bleuet à sa jaquette, sur la route, derrière la haie de rosiers.
Des haies vives de rosiers, sur trois côtés, clôturent cette villa en miniature. La quatrième limite était marquée par un cordon de vigne qui grimpait contre de hauts échalas cachés sous l’emmêlement des feuilles. Le bastidon, voilé par-devant d’un treillis en bois formant berceau, renferme une seule pièce, et, sous le toit en pignon, le grenier dans un coin duquel est le colombier. Alors les jasmins s’enlaçaient au treillis, faisaient courir leurs brindilles sur les losanges, puis se cramponnaient au mur du bastidon jusque sur le toit. De la route, qui est voisine, les passants ne peuvent apercevoir, pardessus la haie de rosiers et la ramure des pruniers, que la toiture du bastidon, le tuyau de la cheminée et les briques vernies, blanches et bleues, qui, fixées dans la muraille et luisant sur le crépi de mortier, entourent l’ouverture carrée du colombier. Elles empêchent d’y pénétrer les martres dont les griffes glissent. Les jasmins fleuris de la tonnelle et les roses de la haie, ainsi que deux syringas, exhalaient autour du bastidon leurs senteurs auxquelles se mêlaient celles des œillets, des thlaspis, des giroflées, des marguerites. Touchant à la route, un champ de blé, aux tiges très hautes et encore vertes, aux épis lourds, ondulait au souffle le plus faible. Au jardin, séparé du blé par une ligne de groseilliers chargés de grappes rouges, s’étendaient les plates-bandes de fraisiers et s’épanouissaient dans les ronds et les ovales, entre les bordures de buis transplantés de la montagne et taillés, les opulentes roses mousseuses. Ensuite le pré, séparé du jardin par une seconde ligne de groseilliers, formait comme un tapis profond avec son fouillis de froment et de luzerne où luisaient les boutons d’or. Un gros lilas, aux bouquets disparus, planté derrière le bastidon, et les pêchers, les pommiers, les cerisiers, faisaient ombre sur le pré, les fleurs et la moisson en herbe étoilée de coquelicots.
Au-dessus passaient, dans l’air ensoleillé, les pigeons pattus.
Dès qu’arrivait Pépin des Grillons, tous deux gagnaient, par la route charretière, le moulin qui est à trois cents pas de là, pour acheter du lait. D’abord ils entendaient le bruit du moulin, où déjà on était à l’ouvrage, et ils voyaient la roue ancienne, luisante de gouttelettes, qui tournait, poussée sans cesse par l’eau du chenal. Puis ils entraient au moulin, plein d’une bonne odeur de farine, et ils buvaient dans l’étable le lait écumant trait par la meunière au pis d’une vache rousse. Ils laissaient le moulin ombragé par des ormes immenses et retournaient au bastidon. A huit heures, ils auraient dû être au collège. (M. Péluque s’offrit, en ce mois de juin, de fréquentes parties solitaires de pêche à la ligne.) Pépin des Grillons et Montclar déjeunaient, aux Sièyes, sur la terrasse de l’auberge du village. Au demeurant, ils étudiaient, couchés à plat ventre dans le pré, à l’ombre, tous les jours, de deux à cinq heures, la philosophie dans le manuel de M. Péluque. Ils lurent même une partie notable des œuvres de Descartes, de Malebranche, de Condillac; ils lurent surtout, ensemble, le poème de Lucrèce: De naturâ rerum. Mais, au milieu d’un vers, entre un spondée et un dactyle, parfois ils s’interrompaient pour observer un petit scarabée grimpant à un brin d’herbe, et, parvenu à la pointe, descendant de l’autre côté.– Cependant, après deux semaines, ils durent revenir à la ville. M. Pé luque, qui, peut-être, désirait avoir l’air de gagner ses appointements, avait fait de vives réclamations.
Malgré le laisser-aller buissonnier de ses études, pas plus que l’année précédente, Montclar ne fut blacboulé à son examen. Il dut se décider à choisir une profession. Le principal, à cause de la note, bien, que Patrice avait eue à ses deux examens, lui parla d’une place de maître répétiteur dans un lycée de Paris. pour s’y préparer à l’Ecole Normale. Patrice fit sa demande qui fut acceptée. Ses parents et ses amis, Gassendi, Pépin des Grillons, Autric l’accompagnèrent à la gare. Au bas du Cours, avant de passer le Grand-Pont, ils distinguèrent assez bien Rosalie, la nièce de Galissian, qui allait à l’atelier de Paticlet. Elle marchait, alerte.
–Dite! Quelle route mon amoureux a pris?
–Ma mignonne, il a pris la route pour Paris.
La maman pleurait, et le père, qui contenait sa douleur intérieure, portait le sac de voyage de son fils, en pen sant que les vieux allaient rester seuls. Le départ du train était à sept heures. Pa trice embrassa ses parents, ses amis, et monta dans un compartiment de troisième. Les wagons s’ébranlèrent. Il vit sa mère qui, debout derrière les barrières de la gare, regardait pour apercevoir en core son fils. Il parut à la fenêtre et cria, la voix étranglée:
–Adieu, maman!
Il ferma la vitre, et, s’accotant dans un coin, il songea. Son cœur se brisait en lui. La vie commençait vraiment, et il allait manger du pain pour lequel il aurait peiné. Que lui réservait l’inconnu, le lendemain?