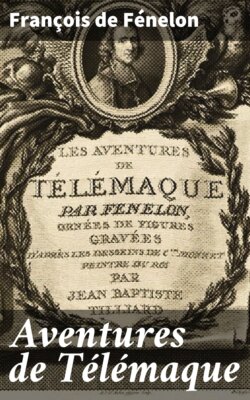Читать книгу Aventures de Télémaque - François de Fénelon - Страница 10
LIVRE TROISIÈME
ОглавлениеSuite du récit de Télémaque. — Le successeur de Bocchoris rendant tous les prisonniers phéniciens, Télémaque est emmené avec eux sur le vaisseau de Narbal, qui commandait la flotte tyrienne. Pendant le trajet, Narbal lui dépeint la puissance des Phéniciens, et le triste esclavage auquel ils sont réduits par le soupçonneux et cruel Pygmalion. Télémaque, retenu quelque temps à Tyr, observe attentivement l’opulence et la prospérité de cette grande ville. Narbal lui apprend par quels moyens elle est parvenue à un état si florissant. Cependant Télémaque étant sur le point de s’embarquer pour l’île de Chypre, Pygmalion découvre qu’il est étranger et veut le faire prendre; mais Astarbé, maîtresse du tyran, le sauve pour faire mourir à sa place un jeune homme dont le mépris l’avait irritée. Télémaque s’embarque enfin sur un vaisseau chyprien, pour retourner à Ithaque par l’île de Chypre.
Calypso écoutait avec étonnement des paroles si sages. Ce qui la charmait le plus était de voir que Télémaque racontait ingénument les fautes qu’il avait faites par précipitation et en manquant de docilité pour le sage Mentor; elle trouvait une noblesse et une grandeur étonnantes dans ce jeune homme qui s’accusait lui-même, et qui paraissait avoir si bien profité de ses imprudences pour se rendre sage, prévoyant et modéré. «Continuez, disait-elle, mon cher Télémaque; il me tarde de savoir comment vous sortîtes de l’Egypte, où vous avez retrouvé le sage Mentor, dont vous aviez senti la perte avec tant de raison.»
Télémaque reprit ainsi son discours: «Les Égyptiens les plus vertueux et les plus fidèles au roi étant les plus faibles et voyant le roi mort, furent contraints de céder aux autres: on établit un autre roi nommé Termutis. Les Phéniciens, avec les troupes de l’île de Chypre, se retirèrent après avoir fait alliance avec le nouveau roi. Celui-ci rendit tous les prisonniers phéniciens: je fus compté comme étant de ce nombre. On me fit sortir de la tour; je m’embarquai avec les autres, et l’espérance commença à reluire au fond de mon cœur. Un vent favorable remplissait déjà nos voiles, les rameurs fendaient les ondes écumantes, la vaste mer était couverte de navires; les mariniers poussaient des cris de joie; les rivages d’Égypte s’enfuyaient loin de nous; les collines et les montagnes s’aplanissaient peu à peu. Nous commencions à ne voir plus que le ciel et l’eau, pendant que le soleil, qui se levait, semblait faire sortir du sein de la mer ses feux étincelants; ses rayons doraient le sommet des montagnes que nous découvrions encore un peu sur l’horizon, et tout le ciel, peint d’un sombre azur, nous promettait une heureuse navigation.
«Quoiqu’on m’eût renvoyé comme étant Phénicien, aucun des Phéniciens avec qui j’étais ne me connaissait. Narbal, qui commandait dans le vaisseau où l’on me mit, me demanda mon nom et ma patrie. «De quelle ville de Phénicie êtes-vous? me dit-il. — Je ne suis point Phénicien, lui dis-je; mais les Égyptiens m’avaient pris sur la mer dans un vaisseau de Phénicie. J’ai demeuré captif en Égypte comme un Phénicien; c’est sous ce nom que j’ai longtemps souffert; c’est sous ce nom qu’on m’a délivré. — De quel pays êtes-vous donc?» reprit Narbal. Alors je lui parlai ainsi: «Je suis Télémaque, fils d’Ulysse, roi d’Ithaque, en Grèce. Mon père s’est rendu fameux entre tous les rois qui ont assiégé la ville de Troie: mais les dieux ne lui ont pas accordé de revoir sa patrie. Je l’ai cherché en plusieurs pays; la fortune me persécute comme lui: vous voyez un malheureux qui ne soupire qu’après le bonheur de retourner parmi les siens et de trouver son père.»
«Narbal me regardait avec étonnement, et il crut apercevoir en moi je ne sais quoi d’heureux qui vient des dons du ciel et qui n’est point dans le commun des hommes. Il était naturellement sincère et généreux; il fut touché de mon malheur, et me parla avec une confiance que les dieux lui inspirèrent pour me sauver d’un grand péril.
«Télémaque, je ne doute point, me dit-il, de ce que vous me dites, et je ne saurais en douter; la douleur et la vertu peintes sur votre visage ne me permettent pas de me défier de vous; je sens même que les dieux, que j’ai toujours servis, vous aiment, et qu’ils veulent que je vous aime aussi comme si vous étiez mon fils. Je vous donnerai un conseil salutaire, et pour récompense je ne vous demande que le secret. — Ne craignez point, lui dis-je, que j’aie aucune peine à me taire sur les choses que vous voudrez me confier; quoique je sois si jeune. j’ai déjà vieilli dans l’habitude de ne dire jamais mon secret, et encore plus de ne trahir jamais, sous aucun prétexte, le secret d’autrui. — Comment avez-vous pu, me dit-il, vous accoutumer au secret dans une si grande jeunesse? Je serai ravi d’apprendre par quel moyen vous avez acquis cette qualité, qui est le fondement de la plus sage conduite, et sans laquelle tous les talents sont inutiles.
«— Quand Ulysse, lui dis-je, partit pour aller au siège de Troie, il me prit sur ses genoux et entre ses bras (c’est ainsi qu’on me l’a raconté); après m’avoir baisé tendrement, il me. dit ces paroles, quoique je ne pusse les entendre: «O mon fils, que les dieux me préservent de te revoir jamais; que plutôt le ciseau de la Parque tranche le fil de tes jours lorsqu’il est à peine formé, de même que le moissonneur tranche de sa faux une tendre fleur qui commence à éclore; que mes ennemis te puissent écraser aux yeux de ta mère et aux miens, si tu dois un jour te corrompre et abandonner la vertu! O mes amis, continua-t-il, je vous laisse ce fils qui m’est si cher: ayez soin de son enfance; si vous m’aimez, éloignez de lui la pernicieuse flatterie; enseignez-lui à se vaincre; qu’il soit comme un jeune arbrisseau encore tendre, qu’on plie pour le redresser. Surtout n’oubliez rien pour le rendre juste, bienfaisant, sincère, et fidèle à garder un secret. Quiconque est capable de mentir est indigne d’être compté au nombre des hommes, et quiconque ne sait pas se taire est indigne de gouverner.»
«Je vous rapporte ces paroles parce qu’on a eu soin de me les répéter souvent, et qu’elles ont pénétré jusqu’au fond de mon cœur: je me les redis souvent à moi-même. Les amis de mon père eurent soin de m’exercer de bonne heure au secret; j’étais encore dans la plus tendre enfance, et ils me confiaient déjà toutes les peines qu’ils ressentaient, voyant ma mère exposée à un grand nombre de téméraires qui voulaient l’épouser. Ainsi on me traitait dès lors comme un homme raisonnable et sûr; on m’entretenait secrètement des plus grandes affaires; on m’instruisait de tout ce qu’on avait résolu pour écarter ces prétendants. J’étais ravi qu’on eût en moi cette confiance: par là je me croyais déjà un homme fait. Jamais je n’en ai abusé ; jamais il ne m’a échappé une seule parole qui pût découvrir le moindre secret. Souvent les prétendants tâchaient de me faire parler, espérant qu’un enfant, qui pourrait avoir vu ou entendu quelque chose d’important, ne saurait pas se retenir; mais je savais bien leur répondre sans mentir, et sans leur apprendre ce que je ne devais pas dire.
«Alors Narbal me dit: «Vous voyez, Télémaque, la puissance des Phéniciens; ils sont redoutables à toutes les nations voisines par leurs innombrables vaisseaux; le commerce qu’ils font jusques aux colonnes d’Hercule leur donne des richesses qui surpassent celles des peuples les plus florissants. Le grand roi Sésostris, qui n’aurait jamais pu les vaincre par mer, eut bien de la peine à les vaincre par terre, avec ses armées qui avaient conquis tout l’Orient; il nous imposa un tribut que nous n’avons pas longtemps payé ; les Phéniciens se trouvaient trop riches et trop puissants pour porter patiemment le joug de la servitude; nous reprîmes notre liberté. La mort ne laissa pas à Sésostris le temps de finir la guerre contre nous. Il est vrai que nous avions tout à craindre de sa sagesse encore plus que de sa puissance; mais sa puissance passant dans les mains de son fils, dépourvu de toute sagesse, nous conclûmes que nous n’avions plus rien à craindre. En effet, les Égyptiens, bien loin de rentrer les armes à la main dans notre pays pour nous subjuguer encore une fois, ont été contraints de nous appeler à leur secours pour les délivrer de ce roi impie et furieux. Nous avons été leurs libérateurs. Quelle gloire ajoutée à la liberté et à l’opulence des Phéniciens!
«Mais pendant que nous délivrons les autres, nous sommes esclaves nous-mêmes. O Télémaque, craignez de tomber dans les mains de Pygmalion, notre roi; il les a trempées, ces mains cruelles, dans le sang de Sichée, mari de Didon, sa sœur. Didon, pleine du désir de la vengeance, s’est sauvée de Tyr avec plusieurs vaisseaux. La plupart de ceux qui aiment la vertu et la liberté l’ont suivie: elle a fondé sur la côte d’Afrique une superbe ville qu’on nomme Carthage. Pygmalion, tourmenté par une soif insatiable des richesses, se rend de plus en plus misérable et odieux à ses sujets. C’est un crime à Tyr que d’avoir de grands biens; l’avarice le rend défiant, soupçonneux, cruel; il persécute les riches, et il craint les pauvres.
«C’est un crime encore plus grand à Tyr d’avoir de la vertu; car Pygmalion suppose que les bons ne peuvent souffrir ses injustices et ses infamies; la vertu le condamne, il s’aigrit et s’irrite contre elle. Tout l’agite, l’inquiète, le ronge; il a peur de son ombre; il ne dort ni nuit ni jour. Les dieux, pour le confondre, l’accablent de trésors dont il n’ose jouir. Ce qu’il cherche pour être heureux est précisément ce qui l’empêche de l’être. Il regrette tout ce qu’il donne; il craint toujours de perdre, il se tourmente pour gagner.
«On ne le voit presque jamais; il est seul, triste, abattu, au fond de son palais: ses amis même n’osent l’aborder, de peur de lui devenir suspects. Une garde terrible tient toujours des épées nues et des piques levées autour de sa maison. Trente chambres qui communiquent les unes aux autres, et dont chacune a une porte de fer avec six gros verrous, sont le lieu où il se renferme; on ne sait jamais dans laquelle de ces chambres il couche, et on assure qu’il ne couche jamais deux nuits de suite dans la même, de peur d’y être égorgé. Il ne connaît ni les doux plaisirs, ni l’amitié encore plus douce; si on lui parle de chercher la joie, il sent qu’elle fuit loin de lui et qu’elle refuse d’entrer dans son cœur. Ses yeux creux sont pleins d’un feu âpre et farouche; ils sont sans cesse errants de tous côtés; il prête l’oreille au moindre bruit et se sent tout ému; il est pâle, défait, et les noirs soucis sont peints sur son visage toujours ridé. Il se tait, il soupire, il tire de son cœur de profonds gémissements; il ne peut cacher les remords qui déchirent ses entrailles. Les mets les plus exquis le dégoûtent. Ses enfants, loin d’être son espérance, sont le sujet de sa terreur: il en a fait ses plus dangereux ennemis. Il n’a eu toute sa vie aucun moment d’assuré ; il ne se conserve qu’à force de répandre le sang de tous ceux qu’il craint. Insensé, qui ne voit pas que sa cruauté, à laquelle il se confie, le fera périr! Quelqu’un de ses domestiques, aussi défiant que lui, se hâtera de délivrer le monde de ce monstre.
«Pour moi, je crains les dieux: quoi qu’il m’en coûte, je serai fidèle au roi qu’ils m’ont donné. J’aimerais mieux qu’il me fit mourir que de lui ôter la vie, et même que de manquer à le défendre. Pour vous, ô Télémaque, gardez-vous bien de lui dire que vous êtes le fils d’Ulysse: il espérerait qu’Ulysse, retournant à Ithaque, lui payerait quelque grande somme pour vous racheter, et il vous tiendrait en prison.»
«Quand nous arrivâmes à Tyr, je suivis le conseil de Narbal, et je reconnus la vérité de tout ce qu’il m’avait raconté. Je ne pouvais comprendre qu’un homme pût se rendre aussi misérable que Pygmalion me le paraissait.
«Surpris d’un spectacle si affreux et si nouveau pour moi, je disais en moi-même: Voilà un homme qui n’a cherché qu’à se rendre heureux; il a cru y parvenir par les richesses et par une autorité absolue: il possède tout ce qu’il peut désirer, et cependant il est misérable par ses richesses et par son autorité même. S’il était berger, comme je l’étais naguère, il serait aussi heureux que je l’ai été ; il jouirait des plaisirs innocents de la campagne, et en jouirait sans remords; il ne craindrait ni le fer ni le poison; il aimerait les hommes, il en serait aimé ; il n’aurait point ces grandes richesses qui lui sont aussi inutiles que du sable, puisqu’il n’ose y toucher; mais il jouirait librement des fruits de la terre, et ne souffrirait aucun véritable besoin. Cet homme paraît faire tout ce qu’il veut; mais il s’en faut bien qu’il ne le fasse; il fait tout ce que veulent ses passions féroces; il est toujours entraîné par son avarice, par sa crainte, par ses soupçons. Il paraît maître de tous les autres hommes; mais il n’est pas maître de lui-même, car il a autant de maîtres et de bourreaux qu’il a de désirs violents.
«Je raisonnais ainsi de Pygmalion sans le voir; car on ne le voyait point, et on regardait seulement avec crainte ces hautes tours, qui étaient nuit et jour entourées de gardes, où il s’était mis lui-même comme en prison, se renfermant avec ses trésors. Je comparais ce roi invisible avec Sésostris, si doux, si accessible, si affable, si curieux de voir les étrangers, si attentif à écouter tout le monde, et à tirer du cœur des hommes la vérité qu’on cache aux rois. Sésostris, disais-je, ne craignait rien, et n’avait rien à craindre; il se montrait à tous ses sujets comme à ses propres enfants; celui-ci craint tout, et a tout à craindre. Ce méchant roi est toujours exposé à une mort funeste, même dans son palais inaccessible, au milieu de ses gardes; au contraire, le bon roi Sésostris était en sûreté au milieu de la foule des peuples, comme un bon père dans sa maison, environné de sa famille.
«Pygmalion donna ordre de renvoyer les troupes de l’île de Chypre qui étaient venues secourir les siennes à cause de l’alliance qui était entre les deux peuples. Narbal prit cette occasion de me mettre en liberté ; il me fit passer en revue parmi les soldats chypriens, car le roi était ombrageux jusque dans les moindres choses. Le défaut des princes trop faciles et inappliqués est de se livrer avec une aveugle confiance à des favoris artificieux et corrompus. Le défaut de celui-ci était, au contraire, de se défier des plus honnêtes gens: il ne savait point discerner les hommes droits et simples qui agissent sans déguisement; aussi n’avait-il jamais vu de gens de bien, car de telles gens ne vont point chercher un roi si corrompu. D’ailleurs il avait vu, depuis qu’il était sur le trône, dans les hommes dont il s’était servi, tant de dissimulation, de perfidie et de vices affreux déguisés sous les apparences de la vertu, qu’il regardait tous les hommes, sans exception, comme s’ils eussent été masqués. Il supposait qu’il n’y a aucune sincère vertu sur la terre; ainsi il regardait tous les hommes comme étant à peu près égaux. Quand il trouvait un homme faux et corrompu, il ne se donnait point la peine d’en chercher un autre, comptant qu’un autre ne serait pas meilleur. Les bons lui paraissaient pires que les méchants les plus déclarés, parce qu’il les croyait aussi méchants et plus trompeurs.
«Pour revenir à moi, je fus confondu avec les Chypriens, et j’échappai à la défiance pénétrante du roi. Narbal tremblait, dans la crainte que je ne fusse découvert; il lui en eût coûté la vie et à moi aussi. Son impatience de nous voir partir était incroyable; mais les vents contraires nous retinrent assez longtemps à Tyr.
«Je profitai de ce séjour pour connaître les mœurs des Phéniciens, si célèbres dans toutes les nations connues. J’admirais l’heureuse situation de cette grande ville, qui est au milieu de la mer, dans une île. La côte voisine est délicieuse par sa fertilité, par les fruits exquis qu’elle porte, par le nombre des villes et des villages qui se touchent presque, enfin par la douceur de son climat; car les montagnes mettent cette côte à l’abri des vents brûlants du midi; elle est rafraîchie par le vent du nord, qui souffle du côté de la mer. Ce pays est au pied du Liban, dont le sommet fend les nues et va toucher les astres; une glace éternelle couvre son front; des fleuves pleins de neige tombent comme des torrents des pointes des rochers qui environnent sa tête. Au-dessous on voit une vaste forêt de cèdres antiques, qui paraissent aussi vieux que la terre où ils sont plantés, et qui portent leurs branches épaisses jusque vers les nues. Cette forêt a sous ses pieds de gras pâturages dans la pente de la montagne. C’est là qu’on voit errer les taureaux qui mugissent, les brebis qui bêlent, avec leurs tendres agneaux qui bondissent sur l’herbe fraîche; là coulent mille divers ruisseaux d’une eau claire, qui distribuent l’eau partout. Enfin on voit au-dessous de ces pâturages le pied de la montagne qui est comme un jardin; le printemps et l’automne y règnent ensemble pour y joindre les fleurs et les fruits. Jamais ni le souffle empesté du midi, qui sèche et qui brûle tout, ni le rigoureux aquilon, n’ont osé effacer les vives couleurs qui ornent ce jardin.
«C’est auprès de cette belle côte que s’élève dans la mer l’île où est bâtie la ville de Tyr. Cette grande ville semble nager au-dessus des eaux, et être la reine de toute la mer. Les marchands y abordent de toutes les parties du monde, et ses habitants sont eux-mêmes les plus fameux marchands qu’il y ait dans l’univers. Quand on entre dans cette ville, on croit d’abord que ce n’est point une ville qui appartienne à un peuple particulier, mais qu’elle est la ville commune de tous les peuples, et le centre de leur commerce. Elle a deux grands môles, semblables à deux bras, qui s’avancent dans la mer, et qui embrassent un vaste port où les vents ne peuvent entrer. Dans ce port on voit comme une forêt de mâts de navires, et ces navires sont si nombreux qu’à peine peut-on découvrir la mer qui les porte. Tous les citoyens s’appliquent au commerce, et leurs grandes richesses ne les dégoûtent jamais du travail nécessaire pour les augmenter. On y voit de tous côtés le fin lin d’Egypte et la pourpre tyrienne deux fois teinte, d’un éclat merveilleux; cette double teinture est si vive, que le temps ne peut l’effacer: on s’en sert pour des laines fines, qu’on rehausse d’une broderie d’or et d’argent. Les Phéniciens font le commerce de tous les peuples jusqu’au détroit de Gadès, et ils ont même pénétré dans le vaste océan qui environne toute la terre. Ils ont fait aussi de longues navigations sur la mer Rouge, et c’est par ce chemin qu’ils vont chercher, dans des îles inconnues, de l’or, des parfums, et divers animaux qu’on ne voit point ailleurs.
«Je ne pouvais rassasier mes yeux du spectacle magnifique de cette grande ville où tout était en mouvement. Je n’y voyais point, comme dans les villes de la Grèce, des hommes oisifs et curieux, qui vont chercher des nouvelles dans la place publique, ou regarder les étrangers qui arrivent sur le port. Les hommes y sont occupés à décharger leurs vaisseaux, à transporter leurs marchandises ou à les vendre, à ranger leurs magasins, et à tenir un compte exact de ce qui leur est dû par les négociants étrangers. Les femmes ne cessent jamais ou de filer les laines, ou de faire des dessins de broderie, ou de plier les riches étoffes.
«D’où vient, disais-je à Narbal, que les Phéniciens se sont rendus les maîtres du commerce de toute la terre, et qu’ils s’enrichissent ainsi aux dépens de tous les autres peuples? — Vous le voyez, me répondit-il; la situation de Tyr est heureuse pour le commerce. C’est notre patrie qui a la gloire d’avoir inventé la navigation; les Tyriens furent les premiers, s’il en faut croire ce qu’on raconte de la plus obscure antiquité, qui domptèrent les flots longtemps avant l’âge de Tiphys et des Argonautes tant vantés dans la Grèce; ils furent, dis-je, les premiers qui osèrent se mettre dans un frêle vaisseau à la merci des vagues et des tempêtes, qui sondèrent les abîmes de la mer, qui observèrent les astres loin de la terre, suivant la science des Égyptiens et des Babyloniens; enfin qui réunirent tant de peuples que la mer avait séparés. Les Tyriens sont industrieux, patients, laborieux, propres, sobres et ménagers; ils ont une exacte police; ils sont parfaitement d’accord entre eux; jamais peuple n’a été plus constant, plus sincère, plus fidèle, plus sûr, plus commode à tous les étrangers.
«Voilà, sans aller chercher d’autres causes, ce qui leur donne l’empire de la mer, et qui fait fleurir dans leurs ports un si utile commerce. Si la division et la jalousie se mettaient entre eux; s’ils commençaient à s’amollir dans les délices et dans l’oisiveté ; si les premiers de la nation méprisaient le travail et l’économie; si les arts cessaient d’être en honneur dans leur île; s’ils manquaient de bonne foi envers les étrangers; s’ils altéraient tant soit peu les règles d’un commerce libre; s’ils négligeaient leurs manufactures, et s’ils cessaient de faire les grandes avances qui sont nécessaires pour rendre leurs marchandises parfaites, chacune dans son genre, vous verriez bientôt tomber cette puissance que vous admirez.
«— Mais expliquez-moi, lui disais-je, les vrais moyens d’établir un jour à Ithaque un pareil commerce. — Faites, me répondit-il, comme on fait ici: recevez bien et facilement tous les étrangers; faites-leur trouver dans vos ports la sûreté, la commodité, la liberté entière; ne vous laissez jamais entraîner ni par l’avarice ni par l’orgueil. Le vrai moyen de gagner beaucoup est de ne vouloir jamais trop gagner, et de savoir perdre à propos. Faites-vous aimer par tous les étrangers; souffrez même quelque chose d’eux; craignez d’exciter leur jalousie par votre hauteur; soyez constant dans les règles du commerce; qu’elles soient simples et faciles; accoutumez vos peuples à les suivre inviolablement; punissez sévèrement la fraude, et même la négligence ou le faste des marchands, qui, ruinent le commerce en ruinant les hommes qui le font.
«Surtout n’entreprenez jamais de gêner le commerce pour le tourner selon vos vues. Il faut que le prince ne s’en mêle point, de peur de le gêner, et qu’il en laisse tout le profit à ses sujets qui en ont la peine; autrement il les découragera: il en tirera assez d’avantages par les grandes richesses qui entreront dans ses États. Le commerce est comme certaines sources: si vous voulez détourner leur cours, vous les faites tarir. Il n’y a que le profit et la commodité qui attirent les étrangers chez vous; si vous leur rendez le commerce moins commode et moins utile, ils se retirent insensiblement, et ne reviennent plus, parce que d’autres peuples, profitant de votre imprudence, les attirent chez eux, et les accoutument à se passer de vous. Il faut même vous avouer que depuis quelque temps la gloire de Tyr est bien obscurcie. Oh! si vous l’aviez vue, mon cher Télémaque, avant le règne de Pygmalion, vous auriez été bien plus étonné ! Vous ne trouvez plus maintenant ici que les tristes restes d’une grandeur qui menace ruine. O malheureuse Tyr, en quelles mains es-tu tombée! autrefois la mer t’apportait le tribut de tous les peuples de la terre.
«Pygmalion craint tout et des étrangers et de ses sujets. Au lieu d’ouvrir, suivant notre ancienne coutume, ses ports à toutes les nations les plus éloignées, dans une entière liberté, il veut savoir le nombre des vaisseaux qui arrivent, leur pays, les noms des hommes qui y sont, leur genre de commerce, la nature et le prix de leurs marchandises, et le temps qu’ils doivent demeurer ici. Il fait encore pis: car il use de supercherie pour surprendre les marchands, et pour confisquer leurs marchandises. Il inquiète les marchands qu’il croit les plus opulents; il établit, sous divers prétextes, de nouveaux impôts. Il veut entrer lui-même dans le commerce, et tout le monde craint d’avoir quelque affaire avec lui. Ainsi le commerce languit; les étrangers oublient peu à peu le chemin de Tyr, qui leur était autrefois si doux; et, si Pygmalion ne change de conduite, notre gloire et notre puissance seront bientôt transportées à quelque autre peuple mieux gouverné que nous.»
«Je demandai ensuite à Narbal comment les Tyriens s’étaient rendus si puissants sur la mer: car je voulais n’ignorer rien de tout ce qui sert au gouvernement d’un royaume. «Nous avons, me répondit-il, les forêts du Liban qui fournissent le bois des vaisseaux, et nous les réservons avec soin pour cet usage: on n’en coupe jamais que pour les besoins publics. Pour la construction des vaisseaux, nous avons l’avantage d’avoir des ouvriers habiles. — Comment, lui disais-je, avez-vous pu faire pour trouver ces ouvriers?»
«Il me répondait: «Ils se sont formés peu à peu dans le pays. Quand on récompense bien ceux qui excellent dans les arts, on est sûr d’avoir bientôt des hommes qui les mènent à leur dernière perfection; car les hommes qui ont le plus de sagesse et de talents ne manquent point de s’adonner aux arts auxquels les grandes récompenses sont attachées. Ici on traite avec honneur tous ceux qui réussissent dans les arts et dans les sciences utiles à la navigation. On considère un bon géomètre; on estime fort un habile astronome; on comble de biens un pilote qui surpasse les autres dans sa fonction; on ne méprise point un bon charpentier: au contraire, il est bien payé et bien traité. Les bons rameurs même ont des récompenses sûres et proportionnées à leurs services: on les nourrit bien; on a soin d’eux quand ils sont malades; en leur absence on a soin de leurs femmes et de leurs enfants; s’ils périssent dans un naufrage, on dédommage leur famille; on renvoie chez eux ceux qui ont servi un certain temps. Ainsi on en a autant qu’on en veut: le père est ravi d’élever son fils dans un si bon métier, et, dès sa plus tendre jeunesse, il se hâte de lui enseigner à manier la rame, à tendre les cordages, et à mépriser les tempêtes. C’est ainsi qu’on mène les hommes, sans contrainte, par la récompense et par le bon ordre. L’autorité seule ne fait jamais bien; la soumission des inférieurs ne suffit pas: il faut gagner les cœurs, et faire trouver aux hommes leur avantage dans les choses où l’on veut se servir de leur industrie.»
«Après ce discours, Narbal me mena visiter tous les magasins, les arsenaux, et tous les métiers qui servent à la construction des navires. Je demandais le détail des moindres choses, et j’écrivais tout ce que j’avais appris, de peur d’oublier quelque circonstance utile.
«Cependant Narbal, qui connaissait Pygmalion, et qui m’aimait, attendait avec impatience mon départ, craignant que je ne fusse découvert par les espions du roi, qui allaient nuit et jour par toute la ville; mais les vents ne nous permettaient point encore de nous embarquer. Pendant que nous étions occupés à visiter curieusement le port et à interroger divers marchands, nous vîmes venir à nous un officier de Pygmalion, qui dit à Narbal: «Le roi vient d’apprendre d’un des capitaines des vaisseaux qui sont revenus d’Égypte avec vous que vous avez mené d’Égypte un étranger qui passe pour Chyprien: le roi veut qu’on l’arrête, et qu’on sache certainement dé quel pays il est; vous en répondrez sur votre tête.» Dans ce moment je m’étais un peu éloigné pour regarder de plus près les proportions que les Tyriens avaient gardées dans la construction d’un vaisseau presque neuf, qui était, disait-on, par cette proportion si exacte de toutes ses parties, le meilleur voilier qu’on eût jamais vu dans le port, et j’interrogeais l’ouvrier qui avait réglé ces proportions.
«Narbal, surpris et effrayé, répondit: «Je vais chercher cet étranger, qui est de l’île de Chypre.» Quand il eut perdu de vue cet officier, il courut vers moi pour m’avertir du danger où j’étais. «Je ne l’avais que trop prévu, me dit-il, mon cher Télémaque, nous sommes perdus! Le roi, que sa défiance tourmente jour et nuit, soupçonne que vous n’êtes pas de l’île de Chypre; il ordonne qu’on vous arrête: il veut me faire périr si je ne vous mets entre ses mains. Que ferons-nous? O dieux, donnez-nous la sagesse pour nous tirer de ce péril. Il faudra, Télémaque, que je vous mène au palais du roi. Vous soutiendrez que vous êtes Chyprien, de la ville d’Amathonte, fils d’un statuaire de Vénus. Je déclarerai que j’ai connu autrefois votre père, et peut-être que le roi, sans approfondir davantage, vous laissera partir. Je ne vois plus d’autre moyen de sauver votre vie et la mienne.»
«Je répondis à Narbal: «Laissez périr un malheureux que le destin veut perdre. Je sais mourir, Narbal; et je vous dois trop pour vouloir vous entraîner dans mon malheur. Je ne puis me résoudre à mentir; je ne suis pas Chyprien, et je ne saurais dire que je le suis. Les dieux voient ma sincérité : c’est à eux à conserver ma vie par leur puissance, s’ils le veulent; mais je ne veux point la sauver par un mensonge.»
«Narbal me répondait: «Ce mensonge, Télémaque, n’a rien qui ne soit innocent; les dieux mêmes ne peuvent le condamner: il ne fait aucun mal à personne; il sauve la vie à deux innocents; il ne trompe le roi que pour l’empêcher de faire un grand crime. Vous poussez trop loin l’amour de la vertu et la crainte de blesser la religion.
«— Il suffit, lui disais-je, que le mensonge soit mensonge, pour n’être pas digne d’un homme qui parle en présence des dieux, et qui doit tout à la vérité. Celui qui blesse la vérité offense les dieux, et se blesse soi-même, car il parle contre sa confiance. Cessez, Narbal, de me proposer ce qui est indigne de vous et de moi. Si les dieux ont pitié de nous, ils sauront bien nous délivrer; s’ils veulent nous laisser périr, nous serons en mourant les victimes de la vérité, et nous laisserons aux hommes l’exemple de préférer la vertu sans tache à une longue vie. La mienne n’est déjà que trop longue, étant si malheureuse. C’est vous seul, ô mon cher Narbal, pour qui mon cœur s’attendrit. Fallait-il que votre amitié pour un malheureux étranger vous fût si funeste?»
«Nous demeurâmes longtemps dans cette espèce de combat; mais enfin nous vîmes arriver un homme qui courait hors d’haleine: c’était un autre officier du roi, qui venait de la part d’Astarbé.
«Cette femme était belle comme une déesse; elle joignait aux charmes du corps tous ceux de l’esprit; elle était enjouée, flatteuse, insinuante. Avec tant de charmes trompeurs, elle avait, comme les Sirènes, un cœur cruel et plein de malignité ; mais elle savait cacher ses sentiments corrompus par un profond artifice. Elle avait su gagner le cœur de Pygmalion par sa beauté, par son esprit, par sa douce voix et par l’harmonie de sa lyre. Pygmalion, aveuglé par un violent amour pour elle, avait abandonné la reine Topha, son épouse. Il ne songeait qu’à contenter toutes les passions de l’ambitieuse Astarbé : l’amour de cette femme ne lui était guère moins funeste que son infâme avarice. Mais, quoiqu’il eût tant de passion pour elle, elle n’avait pour lui que du mépris et du dégoût; elle cachait ses vrais sentiments, et elle faisait semblant de ne vouloir vivre que pour lui, dans le même temps où elle ne pouvait le souffrir.
«Il y avait à Tyr un jeune Lyctien nommé Malachon, d’une merveilleuse beauté, mais mou, efféminé, noyé dans les plaisirs. Il ne songeait qu’à conserver la délicatesse de son teint, qu’à peigner ses cheveux blonds flottants sur ses épaules, qu’à se parfumer, qu’à donner un tour gracieux aux plis de sa robe, enfin qu’à chanter ses amours sur sa lyre. Astarbé le vit, l’aima, et devint furieuse. Il la méprisa, parce qu’il était passionné pour une autre femme. D’ailleurs il craignit de s’exposer à la cruelle jalousie du roi. Astarbé, se sentant méprisée, s’abandonna à son ressentiment. Dans son désespoir, elle s’imagina qu’elle pouvait faire passer Malachon pour l’étranger que le roi faisait chercher, et qu’on disait qui était venu avec Narbal.
«En effet, elle le persuada à Pygmalion, et corrompit tous ceux qui auraient pu le détromper. Comme il n’aimait point les hommes vertueux, et qu’il ne savait point les discerner, il n’était environné que de gens intéressés, artificieux, prêts à exécuter ses ordres injustes et sanguinaires. De telles gens craignaient l’autorité d’Astarbé, et ils lui aidaient à tromper le roi, de peur de déplaire à cette femme hautaine qui avait toute sa confiance. Ainsi Malachon, quoique connu pour Lyctien dans toute la ville, passa pour le jeune étranger que Narbal avait emmené d’Égypte: il fut mis en prison.
«Astarbé, qui craignit que Narbal n’allât parler au roi et ne découvrît son imposture, envoyait en diligence à Narbal cet officier, qui lui dit ces paroles: «Astarbé vous défend de découvrir au roi quel est votre étranger; elle ne vous demande que le silence, et elle saura bien faire en sorte que le roi soit content de vous; cependant hâtez-vous de faire embarquer avec les Chypriens le jeune étranger que vous avez emmené d’Égypte, afin qu’on ne le voie plus dans la ville.» Narbal, ravi de pouvoir ainsi sauver sa vie et la mienne, promit de se taire; et l’officier, satisfait d’avoir obtenu ce qu’il demandait, s’en retourna rendre compte à Astarbé de sa commission.
«Narbal et moi, nous admirâmes la bonté des dieux, qui récompensaient notre sincérité, et qui ont un soin si touchant de ceux qui hasardent tout pour la vertu. Nous regardions avec horreur un roi livré à l’avarice et à la volupté. Celui qui craint avec tant d’excès d’être trompé, disions-nous, mérite de l’être, et l’est presque toujours grossièrement. Il se défie des gens de bien, et il s’abandonne à des scélérats: il est le seul qui ignore ce qui se passe. Voyez Pygmalion; il est le jouet d’une femme sans pudeur. Cependant les dieux se servent du mensonge des méchants pour sauver les bons, qui aiment mieux perdre la vie que de mentir.
«En même temps nous aperçûmes que les vents changeaient, et qu’ils devenaient favorables aux vaisseaux de Chypre. «Les dieux se déclarent, s’écria Narbal; ils veulent, mon cher Télémaque, vous mettre en sûreté : fuyez cette terre cruelle et maudite! Heureux qui pourrait vous suivre jusque dans les rivages les plus inconnus! heureux qui pourrait vivre et mourir avec vous! Mais un destin sévère m’attache à cette malheureuse patrie; il faut souffrir avec elle; peut-être faudra-t-il être enscveli dans ses ruines: n’importe, pourvu que je dise toujours la vérité, et que mon cœur n’aime que la justice. Pour vous, ô mon cher Télémaque, je prie les dieux, qui vous conduisent comme par la main, de vous accorder le plus précieux de tous leurs dons, qui est la vertu pure et sans tache, jusqu’à la mort. Vivez, retournez en Ithaque, consolez Pénélope, délivrez-la de ses téméraires amants. Que vos yeux puissent voir, que vos mains puissent embrasser le sage Ulysse, et qu’il trouve en vous un fils qui égale sa sagesse. Mais, dans votre bonheur, souvenez-vous du malheureux Narbal, et ne cessez jamais de m’aimer.»
«Quand il eut achevé ces paroles, je l’arrosai de mes larmes sans lui répondre: de profonds soupirs m’empêchaient de parler; nous nous embrassions en silence. Il me mena jusqu’au vaisseau; il demeura sur le rivage; et, quand le vaisseau fut parti, nous ne cessions de nous regarder tandis que nous pûmes nous voir.»