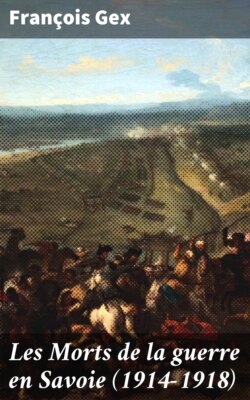Читать книгу Les Morts de la guerre en Savoie (1914-1918) - François Gex - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1° LE CADRE GÉOGRAPHIQUE
ОглавлениеTable des matières
La guerre est, finie; la vague de sang est écoulée. Seules, les larmes ne sont point toutes taries. C’est pourquoi, à la faveur des émotions violentes qui s’apaisent et pour empêcher la prescription du temps, le grand consolateur, qui chaque jour oblitère nos souvenirs et menace d’étendre sur la vision sanglante le voile de l’oubli, il sera bon de compter les manquants, de dresser l’état des pertes humaines de la Savoie. C’est un hommage que nous devons aux rescapés du drame gigantesque, à ses témoins relativement passifs, mais tous terrifiés et meurtris. Nous le devons surtout à la génération qui vient et qui ne nous pardonnerait pas de ne lui en avoir pas laissé le bilan, parce qu’elle aussi a été mutilée dans ses affections et qu’elle est destinée à en recueillir les fruits.
C’est à leur usage commun que cette étude s’efforcera d’établir une statistique complète et comparée des Morts de la guerre en Savoie, aussi exacte que possible. Il s’y révélera des différences frappantes dans le taux de la mortalité suivant les régions bien tranchées qui forment l’ensemble si divers mais si bien harmonisé de notre département.
Sa géographie l’a découpé en zones longitudinales, grossièrement parallèles et qui se retrouvent d’ailleurs dans les autres départements alpestres, particulièrement dans le Dauphiné et en Haute-Savoie.
A l’Ouest s’étend la région qui correspond à peu près à l’arrondissement de Chambéry et qu’on désigne souvent fort improprement sous les noms de Basse Savoie, ce qui est incomplet, de bas pays ou de Savoie préalpestre, ce qui est en partie inexact ou trop vague. Il vaudrait mieux lui restituer sa désignation provinciale très précise et sans équivoque du régime sarde: la Savoie Propre. En tout cas, c’est de beaucoup la région la plus homogène, bien que disparate de structure. Elle comprend une zone plissée qui continue chez nous le Jura: le Petit Bugey. De larges vallées au fond mollassique. glaciaire et alluvial y alternent avec des montagnes calcaires et marneuses, aux crêtes bien régulières, presque rectilignes et d’altitude moyenne: le Mont-Tournier, la chaîne de l’Epine où culmine la Dent-du-Chat à 1.400m et, par-delà le fossé du lac du Bourget, la Chambotte qui s’infléchit avec le Corsuet sous le bas Sierroz vers Aix-les-Bains pour expirer au Roc du Roi à Marlioz.
A l’Est, le Massif des Bauges où 7 plis alignent leurs hautes murailles calcaires de plus en plus pressées entre des vallées surélevées dont l’une, transversale, celle du Chéran, égoutte le massif humide et boisé par la trouée de Bange, péniblement ouverte, et comme burinée dans la dure carapace calcaire du Semnoz. Au Sud, le bassin du Guiers-Vif ou des Entremonts nous réserve une partie du domaine de la Chartreuse, avec les mêmes caractères
Entre ces massifs, s’ouvrent les larges et profondes vallées du bas pays, à qui Chambéry sert de carrefour. Au Nord, l’Albanais, d’Aix à Rumilly, entre le Revard-Semnoz et la Chambotte; la vallée du Bourget et de l’Hyères; les vallées de la Leysse et de l’Albanne ou cluse de Chambéry; vers l’Est, le grand fossé de la Combe de Savoie, la gouttière des Alpes de Savoie par excellence, où débouchent leurs rivières, leurs vallées et leurs routes: l’Arc, l’Isère, le Doron et l’Arly: un carrefour hydrographique, un vestibule, comme une avenue.
Dans toute cette région, un climat humide et tempéré favorise une végétation opulente: en haut la forêt, le taillis ou la prairie suivant l’altitude, l’exposition ou la présence d’un sol marneux, calcaire ou glaciaire; en bas, des cultures prospères en un terrain de riches alluvions à propriété morcelée et faire-valoir intensif et direct. Sur les pentes d’éboulis bien mêlés, partout la vigne, amie de l’abri et du soleil, soigneusement tenue, et le plus souvent rémunératrice à l’égal d’un élevage toujours plus productif et accru. La grande industrie n’y compte presque pas, hors de timides apparitions, parce qu’à défaut de la main-d’œuvre il lui manque la force motrice: le combustible et la houille blanche. Le commerce y est actif et semble, en dehors du transit énorme de la grande voie Paris-Modane et qui profite peu au pays, en dehors de Chambéry, Saint-Jean et Modane, n’obéir qu’à l’attraction des centres d’affaires et marchés agricoles d’Aix, Rumilly, Chambéry, Saint-Pierre-d’Albigny. Aix mise à part, et dans une moindre mesure, Aiguebelette, les Bauges et la Chartreuse, le tourisme ne fait qu’y passer.
Au total, la Savoie Propre, ou arrondissement de Chambéry, abonde en ressources presque exclusivement agricoles. Et cela explique son peuplement essentiellement rural, dispersé, tout au plus rassemblé en gros villages dont la répartition est commandée par les points d’eau, près des sources, le long des rivières, sur les replats latéraux des vallées, bien exposés, près des bonnes terres ou du bien de famille; égrenés le long des routes ou à la «croisée des grands chemins». Au milieu d’eux, trônent les bourgs, marchés agricoles qui bénéficient de la nécessité des échanges agricoles, de l’approvisionnement et de l’outillage de l’exploitation. Au-dessus d’eux émergent deux vi les, Aix et Chambéry, à vie et physionomie bien différentes et qui représentent presque tout l’élément urbain de la région et de la Savoie.
Avec Grésy-sur-Isère nous abordons l’arrondissement d’Albertville, l’ancienne province sardede la Haute-Savoie. C’est une région mitoyenne, de confins, très hybride, une simple expression géographique ou qui n’a de géographique que le fait d’être un carrefour de basses vallées, la Combe de Savoie en amont de Grésy, la Basse Tarentaise en aval de Cevins, et de moyennes et hautes vallées: l’Arly de Flumet et d’Ugine, le Doron de Beaufort avec Hauteluce, Roselend et Arêches, tous vals pastoraux et forestiers. En effet, l’orientation de la Combe de Savoie, prolongée par le Val d’Arly, y engouffre les vents humides du S.-O. Les fortes altitudes du Grand-Arc, du Mirantin, du Beaufortin, du Joly et des Aravis y provoquent d’abondantes pluies et en font la région la plus arrosée peut-être de la Savoie. A leur pied, se retrouvent toutes les riches cultures de la plaine avec un vin inférieur mais compensé par un verger plus prospère. L’altitude croissante les décourage bien vite sur un terrain déjà cristallin et maigre et des pentes excessives. Pa contre elle ménage le triomphe dû bois et de la prairie. En haut, les fortes pluies et les puissantes réserves neigeuses assurent le débit de rivières bien alimentées et à profil raide et saccadé, riches en force motrice et pleines de séductions pour l’industrie hydro-électrique, chimique et métallurgique. Les 80.000 HP. concentrés à Ugine en ont fait, avec ses 3.000 ouvriers, la capitale de la houille blanche dans les Alpes et en France. Le bois, l’élevage, les produits pastoraux, bientôt l’anthracite d’Arêches, un tourisme honnête, sollicité par les splendeurs uniques de la région, en feront bientôt un coin béni et plantureux. La montagne sera devenue le «bon pays» à la place de la plaine voisine dont les ressources et la mise en valeur sont menacées par l’exode de sa main-d’œuvre sans cesse plus alléchée par l’appât des gros salaires faciles d’une usine toute proche qui n’imposera que l’abandon de la terre mais pas celui du pays.
Avec la Tarentaise et la Maurienne, nous entrons résolument dans la zone intra-alpine Ce sont deux vallées sœurs, jumelles même, la réplique presque exacte l’une de l’autre, à peine différenciées par un climat sensiblement plus humide et un paysage plus verdoyant en Tarentaise, plus variée et plus ouverte que la sévère et monotone Maurienne. Extrêmement convulsée et chaotique, un musée pétrographique, un chaos de plis tourmentés et chevauchant, cette région est pourtant toute simple à ne considérer que ses deux artères de pénétration que sont les vallées de ses deux rivières, l’Arc et l’Isère. Ce sont deux gigantesques torrents par définition, enflés périodiquement et presque régulièrement par de puissants torrents latéraux, souvent capricieux et fantasques, en Maurienne principalement. Une énorme muraille cristalline étrangle ces vallées à l’aval, les isole du bas pays, en fait des mondes à part où l’on se croirait à 100 lieues de Chambéry; des mondes fermés, n’étaient l’attraction des grands cols transalpins du Petit-Saint-Bernard et du Mont-Cenis, le transit et le trafic qui en résultent et dont, en tout temps, ces vallées furent animées. Cela leur a épargné l’abandon, le rôle solitaire et humilié de tant d’autres vallées alpestres, apparemment mieux favorisées, mais simples impasses et culs-de-sac. Au delà donc de la grande muraille cristalline de Belledonne, Grand-Arc, Mirantin et Grand-Mont qui les étrangle à Aiguebelle et à Conflans, s’ouvrent, de part et d’autre, une Basse Maurienne et une Basse Tarentaise. Leur plaine a tous les caractères et les ressources de celles du bas pays, mais avec l’avantage d’une énorme forêt sur les versants, des alpages vers les sommets et de la houille blanche de puissants torrents alimentés par de fortes réserves neigeuses. — En amont de Moûtiers et de Saint-Jean s’ouvrent les moyennes vallées: celle-ci plus évasée, plus riante, plus cultivable; celle-là austère, étranglée, une fissure dans la zone houillère aux maigres charbonnages, mais aussi avec une rivière plus rapide, plus motrice, plus industrielle, parce qu’à profil plus saccadé : l’Arc, la vallée de l’aluminium et des produits chimiques de la Cie d’Alais et de la Camargue qui égrène le chapelet de ses usines de Saint-Jean à Modane. — En amont de Modane et de Bourg-Saint-Maurice, c’est la haute vallée: série d’ombilics étagés ou de bassins glaciaires et remblayés, fermés par des verrous impressionnants mais qui se laissent facilement escalader ou tourner. Ici, dans les plaines âprement disputées aux torrents, se risquent des cultures de montagnes: seigle, pommes de terre et potagers. Le gros souci et la principale ressource, c’est le foin, disputé à des pentes abruptes, à la pierraille, aux «ravenas», à la neige qui menace de s’éterniser. Il n’est de bénéfices que ceux du bétail, de l’élevage des tarines, des brebis et de leurs fruits: beurre et persillé (Tignard ou Mont-Cenis), de la location des alpages aux transhumants, des spéculations dû maquignonnage aux foires. A cet effet, on ne regarde pas à la peine. D’ailleurs, si l’effort est dur, il ne dure pas. La saison active n’est qu’un coup de collier: 8 mois d’hiver et 4 mois d’enfer. La marmotte y foisonne et c’est un symbole: elle est faite à l’image du pays, du climat et du genre de vie. Beaucoup cependant cèdent à l’effort de la belle saison, plus encore à l’ennui et à l’âpreté d’un hiver interminable, estimant, non sans raison parfois, que la vie à ces altitudes est un gaspillage de forces. Ils émigrent de plus en plus nombreux, à la ville, en Algérie, dans les pays neufs, à la conquête de la vie facile, sinon plus heureuse et d’un confort qui leur fait déplorablement défaut. Ils s’en vont temporairement d’abord, mais le plus souvent définitivement. Ils sont perdus pour la montagne et pour le pays. Ils n’y reviennent que rarement, même s’ils n’ont pas réussi. En tout cas, l’industrie a peu de chance de les y ramener comme d’y maintenir les chancelants. La houille blanche y mugit de toutes parts; les glaciers s’y pressent pleins de promesses inutilisées, faute d’installation possible, faute de main-d’œuvre, mais faute surtout de moyens de transport pour l’alimentation en matières premières et l’écoulement des produits vers des gares absentes ou trop éloignées. On n’y pourra tenter que des captations en vue de la production d’une force à transporter au loin et sans utilité pour la région.
Telle se présente cette zone alpestre aux ressources agricoles étalées dans ses basses vallées et qui, à l’image d’une lame effilée, plongent vers l’amont et se terminent en pointe en une simple lanière dans les hautes vallées. Par contre, tout au long le commerce est actif, le trafic énorme, en des bourgs nés au pied des grands cols et aux confluents des vallées latérales, à Saint-Jean, Saint-Michel, Modane, Termignon, Lanslebourg; comme à Moûtiers et à Bourg dont les foires sont de plus en plus courues, achalandées, les belles races de la montagne appréciées et exportées au loin, dans tout le Midi jusqu’en Algérie Le tourisme lui-même y prospère brillamment en fonction de l’altitude, à la seule condition d’être assuré d’y trouver une convenable installation hôtelière et de rapides moyens d’amenée à pied-d’œuvre, c’est-à-dire au pied de la montagne séductrice et bienfaisante. Le transit prodigieux de la grande voie internationale profite peu à la Maurienne, si ce n’est à Modane, ville du tunnel du Fréjus et de sa gare internationale. Son développement y a éclipsé l’importance de Lanslebourg, ville de col, bourg déchu; comme elle a tué l’industrie hôtelière des autres bourgs en aval, qui vivaient de leurs relais, de leur qualité de «gîtes et repues», du trafic des voyageurs et marchandises, mais qui ont eu la bonne fortune d’être récemment et brillamment ranimées par les bienfaits de la houille blanche. Celle-ci en effet se fait partout tentatrice, et depuis 1893, chaque année, mais surtout pendant et depuis la guerre, y fixe capitaux, matériel, industries diverses, suscitant vers ses usines une ruée de main-d’œuvre de plus en plus cosmopolite.
Toutefois, il est juste de dire qu’avant de demander l’appoint de l’étranger, elle a opéré et maintient un fort prélèvement sur la main-d’œuvre locale, agricole et pastorale. — Nous allons en surprendre les effets dans la Statistique des Morts; car ces bienfaisantes usines lui auront valu, outre le bénéfice des gros salaires de la guerre, l’avantage de l’avoir mise en sécurité et défendue efficacement contre la mortalité du front.
Dans l’ensemble, ce remarquable développement industriel ne doit pas faire illusion sur le caractère éminemment rural du pays. Outre qu’il est récent et que la guerre l’a intensifié, en attendant son plein rendement à venir et l’appoint que lui apporteront les projets grandioses de l’aménagement du Rhône et de l’Isère, il demeure et ne sera jamais que strictement localisé le long des cours d’eau, générateurs de force, en des vallées qui seules peuvent autoriser la pénétration, l’installation et l’écoulement. Toutes sont ou peuvent être appelées à devenir des rues d’usines, groupées en des centres où se concentreront la main-d’œuvre et l’exploitation: le Guiers, avec Les Echelles, Saint-Béron, Le Pont et Saint-Genix; le Chéran, d’Ecole-Le Châtelard à Rumilly; la Leysse, à Saint-Alban; le Bréda et le Gelon, dans la région de La Rochette; l’Arly, de Flumet à Ugine; le Doron, de Beaufort à Venthon; l’Arc et l’Isère avec le rang éminent déjà acquis et qui peut promettre plus que le double quand seront équipées toutes les forces de leurs torrents latéraux, à l’imitation des Dorons de Bozel.
Découpé par ces artères, subsiste entier et immense le domaine de la culture, des pâturages et de la forêt. Le recensement de 1911, sur 132.000 déclarations de profession, accuse 89.000 personnes occupées à l’agriculture, soit plus des 2/3. Sur les 43.000 qui ne vivent pas de la terre, la grande industrie en réclame 12.000 seulement travaillant dans des exploitations de plus de 20 personnes, dont 1.000 seulement à Chambéry, 1.700 en leur adjoignant les cheminots, et 5.600 dans les usines de la houille blanche. Il sera facile de les retrouver au cours de la Statistique des Morts de la guerre, lorsqu’elle nous promènera le long des rivières motrices connues et aux points d’installation de leurs usines; tout comme les 31.000 personnes occupées aux petits métiers, alimentation, vêtement, outillage mécanique ou agricole, ameublement, etc. Elles ont des chances de se trouver groupées dans les bourgs, centres obligés des échanges et de l’approvisionnement.