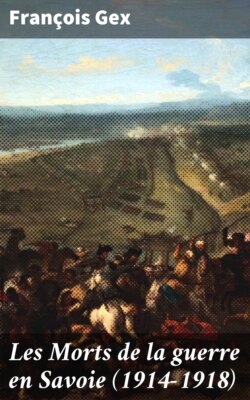Читать книгу Les Morts de la guerre en Savoie (1914-1918) - François Gex - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2° LES SOURCES
ОглавлениеTable des matières
Ce trop long préambule n’était pas inutile pour laisser entrevoir des explications nécessaires et autoriser quelques précisions sur des causes que chacun accuse trop confusément dans la répartition des Morts de la guerre. C’est assez dire qu’elles seront allégées, au risque de les rendre incomplètes et de les réduire à l’état de simples présomptions, de tout ce qui pourra, dans l’étude de cette répartition, être considéré comme la part de ce vain mot qu’on appelle la chance ou le hasard. Il faut en dire autant de ce qui peut relever des influences que nous appellerons purement «humaines», le bien nommé S. D. et autres influences extérieures mais pas toujours étrangères à la volonté des mobilisés survivants et qu’il n’est pas utile de qualifier avec une trop brûlante précision.
Somme toute, cette mortalité de la guerre, comme la mort en général, nous apparaîtra moins comme l’œuvre inéluctable d’un aveugle et brutal destin que comme celle d’un ensemble de circonstances nécessaires, inévitables où, si la part de l’homme est sensible, le jeu des influences naturelles, physiques, géographiques. fatales, prédomine incontestablement. Ce qui revient à dire qu’on y surprendra, cheminant par des voies vaguement connues, la main de la divine Providence, souveraine dispensatrice de la vie et de la mort, dans l’intervention tantôt harmonieuse, tantôt brutale, mais prévue par Elle, des instruments dont elle se sert à ses fins et toujours pour notre bien: les hommes et les choses.
Il est bon de prévenir, et nul ne s’en étonnera, que les chiffres qui vont être alignés dans la colonne des Morts de la guerre ne peuvent pas prétendre à une rigoureuse autant qu’irréalisable exactitude. Car il est presque matériellement impossible d’établir un juste départ entre les morts, nés et domiciliés dans la commune qui les réclame, et ceux qui, simplement originaires, n’y résidaient plus à la mobilisation, ou d’autres qui n’y avaient qu’un domicile accidentel. En effet, les uns sont fils d’étrangers; leur famille est venue s’installer dans la commune peu avant ou simplement pendant la guerre et, à ce titre, elle y a reçu l’avis officiel du décès qui compte, par conséquent, à l’effectif des morts de la commune d’adoption. D’autres, relativement nombreux en montagne et dans les foyers de grande émigration, originaires de la commune où leur famille continue à résider, s’étaient établis ailleurs; ce qui ne les empêche pas d’être revendiqués par leur famille et, partant, par leur commune d’origine. Ce sont les doubles emplois qui ont chance de voir figurer leur nom sur 2 tableaux communaux différents. Il est bien peu de communes où les répartiteurs aient poussé le scrupule jusqu’à s’en assurer et faire ainsi œuvre de rigoureuse sincérité. Un petit nombre sont fils de réfugiés, installés provisoirement dans la commune, dans les bourgs et les villes plus particulièrement, où leur présence a accentué la crise des loyers. Leur famille y a reçu l’avis de décès et, le jour où elle sera rapatriée, elle ne se souciera guère de demander la radiation de son mort. D’autres enfin, notamment en Maurienne, Tarentaise, dans les Bauges, sont des «Parisiens» établis et domiciliés à Paris où la mobilisation les a surpris; tandis que, au cours de la guerre, leur famille, fuyant les avions, les Berthas et la vie chère de la capitale, venait se réfugier au pays... pour y recevoir la fatale nouvelle.
L’exemple de Chambéry suffira à illustrer et caractériser ces surnombres et tous ces cas de doubles emplois. La mairie y a reçu environ 550 avis de décès, sans compter 80 disparus, soit un total de 630 morts. L’élaboration de la liste officielle a amené les élimi nations nécessaires et un tassement réduit bien insuffisamment à 548 unités. En effet, nous y avons relevé, à notre seule connaissance, une dizaine de cas de doubles emplois, identifiés sans peine en confrontant la liste de Chambéry avec les seules listes municipales de la banlieue: Saint-Ombre, Jacob, Saint-Cassin, Vimines, Saint-Baldoph, etc. Il faudrait, de plus, défalquer les officiers et sous-officiers de carrière de sa garnison de 1914, car ils figureront très probablement sur les listes de leurs communes d’origine. Somme toute, il y a tout lieu de croire que les morts «nés-natifs de Chambéry et y domiciliés» ne doivent pas, et il s’en faut, dépasser 500.
Pareil tassement a été opéré et à juste titre à Albertville où de 165 il a été ramené à 141. A Aix-les-Bains, il a passé de 342 à 245; à Saint-Pierre-d’Albigny, de 128 à 101. Saint-Jean-de-Maurienne, où l’opération n’a pas été faite, compterait une vingtaine de domiciliés accidentels sur ses 110 morts. Nous ne dirons rien des communes rurales; les écarts relevés dans la confrontation des deux listes parleront d’eux-mêmes, surtout dans les hautes vallées où sévit l’émigration. C’est pourquoi, en principe, il faut se défier des inflations de certains Monuments des Morts, trop souvent édifiés à l’usage des étrangers. Les noms des morts «indigènes» se trouvent parfois encombrés, noyés au milieu d’autres sans attache effective au pays. Le prétexte est que, généralement, la cotisation et la générosité de la famille de ces derniers ont forcé l’hospitalité complaisante d’une plaque ou d’une stèle funéraire qui, comme le papier, porte tout dès qu’on y met le prix. C’est aussi affaire d’émulation entre communes. Cette mortalité de guerre qu’on redoutait tant, on en fait après-coup volontiers étalage. Cela fait bien, mais un peu de discrétion ferait mieux et ce serait sans préjudice pour la mémoire des morts. Moralité : il ne faut pas trop vite faire foi aux plaques et autres monuments commémoratifs dont Parfois la sincérité ne vaut pas plus que le goût et le choix de l’emplacement.
En définitive, dans l’établissement de la Statistique, il a été tenu compte, dans la mesure du possible, de toutes les circonstances particulières de surcharge et de doubles emplois susceptibles de fausser les résultats, d’enfler démesurément les pourcentages, de donner des allures suspectes à une enquête et un travail utiles à condition d’être sincères. Malgré tout, le total sera peut-être, sûrement, forcé et exagéré, car les causes d’erreur, aussi involontaires que possible, se mesurent au nombre des 330 communes du département. Nous le livrons tel quel à l’appréciation de ceux qui pourraient y trouver quelque intérêt comme aussi matière à plus d’un redressement.
Un premier redressement se fera automatiquement par la simple juxtaposition, pour ne pas dire opposition, de deux listes le plus souvent discordantes: la liste officielle dressée dans les mairies, rassemblée à la préfecture de la Savoie et que nous appellerons la liste ou statistique municipale. L’autre est le résultat d’une enquête privée auprès des lecteurs et amis de notre excellent organe catholique régional, le journal La Croix de Savoie. MM. les Curés du département ont déployé une superbe émulation à lui confier leurs chiffres paroissiaux, d’autant plus appréciés qu’ils sont venus en toute sincérité, passés au crible d’une critique avertie autant que nécessaire, dépouillés de tout apport étranger et libres de tout orgueil de clocher . C’est ce que nous appellerons la liste paroissiale.
Ces deux listes sont de valeur inégale. Le plus grave grief qu’on puisse faire à la liste paroissiale, c’est d’être incomplète: il y manque environ 40 communes. Celles du canton de Saint-Jean-de-Maurienne et du Val d’Arly se sont montrées particulièrement réfractaires. Il y a été suppléé par le chiffre officiel. Il est regrettable que le plus souvent paroisses et mairies n’aient pas su tenter l’accord facile à n’établir qu’une seule liste commune qui eût aisément satisfait tout le monde. C’était un minimum d’union sacrée point irréalisable. — D’autre part, elle est généralement plus allongée que la liste de la mairie; parfois un peu trop garnie et trop amie des chiffres ronds et, malgré toutes les précautions et des avertissements réitérés, on y surprend de nombreux doubles emplois, spécialement en ce qui concerne les morts simplement originaires de la paroisse et établis au dehors. Si presque partout elle a éliminé les étrangers, domiciliés accidentels, par contre, elle a adopté presque intégralement tous les émigrés originaires de la paroisse mais non domiciliés, tous les «Parisiens» temporaires qui y ont conservé, avec l’esprit de retour, des attaches familiales et des biens de famille, sans compter leur inscription au recrutement de la subdivision de Chambéry. Et ce dernier trait leur a valu de servir en grande majorité dans les formations régionales, d’y faire campagne et d’y mourir aux côtés de leurs compatriotes résidents, de sorte que, effectivement, la mort les avait bien retrouvés Savoyards. — De cela, il ne faut pas la blâmer. Cela lui vaut, en ce sens, d’être plus complète, plus représentative, plus régionaliste. Elle se déleste des étrangers au pays pour prendre à leur place des prodigues, mais qui n’en sont pas moins enfants du pays. En un mot, elle est plus intégralement savoyarde, et ceci lui ralliera bien des sympathies. L’excès qu’elle présente relativement à la liste opposée aura ainsi le mérite de figurer la mortalité des Savoyards in partibus, résidant à l’étranger; une différence qui sera soulignée et précieuse à recueillir dans les totaux cantonaux.
L’autre est plus administrative et ce seul titre éveille des soupçons, la rend suspecte, mais bien injustement, dans son ensemble. Elle est plus réduite parce qu’elle ne tient qu’un compte partiel, souvent fantaisiste, des émigrés dont le gros bataillon absent est imparfaitement compensé par les étrangers, des domiciliés temporaires qu’elle retient. Elle prend trop à la lettre les instructions ministérielle et préfectorale des 3 et 10 juin 1919, prescrivant et réglementant la confection des listes des «Morts pour la France». Beaucoup trop de mairies n’en ont vu que la lettre et non l’esprit, et se sont trop reposées sur les lenteurs de l’administration militaire pour accorder à leurs morts la qualité de «Morts pour la France». De la sorte, bien des disparus et des morts de maladie ne figurent pas sur les listes sous le fallacieux prétexte que leur transcription ou l’acte officiel du décès demeurait en souffrance dans les bureaux de comptabilité de dépôts mobiles, introuvables ou peu empressés et n’était pas transmis aux mairies intéressées. Il s’ensuit que plus d’une de ces listes municipales est incomplète, non définitive, du fait de l’état d’esprit formaliste et timoré qui a présidé à sa rédaction. D’autres, au contraire, et c’est plus regrettable, méritent le reproche opposé : ce sont des listes de débarras, squelettiques, qui sentent l’humeur et le mauvais vouloir. Elles alignent des noms secs, décharnés et comme des matricules, qui n’ont même pas la poésie d’une plaque d’identité ; démunies de toute mention d’âge, de classe, d’arme, de grade, de date des décès, — à seule fin d’en finir avec les rappels importuns ou inquiétants, émanés de l’administration supérieure. — Au total, les listes municipales valent ce que vaut leur rédacteur. C’est dire que, dans l’ensemble, elles ont du bon, du très bon. Beaucoup même sont extrêmement précieuses, celles qui donnent à la fois l’état numérique et nominal de leurs morts, avec la mention de la classe, de l’arme, etc., soit tout un état civil et militaire qui nous aura valu de joindre à ce travail un supplément de répartition des morts, qui en forme, à notre avis, une partie qui n’est pas sans intérêt.
La conclusion imposée par cette critique nécessaire de la composition des deux statistiques est que leur intérêt respectif autant que la plus élémentaire probité commandent de les adopter toutes les deux et de leur demander tout ce qu’elles peuvent donner. Or elles peuvent beaucoup, car elles se complètent, et le résultat de leur combinaison apparaîtra, aux yeux des plus difficiles, satisfaisant.