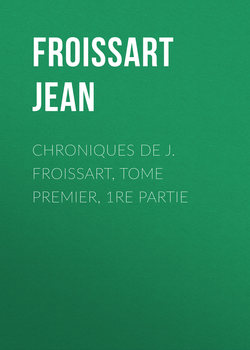Читать книгу Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie - Froissart Jean - Страница 7
PREMIÈRE PARTIE
DU CLASSEMENT DES DIFFÉRENTES RÉDACTIONS ET DES DIVERS MANUSCRITS DU PREMIER LIVRE
CHAPITRE I.
DE LA PREMIÈRE RÉDACTION
§ 4. De la première rédaction proprement dite; – classement des manuscrits de cette rédaction
ОглавлениеLes manuscrits de la première rédaction sont extrêmement nombreux; on en compte environ cinquante, tandis que la seconde n'est représentée que par les deux exemplaires d'Amiens et de Valenciennes, et la troisième par le texte unique de Rome. Une disproportion aussi énorme peut être considérée comme un argument de plus en faveur de la priorité de la rédaction qui compte un si grand nombre de copies, car il tombe sous le sens que des trois rédactions, c'est la première en date qui a dû être le plus tôt et le plus souvent reproduite. L'expérience enseigne que, dans ce cas, l'avantage reste quelquefois au premier occupant; mais cela est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'une transcription aussi longue et aussi coûteuse que celle du premier livre des Chroniques. Serait-il téméraire d'attribuer, en partie du moins, à l'apparition plus tardive des seconde et troisième rédactions la rareté vraiment singulière des exemplaires qui les représentent?
Des cinquante manuscrits de la première rédaction, plus de quarante appartiennent à la première rédaction proprement dite; il reste six mss. seulement de la première rédaction revisée. Encore faut-il comprendre parmi ces six un ms. où le premier livre presque tout entier est perdu, un simple fragment et un abrégé.
On a prévenu le lecteur qu'il ne devait pas chercher ici une description des manuscrits; diverses raisons ont fait renvoyer cette description à la fin de l'édition. Le tableau sommaire qu'on trouvera ci-dessous n'en a pas moins coûté à l'éditeur plus de six mois de travail; il a nécessité de lointains voyages et des recherches sans nombre. Il a présenté d'autant plus de difficultés qu'il est impossible de grouper les manuscrits par familles, en se fondant sur les caractères saillants, extérieurs et pour ainsi dire matériels de ces mss. L'éditeur avait, au début de son travail, nourri cette illusion; mais il a dû y renoncer après bien des tâtonnements et de vains efforts. Ainsi, il semble au premier abord que les manuscrits où le premier livre est coupé au même endroit et se termine beaucoup plus tôt que dans les autres, doivent être rattachés à la même famille; et pourtant il est tel cas où l'on s'égarerait infailliblement en suivant cette méthode. Le ms. de Besançon, par exemple, ne contient pas trois ou quatre chapitres qui terminent le premier livre dans les mss. 2649, 2663, 2674, etc., et néanmoins il appartient à la même famille que ces derniers exemplaires. Au contraire, le ms. de notre Bibliothèque impériale coté 86 et le ms. de Breslau finissent l'un et l'autre le premier livre au siége de Bourdeilles, en 1369; ce qui n'empêche pas ces copies de se rattacher à deux familles différentes.
Écartant donc ces apparences trompeuses et ces analogies purement superficielles, il a fallu pénétrer plus avant pour essayer de saisir les caractères vraiment génériques qui sont les variantes du texte. On comprend tout ce qu'une pareille tâche exige de comparaisons minutieuses et combien ces comparaisons sont difficiles lorsqu'elles doivent porter sur d'énormes manuscrits souvent fort éloignés les uns des autres! Heureusement, un fil conducteur nous a guidé dans ce dédale: ce fil, nous l'avons trouvé dans les titres des chapitres qui, provenant uniquement du fait des copistes, constituent un indice à peu près sûr de l'identité des variantes et par suite de la communauté d'origine des manuscrits où ces intitulés ajoutés au texte sont semblables. Conformément à cette méthode, on n'a rangé dans la même famille que les manuscrits dont le texte présente des modifications identiques qui leur sont exclusivement propres et que l'on ne retrouve point dans les autres. Toutefois, une exception a été admise en faveur de certains exemplaires qui, tout en offrant généralement les mêmes variantes que ceux auxquels on les a réunis, se distinguent cependant de ceux-ci par des différences plus ou moins notables, sans qu'on puisse d'ailleurs les rattacher à une autre famille. Ces manuscrits excentriques ont été joints à ceux dont ils se rapprochent le plus; seulement, on les a laissés en dehors de l'accolade pour bien marquer leur singularité.
Примечание 146
Dans ce tableau comme dans tout le cours de notre édition, la première rédaction proprement dite est désignée par la lettre A suivie d'un chiffre qui varie pour chacun des manuscrits de cette rédaction.
La première classe comprend les manuscrits où le texte du premier livre est reproduit intégralement; non qu'il n'y manque çà et là des mots ou même des membres de phrase, mais ces lacunes résultent de l'inadvertance des copistes et n'ont pas le caractère de suppressions systématiques.
Dans la première famille de cette classe, le ms. de Besançon a47 été mis à part, non-seulement à cause de son antiquité exceptionnelle, mais encore parce que le premier livre, s'il s'étend beaucoup plus loin dans cet exemplaire que dans les cinq congénères, manque en revanche des trois ou quatre chapitres qui le terminent dans ces derniers mss.
La seconde famille (mss. A 7 à 1048) comprend les copies à la fois les moins étendues et les plus anciennes du premier livre; ces manuscrits ont cela de très-particulier qu'ils ne semblent pas dériver les uns des autres et ne présentent pas toujours les mêmes variantes.
Les troisième, quatrième et cinquième familles de la première classe (mss. A 11 à 19) sont plus modernes que les deux familles précédentes; et un certain nombre d'additions des mss. A 11 à 19, mais surtout des mss. A 11 à 14, ne doivent provenir que du fait des copistes.
La seconde classe embrasse les manuscrits où le texte est tantôt complet, tantôt plus ou moins abrégé. Dans les exemplaires de cette classe, les lacunes, les abréviations, au lieu d'être comme dans ceux de la première une exception due à la distraction d'un scribe, deviennent la règle; et ce système de suppressions s'étend à toutes les parties, on pourrait presque dire à tous les chapitres du texte.
La première famille de la seconde classe (mss. A 20 à 22) dérive de la première famille de la première classe (mss. A 1 à 6).
Le texte est encore plus abrégé dans les mss. A 23 à 28 que dans les mss. A 20 à 22.
Si dans la deuxième famille de la seconde classe le ms. de Breslau a été mis en dehors de l'accolade, c'est qu'à partir de 1340 le texte y est plus développé et offre certains détails qu'on ne trouve pas dans les autres mss. de la même famille.
Les simples fragments du premier livre sont rangés dans la troisième classe. Les mss. 34 à 36, qui sont la reproduction les uns des autres, ne contiennent que le commencement du premier livre; le texte, d'ailleurs complet, de ces mss. s'arrête à la mort de Philippe de Valois en 1350. Quant au ms. de Rouen, découvert et signalé pour la première fois par M. Delisle, on n'y trouve que des chapitres détachés.
Les mss. A 38 à 40, qui composent la quatrième classe, renferment le même résumé des quatre livres des Chroniques abrégés chapitre par chapitre; le premier livre est divisé dans ce résumé en 167 chapitres.
46
Les manuscrits désignés simplement par un chiffre appartiennent à notre Bibliothèque impériale. Il faut ajouter à la liste ci-jointe, le bel exemplaire du premier livre conservé dans la bibliothèque du château de Branitz (Prusse). Malheureusement, il ne nous a pas été donné de voir, d'étudier nous-même ce manuscrit; et les renseignements transmis par Son A. le prince de Puckler-Muskau ne nous ont pas permis de le comprendre dans notre classement.
47
Mon ami, M. A. Castan, a publié une excellente étude sur le ms. de Saint-Vincent de Besançon. Bibl. de l'École des Chartes, t. XXVI, p. 114 à 148. Buchon croyait ce manuscrit égaré si non perdu; M. Castan ne l'a pas seulement retrouvé, il a éclairci toutes les questions qui s'y rattachent.
48
Sur la manière dont se terminent ces manuscrits, voyez ce qui a été dit plus haut, p. XIII et XIV, XXVII et XXVIII.