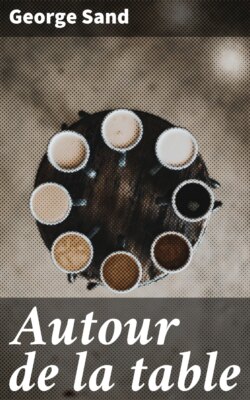Читать книгу Autour de la table - George Sand - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеTable des matières
Si vous êtes calmée et tant soit peu raisonnable aujourd'hui, dit Théodore à Julie, je reprendrai mon analyse. Il faut bien que vous descendiez de vos nuages, et que vous m'accordiez que les mots ont un sens exact qui répond en nous au sens exact des choses.
—Je connais peu de ces mots-là, dit Julie. Il n'y a rien de menteur ou de vague comme les mots.
—Encore! s'écria Théodore impatienté. Il n'y a pas moyen de causer avec elle!
—Laisse-la parler comme elle veut, dit Louise. Elle rêve, mais elle vit. Toi, tu ne divagues pas, mais tu raisonnes. Entre vous deux, nous tâcherons de penser.
—Amen! dit le curé.
—Voyons, continuez, reprit Julie. Comment votre auteur définit-il le laid?
THÉODORE.—D'une manière à la fois juste et ingénieuse. Il le fait consister dans un manque d'harmonie entre la forme d'une chose ou d'un être et l'idée du type qu'il exprime. «En quoi, dit-il, un être organisé nous paraît-il décidément laid? En ce qu'il ne reproduit son idée ou son type que travesti, en quelque sorte, par une forme rebelle qui s'émancipe d'une façon désordonnée. Un degré moindre de laideur est celui où la forme reste en arrière de son type et ne le révèle qu'imparfaitement. Nous disons qu'une plante est laide quand elle est mal venue, qu'un animal est laid quand il reste chétif dans son développement. Nous les comparons alors au type de leur espèce seulement, et la forme ici pèche par défaut. Mais la laideur, au contraire, est bien plus prononcée quand la forme pèche par excès, s'écarte violemment du type et entre en révolte contre l'idée. Il en résulte alors ce que nous appelons une difformité, une caricature, un monstre…. C'est le caractère que nous offrent certaines organisations des animaux inférieurs, parce qu'elles s'écartent le plus du type général de l'animalité.»
—Attends, dit Louise, je ne te suis plus dans cette définition du type particulier confondu avec celle de l'idée générale. Si toute création est une idée divine, Julie a raison de ne pas vouloir entendre dire que quelque chose soit laid dans la nature. Je comprends très-bien comme elle, et comme l'auteur du livre dans la première partie de sa définition, que le laid soit un accident, et qu'une plante avortée, ou un animal fortuitement hors de proportion avec les autres individus de son espèce soit qualifié de nain, de géant, de caricature et de monstre. Je dirais presque, en ce cas, que la laideur est une déformation, une dénaturation de l'être ou de l'objet. Mais vouloir agrandir le domaine du laid dans la création jusqu'à y faire entrer des espèces entières, et décréter que le poisson ou le coquillage est laid parce qu'il ne réalise pas l'idée d'un animal aussi complet que le lion et le cheval, ceci me paraît une concession trop grande au préjugé et à la convention de la part d'un esprit aussi largement éclairé que ton auteur semble l'être.
THÉODORE.—Il ne va pas jusque-là. Il n'admet la laideur que comme une chose relative. Il aime la nature et comprend la grâce, l'éclat extérieur, la physionomie, l'apparence modeste ou comique, le détail enfin qui rachète jusqu'à un certain point chez certains animaux l'infériorité du type comparé à d'autres types. Voyons (ajouta Théodore en s'adressant à moi), toi qui as lu le livre, n'est-il pas vrai que les lois de l'esthétique n'entraînent pas l'auteur au mépris des caprices apparents du beau naturel?
—C'est vrai, répondis-je. Il proclame que, «dans l'ensemble de la nature, c'est le beau qui domine victorieusement, et que la laideur n'est qu'une exception, un détail.» Pourtant, si vous voulez que je dise toute ma pensée, je trouve des contradictions dans ce beau et bon livre; et, pour me servir d'une de ses expressions, des moments de disharmonie entre la théorie et l'application. L'auteur me paraît quelquefois un peu emprisonné dans son rôle de professeur d'esthétique; il semble que son sentiment, sa conscience d'artiste et de poëte se révoltent contre les arrêts de son enseignement, et qu'après avoir posé une règle, un critère, comme il dit, il ait besoin de s'écrier: Et pourtant!… Enfin, laissez-moi tout vous dire, dussiez-vous m'accuser de faire la cour à Julie. J'admire et j'estime sincèrement la recherche des principes du beau, et je fais le plus grand cas de celle-ci; mais, en fait d'art, comme devant la nature, je me sens de l'école de Hugo et de Michelet plus que de celle de M. Pictet.
—Voyons, voyons, dit Julie, parlez: vous aimez mieux les poëtes que les théoriciens?
—Eh bien, oui, j'en conviens, et je m'imagine que les artistes qui se laissent aller à leurs impressions, et même, si Théodore le veut, à leurs divagations, nous en apprennent plus long que les amateurs et les raisonneurs les plus éclairés. La théorie de M. Michelet sur l'âme des oiseaux, sur les douloureuses rêveries de la fauvette captive, sur les extases poétiques du rossignol, sur les modestes vertus du pivert, etc., prêtent tant que vous voudrez à la critique des gens sérieux; mais si l'homme a besoin de quelque chose dans son éducation esthétique, ce n'est pas tant de démonstration que d'émotion, ce n'est pas tant de raison que d'enthousiasme, et de savoir que de sentiment. Quant à moi, il m'est absolument indifférent de savoir que l'Apollon du Belvédère est le prototype du beau, parce que son angle facial dépasse 80 degrés. J'ai vu cet Apollon tant vanté, et il m'a laissé froid comme un marbre qu'il est. C'est sans doute ma faute; mais n'est-ce pas aussi la faute de son archétypisme raisonné? Après l'avoir bien regardé, je rêvai toute la nuit suivante qu'il venait sottement me faire des reproches et me montrer ses beaux bras et ses belles jambes académiques. Or, j'étais furieux de son insistance, et je vous en demande bien pardon, ô Théodore; mais en rêve on est si naïf et si grossier! je m'éveillai, ce matin-là, sous le ciel de Rome, en m'écriant brutalement: «Va-t'en! va-t'en dans ton musée, pédant de beauté, tu m'ennuies!»
Théodore entra dans une si grande colère qu'il me traita, je crois, de réaliste. Julie et Louise rirent de sa fureur, et il me fut permis de continuer.
—Tout à l'heure, dis-je à Théodore, quand votre indignation s'apaisera, je reviendrai à vos prototypes classiques. Laissez-moi vous demander, quant à présent, pourquoi, dans une petite strophe de Hugo ou dans un court paragraphe de Michelet sur les bestioles ou les fleurettes des champs, j'oublie absolument si la poésie me fait un conte de fées ou si elle m'instruit dans la vraie philosophie de la nature. Ce que je sais, c'est qu'elle me charme et m'attendrit; c'est qu'elle me fait voir beaux et grands ces coins de paysage et ces divins petits êtres qui animent le ciel et les bois de leur vol et de leur chant; c'est qu'elle me fait aimer passionnément l'oeuvre divine dans la moindre de ses idées; que dis-je! c'est qu'elle m'insuffle, sans enseignement, une notion plus étendue et peut-être plus équitable du beau dans la nature que celle de mon éducation positive; c'est enfin qu'en me poétisant la créature, quelle qu'elle soit, l'imagination émue m'initie à une puissance, tandis qu'en classant la beauté des créatures par rapport à l'homme, le raisonnement critique me la retire.
THÉODORE.—Et pourtant! comme tu disais tout à l'heure, M. Michelet s'égare continuellement à chercher d'assez puériles ressemblances entre ses oiseaux et le type de l'homme. En ceci, il va bien plus loin que M. Pictet.
MOI.—Oui, c'est vrai; mais nous avons dit, autour de cette table: «Des écarts tant qu'on voudra, pourvu qu'il y ait de la conviction et de l'inspiration!»
THÉODORE.—Vous voulez qu'un traité soit une affaire d'engouement et d'enthousiasme déréglé?
JULIE.—Nous voulons, au contraire, que les traités soient bien raisonnables et bien froids, afin de ne pas les lire.
MOI.—Je ne vais pas aussi loin que vous. J'aime les traités bien faits, et celui de M. Pictet est le meilleur que j'aie lu. M. Pictet est le professeur le plus ingénieux qu'il soit possible de désirer. Mais est-ce par nature d'artiste sobre et difficile, est-ce par devoir de la science qu'il traite, qu'il se défend ou semble se défendre de certaines admirations? Il y a peut-être bien un peu de l'un et de l'autre. Ainsi, en parlant de la statuaire, il dit, selon moi, une grande hérésie qui a dû lui coûter certainement: il affirme, à plusieurs reprises, que la statuaire grecque n'a jamais été dépassée, et moi, je sens qu'elle l'a été de cent coudées par Michel-Ange. Jamais, avant le Moïse et la chapelle des Médicis, la statuaire n'avait réalisé l'idée de la vie divine dans la vie humaine avec cette sublimité. Il y a, entre Michel-Ange et Phidias, la différence qui sépare l'idée chrétienne de l'idée païenne; et, par une puissance et une universalité de génie incomparables, Michel-Ange a résumé les deux idées, donnant à la forme toutes les splendeurs de la matière, et à l'idée tout l'éclat du rayonnement divin. Sur cette grande science, et sur cette large compréhension qui font le style du monarque de la statuaire, plane encore son individualité de penseur passionné; si bien que ses personnages sont l'expression des choses du ciel comme celle des choses de la terre, et encore celle de l'intelligence de Michel-Ange, à nulle autre pareille, à nulle autre comparable dans le domaine de son art.
THÉODORE.—Mais où prends-tu que mon auteur n'apprécie pas Michel-Ange?
MOI.—Il ne le nomme nulle part, et à propos de statuaire, dans son chapitre du Sublime, il cite un lion de Thorwaldsen. Ce lion, je ne le connais pas et n'en dis point de mal; mais le Moïse! N'était-ce pas l'occasion de dire qu'il est le prototype du sublime? J'ai peur que M. Pictet ne le range dans les aberrations du génie.
THÉODORE.—Tu lui fais là un procès de tendance.
MOI.—Alors, je m'arrête, et après avoir fraternisé avec votre satisfaction et votre admiration pour la partie du livre de M. Pictet qui exprime, traduit et critique l'histoire de l'esthétique et celle de l'art (chose bien difficile dans des bornes aussi restreintes que colles, d'un cours contenu dans un volume, et pourtant excellemment réussie), j'arrive à sa conclusion, qui peut-être satisfera mieux Julie que son exposition. «Émanée, comme un pur rayon, de l'intelligence suprême, l'idée de l'universalité du beau, dit M. Pictet, se révèle d'abord dans la nature; puis reflétée par l'art, qui la dégage des accidents de la matière, pour la ramener à sa pureté primitive, elle éclate, sous mille formes diverses, au sein de l'humanité.»
—Attendez, dit Julie, voilà encore une définition, la définition de l'art et de sa mission. C'est bien dit, mais je proteste si, par accidents de la matière, M. Pictet entend, non-seulement les formes individuelles qui ne réalisent pas le type de l'espèce à laquelle l'être appartient, mais celles qui entrent en révolte contre le type général de beauté défini, préconçu et arrêté par les esthétiques. Dans ce cas-là, j'enverrais promener toute cette prétendue philosophie du beau, parce qu'elle condamnerait la grenouille à être laide de par la Vénus de Milo, et que la grenouille est aussi jolie dans son espèce que la plus grande déesse dans la sienne. Il y a dans ces règles d'esthétique des choses qui me paraissent dangereuses pour le progrès de l'art, et contre lesquelles les réalistes ont le droit de réclamer: c'est qu'en partant d'un prototype convenu pour déclarer inférieures toutes les autres idées divines, on pousse des générations d'élèves à faire de l'art grec à contre-sens et sans inspiration, et à dédaigner l'étude du vrai qui sert de base à tout sentiment du beau. On ne dira jamais rien de plus juste que ce vieil adage (de Platon, je crois), que le beau est la splendeur du vrai.
LOUISE.—Moi, je suis de ton avis, chère fille: la laideur est une création humaine, et l'antithèse nécessaire qu'elle apporte dans nos conventions est inutile au procédé divin. Cette antithèse a été apportée dans notre monde par les tâtonnements de la liberté de l'homme. Condamné par ses instincts d'imitation à devenir créateur à son tour, l'homme n'arrive à la notion du beau et du bien qu'en commençant par gâter souvent l'oeuvre divine. Alors il essaye de choisir entre ce qu'il a fait de bon et ce qu'il a fait de mauvais, et, au temps où nous sommes, il se trompe encore à chaque instant et dans son oeuvre et dans son jugement. Dieu, lui, n'a rien fait qui ne soit bien fait et qui ne rentre dans l'harmonie générale. L'homme seul s'en écarte par ignorance et par vanité. N'a-t-il pas réussi à se faire laid lui-même? Lui, le chef-d'oeuvre de la création, il détruit, il avilit, il torture par tous les moyens son propre type. C'est lui, l'ingrat, qui a fait entrer la laideur dans son domaine et dans sa propre famille. Dès qu'il s'est vu affermi dans sa royauté sur le reste du monde organique, il s'est empressé de vivre en dehors des conditions naturelles. Ici trop de paresse physique et de nourriture matérielle, de là l'obésité et toutes ses disgrâces; là, trop de fatigue et de misère, c'est-à-dire la maigreur et l'étiolement. Et puis, en haut comme en bas de la belle échelle sociale inventée par lui, des excès de sentiment, d'intelligence ou de sensualité; des désordres de vice ou de vertu; des abus de jouissance et des abus d'austérité qui engendrent mille maladies et mille difformités inconnues aux animaux sauvages et aux plantes libres. De là la laideur qui se transmet à l'enfant dans le sein de sa mère, même après des générations exemptes de misère ou de vice. L'homme s'en prendra-t-il à Dieu de sa propre folie? Lui reprochera-t-il d'avoir donné à la tortue des pieds trop courts et à l'araignée des jambes trop longues, lui qui a réussi à introduire dans son propre type des ressemblances monstrueuses avec toutes sortes d'animaux?
Vous avez d'autant plus raison, dis-je à la grand'mère que, pour être logique avec son principe qu'il y a du laid dans la création[1], M. Pictet pense rehausser le prix de la beauté en disant qu'elle est une magnificence gratuite de la nature et une superfluité généreuse du Créateur. Il en conclut que la laideur, chez l'homme, ne prouve rien contre l'excellence des individus. Cela est certain; mais il aurait peut-être dû nous dire qu'elle prouve beaucoup, qu'elle prouve tout, en tant que solidarité contre notre race insensée. Elle est un sceau, parfois indélébile, de quelque châtiment infligé à nos pères pour l'abus qu'ils firent sans doute de la beauté primitive départie à tous. Dieu, qui est bon parce qu'il est juste, ne permet pas que l'âme s'en ressente au point d'être enchaînée et rabaissée au niveau de sa forme disgraciée, mais elle souffre du poids de la laideur. L'intelligence en est attristée, si cette laideur est infligée à un être raisonnable et clairvoyant. Si, au contraire, elle est le partage d'un être vaniteux qui s'ignore et se croit beau, elle le condamne à un profond ridicule, et toute sa destinée sociale s'en ressent. Aimons donc beaucoup, estimons infiniment les êtres humains qui supportent la laideur, personnellement imméritée, sans amertume pusillanime et sans grotesque illusion. En général, ces êtres-là sont si bien doués du côté de l'âme ou de l'esprit, qu'un reflet de leur beauté intérieure rachète en eux la sévérité des destinées et illumine leur visage d'une expression qui arrive à plaire et à charmer autant, quelquefois plus, que la beauté.
[Note 1: Il le dit à regret avec mille ménagements. Il dit que la Providence cache soigneusement les écarts de la nature aux regards de l'homme; que ces écarts sont des exceptions, etc.]
Mais ne nous en faisons pas accroire. Quand nous devenons laid avant l'âge, c'est souvent par notre faute, et quand nous naissons laids, c'est par la faute de nos ascendants. Dans tous les cas, nous portons la peine de nos erreurs ou de celles d'autrui, car la nature n'échappe pas, comme la société, à la loi de solidarité. Si les maladies nous défigurent, si la petite vérole a labouré de ses affreux stigmates tant de beaux visages, c'est la faute de nos sciences, qui ne marchent pas aussi vite que les fléaux qui nous atteignent. La laideur est donc une plaie sociale, un fait purement humain. Elle n'est pas dans la création. Tout être qui vit dans des conditions normales de son existence est beau dans son espèce; et ce n'est que par analogie, c'est en voulant comparer ce que Dieu a simplement distingué, et graduer ce qu'il s'est contenté d'enchaîner, que nous sommes arrivés à critiquer avec plus d'orgueil que de clairvoyance la création, l'idée divine elle-même.
—Nous nous entendons, dit Julie. Ce qui prouve bien que la laideur est notre ouvrage, c'est qu'un chardonneret qui vit en liberté n'est pas moins beau que tout autre chardonneret de son espèce, c'est qu'aucun reptile ne louche, c'est qu'aucun pinson n'a la voix fausse, c'est qu'il n'y a point de gazelle bossue.
—Mais le dromadaire a des bosses! s'écria Théodore, et vous ne sauriez dire que le rhinocéros ou l'hippopotame soient d'agréables personnages!
JULIE.—Vous les trouvez affreux parce que vous avez toujours M. Apollon dans vos verres de lunettes. Ces vieux types de la création primitive ont leur caractère de puissance brutale ou terrible. Ils ressemblent à des rochers ou à des troncs de plantes gigantesques; ils ne sont pas mesquins, j'espère, ils réalisent pleinement leur type monumental; ils expriment les idées violentes ou paisibles des premiers efforts de la création organique; et j'aimerais mieux les avoir sans cesse devant les yeux qu'un Cupidon ou un Zéphire sur un candélabre de l'Empire, ou qu'un troubadour avec sa bachelette sur une pendule de la Restauration. Les prétendus écarts de la création divine me jettent dans la rêverie ou dans l'émotion; ils me font réfléchir ou trembler: mais vos objets d'art manqués me rendraient imbécile.
—Allons, dit Louise qui écoutait Julie avec une complaisance maternelle, tout en feuilletant le livre esthétique placé sur la table; j'aime tes instincts, mais tu aurais tort d'attribuer à M. Pictet les goûts contre lesquels tu déclames. Je vois, en lisant au hasard, des pages superbes, et en voici une à la fin du livre qui doit clore la discussion et te réconcilier avec lui:
«L'idée du beau est éternelle, et ses manifestations s'étendent à l'infini dans l'espace et dans le temps. Nous sommes beaucoup trop portés, quand il s'agit des choses divines, à en restreindre la possession à nous-mêmes, à notre petite famille humaine, à notre petite demeure terrestre. Nous oublions que nous ne sommes qu'un point dans l'univers, qu'un instant dans l'éternité…. Qui nous dit que l'univers ne renferme pas un nombre indéfini de natures diverses, d'organismes vivants et expressifs, ayant tous leur beauté propre, infiniment supérieure peut-être à ce que nous connaissons? Le nombre des arts que nous cultivons est forcément limité par les conditions matérielles de notre existence terrestre. Mais là où ces conditions seraient tout autres, là où les données de la forme et de la matière se trouveraient beaucoup plus riches ou plus dociles à l'action de l'intelligence, il devrait naître autant d'arts nouveaux qu'il y aurait de combinaisons nouvelles, et la possibilité de ces dernières n'a pas de bornes. Ainsi chaque nature stellaire doit servir de base à un monde esthétique où elle se reflète et s'idéalise; chaque planète doit avoir sa poésie, comme elle a sans doute sa vie organique et intellectuelle.»
JULIE.—Certes, cette page est belle.
THÉODORE.—Tout l'ouvrage est beau; mais vous ne faites grâce à l'auteur que parce qu'il consent à monter un instant votre dada du monde stellaire.
JULIE.—Mon dada! c'est ma religion, à moi, et l'abbé ne s'en courrouce pas trop: je lui ai prouvé qu'en espérant parcourir tous ces beaux habitacles des cieux, je ne faisais qu'étendre le domaine du paradis.
THÉODORE.—Je ne nie pas votre hypothèse. Je suis de ceux qui ne nient et n'affirment rien sans réflexion; mais je trouve que tous, ici, vous vous préoccupez trop de ces aspirations locomotrices dans l'infini. Cela vous fait oublier d'apprécier tranquillement et justement les données de ce monde-ci, qu'il ne nous est pas permis de vouloir tant dépasser.
—Restez-y si bon vous semble, répondit Julie; moi je vous répondrai avec Platon, avec Hugo et avec Michelet, par le cri de l'âme altérée de lumière et de liberté: Des ailes!
Montfeuilly, 16 août 1856.