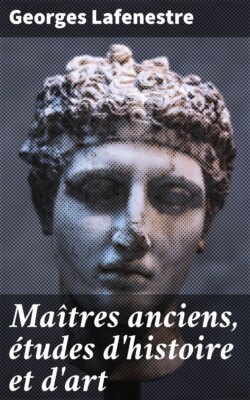Читать книгу Maîtres anciens, études d'histoire et d'art - Georges Lafenestre - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA
SCULPTURE ITALIENNE
AUX XIIIe ET XIVe SIÈCLES
ОглавлениеTable des matières
Le sentiment de la beauté plastique, qui trouve son expression directe dans les arts sculpturaux, s’était déjà considérablement affaibli, chez les peuples antiques, en passant de la race poétique des Hellènes à la race guerrière des Latins. L’avènement définitif du christianisme au quatrième siècle lui porta le dernier coup. La religion nouvelle, en maudissant la nature extérieure comme pernicieuse et corruptrice, détourna peu à peu ses adhérents d’une contemplation dont les jouissances éphémères et vaines les exposaient aux tortures de l’éternelle damnation. Les dieux de marbre, les déesses de bronze, les héros de porphyre, dont la foule éclatante avait, durant huit siècles, peuplé les villes en fête, descendirent l’un après l’autre de leurs autels dans la boue, et de leur gloire dans l’oubli. Ce qui ne fut pas brisé par la haine fut anéanti par l’indifférence. Quand les Barbares, à l’Occident, quand les Iconoclastes, à l’Orient, eurent accompli côte à côte leur stupide besogne, la nuit du moyen âge put s’étendre sur l’Europe. L’antiquité gisait, broyée et salie, sous un tel monceau de ruines, que ses ennemis les plus acharnés purent oublier qu’elle avait vécu.
L’épouvantable période qui s’étend depuis l’invasion jusqu’à l’an Mil, ne fut pas moins funeste aux arts plastiques qu’à toutes les autres activités, nobles ou délicates, de l’intelligence. Dans cette bagarre ténébreuse et sanglante où la postérité n’entrevoit à distance que des éclairs de glaive, des flambeaux d’orgie, des lueurs de villes en flammes, et n’entend monter vers les cieux que l’universelle et stérile lamentation des peuples épouvantés, la Muse des belles formes et des attitudes sereines, la Muse, exilée et maudite, pouvait-elle songer à reparaître? L’Italie, son dernier séjour, ne l’eût pas reconnue. Dépouillée par ses empereurs, saccagée par ses envahisseurs, violée dans tous ses sanctuaires par ses propres habitants, la dominatrice du monde avait perdu jusqu’à son propre souvenir. Quand ses nouveaux maîtres voulurent des palais pour leur cour et des églises pour leur Dieu, ils n’y trouvèrent le plus souvent personne qui les pût bâtir, ils durent demander des plans à ces Grecs dégénérés en qui survivait, du moins, une dernière étincelle de la grande flamme.
La seule activité nationale qui ait persisté se concentre dans les provinces subalpines. Un certain nombre d’ouvriers, fuyant devant l’invasion lombarde (sixième siècle), s’étaient réfugiés dans l’Isoletta Comacina, petite île du lac de Côme. Sous les ordres d’un vaillant seigneur, Francione, ils y résistèrent longtemps aux sommations des chefs barbares. Forcés de se soumettre, ils ne le firent qu’après avoir obtenu pour leur corporation des privilèges importants (590). Les Maestri Comacini, devenus les Francs-maçons, se répandirent bientôt sur tous les points du territoire, comme les seuls possesseurs de la tradition en l’art de bâtir. D’une étude incomplète des monuments romains, combinée avec des réminiscences byzantines, naquit entre leurs mains l’architecture grossière, imposante et bizarre, qu’on est convenu d’appeler l’Architecture lombarde. Pavie, Vérone, Monza, tous les sièges importants de la domination étrangère virent s’élever dans leurs murs des monuments dans ce style. Les cathédrales de ces trois villes, San Zeno de Vérone, San Michele de Pavie, furent construites par les maçons de Côme; leur ornementation brutale, maladroite, presque sauvage, fait mesurer dans toute son étendue le désastre qu’avait subi, dans ce Milanais autrefois si fier de ses villes de marbre, le sentiment antique des formes sculpturales.
Aucun désastre ne pouvait être plus complet. Il fallait créer l’art à nouveau, de toutes pièces, à force de tâtonnements, d’incertitudes, de maladresses, comme si l’Égypte, l’Assyrie, la Grèce, l’Étrurie, n’avaient point existé. Il fallait recommencer, ainsi que les peuples primitifs, par l’adaptation inhabile et incohérente des formes les plus simples, géométriques, animales, végétales, à la décoration externe ou interne des monuments. Un symbolisme religieux, toujours terrible, parfois subtil, présidait aux combinaisons effrayantes, monstrueuses ou grotesques de ces formes. A peine voyait-on çà et là, péniblement, timidement, apparaître la figure humaine sous ses aspects les plus hideux, dans ses attitudes les plus farouches. L’effort pour la dégager de ce chaos est incertain, sans suite, bien lent. Un bas-relief au dessus du portail de la cathédrale, à Monza, le Baptême du Christ (608), les fonts baptismaux de la cathédrale à Cividale (738), un bas-relief représentant Une Procession sur le mur de Santa Maria di Beltrade, à Milan (879), quelques fragments à Parme, dans le dôme, à San Quintino et San Alessandro, les sculptures du porche de San Zeno, à Vérone (exécutées par maestro Pacifico, Guglielmus, Nicolaus, Briolottus, Adaminus, du septième au onzième siècle), ne confirment que trop l’état languissant de l’art dans ces âges désolés entre les mains des maçons de Côme.
La grande secousse de l’an Mil arracha enfin le monde chrétien à sa torpeur. Les peuples, étonnés de vivre, reprirent peu à peu leur sens, comme au sursaut d’un mauvais sommeil, et le goût de l’activité physique et intellectuelle rentra dans leur âme avec l’habitude d’un plus long espoir. Les cités septentrionales de la Péninsule, échappées par surprise à la tyrannie légale des Césars germains, devinrent, en un matin, guerrières, commerçantes, industrielles. Quand les empereurs d’outre-monts voulurent reprendre leurs droits, ils se heurtèrent à des murailles solides, et se brisèrent contre des poitrines héroïques. Barberousse, écumant de rage, dut baisser la tête sous la sandale du pape, et signer l’existence des républiques (traité de Constance, 1167). C’est l’heure glorieuse de l’Italie. Cathédrales et palais publics s’élèvent alors de tous côtés, sur le sol libre, lancent dans le ciel leurs beffrois sonores. Une forêt de tours bariolées, de clochetons ajourés, d’aiguilles ciselées pousse, d’un commun élan, tous ses jets vigoureux au-dessus des enceintes massives. La haine de ses rivales rase une ville en quinze jours, l’amour de ses citoyens la relève en six mois. (Milan, Crémone, Lodi, etc.) Toutes les villes maritimes, Venise, Pise, Gênes, sont les premières à l’œuvre. La piraterie vient en aide au commerce, le brigandage se multiplie, afin de glorifier le Très-Haut. Peu de scrupules sur les moyens, pourvu qu’on s’enrichisse, qu’on grandisse, qu’on bâtisse.
La destruction à l’extérieur est compensée par la construction à l’intérieur. D’un saccage sort une église, chaque assassinat vaut un autel aux saints. Les Sarrasins, les Grecs, les voisins au besoin, paient les frais de l’architecte, remplissent la caisse des consuls. En1065, Pise, à court d’argent, fait mettre Palerme au pillage pour continuer sa cathédrale. En1071, le doge Domenico Selvo oblige, par une loi, toute galère vénitienne à rapporter de chaque voyage une certaine quantité de matériaux bruts ou de fragments antiques destinés à l’embellissement de Saint-Marc.
La sculpture, proprement dite, tient d’ailleurs une place encore très restreinte dans ces constructions. La tradition romaine y maintient, avec rigueur, l’emploi des surfaces planes et des profils vigoureux, qui répugnent aux déchiquetures trop vives et aux ornementations trop brisées. Le ciseau des tailleurs de pierre ne s’exerce qu’autour des chapitéaux, des corniches, des portails, des baies de toute espèce, où les entrelacements traditionnels de chimères bizarres se mêlent aux fleurons de l’Orient et aux losanges de Byzance. A la fin du douzième siècle, on ne connaît encore qu’une tentative sérieuse d’émancipation. Le Baptistère de Parme, couvert de bas-reliefs par son architecte, Benedetto Antelami, fait pressentir un retour prochain vers l’intelligence des formes. Les sujets les plus divers, épisodes de la Bible, scènes de l’Evangile, groupes champêtres, mystiques allégories, y sont enfin traités par un ciseau maladroit mais naïf, qui s’efforce ingénument de reproduire des créatures réelles. Antelami, le premier, a remis le pied sur un terrain solide, au sortir des éblouissements vagues du symbolisme, mais ses élèves l’imitent, sans y rien voir; une fois encore, l’art reste en chemin.
Un coup de génie, plus décisif, allait pourtant ouvrir les yeux si obstinément fermés. Il éclata à Pise, sur la grande place de cette ville pillarde où les fragments de sculpture antique s’entassaient, depuis deux siècles, sans être compris. Un jeune architecte les regarda, les étudia, les imita. Il les compara avec la nature, y reconnut leur origine, mais les trouva plus parfaits qu’elle. Ce jour-là, Nicolas, à Pise, fixait la destinée artistique de l’Italie, comme un siècle plus tard, par un mouvement d’inspiration pareille, Dante Alighieri, à Florence, devait fixer sa destinée poétique.
Nicolas de Pise est une des individualités les plus puissantes qui aient traversé le monde des arts. Dans le treizième siècle qu’il remplit de son activité, l’agitation matérielle et morale de la Péninsule sembla atteindre son paroxysme. La lutte acharnée qui s’élevait de nouveau entre l’Empire et le Sacerdoce, et les précipitait furieusement l’un contre l’autre, entraînant au combat toutes les jeunes républiques, suscita des deux côtés une multitude d’hommes extraordinaires, prodigieux par le vice ou surhumains par la vertu, types de cruautés ou modèles d’abnégation, sans pareils dans le fanatisme, sans rivaux par l’intelligence: Frédéric II et Innocent IV, saint François d’Assise et saint Dominique, Ezzelino de Padoue et saint Thomas d’Aquin. Nicolas mit tour à tour au service des empereurs, des républiques, des papes, son talent d’architecte. Dès sa première jeunesse, il est à Naples, emmené en passant par Frédéric; il y construit le Castel Capuano et le Castel dell’ Uovo. De Naples, il remonte à Padoue, y donne les plans de San-Antonio, puis revient en Toscane. A Florence, Santa Trinità, San Michele in Borgo, San Niccolo, à Arezzo San Domenico, à Volterra la Cathédrale, à Cortona la Pieve et Santa Margherita, attestent la fécondité de son imagination. Par la combinaison savamment variée, suivant le pays et le site, des éléments romans, byzantins et gothiques, il inaugure dans toutes ses constructions un style puissant, naturel et clair, qui correspond à merveille aux besoins complexes de l’esprit contemporain.
Quelques traditions l’ont fait naître en Apulie, dans les provinces occupées successivement par les Grecs et les Normands, les Sarrasins et les Hohenstaufen. Les documents écrits sont contraires à cette assertion: son berceau est à Pise, dans une famille siennoise. Néanmoins, il put connaître fort jeune les monuments du onzième et du douzième siècles, plus nombreux dans les provinces méridionales que dans le nord de la Péninsule, qui portent l’empreinte directe et vive du génie oriental. Quand il partit pour Naples, il n’avait pas seize ans; rien d’étonnant qu’il y ait pris pour les ornementations riches et les décorations polychromes un goût précoce, développé plus tard par la vue de Venise. Si la sculpture apulienne était plus hardie et plus libre, elle n’était d’ailleurs guère préférable, comme exécution, à la sculpture de son pays.
Le bas-relief qu’il fit, à son retour, pour le portail de la cathédrale, à Lucques, la Descent de Croix, mit du premier coup une distance énorme entre lui et ses contemporains attardés dans la routine traditionnelle, Gruamonte, Adeodatus, Rudolfinus, Biduinus, Robertus, dont les reliefs grossiers se voient encore dans les églises de Pise, Lucques et Pistoïa. Néanmoins, de 1233à1260, après cet essai de jeune homme, incomplet encore et timide, on ne lui voit rien produire. Soit que ses travaux d’architecte eussent absorbé toute son activité, soit qu’il ait voulu étudier de plus près les ouvrages romains ou grecs, avant d’entreprendre une œuvre plus considérable, il était déjà sur le retour de l’âge lorsqu’il commença la célèbre chaire du baptistère, à Pise, qui servit de point de départ à l’art italien. Le Tombeau de saint Dominique, à Bologne, la Chaire de la cathédrale de Sienne, la Fontaine publique, à Pérouse, les Sculptures de l’Abbaye, à Viterbe, suivirent d’assez près cet important ouvrage. Par une fortune inattendue, Nicolas, avant de mourir, répandait ainsi, sur tous les points de l’Italie, des modèles nouveaux pour les sculpteurs, comme il avait, dans sa jeunesse, élevé dans les mêmes contrées des spécimens de constructions pour les architectes. Par lui, la Toscane prenait, sur le mouvement des arts dans la Péninsule, la haute main qu’elle conserva durant quatre siècles. La plupart des grands artistes toscans furent des voyageurs infatigables, dont l’influence s’exerça au dehors plus encore qu’en leur propre patrie. Pise, Sienne, Florence, furent tour à tour le foyer toujours brûlant où vinrent se rallumer les convictions prêtes à s’éteindre. Quand Nicolas mourut (vers1278), Giotto venait de naître.
L’histoire des élèves de Nicolas est l’histoire d’un apostolat. Pendant un siècle, on les voit, sans relâche, prendre et reprendre leur bâton de voyage, quitter Pise, la commune patrie, pour s’en aller convertir les grands centres de la vie italienne à ce culte retrouvé de l’éternelle beauté. Giovanni, le fils de Nicolas, s’installe de bonne heure à Naples; plus tard, il remonte au nord, et développe sur sa route, à Pérouse, à Sienne, à Arezzo, à Pistoïa, à Prato, les principes hardis de l’enseignement paternel avec un infatigable enthousiasme. Arnolfo di Lapo se charge de Rome, d’Orvieto, de Florence. A la génération suivante, Balduccio sera l’éducateur des Lombards, Andrea Pisano celui des Vénitiens. Jusqu’à la fin du quatorzième siècle l’école pisane est partout, travaille pour tous, suffit à tout.
Dès que les disciples de Nicolas se sentirent libres, ils se développèrent, d’ailleurs, suivant un même principe, mais dans des sens bien différents. L’héritage laissé par le maître, qui demeura commun, c’était l’intelligence, désormais rendue au monde, de l’art antique, dans son harmonie auguste, dans sa simplicité puissante. La pensée du sculpteur, arrachée aux chaînes étroites du dogmatisme, pouvait désormais se mouvoir à l’aise dans le vaste champ des observations extérieures et des interprétations personnelles. Aucun des élèves de Nicolas ne l’oublia. Le problème magnifique, autour duquel devait graviter l’art moderne, fut posé, précisé, accepté par tous avec une admirable décision. Dès lors, tous les artistes de la Péninsule, architectes, sculpteurs, peintres, marchent par mille chemins vers un même idéal. Fondre la grâce chrétienne dans la majesté païenne, exprimer les passions les plus délicates et les plus subtiles de l’âme inquiète du moyen âge au moyen des formes claires et harmonieuses de l’antiquité, illuminer de la foi des anges des corps parfaits et beaux semblables à ceux des héros disparus, reprendre, en un mot, à l’humanité antérieure son imagination vivace et sa raison solide, sans renoncer ni à ces extases sublimes ni à ces admirables pitiés enseignées aux peuples nouveaux par le Christ, telle sera désormais la préoccupation complexe et grandiose qui agitera l’esprit de tous les artistes. Trois siècles de labeur opiniâtre, de tentatives inégales, de tâtonnements périlleux, n’égaleront qu’à peine l’habileté technique à la hardiesse intellectuelle, l’exécution à la conception, la main à l’âme, de façon à rendre possible l’épanouissement calme et majestueux des génies définitifs, où s’incarne complètement la Renaissance, Léonard de Vinci, Raphaël, Corrége, Titien ou Michel-Ange. Néanmoins, devant l’œuvre de Nicolas Pisan, devant celle de Giotto, on peut déjà prévoir ces grands avenirs; tant ces esprits sincères avaient puissamment embrassé du premier coup l’espace entier ouvert devant eux, tant ils avaient nettement compris les ressources de leur art, son étendue, ses limites!
Les sculpteurs italiens, comme plus tard les peintres, vont donc se séparer en deux camps, non pas ennemis, mais toujours rivaux, suivant leur tempérament, leurs milieux, leurs convictions. Chez les uns dominera l’amour de l’antiquité, chez les autres, le sentiment chrétien; chez les uns s’exaltera l’idéalisme, chez les autres se développera le naturalisme. La séparation, entre les deux tendances, chez aucun ne sera d’ailleurs complète, ni assez tranchée pour que l’effort s’isole trop, et partant soit perdu. La grande unité, créée par Nicolas, subsistera dans toute sa force au-dessus de ces divergences individuelles, toujours prête, il est vrai, à se dissoudre dans l’éparpillement des activités locales, mais toujours rétablie avec autorité par la volonté virile de nouveaux hommes de génie, jusqu’à ce que l’Italie, épuisée par sa fécondité, surmenée par ses passions, tombe de nouveau en proie à l’invasion barbare, et s’affaisse, dans la honte, pour ne plus se relever.
Du vivant même de Nicolas, la scission éclata dans les œuvres de son propre fils. Giovanni Pisano, esprit indépendant, poussa, de son côté, en avant, mais dans le sens expressif, spiritualiste, dramatique. S’arrachant avec résolution au calme majestueux où se tenait son père, à l’imitation trop exclusive et trop directe de l’antique, il se lança résolûment à la poursuite de l’idéal plus complexe, mais plus élevé, qui vivait dans les âmes agitées de ses contemporains. Soit qu’il ait fait voyage au pays d’outre-monts, soit qu’il ait eu commerce avec des architectes d’Allemagne ou de France, il donna une place importante à l’élément ogival, dans tous ses ouvrages d’architecture. Le Campo Santo de Pise, Santa Maria della Spina, sur l’Arno, dans la même ville, la cathédrale de Sienne, celle de Prato, attestent la variété de ses conceptions, tour à tour grandioses et charmantes. La tradition romane, la tradition septentrionale, la tradition orientale s’y mêlent et s’y soutiennent dans des proportions diverses, qui firent de ces monuments autant de types spéciaux offerts utilement à l’étude des générations suivantes.
Dans la sculpture son influence ne fut pas moins décisive. Il y porta la liberté complète, la vie expressive, la poésie ardente qui manquaient encore. Le premier, il osa tailler dans le marbre des figures complètement nues, agencer des groupes de plusieurs personnages, rechercher le mouvement dramatique. La chaire de Saint-André à Pistoïa marque une étape presque aussi intéressante dans l’histoire de l’art italien que la chaire de Saint-Jean à Pise. Giovanni Pisano est le véritable père de cette famille nombreuse d’artistes, émus et chercheurs, qui imprimèrent à la sculpture de la Renaissance, son caractère le plus vivant et le plus poétique, Jacopo della Quercia, Ghiberti, Donatello, Michel-Ange.
Arnolfo del Cambio, son condisciple florentin, montra dans ses nombreux travaux une originalité presque aussi vivace, une imagination non moins active. Comme architecte, il donna à sa ville natale une splendeur inattendue, en lui trouvant sa forme d’art spéciale, en élevant, coup sur coup, la Santa Maria del Fiore et le Patais-Vieux, les églises de Santa-Croce et d’Or San Michele; comme sculpteur, il a mérité la reconnaissance de ses successeurs, en créant à Orvieto, dans le tombeau du cardinal de Braye, le modèle type de ces belles sépultures, dont l’heureuse ordonnance sera respectée en Toscane pendant plusieurs siècles. Pour la première fois, on trouve là, aux pieds de la Madone et de son divin enfant, l’image exacte du mort endormi sur sa couche de pierre, à l’ombre des courtines légères, que des anges silencieux entr’ouvrent de chaque côté avec précaution et soulèvent en souriant. Conception monumentale et touchante, qui répondait aux besoins les plus divers de l’âme, chez les Italiens de cette époque, à toutes leurs croyances religieuses, aussi bien qu’à leurs instincts d’art, et qui satisfaisait leur imagination chaleureuse éprise de poésie en même temps que leur intelligence positive amie de la réalité.
Néanmoins, la direction du mouvement ne passa définitivement aux mains des Florentins qu’après l’apparition de Giotto. L’avènement de ce grand homme fut, dans la sculpture aussi bien que dans la peinture, l’avénement de l’esprit de Florence, esprit à la fois très poétique et très lucide, très ouvert et très judicieux, aussi éloigné des rêveries confuses que répugnant aux basses trivialités. Dante Alighieri dans la poésie, Arnolfo di Cambio dans l’architecture, Giovanni Villani dans l’histoire, Giotto dans la peinture, apparurent tous à la fois, comme les prophètes enthousiastes d’une civilisation nouvelle, et la flamme audacieuse de leur raison, étincelant, claire et subtile, au milieu des ténèbres encore compactes du moyen âge, illumina d’un seul coup, devant l’Italie hésitante, le chemin glorieux qu’elle devait gravir.
Andrea Pisano naquit peut-être à Pise, ainsi que son nom l’indique, ou du moins y étudia de bonne heure, à l’école de Nicolas; c’est à Florence qu’il vécut et qu’il travailla. Son association fraternelle avec Giotto déplaça tout à fait les centres de l’activité artistique en Toscane, permit à Florence d’attirer vers elle tous les sculpteurs de Pise aussi bien que tous les peintres de Sienne, et prépara la fusion de ces deux écoles isolées en une école commune plus complète et plus forte. Avec Andrea s’introduisit, dans la sculpture, le naturalisme, élevé et poétique, dont Giotto fit son principe. Dès ce jour, les peintres et les sculpteurs marchèrent, côte à côte, d’un pas égal, qui leur permit souvent d’associer leurs efforts, et les exposa parfois à confondre leurs buts. Tant que dura, néanmoins, l’autocratie intelligente de Giotto, tant que sa pensée, si nette et si ferme, demeura vivante au milieu de ses élèves, il n’y eut dans la marche des deux groupes ni une hésitation ni un recul. Andrea Pisano et lui avaient compris d’une façon si claire l’étendue et les moyens de leurs arts respectifs, que le progrès y fut constant jusqu’à la moitié du quatorzième siècle.
Andrea Pisano, dont l’activité fut très multiple, a laissé à Florence deux chefs-d’œuvre, les bas-reliefs du campanile de Giotto, les portes de bronze du baptistère. Dans les premiers sont retracés, en groupes ingénus et saisissants, les épisodes divers de la vie primitive, tels que la Construction de la première cabane, le Culte des étoiles, l’Homme domptant le cheval, l’Homme faisant des lois, la Femme pétrissant les vases de terre, la Femme filant à la quenouille, Noé trouvant le vin, Tubal inventant la forge, etc., etc. Ces bas-reliefs hardis et poétiques établissent l’alliance féconde de la tradition et de l’observation, de la forme antique et du sentiment personnel, de la beauté extérieure et de la grandeur morale. Les mêmes qualités de conception et d’exécution se retrouvent, à un degré supérieur, dans les vingt panneaux de bronze qui composent la porte méridionale de San Giovanni, et représentent les épisodes de la vie du saint, en des reliefs très nets et très clairs, d’une ordonnance tout à fait grandiose, d’une facture presque héroïque. Les maladresses d’une main encore inhabile n’enlèvent rien de son magnifique aspect à cet ouvrage, dont l’ensemble, en définitive, reste plus monumental, dans sa simplicité, que la fameuse porte du paradis, la porte merveilleuse et exquise de Ghiberti, où la minutie patiente du travail, la complication pittoresque des compositions, ne charment l’œil étonné du spectateur attentif, qu’au détriment de l’harmonie première et de l’unité générale.
Andrea Pisano, comme son maître Nicolas, eut la bonne fortune de voir sa doctrine portée, par ses élèves, sur presque tous les points de la Péninsule. Lui-même séjourna, croit-on, à Venise. Sous son influence, Filippo Calendario, l’architecte du palais des Doges, le complice de Marino Faliero, pendu à la même époque que son doge, en1354, aurait exécuté les curieux chapiteaux des colonnes fortes et trapues qui soutiennent le splendide édifice, du côté de la Piazzetta. Le choix des sujets y est plus varié, plus libre encore que dans les bas-reliefs de Florence; les scènes de la Bible et de l’histoire ancienne, de la vie rustique et de la vie familière, s’y entrecroisent et s’y mêlent à des décorations purement végétales ou animales, avec une aisance harmonieuse qui donne déjà un caractère particulier à ces premières tentatives de l’art vénitien, fécondé plus d’une fois par l’influence de l’Orient ou de la Toscane, mais conservant toujours son charme national, plus extérieur, plus abondant, plus sensuel.
Une altération, dans le même sens, de la tradition pisane, sous l’influence du tempérament local, ne tarda pas à se faire sentir en Lombardie après le passage de Balduccio, appelé à Milan par Azzo Visconti. Les tombeaux magnifiques de saint Pierre Martyr, à San Eustorgio de Milan, de Visconti lui-même (aujourd’hui dans la galerie de Trivulzi), de Lanfranco Settala, à San Marco, ouvrirent la voie à un grand nombre d’artistes indigènes. L’art sculptural prit un caractère plus décoratif, mieux en rapport avec la vie déjà fastueuse des Lombards et avec leur fréquentation des artistes ultramontains, ainsi qu’on peut le voir dans l’Arcade Saint-Augustin, à Pavie, et les tombeaux des Scaliger, à Vérone.
Ainsi de tous côtés, dans les provinces subalpines, les yeux s’ouvraient peu à peu au sentiment de la beauté plastique par l’expansion de la belle lumière allumée à Pise. L’Ombrie recevait en même temps l’enseignement d’une école de seconde main créée par Nicolas de Pise dans le Siennois, mais qui suivait aussi sa route particulière, demeurant plus fidèle aux idées dogmatiques et poursuivant volontiers une expression plus mystique. L’architecte du dôme d’Orvieto, Lorenzo Maïtani, paraît en avoir été le chef et l’inspirateur; l’histoire nous a transmis des noms en grande quantité sans qu’il soit possible d’assigner à chacun sa part dans la décoration collective de l’immense édifice. Deux d’entre eux, Agostino di Giovanni et Agnolo di Ventura, se sont presque seuls assurés une renommée spéciale en sculptant, dans l’église d’Arezzo, seize bas-reliefs sur le tombeau de l’évêque-soldat Guido Tarlati. L’influence de Giotto s’y fait très résolûment sentir dans l’équilibre ingénieux des compositions et la vérité expressive des attitudes; Vasari n’hésite pas à lui faire honneur des dessins originaux.
Vers la dernière moitié du quatorzième siècle, l’enthousiasme, jeté dans les esprits par Nicolas de Pise et Giotto, s’affaiblit et disparut peu à peu, au milieu des calamités de toute sorte dont l’Italie se sentit accablée. Les pestes épouvantables et les discordes civiles qui décimèrent la Toscane, déterminèrent un affaissement momentané des âmes, dont la trace est visible dans la plupart des ouvrages, littéraires ou artistiques, de cette époque. En vain les derniers élèves d’Andrea Pisano soutinrent la tradition du maître avec une énergie constante et une heureuse fortune. Les germes semés, dans le terrain fécond, par ses fils Nino et Tommaso, et surtout par le puissant architecte de la Loggia. le peintre effrayant du Campo Santo, Andrea Orcagna, ne devaient lever et fleurir qu’après un grand repos, sous les pieds d’une autre génération. Le tabernacle d’Andrea Orcagna, à Or San-Michele, termine la liste des chefs-d’œuvre qui sont dus à l’école, saine et forte. des Sculpteurs-architectes.
Quand Orcagna mourut, vers1370, la tradition pisane parut mourir. Elle n’était que silencieuse. Abandonnée par les constructeurs de monuments, condamnés pour quelque temps à l’oisiveté, elle s’était réfugiée dans les boutiques étroites des orfèvres florentins, et s’y préparait, par des travaux patients, une merveilleuse transformation. C’est sur le Ponte-Vecchio, entre les mains des fins ciseleurs et des joailliers ingénieux, que nous verrons renaître, pour la seconde fois, bien différente d’elle-même, la sculpture italienne, devenue florentine, avec des agréments nouveaux de délicatesse ingénue et de grâce juvénile, avec un goût plus pénétrant et plus vif pour l’expression poétique de la réalité vivante, avec une passion désormais avouée et toujours grandissante pour l’agilité dans les mouvements, la variété dans les attitudes, la beauté dans les formes, l’intelligence sur les visages!
(1870)