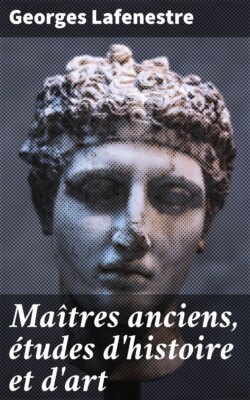Читать книгу Maîtres anciens, études d'histoire et d'art - Georges Lafenestre - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BERNARDINO LUINI
ОглавлениеTable des matières
Les hommes de génie se dressent dans l’histoire comme les grands arbres dans la forêt; tout le soleil est sur leur tête, une ombre épaisse couvre leur pied. L’œil, ébloui par leur magnificence, ne distingue d’abord rien alentour dans la mêlée obscure des végétations vivaces où s’élèvent côte à côte les troncs antiques dont ils sortirent et les rejetons hardis qu’ils ont semés. A Rome et à Florence, combien des travailleurs les plus merveilleux ont disparu, depuis le XVIe siècle, dans la gloire exubérante de Raphaël et de Michel-Ange! Et qu’il faut de patience et d’obstination à la critique moderne, moins exclusive et moins extasiée, pour les remettre en leur véritable place, auprès des puissantes individualités dont la grandeur les écrasait outre mesure, et dont le voisinage les faisait injustement disparaître!
Léonard de Vinci, le premier, resplendit d’un tel éclat en Lombardie, que tous les noms s’y effacèrent près du sien. Si grand qu’il soit, son génie pourtant n’est point isolé, même à cette place; quiconque l’approche ne s’y trompe pas. Avant son arrivée à Milan (1483), la cour des Sforza, voluptueuse et dépensière, avait déjà à son service bon nombre d’excellents peintres, nés la plupart dans le pays. On les pouvait rattacher à trois écoles. Les uns, fraîchement ravis par les élégants ouvrages du Bramante, se laissaient volontiers, à sa suite, appeler les Bramantins; les autres se vouaient plus sévèrement au culte de l’antique, à l’exemple des Padouans, de Squarcione et de Mantegna, tandis que les derniers se préoccupaient spécialement de la nature vivante, comme les réalistes âpres et vigoureux de Crémone et de Brescia. De tous côtés, on était donc en marche. Léonard n’eut qu’à prendre la tête, avec son aisance florentine, pour activer le mouvement, sans ramener pourtant à lui toutes les dissidences. La rude tradition des vieux naturalistes conserva plus d’un fidèle, et Ambrogio de Fossano, dit le Borgognone, l’architecte-peintre de la. Chartreuse de Pavie, ne cessa jamais de résister à cette invasion des grâces toscanes, qu’il estimait dangereuses, corruptrices et amollissantes.
A cette persistance d’activité, en des écoles opposées mais également sérieuses, la Lombardie dut la conservation de son art national jusqu’à la fin du XVIe siècle, en dépit des envahissements du maniérisme déjà répandu dans toute l’Italie. L’enseignement de Léonard, il faut d’ailleurs le répéter à l’honneur de sa haute intelligence, ne participa en rien de l’esprit étroit et systématique qui devait conduire à une décadence rapide les académies fondées sur le modèle de la sienne. Lui-même s’efforçait de mettre en garde ses élèves contre l’imitation de ses propres œuvres, et, s’il les fascina au point que plus d’un n’en revint pas, ce fut par un entraînement fatal de son génie, jamais par un parti pris de sa volonté. «La nature, la nature seule, répétait-il d’habitude dans ses leçons, est la maîtresse des intelligences supérieures.» Ses amitiés solides attestaient la rare liberté d’esprit qu’il savait apporter dans l’appréciation des hommes et des œuvres. Son admiration pour Sandro Botticelli ne fut jamais diminuée par l’enivrement de sa propre perfection. A Milan même, il demandait volontiers conseil à Bernardo Zenale, l’un des champions fidèles de la vieille école lombarde, et confiait d’ordinaire, pendant ses absences, la direction de son académie non pas à ses élèves les plus soumis, mais à celui de tous qui savait le mieux défendre contre lui des convictions individuelles, à Beltraffio, le suivant obstiné des maîtres austères de la génération précédente, que Vinci n’avait pu lui faire oublier, de Squarcione et de Mantegna, de Vincenzo Foppa et de Bevilacqua.
Malgré les précautions prises par le Vinci pour transmettre sans violence et dans leur sens le plus large les traditions du grand art à ses successeurs, la puissance irrésistible de sa personnalité eût sans doute à la longue produit en Lombardie le résultat fatal qu’eurent Raphaël à Rome et Michel-Ange à Florence, sans l’épouvantable série de révolutions qui ensanglanta la haute Italie à partir de la descente de Charles VIII (1494) et coupa court au développement régulier de cette influence. Après la chute de son patron, Lodovico il Moro, Léonard se réfugia d’abord à Florence, puis à Rome; il ne revint à Milan que pour confier le soin de ses vieux jours au conquérant d’outre-monts, au jeune vainqueur de Marignan, qui l’emmena en France (1516). C’est là qu’il mourut, peu de temps après, au château du Cloux, près d’Amboise.
Son entourage dispersé ne se réunit plus. L’élève bien-aimé du maître, le saint Jean aux cheveux bouclés, le bel adolescent aux tendres regards, le charmant gentilhomme Francesco Melzi avait suivi dans tous ses exils le grand homme qu’il nommait son père; il reçut son dernier soupir, lui ferma les yeux; mais, quand il rentra à Milan, il avait le cœur brisé, cessa de peindre, et ne vécut que dans le passé. Andrea Solari, son compagnon, plus ferme ou plus nécessiteux, resta en France et remplit de ses œuvres le château de Gail-Ion; toutes ont péri dans la débâcle de1793. Quant à Beltraffio, il n’était déjà plus: la mort l’avait saisi en pleine jeunesse, avant son maître; et Cesare da Cesto, retenu à Rome par l’amitié de Raphaël, n’en sortit plus.
La place redevenait donc libre à Milan. Il n’y restait, parmi les élèves directs du Vinci, que les moins personnels et les moins illustres, ceux qu’il avait dédaigné d’emmener à sa suite, ou que les rois ne se disputaient pas. L’école antique reprit faveur, quelques-uns se serrèrent autour de son dernier représentant si actif et si tenace, le vieux Borgognone. Le plus grand nombre reprit peu à peu son indépendance, confondit tour à tour dans des proportions diverses les traditions de Padoue et de Florence, de Mantegna et de Léonard, suivant à son gré l’un ou l’autre, et retourna vers la nature. Deux d’entre eux surtout sont devenus célèbres et caractérisent assez bien ces deux courants d’esprit parallèles: l’un est Gaudenzio Ferrari, plus puissant et plus hardi, plus amoureux des grands spectacles et des colorations énergiques; l’autre est Bernardino Luini, plus sympathique et plus séduisant, plus dévot à la grâce et plus sensible à la beauté, tous deux égale ment variés et sincères, tous deux d’une fécondité qui touche au prodige.
Rien ne prouve mieux que l’exemple de Bernardino Luini avec quelle puissance s’impose, même à distance, la fascination d’un grand génie sur les esprits d’une trempe moins forte, mais de même famille. Le suivant fidèle de Léonard, l’imitateur enthousiaste et soigneux qui copiait à s’y méprendre les œuvres du maître, qui recueillait, dit-on, avec piété ses moindres croquis et ses plus insignifiantes maquettes, pour les transformer en tableaux, qui termina un grand nombre de ses ébauches, et fut, le plus souvent, par les amateurs, confondu avec lui, ne fut pas très probablement son disciple immédiat. Léonard, dans ses manuscrits, nomme tous ses élèves sans le mentionner. Les traditions locales (Vid. Bianconi, Resta) le font venir tard à Milan, vers 1500, déjà bon peintre et jouissant d’une certaine réputation. Son premier séjour fut Verceil, où grandissait à cette époque Bazzi, surnommé plus tard le Sodoma, qui devait avoir avec lui plus d’un point de ressemblance. Son premier maître fut Stefano Scotto.
Selon toute apparence, ce fut une admiration tardive et désintéressée d’artiste ébloui qui suffit à déterminer la direction de Bernardino. Toute affirmation à cet égard est d’ailleurs impossible. Les documents, jusqu’à ce jour, manquent sur ce point comme sur beaucoup d’autres. Nous ne sommes sûrs de rien, pas même de son nom. Est-ce Luini? Est-ce Luino? Plus probablement c’est Lovino. Presque toujours lui-même l’écrit ainsi, et nous le retrouvons dans quelques registres. Sa renommée, de son temps, ne fut pas bien grande, au moins hors de Milan, pour les pédants de Florence. Vasari, qui n’aime guère les gens simples, parle de lui, en des termes élogieux, mais par ouï-dire, sans façon, en passant; il n’a pas retenu son nom, et l’affuble d’un sobriquet ridicule, Del Lupino. Baldinucci, plus tard, n’en souffle mot. Suivant Argelati, Luino n’est même pas son nom, son père s’appelait Giovanni Laterio; Luino ne serait qu’un surnom conservé en souvenir de son lieu de naissance, de Luino, la bourgade blanche, aux tonnelles de brique chargées de longs pampres, qui dort en paix sur la rive orientale du lac Majeur, parmi les sombres châtaigniers et les oliviers blanchissants. L’opinion est vraisemblable et conforme aux habitudes du temps. Suivant d’autres, néanmoins son vrai berceau serait à quelques pas plus loin, à Ponte, dans le val de Lugano.
Lugano ou Luino, d’ailleurs, n’est-ce pas tout un pour la splendeur du paysage, l’harmonie des horizons, la transparence des eaux? Sur les deux lacs souffle une brise pareille, embaumée et rafraîchissante; nulle contrée au monde n’est mieux faite pour rasséréner l’âme, éterniser les félicités. Celui qu’on devait appeler il soave pittore y pouvait naître parmi les fleurs. A quelle époque ouvrit-il ses yeux d’enfant au beau spectacle qui l’entourait? On l’ignore aussi. Quand il vint à Milan, de sa province, déjà connu, vers1500, on peut lui supposer une quarantaine d’années. Son portrait à Santa-Maria de Saronno (1525), portrait d’homme déjà vieux, blanc de barbe, blanc de cheveux, est bien celui d’un sexagénaire. Sans trop d’invraisemblance, on peut donc placer sa naissance vers1460, un peu avant, un peu après.
S’il n’a pas suivi l’enseignement direct du Vinci, a-t-il du moins été à Rome? Faut-il attribuer sa ressemblance avec Raphaël, en certains points, uniquement à l’identité sympathique et profonde que la nature peut établir parfois à distance entre de belles âmes?
Le conseiller de Pagave, annotant Vasari en1796, le premier, sans preuves, imagina ce voyage que semble démentir la vie constamment laborieuse de Bernardino en Lombardie, autant que le silence gardé par les correspondances de l’époque. N’eût-on pas signalé sa présence à Rome, comme on signalait celle de ses compatriotes et confrères, de Cesare da Sesto, d’Andrea Salaï, etc.? Les gravures de Marc-Antoine, rapidement jetées à toutes les extrémités de l’Italie, les études et les croquis rapportés de la Sixtine et des Stanze par une multitude de visiteurs enthousiastes, n’ont-ils pu faire connaître à Bernardino les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël, sans qu’il les vît sur place? Son intelligence facile, naturellement préparée, comme celle de ses contemporains, à suivre ce développement nouveau d’un idéal antérieur, n’avait point d’effort à faire pour s’assimiler, dans ce dernier maître, les qualités d’élégance et de noblesse qu’il trouvait déjà dans sa propre nature. Les affinités de cette espèce, communes dans l’histoire des arts, suffisent ici à tout expliquer.
L’existence du peintre devait donc s’achever où elle avait commencé, sous le même ciel serein et clair, dans l’étroit espace de quelques lieues; elle n’y fut cependant exempte ni de troubles intimes, ni de commotions extérieures. En proie, autant qu’il semble, à une misère obstinée, l’artiste insouciant n’évita pas toujours le contre-coup de ces invasions de Barbares, Français, Allemands ou Espagnols qui s’abattaient tour à tour sur la riche Lombardie, comme en un paradis grand ouvert, pour s’y gorger brutalement de victuailles et de luxure, de paresse et de soleil. En1524, une peste épouvantable éclata à Milan parmi la population exténuée de privations et la cohue malpropre des lansquenets en goguette. « On ne voyait que gens clochettes à la main, que chariots pleins de malades; pas d’office qui ne fût des morts, pas de cloche qui ne tintât pour un cadavre. A la cathédrale, on n’officiait pas à l’ordinaire, mais deux ou troisprêtres chantaient à la hâte, comme ils pouvaient.» La famine devint en même temps si grande, qu’on mangeait l’herbe devant les remparts; les loups, maîtres de la campagne dévastée par vingt ans de pilleries, s’avançaient en bandes jusqu’aux portes de Milan. Bernardino se réfugia dans un château voisin, chez les seigneurs de la Pelucca, où il peignit une chapelle, et ne revint à Milan qu’après la disparition du fléau.
C’est alors qu’il fit ses travaux dans l’église San-Giorgio-in-Palazzo (Déposition, Ecce Homo, Épisodes de la Passion). Comme il achevait ces peintures, le curé de l’église voulut les voir de près, et monta près du peintre, sur l’échafaudage. Soit que le pied ait manqué au brave homme, peu coutumier de ces escalades, soit que Bernardino, comme on raconte, l’ait poussé par mégarde en se retournant, le prêtre tomba d’ en haut sur les dalles, et s’y tua. La justice des Espagnols était vive, peu questionneuse, fort expéditive. Luino n’était qu’un pauvre diable, sans valets d’armes, sans cassette; il n’attendit pas l’enquête, et tira des deux vers la Pelucca où ses amis, les seigneurs du lieu, l’accueillirent de nouveau et le prirent sous leur garde. La villa de ses protecteurs, le couvent des frères Umiliati qui l’avoisinait, furent bientôt couverts de fresques religieuses et mythologiques, dans le goût du temps: les saints du Paradis et les déesses de l’Olympe y faisaient bon ménage. Bernardino sauvé s’attardait volontiers dans cet aimable asile; une surprise de l’amour le relança brusquement dans tous les hasards de la vie errante. Jeune de cœur, quoique sur le déclin de l’âge, il se prit, paraît-il, d’une passion profonde pour la fille même des seigneurs de la Pelucca: cette passion fut partagée. La belle Lombarde, sommée par ses parents d’épouser un gentilhomme, refusa net; on la jeta dans un couvent à Lugano. Bernardino dut déguerpir.
On ne s’étonnera pas de le retrouver lui-même à Lugano, quelques mois après, errant autour des murailles solides qui lui cachaient à tout jamais sa bienaimée. Néanmoins il s’était d’abord sauvé dans la Valteline, à Ponte, où il avait laissé des traces de son passage, sur le portail de l’église, une Madone et un Saint Maurice. Longtemps après on parlait encore de lui dans le pays, et les gens du peuple disaient en montrant sa fresque: «Quel dommage que Bernardino n’ait pas tué douze curés, nous aurions peut-être douze belles peintures! »
A Lugano, ville libre, rattachée depuis plusieurs années à la confédération helvétique (traité de Ponte-Tresa, 9mai1517), Bernardino se trouvait enfin à l’abri de toute poursuite, soit à cause de l’accident de San-Giorgio, soit de la part des seigneurs de la Pelucca. Des Milanais de toute condition y affluaient chaque jour en grand nombre, chassés de leur ville par les insolences croissantes des Espagnols et les tyranniques exactions d’Antonio de Leyva. On fit obtenir au fugitif, chez les Pères mineurs de l’Observance, une commande considérable, celle du Crucifiement, dans l’église Santa-Maria-degli-Angeli; c’est son œuvre la plus importante comme dimension, et la dernière qu’il ait signée (1529).
A cette époque, on perd sa trace. La légende assure que sa fiancée, pendant ce temps, était morte de langueur dans son couvent, sans qu’il pût la revoir. L’histoire, de son côté, affirme que son fils, Aurelio Luini, qui devint plus tard un peintre de talent et un anatomiste distingué, naquit en1530. S’il perdit celle qu’il aimait, il aurait donc trouvé ailleurs d’assez promptes consolations. Le champ vague des suppositions reste ouvert.
Si les écrivains du temps sont avares de détails précis au sujet de sa vie et de sa mort, ils le sont moins au sujet de ses habitudes et de son caractère. Tous, même les moins bienveillants, tels que Vasari, s’accordent à le représenter comme un hommea ffable et avenant, de mœurs paisibles et de tendre complexion, qui s’adonnait avec une passion entière à la pratique de son art, et ne sut jamais donner beaucoup de soin à ses propres intérêts: «Fù persona cortese ed amorevole molto delle cose sue. Il fut personne courtoise et fort amoureuse de ses œuvres. Et lui conviennent toutes louanges, convenant à l’artiste qui ne fait pas moins resplendir par l’éclat de sa courtoisie toutes les actions et les habitudes de sa vie, que par l’excellence de son talent toutes les œuvres de son art.» Sa renommée de poète égalait en son temps sa renommée de peintre. A l’exemple de ses contemporains (Antonio Filarete, Léonard de Vinci, Lomazzo, etc…), il analysait volontiers les théories de l’art qu’il exerçait, et fit un Traité sur la Peinture. Ses œuvres littéraires sont restées manuscrites; aucune n’est parvenue jusqu’à nous.
Son portrait, tel qu’il nous l’a donné plusieurs fois, à divers âges, confirme admirablement les trop rares paroles de la renommée. De stature moyenne, de taille bien prise, la tête forte, le front large, l’œil mince et noir, humide et vif, il a lui-même cette vive rougeur des chairs dorées, cet éclat blond d’une abondante chevelure, qu’il donne volontiers à ses créations. Jeune, il sourit; vieux, ilsourit, réfléchissant encore sur son visage l’inaltérable candeur d’une longue adolescence. Tel il apparaît à Milan et à Côme, tel il reparaît ensuite à Saronno, dans la Dispute des docteurs, toujours aimable et avenant, doux et paisible, la main prête à s’ouvrir, les lèvres prêtes à parler. J’ai passé bien des heures avec lui, et je l’ai toujours trouvé tel que je le rêvais; j’ai bien vu en lui l’homme de son œuvre, le bon garçon joyeux et aimable, rêveur et capricieux, insoucieux de son temps et peut-être de sa gloire, tantôt soigneux à l’excès, tantôt négligent à faire peur, mais modeste et sans pose, et qui garda jusqu’au bout, avec la saine ivresse de la vie, l’amour de toute grâce et de toute beauté, au milieu des jeunes filles et des enfants que sa bonté attirait autour de lui, et qu’il aimait par-dessus tout à représenter.
Ses peintures à fresque portent, mieux que ses tableaux, l’empreinte de son génie facile, harmonieux, sympathique. Bien que ses ouvrages de chevalet jouissent à bon droit d’une haute réputation et tiennent une place excellente dans les meilleures collections de l’Europe, ce n’est point là néanmoins qu’il atteint son excellence ni qu’il manifeste à l’aise sa discrète et pénétrante originalité. La plupart de ses tableaux ont été longtemps attribués à Léonard, avec autant de vraisemblance que les travaux de ses élèves immédiats, Salaï bu Marco d’Oggione, Melzi ou Solari. Non seulement Bernardino s’était approprié, à force d’admiration, la manière du maître, au point de tromper l’œil le plus exercé dans ses copies; mais, on le sait encore, il recueillait pieusement tous les dessins et croquis laissés par Léonard, et les prenait pour thème ordinaire de ses petites compositions. Dans l’art monumental, au contraire, il se trouvait plus abandonné à lui-même, et obligé, par la nature de la besogne, à des rapidités d’exécution qui s’accommodaient mieux de ses caprices et laissaient le champ plus libre à ses expansions. Qui veut le connaître et qui veut l’aimer comme il mérite doit donc faire le pèlerinage de la haute Italie et s’arrêter quelques jours à Milan, à Saronno, à Lugano.
A Milan, dans l’église della Passione, dans les galeries du palais Brera, où furent transportées les fresques d’une chapelle maintenant détruite (la Chiesa della Pace), on reconnaîtra ses œuvres les plus anciennes, souvent les plus charmantes, aux incertitudes continues du style, aux maladresses ingénues de l’exécution, Avec un artiste aussi inégal que le fut toujours Luini, la précision des dates n’est pas possible en l’absence de documents. Les fragments dont nous parlons ont néanmoins par instants un tel caractère de gaucherie involontaire, qu’on y doit voir, sans hésiter, les tâtonnements d’une inexpérience juvénile et non pas le laisser-aller d’un homme habile en ses mauvaises heures de nonchalance, de dégoût ou de lassitude. La personnalité du peintre y éclate de tous côtés, dans les faiblesses mêmes, avec une vivacité de séduction très prime-sautière. Dès cet instant il sait mettre dans l’attitude, le geste, la physionomie de ses personnages, une sorte de naïveté affectueuse qui lui est particulière, et garde sans effort, dans sa façon d’agencer les compositions et d’exprimer le sentiment humain ou religieux, une simplicité délicate et primitive qui l’isole peu à peu au milieu de tous ses confrères, de plus en plus emportés par les exemples de Rome et de Venise vers la mise en scène théâtrale et l’agitation pittoresque.
Bernardino, on le voit là, fut un des hommes de la Renaissance qui reçut le plus franchement, le plus naturellement, ses impressions du monde extérieur à la façon antique. La campagne du Vésuve n’avait pas encore rendu au jour le spectacle complet d’une ville romaine; les fragments de stucs grecs ou latins étaient rares, même à Rome. On peut douter que Bernardino en ait étudié un grand nombre, même sur des dessins; mais il s’en pénétra avec une facilité durable qu’explique seule une particulière disposition d’intelligence, portée, comme celle des peintres anciens, à la simplification puissante des ensembles, par la négligence du détail réel et la franchise spontanée de l’expression. Un rêve de Pompéi, d’une Pompéi moins sensuelle, d’une Pompéi chrétienne, s’éveille plus d’une fois dans l’imagination, devant ses tableaux. Dès cette époque la composition en est claire, bien divisée, et rappelle, par sa simplicité, la disposition des bas-reliefs. La lumière y est franche, sans effets violents ni de clair-obscur; les contours des choses n’y sont plus serrés cependant avec la rigidité primitive, et la douce coloration dont elles sont baignées ne laisse à leur aspect aucune de ces âpretés ni de ces sécheresses très communes encore dans les fresques de l’époque. L’attitude des personnages, groupés sans effort, frappe l’œil par sa vérité naïve; l’exquise expression des physionomies l’enchante le plus souvent par une ineffable candeur. Jamais Bernardino n’exprima avec plus de charme ni de tendresse la grâce de l’adolescence qu’en cette délicieuse Vie de la Vierge, rêvée tout entière dans une fraîche matinée de printemps. La virginité, la pudeur, la joie honnête, y sont rendues avec une aisance naturelle que ne dépare point la maladresse ingénue d’un style encore hésitant, et qui garde en son allure quelque chose d’enfantin.
Jamais Luini, et c’est là son caractère le plus sympathique, soit par modestie, soit par nonchalance, n’afficha d’ailleurs les hautes prétentions idéales ou techniques qu’on remarque communément chez les artistes de son temps. Il échappa ainsi toute sa vie au maniérisme et ne dut sa constante séduction qu’à la rapidité singulière avec laquelle il savait saisir, dans la vie commune, les attitudes pittoresques, et à l’élévation naturelle d’une imagination émue et chaste, qui le garda toujours aussi bien des subtilités laborieuses que des basses trivialités. L’impression qu’il laisse est une impression de sérénité, de fraîcheur, de ravissement, que peu d’artistes ont su donner au même degré, et l’ on éprouve une fois de plus, en l’admirant, combien la bonhomie de l’humeur et la franchise du cœur préparent mieux un homme à trouver la vraie poésie des arts, que l’ingénieux labeur où s’usent tant d’intelligences modernes.
Au même musée ont été rapportées quelques fresques du château de la Pelucca, changé en ferme. Les sujets en sont antiques. La Naissance d’Adonis, le Sacrifice au dieu Pan, la Métamorphose de Daphné, montrent, dans tout son abandon, la simplicité du peintre. Le Cavalier lancé au galop, la Grande luse drapée, font partie de cette collection, ainsi que le morceau célèbre des Trois Jeunes Filles qui jouent à la main chaude (a guancialino d’oro, à l’oreiller d’or), délicieuse composition dont l’œil se détache avec peine, et que surpassent seules, dans cette magnifique galerie, la Sainte Catherine enlevée par les Anges, qu’on peut sans doute rapporter aussi à sa jeunesse, et la Vierge entre saint Jérôme et sainte Barbara, datée de1521, où le style devient plus ferme et où la manière s’agrandit.
Vers cette époque Bernardino atteignit, avec l’apogée de son talent, l’apogée de sa réputation, La même année, il commença la grande fresque du Couronnement d’épines dans l’Oratorio de la confrérie de Santa-Corona (aujourd’hui bibliothèque Ambroisienne). Les registres de la société en confirment l’entreprise et l’achèvement:
«Messer Bernardino da Luvino, peintre, s’est engagé à peindre le Christ avec les douze compagnons (les membres de la confrérie) dans l’Oratoire. Il a commencé à travailler le12octobre et la besogne fut terminée le22mars1522. Il est vrai qu’il ne travailla que38journées, et un sien jeune homme11journées, et, en dehors desdites journées, il lui tenait la chaux prête à son besoin. Il avait toujours un garçon pour le servir. Il lui fut donné, pour son salaire, toutes couleurs comptées, 115livres6sols.»
Quelque dépréciation qu’ait subie depuis cette époque la valeur des monnaies, ce salaire était minime; si le peintre avait une famille nombreuse à soutenir, la rapidité du travail, en de semblables conditions, lui devenait une nécessité. La fresque de l’Oratorio, comme beaucoup d’autres, en porte les traces. Toutes les parties n’y sont pas, tant s’en faut, traitées avec un soin égal, même lorsqu’elles semblent traitées par la-même main, la main du maître, qui abandonnait à ses apprentis les compléments les moins importants de l’ouvrage, tels que draperies, architecture et paysages, mais se réservait presque toujours, avec le dessin des figures de premier plan, l’exécution définitive des têtes. La tête du Christ est d’une expression dramatique et douloureuse des plus puissantes, les portraits des membres de la confrérie agenouillés à droite et à gauche sont brossés avec une maestria vigoureuse. Quant aux soldats qui flagellent le Christ, ils ont cette physionomie cruelle, ignoble, triviale que Luini inflige, sans varier, à tous ses bourreaux. Il semble que ce type basané, moustachu, aux yeux étroits, aux cheveux plaqués, ait été, de son temps, un type commun parmi les chenapans qui pillaient, incendiaient, violaient à outrance, au cri de «France» ou d’«Espagne». Le bon Luini, maladroit aux violences, peu enclin au réalisme, se contenta toute sa vie d’un même gaillard hideux et brutal, qu’il trouva toujours prêt à dépêcher, avec un sang-froid stupide, la besogne sanglante de ses décapitations, flagellations et crucifiements.
Ce même bourreau, niais et farouche, se retrouve à Milan même, dans une autre suite de fresques plus variées et plus intéressantes, les fresques de San Maurizio ou Monasterio Maggiore (via Porta Magenta). Cette église, un peu délaissée, doit être pour l’artiste un pèlerinage aussi sacré que le couvent voisin, aujourd’hui caserne de cavalerie, où s’éteignent les restes de la Cène de Léonard. La façade, de Fr. Pirovano, n’en est point remarquable; mais l’architecture intérieure, qu’on doit à Dolcebuono, élève de Bramante (1503), est un merveilleux spécimen du style élégant, délicat et fin de la première Renaissance, qui contraste singulièrement, dans Milan même, avec celui des lourdes et emphati ques constructions que le xvie et le XVIIe siècle y ont entassées. Des dégradations fâcheuses ont altéré les peintures qui couvrent, des fondements au faîte, toutes les colonnes, tous les pilastres, toutes les galeries de la double église, dont l’une était seule ouverte aux fidèles, l’autre demeurant réservée aux religieuses. (Elles sont séparées par une muraille mitoyenne, les maîtres-autels étant dos à dos.) Néanmoins l’impression que l’œil en reçoit encore, surtout dans la seconde chapelle, est des plus vives et des plus charmantes. Nulle violence de lumière, nulle brutalité d’ombre. Une inexprimable harmonie s’échappe de ces mille couleurs admirablement combinées et fondues, flotte autour de ces colonnades perdues dans un vague clair-obscur, enveloppe ces fresques lentement pâlies sous les voûtes des chapelles, et ces arabesques joyeuses et délicates, aux dorures éteintes, qui courent, de toutes parts, le long des pilastres, des moulures et des frises, et, répandant sur leur route tout le trésor de la nature vivante, font à la fois, au-dessus des bancs de chœurs muets et noirs, tordre les faunes et sourire les dryades, monter les lis et nicher les fauvettes.
N’était-ce pas bien là la retraite mélancolique et voluptueuse, demi-couvent, demi-palais, qui devait inspirer le mieux un rêveur tel que Luini? Les religieuses qui l’habitaient étaient la plupart de famille noble. Beaucoup s’y étaient réfugiées à la suite de grands malheurs. Les bienfaiteurs les plus constants de San Maurizio, qui s’y firent enterrer, qui commandèrent, à leurs frais, la plus grande partie des œuvres d’art que contient l’église extérieure, étaient une famille princière en exil, les Bentivoglio, chassés par Jules II de Bologne, où ils avaient plus d’un siècle exercé la seigneurie. Tout le souvenir des cours splendides du xve siècle, où la beauté régnait en maîtresse absolue, revivait donc en ce monastère aristocratique, à l’abri des murailles sacrées, comme un bonheur lointain à tout jamais perdu. Les grandes dames, maintenant recluses, qui avaient toujours mêlé la dévotion à la galanterie aux beaux jours des Sforza et du roi François de France, rejetaient un regard plus tendre et plus mélancolique vers ce passé à mesure qu’il fuyait plus vite. Nul doute que toutes ces impressions diverses n’aient agi à la fois sur l’esprit si poétique et si sensible de Bernardino, quand il peignit ses fresques du Monasterio. On ne retrouve nulle part, ni dans son œuvre, ni dans l’œuvre de ses contemporains, une alliance si étroite et si sincère de la beauté et de la piété, du luxe mondain et de la ferveur monastique, de la grâce exquise des corps et de la délicate noblesse des âmes.
Qui de vous est la plus séduisante, qui de vous est aussi la plus chaste, sainte Ursule ou sainte Cécile, sainte Apollonie ou sainte Lucie? N’êtes-vous pas toutes d’une même race vigoureuse et pure? Le même sang, riche et chaud, ne monte-t-il pas en rouges bouffées à vos joues transparentes? Avec quelle aisance de patriciennes vous étalez vos robes de brocart et portez vos diadèmes d’or! avec quelle candeur de vierges chrétiennes vous tenez, devant le Christ, les palmes de votre martyre! Humbles et luxueuses, fermes et douces, intelligentes et naïves, mélancoliques et souriantes, bienveillantes et fières, vous réalisez, dans sa plénitude, l’idéal féminin tel que put seule le bien concevoir la Renaissance, à la fois si audacieusement païenne et si profondément chrétienne. Nul de ceux qu’a pénétrés votre ineffable sourire n’en oubliera la consolante fraîcheur, ô magnifiques fiancées du paradis, qui vivez dans l’aurore d’un éternel printemps et la sérénité d’une paix inaltérable!
Peut-être, qui le sait, Luini vous regardait-il, déjà vivantes, sous ces voûtes silencieuses, agenouillées devant l’autel, à deux pas de lui, pendant qu’il fixait votre image sur la muraille, en la sanctifiant par son génie? La belle et pâle donataire, agenouillée au-dessus du maître-autel, dans sa robe de satin blanc aux innombrables crevés, relevée par des torsades d’or, n’est-elle pas Ginevra, fille d’Ercole Bentivoglio, ensevelie dans l’église même? Son premier mari, Galéas Sforza, prince de Pesaro, dépouillé de ses États par Jules II, fut arquebusé sur la route de Parme; son second, Manfredo Pallavicini, fut écartelé en place publique, à Milan, par ordre de Lautrec. Et ne pourrait-on retrouver dans les saintes qui l’accompagnent les traits de quelques-unes de ses parentes, d’Alexandra, qui était religieuse dans le couvent, ou de l’autre Ginevra, la fière épouse du vieux Giovanni, le dernier souverain de Bologne, qui mourut, sans pardonner à personne, excommunié, «avec toutes sortes de haines dans le cœur?»
Dans la sainte Catherine agenouillée devant le bourreau, le peuple de Milan voit encore le portrait d’une criminelle fameuse au XVIe siècle, la comtesse de Cellant, décapitée en place publique, par ordre du connétable de Bourbon, gouverneur de Lombardie, au nom de Charles-Quint (1523). Bandello, dans sa Nouvelle quatrième, raconte tout au long cette tragédie d’amour et de sang.
Bianca-Maria, fille d’un riche usurier de Casale, dans le Montferrat, avait épousé, à seize ans, Hermès Visconti. Sa beauté précoce était déjà célèbre en Italie; son entrée à Milan fut un triomphe. Après six ans de mariage, elle devint veuve et retourna à Casale. C’est alors que son tempérament violent commença d’éclater en mille scandales; après quelques années d’une vie fort libre, elle se remaria au comte de Cellant qu’elle abandonna de suite pour aller mener grand train à Pavie. Là, elle eut un premier amant, Ardizzino Valporga, comte de Masino, avec lequel elle rompit au bout d’un an. Le comte évincé ne sut pas se taire, il bavarda; sa maîtresse, offensée, jura de se venger, et dès lors n’eut qu’une idée fixe et furieuse: le faire tuer. Dans ce but, elle s’empara d’un vaillant homme, le comte de Gaiazzo, qui lui promit tout ce qu’elle voulut, la prit pour folle et ne tint rien. De rage, elle se rejeta aux bras de Masino, sous la condition expresse qu’il tuerait Gaiazzo. Mais Masino va droit au gentilhomme, son confrère d’armes et son ami, qui se trouvait à Milan, et lui révèle ce qui vient de se passer. «Le comte, dit Bandello, fit le signe de la croix, et, tout ébahi, s’écria: Ahi! putta sfacciata chè ella è! si ce n’était honte pour un chevalier de souiller ses mains en du sang de femme, et surtout de pareille femme, je lui arracherais moi-même sa langue, à travers la nuque. Mais je voudrais auparavant qu’elle confessât combien de fois, les bras en croix, elle m’a supplié de vous faire tuer!» Et tous deux connurent la malignité de la femme, et, en public et en privé, racontaient ses infamies, en sorte qu’elle devint la fable du peuple.»
A cette nouvelle, d’un bond, la comtesse tombe à Milan, loue un palais, dresse ses pièges; elle était trop belle pour attendre; un jouvenceau s’englue, un capitaine de vingt ans, don Pietro de Cardona, «pigeon de première plume.» Cette fois, Médee a plus d’exigences, il lui faut deux têtes, celles des deux bavards, des deux parjures, d’Ardizzino et de Gaiazzo. Un soir d’hiver, «quand on soupe tard», Ardizzino est assassiné avec son frère sous une voûte de la via de Meravigli. Pietro de Cardona, saisi par le guet, avoue le crime et dénonce sa complice. «Le duc de Bourbon envoya saisir la dame qui, comme une sotte, fit porter avec elle sa cassette, où étaient15,000écus d’or, comptant échapper par ses artifices. On lâcha la main à Pietro de Cardona, qui put fuir. Mais la misérable jeune femme, ayant avoué, fut condamnée à avoir la tête tranchée. La sentence entendue, ignorant que Pietro s’était évadé, elle ne pouvait se résoudre à mourir. A la fin, conduite en la ruelle du Château, vers la place, quand elle vit l’échafaud, elle se prit à pleurer, à désespérer, à supplier en grâce qu’on lui laissât voir son Pietro, afin qu’elle mourût satisfaite. Mais elle chantait aux sourds. Ainsi la misérable fut décapitée, et ce fut la fin de ses vouloirs effrénés. Et qui veut voir son visage portrait sur le vif, n’a qu’à aller au Monasterio Maggiore. Là il la verra peinte.» Bandello ne désigne point la place précise de ce portrait; mais le type accentué, dur et violent de la sainte Catherine décapitée, type du Piémont, brun et sanguin, qui contraste avec le type milanais, plus fin et délicat, cher aux élèves de Vinci, s’accorde avec la scène elle-même, pour affirmer que la légende populaire voit avec raison la comtesse de Collant dans cette attitude tragique plutôt qu’en plein cortège de martyrs, de saintes et de vierges. Cette tradition romanesque nous donne aussi la date approximative des peintures de Bernardino, que la largeur du style, l’aisance d’allure, la sûreté de l’exécution, suffiraient d’ailleurs à faire placer dans la meilleure période de son talent, au milieu de sa plus grande activité, soit un peu avant, soit un peu après la mise en train de ses grands travaux de Saronno, achevés en1525.
L’église Santa Maria de Saronno est un véritable musée. Bernardino Luini et Gaudenzio Ferrari tour à tour y ont répandu, avec une extraordinaire liberté et une merveilleuse profusion, toutes les richesses de leur pinceau. Les murailles de la nef et du chœur, des chapelles et des cloîtres, les colonnes et les voûtes, la coupole et les lunettes, sont couvertes de leurs fresques, que la célébrité du sanctuaire et la sécheresse du lieu ont préservées de toute dégradation.
Quatre grandes compositions surtout y montrent Luini dans la plénitude de sa force et le développement complet de son style. Au Monasterio Maggiore, il attire et séduit par sa grâce et son charme; à Saronno, il étonne par son aisance et sa grandeur; c’est là qu’il a fait son plus grand effort, avec une égalité soutenue qui n’est pas dans ses habitudes.
Les deux premières compositions qui se présentent sont longitudinales. Elles ont2m, 15de hauteur, sur 3m, 25de longueur. A gauche, le Mariage de la Vierge; à droite, Jésus parmi les docteurs1. Dans la première, le grand prêtre, qui unit les deux époux, occupe le centre. Joseph est déjà un vieillard, mais un vieillard vif et robuste, conservant, sous ses cheveux blancs, l’allure jeune et dégagée, l’affabilité naïve et souriante, que Luini donne toujours à ce saint personnage, pour lequel il semble avoir professé une prédilection sympathique et qu’il a souvent peint sous ses propres traits. La Vierge est une belle femme, vigoureuse et forte, dégagée tout à fait de la roideur primitive et de la sécheresse ascétique; c’est une fiancée chaste et pieuse, mais une fiancée humaine, heureuse de sa riche santé, qui ne cache point l’épais trésor de ses tresses blondes. L’influence de l’école romaine est ici très visible, et cette fresque est l’argument le plus sérieux qu’apportent quelques biographes pour supposer un séjour du peintre à l’école de Raphaël. Ce séjour n’est pas prouvé, nous l’avons dit, et la similitude des styles peut autrement s’expliquer. Les deux jeunes hommes rompant la baguette, l’un sur sa hanche, l’autre sous son pied, rappellent, par le style et par la facture, Sodoma plus encore que Raphaël. Or, les rapports de Luini avec Sodoma sont fort problématiques. Les deux peintres étaient alors l’un et l’autre en pleine floraison, l’un à Sienne, l’autre en Lombardie. L’un des deux a-t-il imité l’autre? Lequel a commencé ? N’ont-ils fait que se rencontrer, d’abord dans l’admiration pour les mêmes maîtres, ensuite dans le développement naturel de deux tempéraments identiques? Tout est possible dans ce prodigieux tourbillon de passions actives qui emportait les hommes du XVIe siècle; ces questions, insolubles pour nous, l’eussent été peut-être pour les contemporains.
Quoi qu’il en soit, Bernardino a, de toute évidence, apporté là des préoccupations nouvelles qui le tourmentaient moins à Milan. L’effort qu’il fait pour agrandir son style y éclate, trop ouvertement quelquefois, au point de faire regretter la grâce plus naturelle et plus simple qu’il imprime d’ordinaire à ses œuvres négligées.
Le Jésus parmi les docteurs, d’un style moins soutenu, d’une harmonie plus pâle, a mieux gardé l’empreinte de sa personnalité. L’enfant, déjà grand, qui se tient debout sur les degrés d’un fauteuil de marbre, accueillant sa mère dans le temple, avec une dignité affectueuse, porte sur son beau visage l’expression de suave tendresse et de fine intelligence, particulière à Luini. Nous retrouvons encore le noble génie du peintre dans le caractère de délicate modestie qu’il a répandu sur toute la personne de la Vierge inclinée vers son divin Fils, dans une attitude d’extase respectueuse. Dans un coin, à droite, parmi la foule des docteurs qui conversent, Luini s’est peint lui-même, déjà très vieux et très chauve, avec une longue barbe blanche; il conserve son air accoutumé de douceur, il sourit, et regarde ceux qui entrent, un gros livre à la main.
Les deux fresques du chœur, d’une dimension plus considérable (4m, 65de hauteur sur2m, 70de largeur), n’offrent pas, au même degré, le caractère un peu insolite chez Luini d’une perfection si voulue et d’un effort si manifeste. Le peintre y reprend l’aisance charmante et les libertés d’allure que nous lui connaissons, distribue ses groupes, comme il aime à faire, en petit nombre et sans confusion, plus à l’antique qu’à la moderne; on peut considérer ces deux morceaux comme des chefs-d’œuvre.
L’Adoration des Mages, qu’on voit à droite, reproduit, dans son ensemble, l’ordonnance traditionnelle du sujet déjà traité plus d’une fois par Luini lui-même (trois fois à Milan, à Saint-Eustorgio, au couvent des Servites, à l’oratoire Saint-Michel, et une fois à Côme, dans la cathédrale, en détrempe. Ce dernier tableau reproduit à peu de différence près la fresque du palais Litta que possède aujourd’hui le Louvre). La Vierge, jeune et fraîche, d’une beauté pleine et sobre, qui s’éloigne autant de la gracilité maigre et sèche des maîtres du XVe siècle que de la vigueur épaisse et massive déjà mise à la mode par l’école romaine, est assise, les yeux baissés, sur un pan de muraille basse. Le type en est tout à fait luinesque, aussi bien que celui du Bambino, alerte et vivace, assis sur ses genoux. Deux des rois mages, richement vêtus, sont agenouillés devant le groupe sacré, tandis que le troisième, le roi nègre, à peine descendu de cheval, se fait détacher ses éperons par un négrillon. Derrière, des pages élégants, de beaux gentilshommes, regardent la scène avec attendrissement. Saint Joseph lève les mains vers Dieu en voyant l’étoile fixée sur l’étable. Au fond, un long cortège de cavaliers et de chameaux chargés de présents descend les routes tournantes de la montagne. Dans le ciel ouvert, cinq angelots, debout sur un lambeau de nuée, déroulent en souriant un long rouleau de musique, et entonnent à pleine voix l’Alleluia des bénédictions.
La Présentation au Temple, d’une composition plus simple, d’une harmonie plus douce, a plus de charme encore et de grandeur. L’architecture au milieu de laquelle le grand prêtre reçoit le divin enfant des mains de sa mère produit un effet puissant de solennité. La noblesse naturelle et simple de tous les personnages assemblés pour la cérémonie s’accorde à merveille avec la grandeur du cadre qui les entoure. C’est là qu’on voit s’avancer derrière la Vierge la jeune fille aux colombes, une des créations les plus suaves de Luini, où se montre avec le plus de franchise le sentiment exquis qu’il eut toujours à la fois de l’art antique et de la nature vivante. Dans un lambeau d’étoffe blanche cloué sur un pilastre, le peintre a laissé, cette fois, en grosses lettres, une inscription « BERNARDINUS LOVINVS PINXIT, ANNO MDXXV.» Le salaire qu’il reçut à Saronno fut d’ailleurs, à ce qu’il semble, aussi maigre qu’à Milan. Une admirable Nativité qu’on peut voir dans un cloître voisin, attenant au presbytère, passe pour avoir été faite par-dessus le marché, comme bon souvenir laissé aux religieux.
La dernière grande œuvre du peintre, le Crucifiement, dans l’église Santa-Maria-degli-Angeli, à Lugano, porte la date de1530. On peut donc placer une bonne partie des fresques de la Pelucca dans l’intervalle qui dut s’écouler entre l’achèvement des fresques de Saronno et l’arrivée du peintre à Lugano. La vaste composition qui couvre toute la muraille transversale, bâtie entre la nef et le chœur, dut d’ailleurs exiger de l’artiste un temps considérable, quelle que fût sa facilité. On n’y compte pas moins de quarante personnages plus grands que nature sur les premiers plans, et une centaine de figures en recul représentant dans l’éloignement les divers épisodes de la Passion. La scène principale conserve l’ordonnance traditionnelle, dont l’origine remonte aux miniatures du moyen âge. Masaccio, l’un des premiers, l’a rendue célèbre par ses fresques de San-Clemente, à Rome. Luini a développé la scène en y ajoutant un certain nombre de personnages.
La multiplicité des épisodes, l’état de dégradation dans lequel se trouve aujourd’hui cette étonnante peinture, ne permettent pas d’abord aux yeux d’ en bien démêler la confusion. Peu à peu cependant, tous les groupes se séparent, s’éclaircissent, s’animent; on reconnaît que le peintre n’a jamais déployé une pareille puissance dans l’expression, ni une pareille sûreté dans le style. Les réminiscences de Vinci, de Raphaël, de l’antique n’y sont plus perceptibles qu’à l’analyseur obstiné, en quelques airs de tête. La Vierge évanouie entre les bras des saintes femmes, la Madeleine aux cheveux épars, les bras ouverts, agenouillée, en extase devant la croix, le centurion à cheval, qui s’essuie une larme du poing, le saint Jean qui s’avance vers la croix, la main sur son cœur, tous, jusqu’au groupe énergique des soldats déchirant le manteau, appartiennent bien à Luini par la majesté des attitudes, la noblesse des mouvements, la beauté intime et pathétique des physionomies. A l’époque où cette fresque fut achevée, dix ans après la mort de Raphaël, il n’y avait plus en Italie que trois hommes capables de comprendre l’art religieux avec cette profondeur et cette simplicité, Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari, son élève, etle Sodoma, son condisciple. Encore Bernardino nous paraît-il le plus naïvement ému, celui qui sacrifia le moins à l’éclat des grandes mises en scène pittoresques ou dramatiques la vivacité d’une foi candide, toujours prête aux expansions les plus sympathiques et aux plus sincères attendrissements. La fresque de Lugano peut, dans ses bonnes parties, soutenir la comparaison avec les chefs-d’œuvre les plus célèbres de l’art italien.
Une Madone entre le Bambino et le petit saint Jean jouant avec l’agneau, qu’on voit dans la sacristie de la même église, date aussi de la même époque, et nous montre, dans son exécution facile, toutes les qualités originales de Luini.
Les tableaux de Bernardino, dispersés dans toutes les galeries d’Europe, ne sont guère moins intéressants que ses travaux à fresque. Les musées de Milan, de Florence, de Rome, de Paris, de Londres, de Vienne en contiennent tous de remarquables, attribués quelquefois, non sans apparence de raison, soit à Léonard de Vinci lui-même, soit à quelqu’un de ses élèves. Le talent d’imitation fut poussé par tous à un si haut point de perfection, que ces erreurs d’attribution devinrent inévitables, lorsqu’il s’agissait soit de copies faites d’après les originaux du maître, soit même de peintures exécutées dans sa manière, d’après les compositions, ébauches, cartons et croquis laissés par lui. Le faire de Luini, plus inégal et négligé, se distingue néanmoins, en général, par une juxtaposition de parties soignées jusqu’à la sécheresse, et de morceaux rapidement brossés, qui s’éloigne beaucoup de la perfection harmonieuse et soutenue de Léonard. Les mouvements y sont moins souples, les modelés moins savoureux, les clairs-obscurs évités avec quelque appréhension. Il est rare qu’on n’y trouve point, soit dans le dessin, soit dans la coloration, quelqu’une de ces gaucheries naïves qui donnent souvent un charme réel aux compositions simples et sans apprêt de Bernardino, mais qui n’eussent point échappé à la volonté sûre d’un artiste toujours maître de lui-même en ses plus grandes audaces, comme l’était le chef de l’école lombarde.
Quant à ses œuvres personnelles, elles portent sa marque, à ne s’y pas méprendre, et ne sauraient se confondre avec celles de ses condisciples qui ont avec lui le plus d’affinité. Le caractère sympathique de simplicité affectueuse, de naïveté délicate, de bonté naturelle dont elles sont empreintes, leur donne un charme particulier qui les distinguerait des tableaux contemporains, lors même que les détails de l’exécution matérielle n’y révéleraient pas sa main à tous les yeux exercés. Les sujets en sont peu variés et traités fréquemment dans la même disposition. L’Hérodiade portant la tête de Saint Jean, le Repos de la sainte Famille, la Madone avec son enfant, ont été pour lui des thèmes inépuisables qu’il a renouvelés bien souvent en y montrant une intelligence exquise de la beauté féminine et un sentiment très délicat de l’amour maternel.
Ses types de femmes, empruntés aux races nationales, peuvent se ramener à deux principaux, qui semblent avoir hanté jusqu’à la fin son imagination vive et chaleureuse. L’un est lafemme svelte, aux mouvements rapides, de sang aristocratique, fine, délicate, blanche, dont les blondes tresses crespelées, les yeux noirs perçants et passionnés, le sourire inquiétant et profond, avaient déjà ensorcelé Léonard; l’autre est la forte fille du peuple qui gravit d’un pied solide les pentes vertes des lacs de Lombardie, aux épaules carrées, aux larges mâchoires, aux belles chairs de pourpre, au sourire salubre et franc, aux épaisses torsades noires. La maternité n’est qu’une gloire sans fatigue pour ces magnifiques créatures. Les vierges de Luini en reproduisent presque toujours lestraits robustes de même que ses petits Jésus ou saints Jean, toujours vivaces, potelés et sanguins, sont les portraits des enfants tapageurs qu’on voit rouler, tout nus, sur la route poussiéreuse, devant la porte où sont assises tout le jour ces mères joyeuses, tirant leur quenouillée et fredonnant une chanson.
Ce sentiment délicieux de la grâce sans affectation chez les femmes, chez les adolescents, chez les enfants, donne au moindre croquis de Bernardino une séduction délicate qui lui assure un rang à part dans l’histoire de l’art. Contemporain des grands metteurs en œuvre, des habiles à tour de bras de Rome, de Florence et de Venise, il eut l’inappréciable mérite de ne point égarer son talent naturel et sympathique à la poursuite des grands effets de théâtre et des tours de force d’exécution. Peintre formé à la plus savante des écoles, il resta néanmoins, par la candeur des impressions et la modestie des visées, un artiste des temps primitifs, semblable à ces ouvriers de génie qui firent, presque à leur insu, la gloire du XIVe et du XVe siècle. Comme eux il ne chercha, dans les sujets religieux qui lui furent offerts, qu’un prétexte à répandre l’amour et la pitié dont son âme était pleine, et non pas l’occasion d’étaler son savoir-faire: comme eux, il ne cessa de s’abandonner, sur son chemin, aux impressions les plus simples et les plus douces que lui offrait la nature vivante, et de les rendre, avec une naïve franchise, par tous les moyens qu’il avait à sa disposition, sans souci de la perfection ni de l’originalité; comme eux aussi, il nous pénètre et nous enchaîne par l’expansion d’une poésie sincère et profonde qui disparaîtra chez les artistes italiens à mesure qu’ils deviendront plus esclaves d’une tradition. Moins savant et moins hardi, moins puissant et moins libre à coup sûr que son maître Léonard, moins soigné peut-être dans son exécution que ses condisciples Cesare da Sesto, Salai, Solari, moins varié dans ses compositions et moins riche dans sa couleur que Gaudenzio Ferrari, son compagnon et son élève, il reste leur supérieur par ce charme sympathique de l’émotion naïve et de la tendresse profonde, qu’il a répandues en tous ses ouvrages. Le voyageur le plus fatigué par l’éclat continu des musées italiens peut toujours rencontrer un fragment de Bernardino; ses yeux étonnés s’y arrêtent sans effort, comme en un lieu charmant de repos inattendu: une inexprimable fraîcheur monte tout à coup vers sa tête endolorie, semblable à celle qui s’élève d’une rivière en marche aux approches d’un grand fleuve, et dont le cours modeste roule avec moins d’éclat, mais s’enveloppe d’ombres plus douces.
1870.