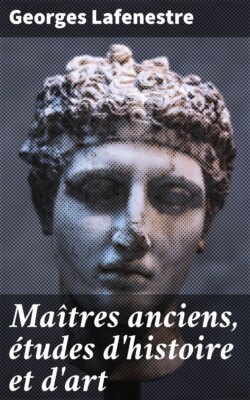Читать книгу Maîtres anciens, études d'histoire et d'art - Georges Lafenestre - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA
PEINTURE MILANAISE
ОглавлениеTable des matières
Dans le grand désordre et la triste nuit qui suivirent, en Italie, la chute de l’empire romain, la ville de Milan, siège d’un épiscopat vénéré, capitale active d’un royaume barbare, semble avoir eu le privilège de conserver, presque seule, quelques traditions de l’art antique. On ne cessa jamais d’y bâtir, d’y sculpter, d’y peindre. Dans quelle grossièreté les sculpteurs étaient retombés, on le peut voir à la basilique de Saint-Ambroise et dans les églises de Pavie, construites aux IXe et Xe siècles; néanmoins, le fameux Paliotto, ouvrage d’un certain Wolvinius, donné à l’église Saint-Ambroise par l’archevêque Angilbert Il (824-835), et quelques autres pièces remarquables d ’orfèvrerie prouvent que les arts décoratifs s’y maintinrent toujours à une certaine hauteur. De la même époque datent les mosaïques grandioses qui ornent l’abside de la célèbre basilique, et peut-être les peintures environnantes représentant la série des évêques milanais. L’existence ininterrompue d’une école de peinture en Lombardie est d’ailleurs prouvée par le témoignage de Paul Diacre et par le traité du moine Théophile, De omni scientia Artis pingendi, qui s’ouvre par ces mots: Incipit tractatus Lombardicus.
Quoi qu’il en soit, les rares vestiges de cet art, à la fois vieilli et enfantin, qui sont parvenus jusqu’à nous, ne nous en donnent pas une haute idée. C’était un art grossier, de pure pratique, tout en formules traditionnelles, que nul ne songeait à élargir. Pour réveiller l’esprit milanais, il lui fallut le contact du libre génie florentin représenté par son premier missionnaire, le plus hardi, le plus passionné, par le grand Giotto, que sa destinée laborieuse et errante poussa successivement à toutes les extrémités de l’Italie pour lui faire allumer partout, de ses mains d’apôtre, la vive lumière de la Renaissance. C’est en1336que Giotto entra à Milan, accompagné de ses meilleurs élèves, sur le pressant appel d’Azzo Visconti, qui le chargea de décorer son palais seigneurial, admirable monument dont la description nous a été conservée par le chroniqueur Galvano Fiamma. Vers le même temps y arrivait un autre Toscan, le sculpteur pisan Giovanni Balduccio, élève d’Andrea Pisano, pour y élever le tombeau de S. Pierre martyr, dans l’église Sant’Eustorgio. Dans les trois arts à la fois, peinture, sculpture, architecture (car Balduccio, comme Giotto, était aussi architecte), le génie toscan, rappelant les artistes à l’étude de la vérité par l’intelligence de l’antiquité, prenait donc, du premier coup, possession du terrain nouveau qui s’offrait à lui avec l’autorité exclusive qu’on s’accoutuma de subir jusqu’à la fin du XIVe siècle.
Déjà pourtant, à Milan, dans cette première période, sous le caractère général d’imitation giottesque, apparaissent çà et là dans les rares peintures d’église qui ont échappé à la destruction quelques traits particuliers dus au tempérament local qui, en se développant, deviendront la marque de l’école: par exemple, un goût très déterminé pour les colorations fortes, un peu tristes, quelquefois lourdes, et pour les figures réelles, d’une expression plus vive que noble, d’une tournure souvent épaisse et d’une allure mal dégagée. Dès les premières années du XVe siècle le naturalisme milanais se distingue assez nettement du naturalisme de Florence, si spirituel, si souple, si alerte, aussi bien que du naturalisme de Padoue, plus fortement empreint du souvenir de la statuaire antique et plus constamment épris des couleurs claires. C’est de Padoue, cependant, que lui vint la grande impulsion par Vincenzo Foppa, élève de Squarcione, condisciple d’Andrea Mantegna, le plus célèbre des vieux maîtres de Milan et le véritable fondateur de l’école. L’existence de Foppa paraît avoir été laborieuse; son influence fut considérable; ce fut lui qui, sous les principats de Filippo Visconti et de Francesco Sforza, marcha à la tête des peintres du pays déjà fort nombreux, si l’ on en juge par la liste de ceux qui travaillèrent à la décoration du château de Milan, Giovanni della Valle, Costantino Vaprio, Vincenzo Civerchio, Ambrogio et Filippo Bevilacqua, pour ne citer que les Milanais d’origine. Vincenzo Foppa accentua la manière des Padouans dans le sens qui convenait à ses protecteurs et à son entourage; il rechercha l’expression vivante et réelle en poursuivant avec moins d’ardeur l’idéal antique ou chrétien. Par son goût pour les recherches techniques et précises, par sa passion pour l’anatomie et la perspective, il imprima à la peinture milanaise un caractère de rigueur scientifique qui fit son originalité et sa force, et qui lui permit, à la décadence, de résister plus longtemps que telle autre à l’envahissement du maniérisme. Il est à remarquer, en effet, que la plupart des peintres de Milan, avant comme après le passage de Léonard de Vinci, furent des spéculatifs et des érudits, non moins préoccupés de la théorie que de la pratique, passionnés pour l’enseignement autant que pour l’exercice de leur art. Les traités de Foppa sur la perspective et l’anatomie servirent, dit-on, à Raphaël ainsi qu’à Albert Durer. Il n’est, pour ainsi dire, pas un de ses élèves ou de ses successeurs, pendant deux siècles, qui n’ait tenu à consigner, dans des manuscrits, presque tous par malheur perdus ou inédits, les résultats de sa propre expérience.
Doit-on être surpris qu’avec des habitudes d’esprit si ouvertes et si actives le groupe des artistes milanais se soit montré de bonne heure hospitalier pour les étrangers, et qu’il ait attiré à lui les illustres artistes des États voisins? Des causes morales d’un ordre plus élevé que l’intérêt personnel et les protections princières durent certainement agir sur tous ces Toscans et sur tous ces Ombriens qui tour à tour s’installent à Milan, y donnent la fleur de leur génie, et s’y transforment eux-mêmes, sous les influences locales, aussi heureusement qu’ils ont transformé par leur action personnelle les artistes indigènes. Evidemment, l’art se développait là tout à l’aise, dans un milieu des plus favorables; deux Florentins, Michelozzo Michelozzi, constructeur d’un palais pour les Médicis en exil, Antonio Filarete qui fit les plans du Grand Hôpital, et surtout l’Urbinate Donato Bramante, en firent successivement l’expérience. Comme peintre aussi bien que comme architecte, ce dernier, pendant un séjour qui dura vingt-quatre ans (de1476à1499), eut une action considérable. Malgré la disparition de ses peintures, on peut, en examinant celles de son maître Fra Carnevale, et celles de son élève favori, Bartolomeo Suardi, dit le Bramantino, s’imaginer quel genre de qualités, chères aux Ombriens, il introduisit à Milan: la clarté dans les compositions, la fraîcheur dans le coloris, la délicatesse dans l’expression, l’élégance dans les détails, en un mot le charme et la grâce.
Lorsque le beau florentin Léonard de Vinci vint, en1483, offrir ses services au duc de Milan, Lodovico Sforza, il se présentait donc, on le voit, sur un terrain bien préparé. Entre ses studieuses habitudes et les tendances des peintres milanais, il y avait une conformité préalable qui permit à son génie ouvert et expansif d’entrer immédiatement en une généreuse communication avec eux, aussi bien pour s’assimiler leurs qualités locales que pour leur inculquer celles qu’il apportait de Toscane. Sans les détourner violemment de leur voie traditionnelle, il se mit de suite ou plutôt se trouva naturellement à leur tête et les entraîna par les charmes réunis de son génie et de sa personne vers un idéal plus élevé. Attaché comme eux aux études scientifiques, pénétré comme eux de respect pour la réalité et la vie, fondant comme eux la grandeur de l’art sur l’amour de la nature, il possédait de plus qu’eux le sens profond de la beauté expressive. Il leur apprit donc à mettre l’observation naturaliste au service d’une imagination émue et ravie et leur révéla, avec plus de clarté encore que Bramante, les grâces du corps humain et les enchantements de la lumière. Il saisit, enfin, le premier, sur les lèvres en fleur des belles Milanaises, ces douceurs mystérieuses du sourire féminin qu’avaient dédaignées ses austères prédécesseurs, plus attentifs aux irrégularités typiques. La Joconde est une œuvre essentiellement milanaise; du jour où resplendit ce merveilleux visage, tous les peintres du pays en furent éclairés; c’est à cette lueur charmante qu’ils travaillèrent pendant plus d’un siècle, et les plus dégénérés d’entre eux, s’ils brillèrent une heure, ne brillèrent que par ses derniers reflets.
Quant aux disciples immédiats du grand homme, ils se pénétrèrent si complètement de son génie qu’ils se confondent presque avec lui dans l’éclat d’une gloire collective. Quelle escorte aimable et dévouée que celle de tous ces jeunes gens, beaux et ardents, qui ne le quittent pas durant sa vie et qui lui restent fidèles après la mort! Salaino, Melzi, Marco d’Oggione, absolument voués à son culte, ne travaillent guère que sur ses dessins; d’autres, pour l’avoir seulement approché, Solari, . Cesare da Sesto, Luini, Bazzi le Sodoma, quoique d’esprit plus libre et de goût plus curieux, emportent partout, conservent partout, à Paris comme à Rome, à Sienne comme à Milan, même à côté de ce Raphaël qu’ils admirent comme un dieu, la marque ineffaçable du premier enchantement qui ravit leur adolescence.
Toute l’école milanaise subit donc l’ascendant irrésistible du grand Florentin; mais, dans un autre groupe, l’évolution ne se fit pas sans peine. La plupart des élèves des vieux maîtres, de Foppa et de Civerchio, protestèrent contre cette importation de la grâce souriante, qu’ils jugeaient dangereuse pour l’avenir de l’art, jusqu’alors rigoureusement maintenu dans les voies de la sévérité chaste et de la noblesse austère! Ils se défiaient de ces compositions subtiles, de ces physionomies séduisantes, de ces attitudes recherchées, de ces perpétuelles tendresses, prévoyant, de beaucoup trop loin sans doute, mais avec une certaine perspicacité, les raffinements de maniérisme où pourrait conduire un jour ce style enchanteur. Parmi les amis et les élèves même de Léonard, plusieurs, tout en l’imitant, partageaient ses défiances, maintenaient fermement vis-à-vis de lui les traditions locales du dessin rigoureux et du style accentué; tels sont, par exemple, B. Zenale, son compagnon de travail à Santa Maria della Grazie, et même Beltraffio, qu’il chargeait, en son absence. de diriger son académie. D’autres continuaient leur routesans presque s’occuper de lui. Ainsi fit cet Ambrogio Borgognone, architecte et peintre de la fameuse Chartreuse de Pavie, qui garda intacte, jusqu’en1530, la tradition hiératique du xve siècle. Ainsi firent les peintres de Verceil, qui donnèrent à Milan tout un groupe de peintres religieux, dont le style s’agrandit au contact de l’école romaine, mais sans perdre toutefois son caractère primitif; ce groupe est représenté avec éclat par Gaudenzio Ferrari et par son élève Bernardino Lanini. Cette branche latérale se distingue par son goût des compositions agitées, des figures réelles, des ajustements bizarres, des colorations voyantes, non moins que par son sentiment élevé de l’expression religieuse; elle se maintint à Milan jusqu’à la fin du siècle avec Battista della Cerva, Lomazzo, Ciocca, Figino et se perdit enfin dans l’imitation inconsidérée de Michel-Ange, dont surent naturellement mieux se garer les peintres, délicats et soigneux, restés fidèles aux traditions prudentes de l’école de Léonard.
Vers la fin du XVIe siècle d’ailleurs les deux branches également épuisées, ne portent plus aucun fruit. Il ne reste plus à Milan de peintres milanais que les fils dégénérés de Luini et quelques-uns de leurs condisciples. Tous les peintres qui travaillent dans les églises sont des étrangers, crémonais, génois, bolonais ou vénitiens. L’imitation des peintres de Venise, et en particulier de Titien, se répand soit par des artistes du terroir, Caliisto de Lodi et Giovanni da Monte, soit par des Vénitiens transplantés, Cesare Dandolo et Peterazzano. Ce dernier s’efforce de combiner avec le coloris de son maître la profondeur d’expression, la science des raccourcis, les hardiesses de perspective qui étaient restées, malgré tout, les qualités milanaises. Néanmoins, c’est à des Bolonais, à la famille des Procaccini, qu’était réservé l’honneur d’arrêter un instant le cours de cette prompte décadence et de rendre à l’école milanaise un certain éclat.
Les Procaccini, compagnons ou élèves des Carraches, n’eurent en réalité qu’un vrai maître, le Corrége; c’est grâce à cette noble filiation qu’ils purent soutenir le rôle que les circonstances leur offrirent. Ercole, le père, dessinateur assez mou, était un peintre très consciencieux, très exact, très soigneux; il lui suffit d’avoir le respect de son art pour combattre utilement les habitudes d’exécution expéditive si fort à la mode chez ses contemporains. Son fils aîné, Camillo, ne l’imita pas sous ce rapport; il s’abandonna sans frein à la facilité de sa verve abondante et banale; mais Giulio Cesare, le cadet, maintenu dans des habitudes plus dignes par ses premières études de sculpture et par son admiration pour le Corrége, fut d’un bon exemple pour les jeunes peintres de Milan, qui pendant toute la fin du XVIe siècle n’eurent d’autre école que son atelier. Il est impossible de faire l’énumération complète des peintres qui passèrent alors entre les mains des Procaccini. Lanzi y a renoncé, et il ajoute: «Il y eut bien parmi eux quelques inventeurs d’un style original, comme il y en eut parmi les élèves des Carrache; mais la plupart mirent tout leur esprit à suivre la manière de leurs maîtres, les uns la maintenant par le soin qu’ils apportaient à leurs ouvrages, les autres la gâtant par leurs procédés expéditifs.»
Tous les voyageurs qui ont visité Milan savent quel effroyable déluge de peintures médiocres a produit cette école des Procaccini. Malgré l’effort estimable fait par Giulio Cesare Procaccini pour reconstituer une école milanaise, il n’y avait plus assez d’énergie locale pour résister à l’envahissement de l’éclectisme confus dans lequel se perdait l’art italien. Du temps des Procaccini, à Milan même, d’autres peintres étrangers y apportaient aussi de tous côtés d’autres influences; les jeunes Milanais allaient, en outre, terminer leur éducation le plus souvent à Venise et quelquefois à Rome; s’ils en rapportaient des talents faciles et souples, quelquefois fort agréables encore, ils y perdaient de plus en plus toute originalité.
Ce n’étaient pourtant pas les encouragements de toute nature qui manquaient alors aux artistes. La famille des Borromée, représentée par les deux grands archevêques de Milan, S. Charles et le cardinal Frédéric, donnait aux arts et aux lettres une impulsion vigoureuse et élevée. Les .peintres se rendirent bien à l’appel; on n’en vit jamais tel nombre, mais combien peu surent ou purent s’élever au-dessus de la médiocrité! Dans cette foule de noms, justement obscurs, qu’on lit sur les vastes toiles dont sont encombrés tous les édifices milanais, on n’en distingue qu’un seul porté à la fois par deux hommes remarquables. Giovanni Battista Crespi dit le Cerano, peintre, architecte, sculpteur, fut le directeur de l’Académie fondée par le cardinal Frédéric Borromée et l’instigateur de toutes ses grandes entreprises; Daniele Crespi était un artiste éclectique, d’une imagination puissante, d’un goût élevé, qui malheureusement mourut fort jeune, enlevé par la grande peste de1630.
Après Daniele Crespi, «le dernier des Milanais», comme l’appelle Lanzi, la décadence suit sa pente avec une rapidité que nul effort ne pouvait arrêter, car cette décadence tenait à l’affaissement général de l’esprit public et à l’épuisement complet du génie italien. L’Académie fondée par le cardinal Borromée s’était fermée après sa mort en1631. Vainement Antonio Busca tenta-t-il de la réorganiser quelques années plus tard; tout enseignement sérieux était dédaigné; il était si facile à la multitude des gâcheurs qui pratiquaient le métier de peintre, d’apprendre n’importe où ces procédés expéditifs qui leur permettaient de couvrir au galop les plus vastes murailles! Jamais on ne brossa plus de peinture à la toise. Ni dessin, ni couleur, ni caractère; aucun souci de la vérité, non plus que de la beauté; pas plus d’étude que d’inspiration. Une certaine facilité de composition banale et creuse, une certaine grâce de coloris, fade et écœurante, tenaient lieu de tout. Les traditions des deux écoles rivales étaient également mises en oubli; Foppa aussi bien que Léonard, Gaudenzio Ferrari aussi bien que Bernardino Luini, étaient définitivement stériles.
Il faut reconnaître que cette uniformité désolante des derniers praticiens milanais était due, en grande partie, à l’influence désastreuse du dernier des Procaccini, Ercole, qui succéda à ses oncles dans la direction de leurs ateliers, mais qui n’eut ni leurs qualités, ni leur science, ni surtout leur conscience, et qui ne cessa d’inonder de ses œuvres les églises du pays. Pour le malheur de ses contemporains, Ercole vécut quatre-vingts ans! A peine peut-on distinguer, dans la cohue qui l’environne, quelques artistes plus scrupuleux et plus intéressants, tels qu’Antonio Busca, Carlo Vimercati, Cristoforo Storer, Federigo Blanchi, Giovanni Battista Discepoli, dit le Zoppo de Lugano. C’est en vain que Giovanni Mauro Rovere rachète quelquefois, par une verve chaleureuse, l’incroyable désordre et le laisser-aller de ses grandes machines; c’est en vain qu’on se met en famille pour fabriquer mieux et plus vite; les Sant’Agostini sont trois, les Rossetti sont trois, les Nuvoloni sont quatre. Chacun d’eux traîne à sa suite une grosse bande d’élèves. A quoi bon les nommer? Tous se ressemblent. Malgré l’habileté incontestable de quelques-uns d’entre eux, plus ils accumulent de toiles, plus ils s’éloignent de l’art. La grande flamme allumée par Giotto, Mantegna, Bramante, Léonard, est décidément éteinte; tous les efforts faits pour la rallumer sont des efforts en pure perte, et c’est à peine si on en retrouve çà et là quelques étincelles sous le tas de cendres rapidement accumulées par deux siècles d’incessante production.