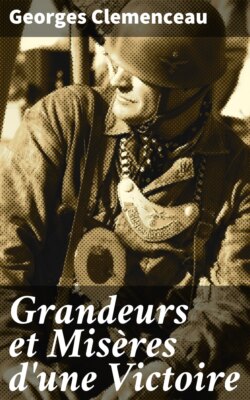Читать книгу Grandeurs et Misères d'une Victoire - Georges Clemenceau - Страница 10
L’EMPLOI DES CONTINGENTS AMÉRICAINS
ОглавлениеUn assez grave dissentiment avec le général Pershing.
Chacun sait que les soldats américains, au premier rang pour la bravoure, représentaient surtout d’excellents effectifs à l’état d’improvisation. Quelques divisions étaient déjà entrées en ligne sous les commandements anglais et français. Il ne pouvait en être autrement. Quant au reste, dont il fallait achever l’instruction, des instructeurs avaient été distraits du front pour commencer en Amérique l’enseignement militaire qui s’achevait en France sous d’autres officiers. Cela demandait du temps. Et c’était grand’pitié de voir faucher nos hommes sans relâche, tandis que, sous le commandement de leurs bons chefs, d’importantes troupes américaines restaient inactives, à portée du canon.
Pour moi, ministre français de la Guerre, qui voyais tous les jours nos rangs s’éclaircir après des sacrifices qui n’avaient rien de comparable dans l’histoire, y avait-il tâche plus urgente que de hâter, dans la mesure du possible, les effets de l’intervention américaine? J’avais passé en revue un des derniers contingents britanniques, dont l’infériorité physique attestait que notre excellente alliée, à son tour, faisait feu de tout bois. Devais-je me contenter de débats théoriques? Ce n’était pas ainsi que je comprenais mon devoir.
J’assiégeais donc de toute ma puissance le général Pershing (le président Wilson était alors en Amérique), pour n’obtenir que des réponses évasives. Pershing, avec son sourire pincé, ajournait de délai en délai. Je ne doutais pas que Foch ne s’efforçât de son côté. C’était souvent le sujet de nos entretiens. Mais, j’en dois faire l’aveu, je jugeais le général en chef un peu trop résigné aux refus de Pershing, et cela, quelquefois, aiguisait les conclusions de nos entretiens.
Avec ou sans l’approbation de Foch, je ne cessais de harceler le commandant allié pour le prier d’envoyer au combat, dans nos rangs, les premiers régiments américains jugés suffisamment instruits, en vue de nous soulager, au plus pressant d’une crise d’effectifs comme nos armées n’en avaient encore jamais connu. Le général Pershing ne demandait sûrement pas mieux que de nous venir en aide, puisque c’était pour cela même qu’il avait traversé la mer. Mais il avait, envers le romantisme de son intervention, le devoir de former une armée américaine autonome, devoir que, du reste, je ne méconnaissais pas.
Son gouvernement, son pays, son armée elle-même, le tenaient en suspens. L’opinion publique, de l’autre côté de l’océan, entendait improviser des officiers aussi bien que des soldats, tandis que je cherchais, avant tout, le succès final de l’épreuve décisive. Le général Pershing, amicalement mais obstinément, me demandait d’attendre qu’il fût en possession d’une armée de toutes pièces, et j’insistais avec des sursauts de nerfs, quand le sort de mon pays se jouait à toute heure sur les champs de bataille qui avaient déjà bu le meilleur du sang français. Et plus j’insistais, et plus le général américain résistait. Si bien que nous nous quittions parfois avec des sourires où il y avait, de part et d’autre, des grincements de dents.
Est-il bien étonnant que l’idée me soit venue de rechercher de quelle aide me fut en cette affaire le commandant en chef? En principe, le généralissime ne pouvait être d’un autre avis que le mien.
Le 4 mai 1918, j’envoie à M. Jusserand, ambassadeur de France à Washington, un télégramme où je lui fais connaître le texte de l’accord conclu à la Conférence d’Abbeville entre les puissances alliées.
Ce texte se réduit à ceci:
«Le Conseil supérieur de guerre estime qu’il y a lieu de former aussitôt que possible une armée américaine, qui sera soumise à l’autorité directe de son chef et combattra sous son propre drapeau.
«Mais, tout en tenant compte de cette nécessité, la priorité de transport sera donnée aux unités d’infanterie et de mitrailleuses, qui termineront leur instruction en commençant par servir aux armées françaises et britanniques, sous la réserve que lesdites unités d’infanterie et de mitrailleuses seront, éventuellement, retirées des armées françaises et britanniques, afin de constituer, avec leurs propres artillerie et services, des divisions ou des corps d’armée, cela au gré du commandant en chef du corps expéditionnaire américain, qui devra, toutefois, prendre au préalable l’avis du commandant en chef des armées alliées en France.»
«Pendant le mois de mai, la priorité sera donnée au transport des unités d’infanterie et de mitrailleuses de six divisions. Tout tonnage supplémentaire servira au transport des autres troupes dont le commandant en chef du corps expéditionnaire américain décidera l’embarquement.
«En juin, le même programme sera réalisé, à condition que le gouvernement britannique procure les moyens nécessaires au transport de 130 000 hommes en mai et de 150 000 en juin. Les six premières divisions iront aux armées britanniques. Les troupes transportées en juin seront affectées selon que le décidera le général Pershing.
«Si les Anglais peuvent transporter en juin un supplément de 150 000 hommes, ce supplément sera composé d’infanterie et de mitrailleuses. Au début de juin, on procédera à un nouvel examen de la situation.»
Tel est—en résumé—le texte de la Conférence d’Abbeville du 2 mai 1918[28].
Est-il besoin de noter que ce programme s’inspirait des idées du général Foch lui-même? A Abbeville, le commandant en chef de nos armées avait lu à la Conférence la déclaration suivante, dont je communiquai le texte à M. Jusserand:
«—J’ai été choisi, comme commandant en chef des armées alliées, par les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la France et de la Grande-Bretagne: à ce titre, il m’est impossible, au plus périlleux de la plus grande bataille de la guerre, d’admettre que je n’aie pas le droit de me prononcer sur les conditions de l’arrivée en France de l’armée américaine.
«C’est pourquoi, pénétré de la très lourde responsabilité qui m’incombe, à l’heure où la plus grande offensive allemande menace aujourd’hui, simultanément, Paris et nos communications avec la Grande-Bretagne, par les voies de Calais et de Boulogne, je tiens expressément à ce que chacun des gouvernements prenne, à son tour, la part de responsabilité qui lui est impartie.
«Dans ma conscience, il est de toute nécessité qu’il arrive mensuellement d’Amérique en France, pendant au moins les mois de mai, juin et juillet, par droit de priorité, 120 000 soldats américains d’infanterie et mitrailleurs. J’estime même que, si le tonnage le permet, ainsi qu’on nous l’a lait entrevoir, il serait hautement désirable que ce chiffre fût dépassé. Car plus élevé sera le chiffre de l’infanterie américaine qui pourra paraître à bref délai sur les champs de bataille[29], plus rapide et plus décisif sera le succès des armées alliées.
«Il est nécessaire, en effet, de bien comprendre que le caractère de la dernière offensive ennemie est d’avoir amené des pertes d’infanterie et de mitrailleurs hors de toute comparaison avec les pertes de la guerre, telle qu’elle s’est développée dans les trois dernières années. Les pertes d’infanterie de l’armée britannique ont dépassé, dans des proportions imprévues, toutes celles qu’elle avait subies précédemment. Il en a été de même des Français dans la proportion où ils ont participé à la bataille, et, dans les semaines qui vont suivre, il est inévitable que les pertes en infanterie aillent en s’aggravant. Ce sont donc, avant tout, des troupes d’infanterie et des mitrailleurs qu’il faut récupérer sans perdre un instant, d’autant plus que les ressources des dépôts allemands en infanterie et mitrailleurs sont estimés à 5 ou 600 000 hommes, tandis que les dépôts britanniques sont à peu près vides et que les dépôts français resteront sans ressources jusqu’au mois d’août prochain.
«Je demande de la façon la plus catégorique au Comité supérieur de guerre, composé des gouvernements alliés, de se prononcer sur cette demande, et de vouloir bien la soumettre à M. le président des États-Unis.
«Ce n’est pas que je ne tienne compte des observations de M. le général Pershing, qui désire, justement, amener le plus tôt possible, en France, l’ensemble des services complémentaires qui lui permettront d’achever, à bref délai, la constitution de la grande armée américaine dont il est le chef et que nous appelons de tous nos vœux. Mais en constatant que ma demande ne peut causer qu’un délai d’un petit nombre de semaines, mon devoir impérieux de soldat et de général en chef m’oblige à déclarer que, lorsque la plus grande armée allemande prononce la plus grande offensive de cette guerre devant Amiens et devant Ypres, un si léger retard ne peut être pris en considération, quand l’issue de la guerre elle-même peut dépendre d’un succès de l’ennemi devant les deux objectifs ci-dessus indiqués.
«Après les pertes énormes qu’elle a subies avec une magnifique vaillance, l’armée anglaise vient de voir supprimer dix de ses divisions et il ne suffit pas de les remplacer pour arrêter définitivement les armées allemandes. Ce sont de nouvelles forces d’infanterie et de mitrailleurs qui nous sont nécessaires sans aucun délai. Et si l’on considère que les troupes américaines auront besoin, au débarquement, d’une rapide instruction supplémentaire, on doit comprendre combien l’urgence de la décision dont il s’agit s’en trouve renforcée.
«Signé: Foch.»
A quoi j’ajoutai: «Je n’ai pas cru qu’il convînt d’envoyer ce texte au président Wilson dans la crainte de blesser le général Pershing. Mais M. Jusserand est prié de s’en inspirer.»
Le lecteur voit clairement ici que j’étais d’accord sur tous les points avec le général Foch, sans aucune réserve. C’est là-dessus que le Mémorial fonde ce qu’il appelle «un grave désaccord.»
Le même jour, 4 mai 1918, j’envoie un nouveau télégramme à M. Jusserand: «M. Balfour m’informe qu’il serait heureux si je donnais communication au président Wilson de la déclaration du général Foch. Prière, donc, de communiquer, tant au nom du gouvernement français que du gouvernement britannique.»
Le 8 mai 1918, j’envoie le télégramme suivant à M. Tardieu, Haut Commissaire de la République française à New York: «La question est de la plus haute gravité pour l’issue de la guerre par l’intervention décisive des troupes américaines qu’il ne faut à aucun prix exposer à une aventure comme celle de la Ve armée britannique sous les ordres du général Gough[30]. La question est d’une telle importance que j’ai la pensée d’envoyer sans aucun bruit, sous couleur d’une inspection de nos troupes d’instruction en Amérique, l’un de nos meilleurs généraux pour exposer, du point de vue purement technique, les éléments du problème au président Wilson».
J’ajoutais:
«On m’a fait remarquer très justement que les arguments du général Pershing se trouvent être tous d’ordre politique, tandis que ceux du général Foch, auxquels il n’a pas été répondu, sont d’ordre exclusivement militaire. Je crois que nous devons nous garder d’intervenir avec trop d’insistance auprès du président Wilson, qui a certainement toute la maturité de jugement nécessaire pour prononcer utilement, lorsque tous les aspects du problème lui seront connus.
«La consigne est d’écouter autour de vous, sans cacher votre opinion, bien entendu, mais en ne l’indiquant qu’avec la discrétion convenable. Au Président de la République américaine de dire la parole définitive quand l’heure sera venue.»
Le général que j’envoyais en Amérique ne parlait pas l’anglais. Mais il était accompagné du colonel Fagalde, officier très compétent, particulièrement propre, en la matière, aux fonctions d’interprète.
Le 9 mai, je télégraphie à M. Jusserand:
«Vous vous plaignez avec grande raison que les dispositions prises par la Conférence d’Abbeville soient insuffisantes. C’est que cette Conférence n’a été qu’un interminable débat entre M. Lloyd George, moi-même et le général Pershing, lequel défendait obstinément la thèse de la prompte venue des services accessoires, en alléguant que le peuple américain et le gouvernement de Washington désiraient avant tout la constitution d’une grande armée américaine.
«Lorsque le général Pershing nous avait concédé que des troupes d’infanterie et des unités de mitrailleurs viendraient avant tout en juin, il refusait obstinément de nous faire la même concession pour juillet, et tout ce que nous pûmes obtenir fut qu’au commencement de juin cette question serait de nouveau soumise à nos délibérations.»
Le 17, j’expédie un télégramme à M. Lloyd George:
«Les dispositions qui ont prévalu à Abbeville doivent être révisées en vue de nous faire envoyer dans le plus bref délai possible un chiffre très supérieur de fantassins et de mitrailleurs américains, ainsi que le président Wilson et M. Baker[31] sont disposés à le faire. Je n’ai pas besoin de vous dire que le général Foch, que j’ai consulté hier à cet égard, insiste vivement pour que cette réunion du Conseil supérieur de guerre ait lieu le plus tôt possible. Car les contre-offensives qu’il prépare seront nécessairement très limitées aussi longtemps que les effectifs lui feront défaut.»
Le 20 mai 1918, j’envoie ce nouveau télégramme à M. Lloyd George: «Il résulte des dépêches de M. Jusserand, aux informations de qui s’ajoute l’autorité de ses conversations avec lord Reading, que le président Wilson est absolument avec nous en cette affaire. A. M. Jusserand, qui lui demandait d’augmenter le nombre des fantassins et des mitrailleurs en mai, il a répondu qu’il le ferait volontiers, s’il n’y avait pas une décision d’Abbeville à laquelle il se croyait tenu de se conformer. M. Baker a tenu à M. Jusserand un langage à peu près identique[32].»
«Enfin, le général Pershing (peut-être à la suggestion de Washington) m’a fait l’honneur de me venir voir pour me dire qu’il craignait de n’avoir pas été compris à la Conférence d’Abbeville; qu’il était un esprit ouvert et qu’il ne demandait pas mieux que de se rendre aux arguments d’extrême urgence qui lui avaient été soumis.
«Je lui ai répondu que je comptais sur la prochaine réunion du Conseil supérieur de guerre pour obtenir en juin, sans parler de juillet, un envoi de 100 000 soldats américains. Sa réponse fut qu’il était tout prêt à tomber d’accord avec moi sur ce chiffre et qu’il n’y avait pas besoin d’une séance à Versailles pour cela. Je refusai naturellement de renoncer à la Conférence de Versailles.
«Il me dit alors qu’il allait voir le général Foch, et que l’accord entre eux se ferait très facilement. C’est en effet ce qui eut lieu.»
Le 1er juin 1918 le Comité supérieur de guerre se réunit à Versailles.
Et le 7 juin, je télégraphie à M. Jusserand:
«Nous n’avons rien à cacher au gouvernement américain. Quant à la nécessité pour lui d’engager ses forces militaires en armées, personne ne le comprend mieux que moi, et le Président peut compter que toutes facilités seront données par nous à cet égard... Nos indications antérieures provenaient de deux sentiments qu’il est trop facile de comprendre: 1o notre besoin urgent de combattants; 2o le grand avantage, dans un cas si pressant, d’achever l’éducation pratique, au feu, des formations américaines avant la constitution des États-Majors[33]...»
J’ai exposé aussi clairement que j’ai pu les préliminaires du «grave désaccord» survenu entre le maréchal Foch et moi à propos de l’emploi, immédiat ou lointain, des forces américaines. Le point le plus étrange de ce «grave désaccord» consistait en ceci que nous nous trouvions absolument d’accord sur tous les points.
Comment tirer de cet accord un désaccord qui effraya le général Foch lui-même, et jusqu’à M. Poincaré? Rien de plus simple. L’accord était sur le fond et le désaccord sur la procédure que ni le général Foch ni M. Poincaré ne voulaient pousser jusqu’au bout. En d’autres termes, j’allais jusqu’à réclamer un ordre du commandant en chef au général américain—ce à quoi s’opposaient le commandant en chef lui-même et M. Poincaré[34].
Nous étions d’avis, tous les trois, le général Foch, M. Poincaré et moi, que nous avions le plus pressant besoin d’effectifs pour remplacer les hommes qui tombaient tous les jours sur le champ de bataille. Mais le général Foch et M. Poincaré voulaient que cet «avis» demeurât à l’état d’avis, et moi, j’avais la prétention d’en tirer quelque chose qui fût de l’action. Mes deux contradicteurs ne voulaient pas affronter l’obstination du général Pershing qui pouvait amener une rupture. En d’autres termes, je voulais trop, prétendaient-ils, à quoi je répondais qu’ils ne voulaient pas assez. Foch se refusait à donner un ordre à son subordonné, alléguant toujours que son autorité de chef suprême aboutissait, non pas à commander, mais simplement à suggérer. Et M. Poincaré me contestait le droit de donner un ordre à Foch dans cette matière et même de le conseiller trop énergiquement. Que résultait-il de tout ce bruit d’une question sur laquelle, au fond, tous les Alliés étaient unanimes, sinon un arrêt subit de volonté chez deux des chefs qui avaient charge de commander?
Le problème était dans ce seul fait que nous étions au combat depuis bien longtemps quand nous avions été rejoints par les premiers contingents américains nécessairement inexpérimentés. La fonction des Alliés américains était surtout de nous faire rattraper le temps perdu, en entrant dans la guerre à mesure qu’ils arrivaient, tandis que le naturel orgueil de la grande démocratie la portait à donner en bloc, pour la suprême victoire, sur le dernier champ de bataille. Problème de jour et d’heure qui pouvait et devait décider dramatiquement du succès, moins par la qualité doctrinale du combat que par l’entrée en jeu d’un effort militaire capable de s’adapter, de se prolonger et même de s’accroître indéfiniment. Nous avions envoyé aux États-Unis, comme j’ai dit, de très importantes missions d’officiers instructeurs. La mission de contrôle du général Berthelot (fin mai 1918), auprès des camps français d’instruction militaire en Amérique, fut d’un heureux succès pour tout le monde. Des officiers instructeurs, rien que d’excellent. Travail d’entrain dans le meilleur accord. Enthousiasme guerrier. Le chef de la mission rendait hommage au colonel House dont la lumineuse intelligence avait merveilleusement facilité le travail.
Un seul point noir: l’obstination fanatique des grands chefs de l’armée américaine à retarder l’arrivée du drapeau étoilé sur le champ de bataille. L’organisation tardive de la grande armée américaine nous coûtait beaucoup de sang ainsi qu’à nos Alliés, mais devait résoudre, tout d’un coup, nous disait-on, l’ensemble des problèmes militaires. Ainsi arriva-t-il que la guerre était virtuellement finie, quand l’Argonne fit voir aux beaux et braves soldats de la vaillante Amérique qu’il ne suffisait pas d’être brave à outrance pour remporter des avantages stratégiques.
Je les avais avertis[35]. Mais leur super-patriotisme farouche ne voulait rien entendre et il ne leur fallait rien de moins qu’un coup de stratégie providentielle qui leur permît, d’un même coup, de commencer et de finir la guerre en beauté. Si ce miracle s’était produit, je serais assez prêt à croire que l’opinion publique eût imposé au Sénat le vote du Traité.
Dans son Rapport final (p. 39 et 40), le général Pershing constate que le général Pétain avait mis sous ses ordres des troupes françaises pour la bataille de Saint-Mihiel. Il a pu voir ainsi que nous ne marchandions pas notre confiance en son commandement.
Le jour vint enfin (septembre 1918) où Saint-Mihiel vit nos camarades arriver (avec des canons français) aux talons des soldats allemands. Ce fut une fête indescriptible. En des automobiles, en des camions de toutes figures, nos gens avaient entassé tous les enfants de la ville avec les joyeuses mamans, parmi les fleurs, les branchages, les friandises, les chants, les rires, les embrassades, les cris de la France retrouvée dans la poignée de main américaine. Pourquoi faut-il que cette heureuse procession de glorieux enthousiasme s’achève aux finales balances d’un doit et avoir fâcheusement mesurés?
Avant d’en arriver à l’affaire de mon «désaccord» avec le maréchal Foch je dois dire que celui-ci avait établi un certain nombre de points:
1º «Grâce à sa méthode de collaboration intelligente, amicale et même affectueuse, il tirait des armées étrangères, placées sous ses ordres, le maximum de ce qu’elles pouvaient donner[36];
2º «L’armée américaine, était une armée «excellente», pleine d’ardeur;
3º «Mais elle était «inexpérimentée, novice», ayant à apprendre, en quelques mois, ou même quelques semaines, ce qui nous avait demandé, à nous, plusieurs années.»
Telle étant l’armée américaine en octobre 1918, quelles furent, respectivement, au dire du maréchal, l’attitude du ministre de la Guerre français et du général en chef des armées alliées?
Pour ce qui est de celui-ci, «il lui semblait, raconte-t-il, injuste et peu raisonnable, de ne pas tenir compte, dans ses rapports avec cette armée, de ce manque d’expérience; de la traiter comme si elle combattait depuis très longtemps à nos côtés.»
Comment donc la traiter? En employant «la douceur, la patience[37], la persuasion, de préférence à la sévérité et à la violence»[38].
Quant à moi, le maréchal Foch allègue que j’étais d’avis qu’il fallait faire appel à d’autres méthodes. «M. Clemenceau reprochait au général Pershing de chercher, avant tout, à constituer une armée autonome, pourvue d’un nombreux et important État-Major, agissant par elle-même, sans se soucier suffisamment des autres. Il reprochait au maréchal de se montrer beaucoup trop patient, beaucoup trop accommodant vis-à-vis du général Pershing.»
«La manière douce, affirmait M. Clemenceau, ne donnant aucun résultat, le moment était venu de recourir à la manière forte, de faire un éclat, de s’adresser par-dessus la tête de Pershing au président Wilson lui-même, en le priant d’intervenir pour forcer la main au général.»
Et le Mémorial conte que, le 21 octobre 1918, j’adressai au maréchal une lettre «pressante», où je lui faisais part de mes préoccupations. «Cette lettre, d’une très belle forme au demeurant, déclare le maréchal, ne me fit pas varier d’une ligne. Je n’en tins absolument aucun compte.»
Foch me répondit en m’assurant à nouveau que la méthode qui consisterait à tout briser[39] ne valait rien».
Et il terminait sa lettre par ces mots:
«On ne peut nier l’effort fourni par l’armée américaine. Après avoir attaqué à Saint-Mihiel le 12 septembre, elle a attaqué le 26 en Argonne. Elle a perdu par le feu, du 26 septembre au 20 octobre, 54 158 hommes pour de faibles gains, sur un front étroit, il est vrai, mais sur un terrain particulièrement difficile et en présence d’une sérieuse résistance de l’ennemi.»
Trois semaines après, c’était l’armistice. Avais-je donc tort d’être pressé?
En forme de conclusion, le maréchal déclare: «Je me flatte d’être demeuré l’ami de Pershing.» En vérité, la France demandait aux Américains, éminemment combatifs, autre chose qu’une parade d’amitié militaire entre les grands chefs[40].
Il y a peut-être lieu de conter ici l’histoire de ma lettre «pressante» à Foch et des conditions dans lesquelles elle fut d’abord différée, puis envoyée.
Le 11 octobre 1918—à un mois, répétons-le, de l’armistice—je renonçai donc à la «manière douce». Ce jour-là, accompagné de M. Jeanneney, sous-secrétaire d’État à la présidence du Conseil, je me rendis à l’Élysée, afin de communiquer à M. le Président de la République le projet de lettre que j’avais l’intention d’envoyer au maréchal Foch pour provoquer une décision touchant cette inertie des troupes américaines, si préjudiciable aux armées alliées en pleine bataille. La lettre était assurément assez vive de ton: des centaines de milliers de morts, l’effort surhumain fourni depuis des années par nos grands soldats, l’avaient dictée. Elle était «dure» et pour Pershing, qui ne voulait pas obéir, et pour Foch, qui ne voulait pas commander.
M. Poincaré lit cette lettre et, formellement, déconseille de l’envoyer.
—Je ne crois pas aux secrets, dit-il. Si cette lettre est envoyée, elle sera connue de l’entourage du Maréchal, et, sans doute, aussi du général Pershing. Il en peut résulter de graves froissements. Il me semble, en tout cas, que certains de ses termes devraient être adoucis.
Comment pouvait-on émettre une pareille crainte quand, en mai, la lettre de Foch, non moins décisive que la mienne, avait été connue de Pershing et—bien loin de blesser personne—avait convaincu Wilson lui-même.
Je ne pouvais pas ignorer les communications constantes du Maréchal avec le Président de la République. Rien n’était plus légitime. Il aurait seulement fallu que les deux personnages fussent capables de vivre dans une moindre exaltation de leur personnalité. Il leur fut trop facile de se réunir pour s’opposer à mon action.
Je reprends ma lettre, je la corrige, je l’atténue et, au moment de partir pour le front, je prie M. Jeanneney de retourner à l’Élysée le lendemain et de remettre une seconde fois à M. Poincaré le projet de document où il était tenu compte de ses observations.
Le lendemain, M. Jeanneney retourne donc à l’Élysée, remplit sa mission, et, le soir même, M. Poincaré lui adresse une fort longue lettre où il déclare en substance: «Je maintiens mon point de vue. Il ne faut pas écrire cette lettre. Il n’est pas impossible qu’elle provoque la démission du Maréchal.
«Si, contrairement à mon avis, M. Clemenceau croit devoir envoyer cette lettre, il faut l’atténuer encore. Elle est encore trop dure pour les Américains, encore trop dure pour Foch. M. Clemenceau dit notamment au Maréchal: «La Patrie commande que vous commandiez.» Si l’on me disait cela à moi, je démissionnerais.
«Et, d’ailleurs, M. Clemenceau a-t-il bien a s’occuper de ce que fait le maréchal Foch comme commandant en chef de l’armée américaine? En cette qualité, le maréchal Foch ne relève-t-il pas plutôt du gouvernement américain?»
Le voilà donc connu ce secret plein d’horreur!
Le général Foch m’avait demandé de le faire nommer commandant en chef des armées alliées, et, ce titre obtenu, je découvre qu’il comprend le commandement unique comme un conseil d’administration à trois, où l’on échange des raisonnements. Je voudrais bien savoir à quel moment le commandement unique m’avait enlevé une part de mon autorité sur le commandement militaire français. Il y avait des alliés, sans doute, qui avaient leur mot à dire dans les mêmes formes que moi-même, et, si l’on n’était pas d’accord, il y avait la ressource d’un conseil supérieur. Ici le beau du phénomène c’est que, tout le monde étant d’accord, même le général Foch, même M. Poincaré, la seule difficulté était que ces deux personnages se refusaient (dans le moment le plus grave de la guerre) à mettre en action l’autorité conférée au généralissime à Doullens. Mais surtout, quelle étrange aventure de ce chef du gouvernement français qui se demande si le généralissime français ne relève pas «plutôt» du gouvernement américain—supposé adversaire—dans un débat où la vie et la mort de la France sont en jeu!
Pendant la bataille, Foch domine les combattants comme à la Marne et à l’Yser. Dans le conseil, c’est aux formules de plaidoirie qu’il fait confiance. Dans le débat américain, nous sommes tous d’accord, et, puisque la question est d’ordre purement militaire, c’est à lui de dire la parole d’autorité. Point du tout. Pershing s’obstine à ne pas agir et Foch à ne pas commander. Il faut donc que je prenne sur moi, pour secourir nos propres soldats, de dire la parole décisive au chef de volonté paralysée, avec qui je suis d’accord sur tous les points, sauf sur ce fait qu’il appartient au général en chef de convertir son opinion personnelle en ordres coordonnés.
C’est la situation qui se résume en mon adjuration: «Commandant, la Patrie commande que vous commandiez.» Ce pourrait être la parole décisive, la formule de salut qui rappellerait Foch à la terrible réalité. Mais elle effraya M. Poincaré qui lui refusa son assentiment, sans me conseiller de faire autre chose que de regarder tomber nos soldats.
Je devais découvrir plus tard, longtemps après la guerre, en prenant connaissance enfin[41] de la lettre de M. Poincaré à M. Jeanneney, que la nouvelle théorie présidentielle consistait tout simplement à m’enlever—en vertu du commandement unique—une part d’autorité sur le maréchal Foch.
Si je n’avais pas eu le document sous les yeux, je ne l’aurais pas cru. En pleine guerre, le président de la République française donnait des arguments au commandant des armées alliées pour l’encourager à résister à son chef immédiat, le président du Conseil, ministre de la Guerre. Il exposait à l’innocence de l’âme antijuridique du soldat, que les gouvernements alliés, en lui remettant des pouvoirs sur leurs troupes, l’avaient en partie soustrait à l’autorité du président du Conseil, ministre de la Guerre.
C’est sur l’action qui doit suivre que porte le différend. Le général Pershing ne veut pas changer de méthode. Le maréchal Foch, à qui M. Poincaré ne peut enlever son droit de commander à Pershing, ne veut pas commander, et M. Poincaré qui ne veut pas que je commande à Foch de commander, prétend que nous nous regardions tous les trois, dans l’impuissance d’agir née d’une organisation suprême du commandement effectif qui, pour remporter la victoire, exige que nous laissions nos soldats sans secours! Voilà de quoi il fallait s’occuper quand le sang de nos soldats coulait à flots, tandis que deux millions d’hommes venus pour les secourir, devaient attendre que nos grands seigneurs de la guerre eussent changé d’humeur.
Et comme conclusion après cet étrange exposé de doctrine[42], ces mots qui sont du Poincaré le plus pur: «L’essentiel me paraît être de nous trouver d’accord avec le Maréchal sur la nécessité d’une organisation rapide (?) et de lui demander régulièrement compte de ce qu’il entreprend en ce sens et de ce qu’il obtient[43]. Si, au bout de quelques semaines[44], les choses restaient en l’état, on recourrait alors aux mesures extrêmes, mais, comme avec des étrangers un peu susceptibles, elles peuvent tout gâter, il ne faut, à mon avis, y recourir qu’au cas où la situation deviendrait réellement désespérée.»
Je cite ces mots textuellement. C’était conclure: Les mesures que vous proposez peuvent tout gâter. Donc il ne faut les employer que lorsque la situation sera réellement désespérée. On aurait pu ainsi attendre que les campagnes défaitistes eussent gangrené les esprits en décomposition pour se décider à mettre la main au collet des traîtres. Cette peur de soi-même aura fait couler trop de sang.
Le 14 octobre, au matin, je rentre du front, où les nôtres tombent toujours. M. Jeanneney me dit: «M. Poincaré vous déconseille à nouveau d’écrire au Maréchal. Voici la lettre qu’il m’adresse.»
Rageusement, je ne m’en cache pas, je repousse le pli après avoir consigné de ma main sur l’enveloppe, en une note signée, que je refuse d’en prendre connaissance. Ainsi s’attestent les sentiments que m’inspiraient les excès de patience auxquels j’étais convié, tandis que se jouait la partie suprême de la France. Il n’y avait qu’une chose que le bon président ne faisait pas suffisamment entrer en ligne de compte, c’est que, tandis qu’il pesait et composait des si, nos soldats jonchaient la plaine, pendant que leurs camarades américains frémissaient d’impatience en attendant leurs jours de gloire.
J’envoie ma lettre au Maréchal. Il n’en est pas question dans le Mémorial. Elle aurait mis les choses au point.
En recevant mon message, que fait le maréchal Foch? Le chef de l’État a pris soin de l’informer que, constitutionnellement, en tant que commandant en chef de l’armée américaine, il était «plutôt» sous les ordres de M. Wilson. Ma lettre—il le déclare lui-même—«ne le fait pas varier d’une ligne.»
«Je n’en tins absolument aucun compte...» dit-il.
Pour tant de mouvements de fâcheuses incohérences, il doit cependant y avoir une explication.
C’est une question capitale pour l’histoire de la guerre que de savoir comment, en fin de compte, le maréchal Foch a exercé le commandement unique. Tout le monde parle encore avec enthousiasme de ce merveilleux engin de victoire. Mais, jusqu’à ce jour, aucune démonstration de fait n’a encore suivi ces discours. C’est pourtant la question que se posera l’avenir.
J’ai dit, sans aucune réserve, que dans les très durs combats de l’Yser, le Maréchal s’était montré un héros. Je n’ai garde de lui chicaner quoi que ce soit du magnifique élan qui le porta dans cette épreuve, l’une des plus ardues de la guerre, et je lui ai rendu hommage, avec joie, sur ce point.
La question de savoir dans quelle mesure il fut véritablement un stratège peut être déplaisante pour un homme qui se laissait parfois comparer à Napoléon. C’est une question que l’historien devra résoudre, et je ne puis mieux faire que de m’en rapporter aux juges libérés des passions d’aujourd’hui. Cependant, j’ai bien le droit de dire que le brevet militaire d’académie civile décerné par M. Poincaré, dans le cénacle du palais Mazarin, n’a pas plus de valeur positive qu’une simple chanson. Il nous faudra, quelque jour, des juges compétents qui prononceront sur pièces, au lieu d’un lyrisme de plaidoirie. Les historiens qualifiés pourront alors prendre des conclusions et juger en connaissance de cause.
Le maréchal Foch, sans avis préalable, a ouvert la tranchée contre les camarades, dont l’un a pourtant Verdun à son compte, en décrétant, sans rien démontrer, que nous aurions pu finir la guerre en 1917. Avec des si, que ne prouve-t-on pas? Ces sortes d’arguments sont la grande ressource des hommes en quête d’une diversion. S’il a cru qu’il ferait dévier ainsi la critique de sa propre stratégie, il s’est trompé.
—«Voyez-vous, disait-il, le commandement unique, ce n’est pu’un mot. En 1917 on l’avait réalisé avec Nivelle, cela n’avait pas marché[45]. «Il faut savoir conduire les Alliés. On ne les commande pas. Il ne faut pas faire avec les uns comme avec les autres... C’est ça le commandement unique: on ne donne pas d’ordres, on suggère.»
Le Maréchal nous fait ainsi connaître que le commandement unique ne s’exerce pas d’un général en chef à ses égaux, comme d’un sergent instructeur à un peloton de recrues. Nous le savions déjà. Pourquoi donc tant de bruit pour la conquête d’une autorité décisive qui, l’heure venue, doit, paraît-il, s’évaporer en de précieuses dilutions oratoires. Pourquoi tant de bruit pour rien? Le maréchal ne donne pas d’ordres: il suggère. «Ils auraient secoué leur chaîne, si j’avais voulu la leur faire sentir.»
Qui pourrait croire que c’est un soldat qualifié qui manifeste si hautement cette totale incompréhension du commandement suprême? Où en serons-nous quand, pour suivre ce bel exemple, les officiers renonceront à commander, pour «suggérer» des vues militaires à leurs subordonnés? On croit rêver.
Je me suis demandé quels brouillards d’obnubilation avaient pu éveiller, dans l’âme du commandant unique, une telle défiance de sa propre autorité. Ce que nous cherchions, c’était la rapidité des correspondances directes de mouvements par les coordinations d’une volonté suprême, tandis que notre commandant unique prétendait obtenir un résultat supérieur par de simples essais de persuasion.
Je ne doute pas que le Maréchal n’ait parlé sincèrement quand il s’est dit hanté du désir de contenter tout le monde. D’un chef, ce n’est pas toujours une qualité congrue. C’est même tout l’opposé du but que se propose le commandement militaire. Le Maréchal savait bien que, de lui à moi, tous différends finiraient par s’arranger. Mais sir Douglas Haig réagissait violemment quelquefois. M. le président Wilson inquiétait l’interlocuteur par un sourire de loup bienveillant. M. Lloyd George n’était pas l’agneau bêlant de la fable. C’est de ces divers côtés que le généralissime entendait vraisemblablement se garder, d’autant plus que le texte de l’accord prévoyait, en cas de dissidence, l’appel du général allié à son gouvernement. Je suis loin de blâmer le commandant en chef de tous les ménagements obligatoires envers ses nouveaux subordonnés. Tous les prédécesseurs de Foch dans l’histoire en avaient fait la découverte avec l’assentiment universel. Encore fallait-il qu’une volonté supérieure se dégageât de tous atermoiements. Sinon l’unité de commandement n’était qu’une parade supplémentaire d’impuissance à l’usage des esprits simples, et qui ne jouait même pas quand il s’agissait d’engager une ou deux divisions américaines à rejoindre des divisions alliées.
Si légitimes qu’elles fussent, les préoccupations du commandant en chef à cet égard ne devaient changer ni la forme, ni le fond des ordres militaires à de nouveaux subordonnés mis à sa disposition pour hâter l’exécution de mouvements ralentis par l’art de suggérer. Il se fût ainsi épargné l’ennui de dissocier spontanément la puissance supérieure qui lui avait été confiée, sans parler de l’ennui d’avoir l’air quelquefois de s’accorder plus aisément avec M. Lloyd George qu’avec son propre gouvernement, comme il arriva dans l’affaire dite de la Villa romaine.
Comme je ne cessais d’insister auprès du «commandant unique», pour qu’il donnât l’ordre au général Pershing de mettre à sa disposition l’une des divisions américaines prêtes à entrer en ligne, il finit par me dire qu’il avait donné «un ordre écrit» au général Pershing et que celui-ci avait formellement refusé d’obéir[46]. J’en conçus une fâcheuse impression mais je n’osai pas pousser l’aventure plus loin que ne le désirait le commandant en chef. J’ai lu dans un journal que Foch s’était laissé aller à dire que «personne n’avait désobéi». Ce n’est pas ce qu’il m’avait dit du général Pershing. Avant de se prononcer, il faudrait pouvoir dire dans quelle mesure il avait «commandé»—je ne dis pas «suggéré».
Quant à moi, comment pouvais-je me trouver répréhensible en réclamant énergiquement la mise en œuvre de l’accord qui avait créé le haut commandement pour accroître la coordination de nos forces sur le champ de bataille? Je m’appliquais de mon mieux à rendre tout facile à l’organisation américaine. Je n’ai point à cacher qu’en de terribles circonstances je cherchais à en obtenir la plus grande somme de rendement militaire et que, grâce aux autorités supérieures, je n’y ai pas réussi. Y avait-il donc là une pensée dont j’aie à me défendre? Le maréchal Foch, pour éviter de répondre à la question, s’abstient prudemment de la poser. Moi, je la pose, et il le faut bien puisque c’est tout le débat entre Pershing, Foch et moi.
Le Maréchal avait le pouvoir de commander. De son propre aveu, il préférait «suggérer»[47]. D’où le conflit. C’était d’autant moins mon compte qu’à mon avis, les Allemands, dès qu’ils sentiraient le choc de la réaction américaine sur le champ de bataille, comprendraient que tout espoir de vaincre leur était désormais interdit.
J’étais donc très pressé, très pressant, quand je demandais à Foch, et même à Pershing directement, d’envoyer au feu, sans délai, parmi les nôtres, à mesure qu’elles seraient en état de combattre, les premières divisions américaines.
En somme, le «grave désaccord» entre le maréchal Foch et moi sur le meilleur emploi des forces américaines se réduisait à une parfaite communauté de vues sur l’utilisation des contingents pour leur entrée en ligne au fur et à mesure d’un achèvement d’éducation militaire. Il n’y eut pas, il était impossible qu’il y eût un débat sur le fond. Le Maréchal ne pouvait que demander des contingents. On a vu, par sa propre déclaration aux gouvernements alliés, que rien ne lui échappait des difficultés qui nous mettaient en conflit avec le général Pershing, et qu’il n’était pas embarrassé d’exposer fortement son point de vue quand on ne lui demandait pas de l’action.
Pourquoi le Maréchal n’a-t-il pas publié ma lettre comme je publie le document où il expose, en excellent langage, son propre point de vue? Pourquoi se vanter de n’avoir pas tenu compte de ma lettre à l’heure même où il essayait de la mettre tant bien que mal en action? Pourquoi M. le président de la République se donna-t-il tant de mal pour me dissuader de l’écrire, dans la crainte qu’une indiscrétion la portât à la connaissance de M. le président Wilson, alors que M. Lloyd George et lord Balfour (si modéré) m’avaient demandé de porter le document (où Foch, disait la même chose que moi) à la connaissance du même président Wilson, qui l’approuva?
Tout cela parce que le général Pershing se cantonnant dans une résistance passive, le maréchal Foch, invité par moi à donner un ordre à son subordonné, craignait, s’il n’était pas obéi, de se faire une affaire avec le gouvernement américain. Il préférait se créer des difficultés avec moi, contre qui le soutiendrait M. Poincaré, comme dans l’affaire de la Rhénanie. Cependant, il y avait les soldats, monsieur le Maréchal!
L’embarras était que, trop souvent, l’idéal ne s’accommode pas de la réalité. Il s’agit de les accommoder l’un et l’autre. On n’y réussit pas toujours. Quand on sait que la France reçut plus de deux millions de soldats américains, on s’étonne qu’on n’ait pas facilement réussi à constituer la première armée américaine, en même temps qu’à fournir des effectifs en nombre suffisant sur les champs de bataille où les réclamaient d’urgence nos héroïques soldats. Hélas! dans cette redoutable crise, le maréchal Foch qui, sans posséder le commandement sur l’Yser, avait si bien su le prendre, ne put venir à bout de l’exercer quand on le lui eut donné.
| [28] | Il faut dire qu’auparavant lord Milner et le général Pershing, sans consulter la France et sans même en informer Washington, avaient conclu un accord pour le mois de mai et le mois de juin, exclusivement à l’avantage de l’Angleterre, laquelle, il est vrai, avait un pressant besoin d’effectifs. La Conférence d’Abbeville a remplacé cet accord par le texte ci-dessus. |
| [29] | C’est moi qui souligne. |
| [30] | Très grave question, qui n’est ici qu’indiquée. Pour le début de l’armée américaine, il fallait absolument éviter un échec. Importante raison pour associer les vieilles et les jeunes troupes sur le champ de bataille. J’encourais une lourde responsabilité si quelque manœuvre, mal comprise ou mal exécutée, avait de fâcheuses conséquences. |
| [31] | Ministre de la Guerre américain. |
| [32] | Il ignorait que la décision d’Abbeville était un minimum au delà duquel l’approbation du général Pershing nous avait été refusée. |
| [33] | Le général Pershing dut attendre encore plusieurs semaines avant de voir se réaliser son rêve d’une grande armée américaine autonome. Je ne pus alors qu’applaudir: c’est que l’heure était venue et je télégraphiai au commandant américain:27 juillet 1918: «Félicitations cordiales pour la création de «la première armée américaine. L’histoire vous attend. Vous ne lui ferez pas défaut, G. Clemenceau.» |
| [34] | Je nommerai M. Poincaré le moins souvent possible. Mais quand je me défends contre le maréchal Foch qui m’aborde avec le Président de la République pour couverture, il faut bien que je réponde à mes deux adversaires à la fois. |
| [35] | Tous les représentants de la haute autorité militaire américaine penchaient ouvertement du côté de Pershing, le général Bliss, seul, faisant exception. Ils voulaient une armée américaine. Ils l’ont eue. Qui a vu, comme moi, le terrible embouteillement de Thiaucourt, témoignera qu’ils peuvent se féliciter de ne l’avoir pas eue plus tôt. |
| [36] | Rien de tel que de se donner à soi-même de bons certificats. |
| [37] | A moins d’un mois de l’armistice! La patience, c’est du temps. Il y a vraiment des heures pour l’action. |
| [38] | La prétendue «violence» consistait à se faire obéir dans l’emploi militaire d’une force militaire pour des résultats militaires dont le maréchal Foch n’a jamais contesté, non seulement l’avantage, mais la nécessité. |
| [39] | Où voit-il que j’aie risqué de «tout briser» en demandant au commandement suprême d’exercer son autorité en vue du résultat qu’il était le premier à préconiser: le coup d’épaule aux soldats alliés. Foch, en somme, refusait de commander à Pershing de lui envoyer des soldats. Ceci était du 21 octobre 1918. Un cas analogue s’était déjà présenté d’un dissentiment entre Foch et Haig, et Foch lui-même m’ayant appelé pour résoudre le conflit, j’avais été assez heureux pour faire céder l’Anglais. Voici ce qu’en écrit le général Mordacq (le Commandement unique, p. 144):«Dans les premiers jours de juin, ayant voulu déplacer des réserves anglaises—ce qui était son droit absolu—pour les faire intervenir sur le front français, le général Foch se heurta à une opposition complète du maréchal Haig. Toujours pour éviter un heurt—particulièrement délicat en pareille situation—il en rendit compte à M. Clemenceau, qui, le 7 juin, réunit dans son cabinet, au ministère de la Guerre, lord Milner, le maréchal Haig ainsi que les généraux Foch et Wilson. Nos alliés s’efforcèrent de démontrer que l’offensive récente des Allemands sur le front français (Chemin des Dames) n’était qu’une démonstration, et qu’ils allaient exécuter l’attaque principale, l’attaque logique, l’attaque stratégique sur le front anglais, soit pour séparer l’armée britannique de l’armée française, soit pour s’emparer de Dunkerque, Calais et Boulogne, et couper par suite les armées britanniques de l’Angleterre.»La question, comme on voit, était de même ordre. Seulement, cette fois, Foch, calmé par l’effondrement du Chemin des Dames, n’hésita pas à me faire appel sans attendre mon initiative. |
| [40] | Foch se vante d’être demeuré l’ami de Pershing parce qu’il a lénifié l’emploi du commandement jusqu’au laisser faire. Je crois bien pouvoir dire que j’ai obtenu le résultat cherché, sans m’aliéner l’amitié du général Pershing. Le commandant en chef américain ne souffrait sans doute pas moins que nous de voir sa belle armée immobilisée aux portes du combat. En tout cas, il osait dire oui ou non et ne pouvait blâmer tout au fond de lui-même ceux qu’il voyait défendre de leur mieux les intérêts de la cause commune. A l’heure même où Foch me dénonçait ridiculement aux Américains, le général Pershing ne m’a pas ménagé les témoignages d’estime que je me plais à lui retourner hautement.Quand je suis allé en Amérique, pour défendre la France contre l’accusation de militarisme, le général Pershing, à New-York, m’a publiquement apporté son salut amical à la grande réunion du Metropolitan. Plus tard, il quittait Indianapolis pour entrer à Chicago, en uniforme, dans ma voiture, avec le général Dawes, parce qu’on craignait je ne sais quoi d’une municipalité et d’une population courtoises, mais avec des parties de sympathies allemandes. Enfin, lorsque l’American Legion me fit récemment le grand honneur d’une visite à Paris, le général Pershing tint à se joindre à ses camarades pour venir me saluer. Est-il rien de plus clair? Et puis, si mon tempérament, au plus fort de la crise, m’avait induit à quelque excès de langage, serait-ce à un Français (général ou civil) de me dénoncer? |
| [41] | Je ne l’avais pas voulu faire plus tôt et ne m’en repens point. |
| [42] | Étrange parce qu’on peut s’étonner que cette thèse—qui ne résiste d’ailleurs pas cinq minutes à l’examen—soit défendue par le président de la République française. Les juristes nous réservent de ces étonnements. Rien de plus simple que la solution du problème prévu par l’acte de Doullens. Le général qui ne croit pas devoir, ou pouvoir, obéir au commandant en chef fait appel à son gouvernement qui prononce en fin de compte. |
| [43] | Une haute leçon d’action dans le pire danger. |
| [44] | Or—encore une fois—nous étions à un mois de l’armistice! |
| [45] | C’était justement pour changer cet état de choses que le commandement suprême, c’est-à-dire le droit de parler comme un chef, lui fut donné. Or voici que ce droit précieux dont on a fait tant de tapage, il y renonce à l’heure même où la rapidité de l’exécution exige l’obéissance militaire dans la rigueur d’une inflexible autorité. |
| [46] | J’ai pris la liberté de consulter là-dessus M. le général Pershing qui m’a répondu qu’il n’en avait pas gardé le souvenir. |
| [47] | «Il y avait un matelas à peu près imperméable entre le haut commandement et les exécutants. Les directives générales n’étaient transmises que par fragments, et tel commandant d’armée, le plus activement engagé, n’a connu celles du maréchal Foch que par la lecture de M. Louis Madelin dans la «Revue des Deux Mondes». Comment finit la guerre, général Mangin. |