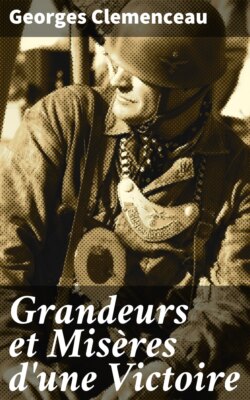Читать книгу Grandeurs et Misères d'une Victoire - Georges Clemenceau - Страница 8
LE CHEMIN DES DAMES
ОглавлениеDonc, Foch ne voulait pas dégarnir les Flandres où il attendait l’attaque allemande. C’est sur l’Aisne qu’elle se produisit: ce qui n’empêcha pas le commandant en chef de maintenir ses réserves dans le Nord et sur la Somme, estimant que l’attaque sur l’Aisne ne pouvait rien donner aux Allemands. Trois rivières passées en cinq jours n’en amenèrent pas moins le canon allemand à Château-Thierry, c’est-à-dire à quatre-vingts kilomètres de Paris. Soutiendra-t-on que ce n’est pas un résultat important? Tout le monde peut se tromper. Ce n’est pas une raison suffisante pour s’obstiner contre l’évidence. Qui se sait faillible pourrait devenir indulgent. Quand le Maréchal leur faisait la leçon parce qu’ils n’avaient pas gagné la guerre en 1917, ses camarades auraient pu lui répondre par l’offensive manquée de la Somme en 1916 et l’effondrement du Chemin des Dames en 1918. Autant dire que si le maréchal Joffre avait gagné la bataille de Charleroi, la guerre aurait pu en rester là.
Pour éviter toute contradiction, l’affaire du Chemin des Dames est traitée, dans le Mémorial, par voie de prétérition. Ce serait, en vérité, trop simple si cela permettait d’éviter le débat.
Le commandant en chef a pu se méprendre, même de la façon la plus grave, sur la question de savoir où l’ennemi l’attaquerait. Mais d’abord il était tenu de se garder, le mieux possible, et le Chemin des Dames, notre plus importante fortification de campagne, était mal, et même très mal gardée. L’événement n’en a que trop bien fourni la démonstration.
A mes premières interrogations, il fut sommairement répondu que de tels événements sont inévitables à la guerre; que, militaire ou civil, chacun peut être pris en faute, et qu’il n’était pas bon de s’appesantir là-dessus. L’entretien ainsi engagé, Foch changeait la conversation. Quand il me vit pousser l’enquête, il me demanda si j’avais l’intention de le faire passer en Conseil de guerre—à quoi je répondis qu’il ne pouvait pas en être question.
Cependant, des responsabilités se trouvaient engagées, et nous devions chercher d’abord une liquidation provisoire du procès, tout en prenant garde de ne pas ébranler ce qui restait de confiance dans les esprits. Aujourd’hui, cela paraît élémentaire. Mais en une telle rencontre, où se jouait la vie même du pays, un chef de gouvernement devait avoir la décision prompte et trouver la juste mesure entre l’énergie et la modération.
Comme il était naturel, le Parlement, activé par l’opinion publique, réagissait fortement et ne ménageait pas les chefs militaires, ce qui n’empêchait pas que j’aurais singulièrement aggravé la situation si j’avais entrepris, dans ce cruel désarroi, de les remplacer par d’autres qui, somme toute, se trouvaient peut-être moins bien préparés. Il fallait d’abord tenir tête aux mouvements d’opinion qui exigeaient des sanctions avant de savoir où elles devaient porter.
J’étais bien résolu à ne pas jouer le succès final sur un coup d’aventure. Je me prêtai, sans hésiter, à toutes les demandes d’informations qui me vinrent du Parlement. Je comparus devant les Commissions où je rencontrai de très vives hostilités. Mais une certaine confiance revint bien vite dès qu’il fut évident que j’entendais ne rien cacher.
Cependant, je ne cessais de courir la campagne pour voir les chefs à leur poste de commandement, pour les réconforter, les encourager, s’il était nécessaire, et maintenir la confiance autant qu’il était en moi. Dans de telles conjonctures, un chef, avec ou sans uniforme, qui s’obstine à vouloir vaincre, a de l’occupation.
Ci-dessous ce que je puis extraire du carnet du général Mordacq, dont l’inlassable dévouement ne connut pas une heure de relâche:
«Le 27 mai 1918, le Chemin des Dames, qui passait pour une fortification imprenable, tombe sans résistance au premier choc de l’attaque allemande. Les ponts de l’Aisne sont emportés sans que jusqu’à ce jour on ait essayé de nous dire comment. L’ennemi va traverser successivement trois rivières sans être inquiété. Il atteint Château-Thierry où il fait sauter le pont.
«Le lendemain, 28 mai, voyage à Sarcus, au Q. G. du général Foch, qui ne croit pas à une attaque de grande envergure, étant acquis qu’elle ne peut donner aux Allemands des résultats stratégiques importants. Il n’estime donc pas devoir déplacer ses réserves stratégiques, qui sont actuellement dans les Flandres et dans la région d’Amiens[20].
«26 mai 1918.—Situation tactique française sur le front de l’Aisne (Chemin des Dames):
«Ce front, qui s’étendait sur une longueur de 90 kilomètres, était très faiblement tenu: 3 corps d’armée (11 divisions) disposant d’un millier de canons.
«Situation tactique allemande sur ce même front (entre Noyon et Reims):
«9 divisions entre Noyon et Juvincourt.
«3 divisions entre Juvincourt et Courcy.
«Pour exécuter l’attaque du 27 mai, les Allemands portèrent d’abord ces forces à 30 divisions, puis, du 27 au 30 mai, à 42 divisions appuyées par 4 000 pièces d’artillerie.
«Les Allemands allaient donc attaquer avec des forces quadruples (en infanterie et artillerie) des forces alliées.
«Plan allemand.—L’attaque dans les Flandres n’ayant pas donné le résultat espéré (séparer l’armée belge de l’armée anglaise, user les réserves anglaises et atteindre la mer), Ludendorff décide d’attaquer les Alliés sur l’Aisne, secteur qu’il sait faiblement défendu et dépourvu de réserves stratégiques. Son intention est d’y attirer les réserves alliées pour reprendre ensuite l’attaque principale dans les Flandres, afin d’en finir avec l’armée anglaise[21].
«L’attaque, 27 mai.—L’attaque d’infanterie est déclenchée à 4 heures du matin, après une préparation d’artillerie qui a duré trois heures.
«Les Allemands, grâce à leur supériorité numérique, avancent rapidement. A 8 heures, ils franchissent le Chemin des Dames[22]. A midi, ils traversent l’Aisne et dans la soirée atteignent la Vesle.
«28 mai.—Leur progression continue: à 11 heures ils enlèvent Fismes et en fin de journée arrivent devant Soissons, après avoir capturé un nombre considérable de prisonniers.
«A Paris, l’émotion est énorme. Le G. Q. G. français, dès cette journée, dirige neuf divisions vers la région de Soissons, mais sans se préoccuper suffisamment de l’organisation du commandement.
«29 et 30 mai.—La marche victorieuse des Allemands continue: ils s’emparent de Soissons, franchissent l’Arlette le 30, et atteignent, ce même jour, la Marne à Jaulgonne.
«Les réserves françaises continuent à arriver[23]. La 10e armée est rappelée de la région de Doullens.
«31 mai et 1er juin.—Les Allemands bordent la Marne de Dormans à Château-Thierry. Partout ailleurs ils n’avancent plus que péniblement, se heurtant aux renforts qui arrivent de plus en plus nombreux. En vain essayent-ils de déborder le massif boisé de Villers-Cotterets, ils ne peuvent pénétrer dans la forêt même, solidement tenue par nos troupes.
«2 juin.—On peut dire que le 2 juin l’attaque allemande est enrayée: les Allemands ont maintenant en face d’eux 37 divisions réparties en 3 armées (Maistre, Duchesne et Michelet), 15 autres divisions sont en route pour les renforcer. La ruée ennemie ne pourra donc pas s’étendre encore bien loin.
«2 au 8 juin.—Et, en effet, du 2 au 8 juin, tous les efforts des Allemands se brisent contre la résistance organisée des Alliés.
«Au cours de cette bataille du Chemin des Dames, les Alliés avaient perdu plus de 60 000 prisonniers, 700 canons, 2 000 mitrailleuses, un matériel d’artillerie et d’aviation considérable, de grands dépôts de munitions, de vivres, d’approvisionnements de tous genres, des organisations sanitaires importantes, etc...
«La voie ferrée, si nécessaire à nos ravitaillements, Paris-Châlons, n’était plus utilisable.
«C’était donc un véritable désastre[24].
«Cette attaque était bientôt suivie de celle de Compiègne (9 au 12 juin).
«28 mai.—Visite à Belleu, Q. G. du général Duchesne, commandant la 6e armée; il s’est replié à Oulchy-le-Château. Nous y allons. Il expose la situation, qui n’est pas brillante: les Allemands avancent, nous n’avons que «de la poussière» à leur opposer. Se plaint que depuis le début de l’attaque il n’a vu aucun grand chef.
«Le soir, nous couchons à Provins, Q. G. du général Pétain. Il se plaint que Foch ait envoyé les réserves dans le Nord et sur la Somme. Il s’y est opposé. Il envoie des divisions pour boucher le trou, mais sont mal employées. L’artillerie fait défaut.
«Le lendemain, 29 mai, allons à Fère-en-Tardenois, où nous arrivons en même temps que les Allemands. Nous leur échappons. Puis à Fresnes, P. C. du général Degoutte. Son rôle dans l’action: il nous parle de divisions jetées successivement dans la bataille, sans artillerie. Spectacle tragique du général anxieusement penché sur un lambeau de carte, tandis que des motocyclistes, de minute en minute, se succèdent pour venir annoncer l’approche de l’ennemi. Je le quittai, n’espérant plus le revoir. C’est pour moi un des plus poignants souvenirs de cette guerre.
«Déjeuner à Oulchy-le-Château, chez le général Duchesne, pour le réconforter et tâcher d’obtenir des renseignements précis sur la bataille.
«Visite au général Maud’huy à Longpont. Ses impressions—sa colère contre Duchesne. Ensuite, Ambreny, Q. G. du général Chrétien.
«On rentre à Paris. Situation confuse.
«Affolement à la Chambre.
«30 mai.—Visites à Trilport (P. C. du général Duchesne), à Coupru (P. C. du général Degoutte), à Longpont (général de Maud’huy).
«On colmate le trou, mais manque d’artillerie.
«L’agitation à Paris. On demande la tête de Duchesne, de Franchet d’Esperey, de Pétain et de Foch.
«Entrevue de Trilport. Conversation dans voiture. Foch, Pétain, Duchesne vivement critiqués. Faiblesse du commandement subalterne. Nécessité de sabrer.
«A Paris, grande nervosité, surtout au sujet de l’abandon des ponts de l’Aisne.
«Malgré l’animosité des Alliés contre Foch, M. Clemenceau fait insérer cette phrase dans un télégramme aux gouvernements alliés: «Nous estimons que le général Foch, qui mène la campagne actuelle avec une habileté consommée, et dont le jugement militaire nous inspire la plus grande confiance, n’exagère pas les nécessités actuelles[25].»
«3 juin, soir.—Séance à la Commission de l’armée. M. Clemenceau: «Il faut avoir confiance en Foch et Pétain, ces deux grands chefs qui se complètent si heureusement.»
«4 juin.—Mon entrevue avec Foch à Mouchy-le-Châtel. Nécessité de frapper divisionnaires incapables. Foch doit en parler à Pétain.»
«Meilleures nouvelles du front.»
J’avais à régler mon compte avec le Parlement.
A travers tout, je demeure invariablement d’esprit parlementaire. Mais je dois convenir que le parlementarisme, tel que nous le pratiquons, n’est pas toujours une école d’impavidité. Toutes les conversations précédant la redoutable séance étaient grosses de prédictions fâcheuses pour le haut commandement. Je n’eus pas d’hésitation. Je couvris tout le monde, au grand étonnement de ceux qui m’avaient annoncé qu’en laissant toutes responsabilités au commandant en chef, je reprenais l’autorité de ma position.
D’évidence, plus les pouvoirs de Foch avaient été accrus, plus gravement sa responsabilité militaire se trouvait engagée. Personne ne le savait mieux que lui. De sa nature, il n’était pas parleur. Je ne cherchais pas (car le temps me manquait) à me faire une opinion personnelle sur l’ensemble des responsabilités militaires, et l’occasion ne me fut pas fournie de m’éclairer plus tard. Je n’échangeai donc que des propos imprécis avec le généralissime, et m’en allai à la bataille parlementaire sans avoir averti personne de ce que je me proposais de faire. Je remportai une éclatante victoire en couvrant tous mes subordonnés, mais nul ne peut douter sérieusement que, si j’avais faibli un seul instant, le haut commandement était emporté. Foch ne me dit jamais un mot de cette séance, où je ne me vante pas quand je dis que je l’ai sauvé. Avouez cependant que ce silence de Foch pourrait prêter à des commentaires. Nous n’en étions pas encore à nos grandes querelles sur l’armée américaine et sur l’annexion de la Rhénanie. Aucune mauvaise parole n’avait et n’a jamais été échangée entre nous. Rien de plus, peut-être, que les oppositions inévitables du pouvoir civil et du pouvoir militaire. Mais je m’appliquais persévéramment à ne jamais pousser trop loin le débat et, de mon côté, il n’y eut jamais de réaction caractérisée, jusqu’au jour où il essaya de me soutenir qu’il n’était pas mon subordonné, pour en venir à l’insubordination à ciel ouvert dans l’affaire de la dépêche Nudant.
«Séance à la Chambre. 4 juin 1918.—Affaire du Chemin des Dames[26]. Demandes d’interpellations:
«M. Aristide Jobert.—J’avais demandé à interpeller le gouvernement sur les mesures qu’il comptait prendre pour donner à notre héroïque et admirable armée française les chefs qu’elle mérite, et pour lui demander quelles sanctions il comptait prendre à l’égard des incapables...»
«M. Frédéric Brunet.—...Monsieur le Président du Conseil, il ne nous a pas paru que dans les combats récents, toutes les mesures de précaution nécessaires pour sauvegarder la vie de ces hommes, pour employer leur héroïsme d’une façon plus utile, aient été prises avec assez de prévoyance. Quand nous avons assisté à la première ruée allemande dans la Somme, pas une âme dans ce pays n’a défailli; nous avons tous répété avec vous: «Ils ne passeront pas!» Mais quand nous avons vu ce Chemin des Dames où tant des nôtres sont tombés pour en assurer la possession à la France, nous avons eu un instant d’angoisse et nous nous sommes demandé si les chefs qui commandaient là avaient vraiment fait tout leur devoir... et si la loi s’appesantit d’une façon formidable sur le soldat qui défaille à son devoir, elle doit être plus terrible encore pour le chef qui, par négligence ou imprévoyance, peut causer des défaites irréparables.»
M. Clemenceau prend la parole:
«—S’il faut, pour obtenir l’approbation de certaines personnes qui jugent hâtivement, abandonner les chefs qui ont bien mérité de la patrie, c’est une lâcheté dont je suis incapable. N’attendez pas de moi que je la commette...
«...Si nous devions susciter dans l’esprit des soldats des doutes sur certains de leurs chefs, et peut-être des meilleurs, ce serait un crime dont je ne prendrais pas la responsabilité...
«Ces soldats, ces grands soldats ont des chefs, de bons chefs, de grands chefs, des chefs dignes d’eux en tous points.
«...Est-ce à dire qu’il n’y ait de fautes nulle part? Je suis incapable de le soutenir. Je le sais très bien. Mon office est de trouver ces fautes et de les corriger. C’est à quoi je m’applique. En cela, je suis soutenu par deux grands soldats qui s’appellent le général Foch et le général Pétain.
«...Le général Foch a, à ce point, la confiance de nos Alliés que, hier, à la Conférence de Versailles, ils ont voulu que, dans le communiqué qui fut donné à la presse, il fût fait témoignage de la confiance qu’ils ont en lui.»
«Un député.—C’est vous qui le leur avez fait dire.»
«Ces hommes livrent en ce moment la bataille la plus dure de la guerre et ils la livrent avec un héroïsme pour lequel je ne trouve pas d’expression digne de la qualifier. Et c’est nous qui, pour une faute qui se sera produite dans telle ou telle partie, ou même qui ne se sera pas produite, avant de savoir, demanderons des explications, exigerons, au cours de la bataille, d’un homme épuisé de fatigue et dont la tête tombe sur sa carte, comme je l’ai vu à des heures terribles, c’est, à cet homme que nous viendrions demander des explications pour savoir si, à tel ou tel jour, il a fait telle ou telle chose?
«Chassez-moi de la tribune, si c’est cela que vous demandez, car je ne le ferai pas.
«...Je disais que l’armée est au-dessus de ce que nous pouvions attendre d’elle, et quand je dis «l’armée», j’entends les hommes de tous rangs et de tous grades qui sont au feu. Là est l’un des éléments de notre confiance, l’élément principal. En effet, la foi dans la cause est une admirable chose, mais cela ne donne pas la victoire; il faut que les hommes meurent pour leur foi pour que la victoire soit assurée et les nôtres sont occupés à mourir.
«Nous avons une armée faite de nos enfants, de nos frères, de tous les nôtres. Que pourrions-nous avoir à dire contre elle?
«Les chefs aussi sont sortis d’entre nous, ce sont nos parents, eux aussi, ce sont de bons soldats, eux aussi; ils reviennent couverts de blessures, quand ils ne restent pas sur le champ de bataille. Qu’avez-vous à dire contre eux?
«...Nous avons des alliés qui se sont engagés avec nous à pousser la guerre jusqu’au bout, jusqu’au succès que nous tenons, que nous sommes à la veille de tenir si nous avons l’obstination nécessaire. Je sais bien que la majorité de cette Chambre aura l’obstination qu’il faut. Mais j’aurais voulu que ce fût l’unanimité.
«J’affirme, et il faut que ce soit ma dernière parole, que la victoire dépend de nous... à condition que les pouvoirs civils s’élèvent à la hauteur de leur devoir, parce qu’il n’y a pas besoin de faire cette recommandation aux soldats.
«Renvoyez-moi d’ici si j’ai été un mauvais serviteur, chassez-moi, condamnez-moi, mais prenez pour cela la peine de formuler au moins des critiques.
«Quant à moi, je prétends que le peuple français, jusqu’ici a fait, dans toutes ses parties, le plein de son devoir. Ceux qui sont tombés ne sont pas tombés en vain puisqu’ils ont trouvé moyen de grandir l’histoire française.
«Il reste aux vivants de parachever l’œuvre magnifique des morts.»
Foch est sauvé.
Encore les notes de Mordacq:
«5 juin.—Les intrigues parlementaires se donnent cours. M. Clemenceau, obligé de rester à Paris, m’envoie le 5 juin à Bombon (Q. G. du maréchal Foch) et à Provins (général Pétain). Il faut en finir avec les chefs incapables. D’autre part, plus que jamais, le besoin de chefs énergiques et compétents se fait sentir. M. Clemenceau décide de rappeler d’Orient Guillaumat et de le remplacer par Franchet d’Esperey. Foch et Pétain sont de cet avis.
«Résolution prise sans consulter M. Lloyd George, qui s’était prononcé contre Foch et Pétain.
«7 juin.—Réunion au ministère de la Guerre: lord Milner, Haig, Foch, Wilson. Emploi de divisions anglaises sur front français. Réponse dilatoire de Foch.
«8 juin.—Visite 3e armée, général Humbert (Oise). Attaque allemande annoncée. Tout est préparé pour la recevoir.
«9 juin.—L’attaque est déclenchée.»
Depuis le vote de confiance, jour et nuit je roulais sur les routes pour visiter les postes de commandement. De toutes parts, je me voyais ramené à l’éternelle question des défaillances des chefs de second plan. Cette lamentable déroute, sur laquelle il faudra bien se résoudre à faire la lumière quelque jour, était sans doute imputable au commandement suprême en contact insuffisant avec les éléments de combat. Mais si les commandements secondaires avaient été bien soudés, nous aurions pu tenir, même en l’absence des réserves immobilisées, l’arme au pied, dans les Flandres, par le général Foch.
Je déclarai finalement au général en chef que, du fait de notre victoire parlementaire, de nouveaux devoirs nous étaient imposés, et je fis appel à sa conscience militaire de chef suprême pour me dire s’il n’avait pas d’urgentes réformes du personnel à me proposer. Sans hésiter, le général me répondit que la principale faute était dans l’insuffisance des moyens à la disposition de son État-Major[27], mais que la difficulté d’une réorganisation était grande parce qu’il faudrait démembrer l’État-Major du général Pétain.
Je répondis que le général Pétain était l’homme désintéressé par excellence, et qu’il suffirait certainement de lui faire la démonstration à laquelle il avait droit. En même temps je tirai de ma poche une assez longue liste de chefs vieillis dont j’avais décidé le remplacement.
J’avais défendu le haut commandement à la tribune, mais je savais fort bien, pour l’avoir vu de très près dans mes courses au front, qu’un groupe important de généraux avaient vieilli et devaient être remplacés. Foch le savait aussi bien que moi, mieux même, certainement, mais comme chez beaucoup de chefs, l’appellation de «vieux camarade» était auprès de lui un talisman d’une haute efficacité.
Je dois dire que, devant ma résolution, le général Foch ne fit aucune résistance. Sans perdre un moment, nous nous rendîmes auprès du général Pétain à qui, de mon mieux, j’exposai l’entretien que je venais d’avoir avec son chef. Placide, à son ordinaire, le général Pétain, commandant en chef de l’armée française, écouta mes paroles sans rien dire, puis:
—Monsieur le Président, je vous donne ma parole que si vous me laissez un corps d’armée à commander je me tiendrai pour grandement honoré et demeurerai content dans la bonne exécution de mes devoirs.
Ce fut une heure de suprême noblesse qui ne peut pas être oubliée.
Je revins alors à ma liste de généraux à limoger, qui ne provoqua pas du généralissime une seule contestation. Il connaissait trop bien les insuffisances de chacun. A certains noms, je le voyais hausser les épaules en murmurant: «Un vieil ami...» Le sacrifice fut consommé à peu d’exceptions près. Foch, en effet, me demanda grâce pour ceux de ses «anciens camarades» qui se trouvaient sur des parties du front où l’on ne se battait pas, en promettant que si l’occasion venait à le demander, il les ferait passer sous le commun niveau.
Mon devoir eût été de résister à cet appel aux faiblesses coutumières, car le combat pouvait reprendre d’un moment à l’autre sur les points où, provisoirement, il était en sommeil. On aurait eu le droit de m’infliger un trop juste blâme si l’affaire avait mal tourné. Je risquai le coup de chance, pour me concilier les bonnes grâces du généralissime maintenu lui-même à son poste par mon intervention à la Chambre. Sur quoi il m’accuse de l’avoir persécuté! Où seriez-vous, à cette heure, mon pauvre Maréchal, si je n’avais mis ma poitrine entre vous et vos juges? Il faut bien que je vous le rappelle puisque cette pensée ne vous est jamais venue.
Ainsi que je l’avais promis, une commission parlementaire se vit remettre le dossier, que je n’ai jamais vu, en raison d’occupations plus pressantes. Quand elle eut déclaré son impuissance à établir les responsabilités, il ne resta plus devant moi que le maréchal Foch, et l’on comprend trop bien aujourd’hui la raison du silence où le Mémorial s’est enfermé.
| [20] | Je me permets de croire qu’il y aurait beaucoup à dire sur les passages soulignés.Se reporter à nos pertes en hommes et en artillerie, comme au terrain perdu, avant d’admettre avec Foch que l’affaire du Chemin des Dames «n’était pas une attaque de grande envergure». Laisser venir les Allemands à 80 kilomètres de Paris, de quelle envergure cela peut-il être?Les Allemands avaient l’avantage du nombre, mais parce qu’ils avaient réussi à tromper Foch, ce qui ne peut pas être pour lui un titre de gloire. On m’a appris au collège que la première partie de l’art de la guerre est de se trouver en force devant l’ennemi. |
| [21] | Intention présumée pour justifier l’abandon de l’Aisne. |
| [22] | En quatre heures! Et la défense? Pourquoi n’a-t-on pas fait sauter les ponts de l’Aisne? |
| [23] | Il est temps. |
| [24] | Si l’opération était d’aussi faible envergure que l’avait prétendu le Maréchal, pourquoi la formidable organisation en cet endroit? Cela même n’explique pas qu’on l’ait abandonnée aussi rapidement. Il y a vraiment trop de pourquoi en cette étrange affaire. |
| [25] | Je l’ai dit au chapitre l’Unité du commandement. |
| [26] | Officiel. |
| [27] | Tout ce que j’ai appris, depuis ce temps, des événements du Chemin des Dames, ne m’a pas paru confirmer cette explication. C’est un procès à faire. Il faudra en arriver là. |