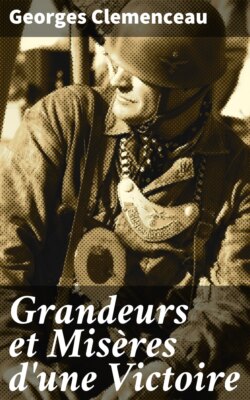Читать книгу Grandeurs et Misères d'une Victoire - Georges Clemenceau - Страница 4
ENTRÉE EN MATIÈRE
ОглавлениеAmbitions et défaillances, c’est de l’humanité de tous les temps.
Mes relations avec le général Foch sont antérieures à la guerre qui nous réunit, si différents, dans une action commune au service de la patrie. Les journaux ont raconté comment je le nommai commandant de l’École de guerre, m’en référant à ses capacités présumées, sans faire état de ses relations avec la congrégation de Jésus. Le hasard veut que les choses se soient à peu près passées comme on les raconte. Ce n’est pas l’ordinaire. Je confirme donc l’échange des deux propos:
—J’ai un frère Jésuite.
—Je m’en f...
J’aurais pu faire choix d’une expression plus réservée. Mais mon interlocuteur était un soldat, et je tenais à être compris. A défaut d’autres mérites, ma parole avait l’avantage d’être claire. Cela pouvait suffire. Le général Picquart, ministre de la Guerre, m’avait recommandé très chaudement le général Foch pour la mise en œuvre d’un cours de stratégie qui était à créer. Je ne demandai rien de plus. Si les rôles s’étaient trouvés intervertis, je ne suis pas sûr que tel ou tel de mes adversaires eût été capable de suivre mon exemple[1].
Je ne me réclame naturellement d’aucun mérite particulier pour un acte si simple de patriotisme français. J’appartenais à la génération qui avait vu perdre l’Alsace-Lorraine, et je ne pouvais m’en consoler. Je rappelle, à ce propos, avec un innocent orgueil, qu’en 1908 j’ai tenu tête à l’Allemagne dans l’affaire de Casablanca, et que le gouvernement de Guillaume II, après nous avoir demandé des excuses, dut à ma tranquille résistance d’avoir à se contenter d’un simple arbitrage, comme dans n’importe quel litige. Nous n’en étions pas encore à l’humiliante cession d’une partie arbitraire de notre Congo à l’Allemagne par M. Caillaux et par M. Poincaré, son successeur.
Je ne cache pas qu’il y eut pour moi une ou deux nuits d’un sommeil inquiet. J’encourais un redoutable risque. Les faibles, qui sont généralement le nombre, en eussent été quittes pour me désavouer. Cependant, l’honneur de mon pays demeura sauf entre mes mains.
Si j’eus des relations avec le général Foch, depuis ces jours lointains jusqu’à la guerre, je n’en ai pas gardé le souvenir. Il n’était pas dans la politique et n’avait aucun besoin de moi.
A Bordeaux, après la bataille de la Marne, je reçus une lettre de mon frère Albert, qui s’était engagé et que le général Foch, qui ne le connaissait pas, avait mandé pour cette confidence: «La guerre est maintenant virtuellement terminée.» C’était peut-être aller un peu vite en besogne. Personne, sans doute, ne le sentit mieux que le général lui-même quand il eut en mains la responsabilité militaire. Mais l’heureuse prédiction n’en a pas moins été confirmée par les événements. Elle fait honneur à la vivacité d’intuition du soldat.
Mes dispositions, à l’égard du chef militaire qui voulait déjà tenir pour achevée, la belle réaction victorieuse, ne pouvaient être meilleures. Je ne fus donc pas trop surpris quand, en de mauvais jours—fin 1914—où ma tâche ingrate me confinait dans une sévère opposition,—je reçus du général Foch, toujours par l’entremise de mon frère, la demande d’une entrevue particulière, à la préfecture de Beauvais, alors occupée par mon ami M. Raux, plus tard préfet de police.
Dans ma naïveté, j’avais cru qu’une importante révélation allait justifier cette démarche inattendue. J’arrivai donc tout chaud, pour me trouver de glace quand je découvris qu’il s’agissait simplement d’être interrogé, en temps de guerre, par un chef d’armée, sur les dispositions plus ou moins favorables du monde politique à propos d’un remaniement du haut commandement qui intéressait d’une façon personnelle mon interlocuteur[2].
Mon attitude générale fut d’une aimable réserve. J’acceptais assurément de faire confiance aux capacités professionnelles de l’ancien professeur de stratégie à l’École supérieure de guerre, mais je n’en regrettais pas moins la préoccupation d’intérêt purement personnel. Je revins donc plutôt désappointé. Ainsi finit, sans avoir commencé, ce colloque mystérieux.
Plus tard, en 1916, une autre surprise m’attendait. Ne voilà-t-il pas que m’arrive mon collègue parlementaire, M. Meunier-Surcouf, officier d’ordonnance du général Foch, m’apportant le buste (simili terre cuite) de son chef avec les compliments de celui-ci. J’en demeurai bouche bée. Qu’attendait-on de moi par de tels procédés? Interrogé à ce sujet, M. Meunier-Surcouf me déclara qu’un sculpteur avait été mandé au quartier général pour recevoir l’ordre de débiter, d’après un grand modèle, quinze pièces de réduction destinées à divers personnages supposés influents. L’opération était d’envergure. Cela peut faire sourire. Il demeure qu’une telle démarche devait paraître étrange au plus fort d’une guerre où la vie même de la France était engagée. J’avais entendu dire que les rois envoyaient leur photographie aux visiteurs dont ils étaient satisfaits. Le général Foch poussait jusqu’au buste, et je puis assurer que, pour un homme qui ne conspire ni avec les militaires, ni avec les civils, c’était un objet fort embarrassant.
Plus explicite que son chef, l’officier d’ordonnance ne me cacha pas qu’il était d’avis de mettre le général Foch à la tête des armées françaises. J’étais loin d’y être opposé. M. Meunier-Surcouf multiplia ses visites pour me confirmer dans ses vues. De son cahier de notes, il a bien voulu extraire un compte-rendu dont je citerai quelques passages:
«Il était 10 heures du matin quand le 15 avril 1916 je me présentai chez M. Clemenceau, à son domicile de la rue Franklin; je n’avais jamais eu l’occasion de l’approcher.
«Qu’est-ce qui m’incitait à lui rendre visite?
«C’est qu’à travers la polémique parfois violente de l’Homme enchaîné, on devinait en lui un amour indiscutable de la France et un désir absolu de la victoire.
«—Je suis vieux, me dit-il, je ne tiens pas à la vie, mais j’ai juré que ma vieille carcasse tiendrait jusqu’à la victoire complète, car nous l’aurons, la victoire, monsieur Charles Meunier, nous l’aurons.»
«A mon tour, je mis mon interlocuteur au courant de la situation militaire telle qu’elle m’apparaissait par l’appréciation des faits...
«—Je n’ai vu, lui dis-je, autour de moi, qu’un seul général qui croie absolument à notre victoire militaire, c’est le général Foch. Comme, à cette foi nécessaire, il joint les qualités qui font de lui un des premiers dans son métier, il me paraît désigné pour conduire nos armées, et le gouvernement trouvera en lui l’appui le plus sûr et aussi le plus loyal dans les mois difficiles qui viennent.
«Je ne veux pas que vous puissiez croire que j’en parle comme un officier dévoué, en ami qui s’est attaché à lui pendant dix-huit mois qu’il a été à ses côtés. Je veux m’appuyer sur des faits.
«Et je lui fis, à ma manière, l’historique de la manœuvre de la bataille de la Marne (lorsque Foch commandait la 9e armée), à laquelle j’avais assisté comme officier dans un groupe d’artillerie de la 60e division de réserve et de la «course à la mer» qui se termina par l’arrêt de l’offensive allemande dans le Nord le 15 novembre 1914.
«Il y avait dans ces deux actions des révélations de qualités d’offensive, d’utilisation et d’économie des réserves d’énergie morale, et même de diplomatie telles, que l’on pouvait affirmer que, si nombre de nos généraux avaient d’excellentes qualités, le général Foch paraissait être d’une classe supérieure.
«D’ailleurs, ajoutai-je, venez le voir. Vous êtes venu deux fois de nos côtés—je vous ai aperçu—sans vous arrêter à notre Q. G. Je crois fermement que si vous êtes ensemble, vous à l’intérieur, et lui à l’armée, nous serons dans les meilleures conditions pour obtenir le succès final.
«Les qualités d’offensive du général le rendent capable de gagner la victoire, mais il peut perdre une bataille; il est indispensable qu’il ait près de lui quelqu’un qui puisse le couvrir, le soutenir alors devant les Chambres[3], devant le pays dont vous connaissez la sensibilité, et je pense que vous êtes l’homme qu’il faut pour cela. Il est temps, monsieur le Président, que vous vous mettiez d’accord.»
J’avoue que la distribution des bustes m’inspirait certaines hésitations sur le candidat au poste de commandant en chef. Le souvenir du général Boulanger...?
En me quittant, l’officier d’ordonnance du général Foch me dit:
—C’est bien promis, n’est-ce pas?
—Je n’ai à faire de promesse à qui que ce soit, répondis-je. Mais je suis bien disposé. D’ailleurs, je ne serai pas consulté.
Le temps passa. Surprise! Un matin, fin 1916, je vois entrer chez moi le général Foch lui-même, fortement ému:
—J’arrive tout droit de mon quartier général, me dit-il, où je viens de recevoir la visite du général Joffre. Voici le discours qu’il m’a tenu:
—«Je suis un malheureux. Je viens m’excuser auprès de vous d’une mauvaise action que j’ai commise. M. Poincaré m’a fait appeler et m’a donné l’ordre de vous limoger. Je n’aurais jamais dû consentir. J’ai cédé. Je viens vous en demander pardon.»
Et le général Foch de conclure:
—Et moi, je viens vous demander un conseil. A votre avis, que dois-je faire?
De la cause du désastre, pas un mot. C’était mauvais signe. Je m’abstins d’interroger. C’était pourtant le point capital de l’affaire. Mais je crus devoir ménager les nerfs du général enlevé à ses soldats.
—Mon cher ami, répondis-je, votre devoir est tout tracé. Des compétitions, que j’ignore, peuvent avoir causé cette disgrâce momentanée. On ne peut pas se passer de vous. Point de tapage. Obéissez sans récriminations. Rentrez tranquillement chez vous. Tenez-vous coi. Avant quinze jours, peut-être vous aura-t-on rappelé.
Mes prévisions furent largement dépassées puisque le général demeura limogé pendant plusieurs mois.
Plusieurs mois de méditation, c’est beaucoup pour un vaillant soldat qui voit les camarades tomber devant lui sur le champ de bataille. Foch supporta l’épreuve sans parler. C’est un accomplissement que j’apprécie.
Au cours des années suivantes, je racontai cette histoire à M. Poincaré qui haussa les épaules en riant, avec cette seule remarque:
—Ces généraux! Ils sont toujours les mêmes!
Je n’en fus pas beaucoup plus éclairé.
En novembre 1917, je trouvai le général Foch à Paris, chef d’État-Major général, n’exerçant, en somme, aucun commandement actif. J’avais attendu de lui, au rapport de Picquart, une éclatante manifestation de talents militaires. Peut-être le dernier mot n’était-il pas dit.
M. Poincaré et le maréchal Joffre connaissent, sans aucun doute, tous les détails de cette histoire. On a parlé d’une intrigue conduite par un général politicien qui se portait ouvertement comme concurrent de Foch, et rendait alors de fréquentes visites à l’Élysée. M. Painlevé a écrit que Foch fut relevé de son commandement par Joffre, pour des causes purement militaires. De son côté, le commandant Bugnet déclare expressément qu’il s’agissait de l’offensive de la Somme, insuccès caractérisé, qu’on voulut nous donner, plus tard, comme une simple tentative pour «soulager Verdun». Dépourvue de moyens de transport pour exploiter la percée, l’offensive de la Somme se présente comme une opération manquée. Certains chefs, après coup, ont trop souvent une explication toute prête pour justifier un insuccès. Ainsi est-il aisé de se tirer d’embarras à bon compte. On ne s’étonnera pas que ceux qui avaient prétendu dégager Verdun ne s’en trouvèrent pas moins tenus de limoger Foch «pour l’exemple». Cette affaire s’éclaircira quelque jour. Mais pour que M. Poincaré, très soucieux des responsabilités, ait écarté du combat le soldat de la Marne et de l’Yser, on peut croire qu’il avait fallu de graves raisons. Ils ont fini tous deux par se comprendre. L’histoire n’en sera pas étonnée.
Pour moi, dès mon arrivée au ministère, je repris naturellement mes bons rapports avec le nouveau chef. J’escomptais toujours l’effet de ses talents stratégiques. Quant à lui, avec ou sans buste, il avait succédé à son ancien rival dans la familiarité du chef de l’État. Chacun jouait désormais sa partie sur la carte de confiance réciproque qui lui paraissait la plus sûre.
Avant de pousser plus loin, je tiens à déclarer expressément que ce livre ne doit pas être considéré comme un cahier de mémoires. On m’a mis en demeure de répondre sur certains points, je réponds, mais sans me dégager des considérations d’ensemble qui s’imposent en pareil sujet. Pendant plus de dix ans, il ne m’en a pas coûté de garder le silence, malgré les attaques qui ne m’ont pas été ménagées, et ce n’est certes pas la crainte du débat qui m’a retenu.
J’avais simplement considéré que, dans la situation redoutable faite à notre pays, une extrême réserve m’était commandée—et jusqu’au dernier mot de ce livre, je regretterai de m’en être départi. Après l’effroyable saignée que la France a subie, il apparaît qu’elle a réagi moins virilement dans la paix qu’aux grands jours de l’épreuve militaire. Ses «gouvernants», tous à peu près de même mesure, semblent avoir ignoré qu’il ne faut pas moins de résolution pour vivre la paix que la guerre. Peut-être, à certaines heures en faudrait-il davantage. Quelques-uns le savent qui parlent l’action au lieu de l’engager. Que ce soit au gouvernement, au Parlement, ou dans l’opinion publique, je ne vois partout que défaillance et fléchissement.
Nos alliés, désalliés, y ont puissamment concouru et nous ne les avons pas découragés. L’Angleterre, sous des apparences diverses, est retournée à sa vieille politique de discorde continentale, et l’Amérique, prodigieusement enrichie par la guerre, nous présente un bilan de maison de commerce qui fait plus d’honneur à ses appétits qu’à sa fierté.
Toute à ses efforts de reconstitution économique, hélas! trop justifiés, la France cherche, dans les cimetières de la politique, des restes de vie humaine pour figurer des fantômes de ce qui a été. L’élan n’y est plus. Homme fini moi-même, me voilà aux prises avec un soldat du temps passé qui suscite contre moi des arguments à la portée des simples, quand j’avais doucement changé d’atelier pour finir mes jours dans la philosophie.
Beaucoup moins sage, après dix ans de réflexion, il s’avise de me lancer une vieille cartouche d’offensive retardée, en s’épargnant, par un cas prémédité de carence, le souci d’une riposte inévitable. En bon stratège, il assurait ainsi ses derrières pour donner libre cours contre moi à de vieilles rancunes des plus caractérisées. Pour quiconque n’est candidat qu’au repos, cela n’a pas d’importance, mais, pour un chef de combat, laisser dormir sa bataille pendant dix ans, puis charger un passant de l’évoquer, ce n’est ni d’une âme sûre d’elle-même, ni d’un cœur un peu haut placé.
| [1] | A propos d’une candidature universitaire, dans une circonstance moins grave mais encore délicate, je fixai mon choix, de la même façon, sur M. Brunetière, bien qu’il fût l’adversaire de mes idées, parce qu’il me parut le plus qualifié. Je mets une fierté dans cette sorte d’achèvement qui procède d’une entière confiance dans le filtrage ultime de la vérité par le libre jeu de l’esprit humain. |
| [2] | Une suite de lieux communs sur la guerre, sur nos chances de succès, sur ce qu’on pourrait tenter. Mon interlocuteur me parut court d’idées. |
| [3] | C’est moi qui souligne. M. Meunier-Surcouf prévoyait le Chemin des Dames. |