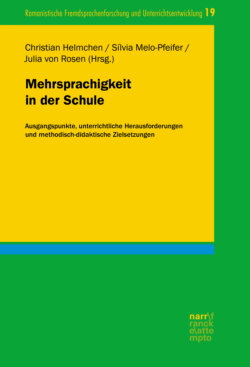Читать книгу Mehrsprachigkeit in der Schule - Группа авторов - Страница 21
Оглавление4 Analyse des résultats: description du réseau conceptuel
Une analyse de notre corpus nous a permis d’ébaucher un modèle gravitationnel du concept d’IC, ainsi que de ses toiles internes (voir schéma 1). Comme prévu, le concept d’IC s’assume dans ces études comme concept hyper-central (avec un total de 36 occurrences), autour duquel d’autres circulent comme super-centraux (entre 10 et 15 occurrences), centraux (entre 4 et 9) ou périphériques (entre 1 et 3). Par rapport aux concepts périphériques, nous avons établi deux niveaux de périphérie : ceux qui n’apparaissent que dans un texte et qui ne semblent pas partagés par les chercheurs (par exemple : style communicatif, adaptation communicative, connaissances grammaticales) et ceux qui comptent entre 2 et 3 occurrences (par exemple : transparence, opacité, acquisition).
Pour besoin d’espace, nous ne ferons allusion dans le schéma-synthèse qu’aux concepts du premier niveau de périphérie (2 ou 3 occurrences). Au centre, nous trouvons le concept hyper-central; en deuxième rang, ceux classés comme « super-centraux » et dans le troisième rang, ceux rangés comme centraux. Les concepts périphériques finalisent la constellation. Ceci ne vaut pas dire que les concepts plus périphériques ne soient pas importants pour préciser les problématiques des chercheurs, mais qu’ils ne font pas partie du « noyau dur » du concept. En effet, plus les concepts-clés sont périphériques, plus on entre dans la spécificité des études ; au contraire, plus les concepts sont centraux, plus nous arrivons à des aspects transversaux de la recherche : « c’est la combinaison originale de ces différents traits sémantiques (centraux et périphériques) par les chercheurs qui est à l’origine de la multidimensionnalité et de l’hétérogénéité actuellement assignées au concept d’IC » (Gueidão et al. 2009, 73).
Schéma 1:
Modèle gravitationnel conceptuel de l’IC.
Malgré l’apparente simplicité et lisibilité de cette constellation, nous pouvons discuter la richesse des sens évoqués (« l’empire des sens » de l’IC) et quelques problèmes observables dans sa formation, notamment des réseaux conceptuels ambigus et des impasses (les « liaisons dangereuses » que le concept d’IC établit avec d’autres).
4.1 L’empire des sens
L’empire des sens est visible, dans un premier moment, dans le nombre de concepts-clés apparus: 93. Malgré cet « empire des sens », il faut dire que les sens généralement associés à l’IC et qui le plus souvent concourent à sa nature multiforme sont reliés entre eux, même si quelques-uns évoquent le voisinage conceptuel, et d’autres le cadre disciplinaire ou méthodologique:
| Les 3 concepts super-centraux | Total d’occurrences |
| Représentations + Images (des langues) | 15 |
| Interaction (en ligne) | 10 |
| Didactique (de l’Intercompréhension, du Plurilinguisme) | 10 |
Tableau 2:
Les concepts super-centraux.
La compréhension de ces trois concepts « super-centraux » est aidée par la liste de concepts « centraux », qui affinent le sens à donner aux concepts de rang supérieur:
| Les 13 concepts centraux | Total d’occurrences |
| TICE | 9 |
| Compétence plurilingue | 6 |
| Langue étrangère | 6 |
| Connaissance professionnelle/didactique | 6 |
| Formation (d’enseignants) | 6 |
| Communication | 5 |
| Compréhension écrite/lecture | 5 |
| Distance inter-linguistique | 5 |
| (Intercompréhension entre) langues voisines | 5 |
| Plurilinguisme | 4 |
| Conscience (meta)linguistique | 4 |
| Identité (professionnelle) | 4 |
| Biographie (linguistique et culturelle) | 4 |
Tableau 3:
Les concepts centraux.
La liste ci-dessus nous laisse voir que les TICE, en général, et les plate-formes d’apprentissage et les CD-Rom, plus particulièrement, s’avèrent des outils privilégiés dans les études en intercompréhension (Melo & Araújo e Sá 2007). La Didactique, qu’elle soit désignée comme DL, Didactique du Plurilinguisme ou Didactique de l’Intercompréhension, apparaît comme cadre épistémologique de ces recherches. Il faut encore noter que deux cadres d’études sont présents en concurrence : l’IC dans le cadre de l’interaction plurilingue et dans le cadre de la compréhension (surtout à l’écrit, la compréhension explicitement à l’oral n’ayant eu que 3 occurrences). Il faut cependant avouer que les occurrences des mots-clés périphériques liés à la compréhension (cadre, texte, lecture, écriture, …) sont antérieurs à ceux en rapport avec l’interaction plurilingue (contrat communicatif, contrat d’apprentissage, clavardage, marques transcodiques, choix de langue, …), ce qui met en évidence une évolution dans les problématiques en étude.
En plus, bien que ces études soient développées dans le cadre du plurilinguisme et du développement de la Compétence Plurilingue, l’occurrence de « langues voisines » ou « Langues Romanes » (avec deux occurrences, étant classées comme périphériques) en tant que mots-clés cible un plurilinguisme restreint. Même quand on analyse les textes où « Langue(s) Etrangère(s) » et « Langue(s) » sont signalés en tant que mots-clés, la majorité des études menées se situe dans le cadre des langues romanes (noyau dur des recherches de ce groupe de travail).
Il faut encore signaler que les questions liées à la formation, surtout initiale de professeurs, apparaissent fréquemment, bien que récemment. Les concepts centraux plus fréquents étant « connaissance professionnelle » et « identité » situent ces travaux dans un contexte qui prône la formation à l’IC en tant qu’individualisée et constitutive des sujets. Ceci encore signale un tournant dans les préoccupations de recherche.
4.2 Liaisons dangereuses
Au niveau des « liaisons dangereuses », observables dans notre constellation conceptuelle et sémantique, nous pouvons signaler deux types d’ambiguïtés: celle en rapport avec des co-occurrences qui pointent des conceptions concurrentes; celle en rapport avec un manque de « différance » (Derrida 1968) entre les concepts, capable de les distinguer.
Un exemple pour chacune de ces liaisons s’impose. Pour le premier type d’ambiguïté, nous remarquons des co-occurrences comme « intercompréhension », « compétence d’IC » ou « stratégies d’IC », soit dans un même texte, soit dans plusieurs textes d’un même auteur. Ainsi, l’IC peut devenir soit le but de l’apprentissage (une compétence que l’on acquiert), soit l’outil cognitif mis en place pour acquérir d’autres compétences en LE.
Encore par rapport à ce type d’ambiguïté, on trouve des co-occurrences de « compréhension », « activité méta-linguistique1 », du domaine de l’IC écrite, et « stratégies de communication », du domaine de l’IC en interaction, respectivement. Ou encore, « intercompréhension » et « compréhension plurilingue », d’un côté, et « compréhension multilingue » et « compréhension plurilingue », de l’autre. Ces deux derniers exemples montrent comment les distinctions entre « compréhension » et « intercompréhension » et « multilingue » et « plurilingue », respectivement, sont encore à conceptualiser et à discuter.
Pour le deuxième cas, nous trouvons dans un cas, la co-occurrence d’« interactions », « communication exolingue » et « communication plurilingue » et, dans un autre, « interaction », « communication plurilingue », « clavardages plurilingues » et « communication médiatisée par ordinateur ». Dans ce cas, ces mots-clés sont présentés comme différents, puisqu’ils intègrent une liste, mais ni l’étude, ni li titre, ne permettent de les distinguer, en leur attribuant soit des rapports d’hyperonymie, soit de « voisinage conceptuelle ».
Une autre étude fait référence à « apprentissage multilingue », « didactique intégrée » et « intercompréhension entre langues voisines ». Ici, c’est le problème de distinguer les approches plurielles qui semble apparaître (Candelier 2007). Une autre question peut se poser, après la lecture des occurrences de « Didactique »: quelles sont les spécificités d’une Didactique des Langues, d’une Didactique du Plurilinguisme et d’une Didactique de l’Intercompréhension ? Là encore, d’importantes questions épistémologiques émergent pour la définition même du cadre disciplinaire de ces études.
Quoi qu’il en soit, ces remarques ne sont pas en soi négatives, mais elles pointent le besoin d’un plus grand souci dans le choix des mots-clés, puisqu’ils sont représentatifs de la recherche faite. Or, s’ils sont présentés dans une liste qui n’est pas capable de leur établir un rapport, ceci peut nuire à la réception des textes et, de par ce biais, contribuer à un amalgame interprétatif de la notion centrale. En plus, il faut signaler que, bien que titres et mots-clés soient compris en tant que complémentaires, nous avons parfois eu l’impression qu’aucun rapport n’était présent entre les deux, ce qui, à nouveau, provoque des difficultés dans l’appréhension du sens du concept d’« Intercompréhension ».
Finalement, ce que ce rapide relevé d’ambiguïtés nous montre, c’est le besoin, dans le cadre de chaque texte, de bien présenter la conception d’IC liée à chaque recherche et de choisir attentivement les liaisons conceptuelles que l’on désire établir.