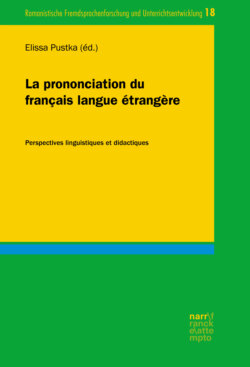Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Le schwa
ОглавлениеConcernant le schwa, les manuels de référence fournissent de longues listes de règles et d’exceptions. Ceux-ci dégagent trois grands facteurs pour expliquer leur (non-)réalisation : (i) la longueur du mot (monosyllabique vs polysyllabique) et, pour les mots polysyllabiques, la position dans le mot (syllabe initiale, interne ou finale), (ii) la position dans le groupe accentuel (début, milieu ou fin) ainsi que (iii) le contexte gauche (après une ou deux consonnes). Le tableau 1 montre que, dans les trois manuels, les mêmes régularités émergent : après une seule consonne, le schwa tombe – sauf dans les clitiques (monosyllabiques) et en syllabe initiale de mots polysyllabiques où il est variable ; en revanche, après deux consonnes, le schwa est réalisé – sauf en syllabe finale devant consonne où il est variable et en finale absolue où il est élidé. Les quelques petites divergences constatées entre ces trois auteurs concernent des exceptions lexicales. À titre d’exemple, Fouché 1959 considère que le schwa peut être prononcé dans un s(e)cret à cause des deux consonnes qui le suivent, et Martinon 1913 note en syllabe interne quelques exceptions comme appart(e)ment qu’il ne considère cependant pas comme correctes. Concernant la position finale devant consonne, tous admettent que la réalisation du schwa après un groupe obstruante-liquide est variable (3) :
(3) quatr(e) [katʁə]/[katʁ̩]/[katʁ̥]/[kat])
Pour ce qui est des autres groupes consonantiques, les avis divergent : en opposition aux deux autres, Fouché 1959 admet que l’élision est ici de règle (4) :
(4) il rest(e) debout [il.ʁɛst.də.bu]
| Début de groupe | Après une consonne | Après deux consonnes | |||||||||
| Clitique | Mot polysyllabique | Clitique | Mot polysyllabique | ||||||||
| Syllabe initiale | Syllabe interne | Syllabe finale | Fin de groupe | Syllabe initiale | Syllabe interne | Syllabe finale | Fin de groupe | ||||
| Manuel | ##C_#C | V#C_#C | V#C_C | VC_C | VC_#C | VC_## | VC#C_#C | V#CC_C | VCC_C | VCC_#C | VCC_## |
| Grammont 1914 | [ə]/∅ | [ə]/∅ | ∅ | ∅ | ∅ | --- | [ə] | [ə] | [ə] | [ə]/∅ | --- |
| Martinon 1913 | [ə]/∅ | [ə]/∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | [ə] | [ə] | [ə](/∅) | [ə]/∅ | ∅ |
| Fouché 1959 | [ə]/∅ | [ə]/∅ | ([ə]/) ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | [ə] | [ə] | [ə] | [ə]/∅ | ∅ |
Tab. 1 :
Le comportement du schwa selon les manuels classiques (encadré en gras : classification remise en cause par la recherche actuelle au profit de [ə]/∅).
Ces dernières décennies, la phonologie de corpus a légèrement modifié mais aussi précisé ces propos. Le point le plus discuté est certainement la réalisation fréquente du schwa en syllabe initiale, voire sa stabilisation dans un nombre important de mots : p. ex. depuis, relation, secrétaire. Dans d’autres mots et groupes figés, en revanche, c’est la variante sans schwa qui s’est (presque) stabilisée : p. ex. d(e)mi, p(e)tit, s(e)maine, s(e)ra ; je ne sais pas [ʃepa], qu’est-c(e) que/qui, tout l(e) temps (cf. Hansen 1994, Pustka 2007).
Des travaux plus récents ont également permis de montrer que les contextes variables sont fortement influencés par des facteurs sociolinguistiques classiques. Ainsi, des études telles que celle d’Hansen 2000 ou encore de Lyche 2016 établissent que le genre et le niveau d’éducation n’influencent pas l’élision du schwa, en revanche l’âge et l’origine géographique jouent un rôle très important. En effet, d’une part, les jeunes locuteurs élident plus fréquemment des schwas variables que leurs ainés et, d’autre part, dans le nord de la France le schwa est plus souvent élidé que dans la Sud de la France (cf. Lyche 2016), mais moins fréquemment qu’au Canada (cf. Côté 2012). Cependant, le facteur explicatif le plus important semble être la présence ou l’absence d’un support graphique. Plusieurs études ont souligné la grande différence entre les tâches de lecture et de parole spontanée : selon Hansen 1994/2000 et Lyche 2016, les francophones réalisent le schwa considérablement plus fréquemment en lecture qu’en parole spontanée. En lecture, entre seulement 0 % et 23 % des schwas sont élidés dans les contextes variables (clitiques et première syllabe de mots polysyllabiques).
Ce bref survol de l’état de l’art sur le schwa en français de référence montre donc qu’un petit nombre de régularités et d’exceptions lexicales se cachent derrière la variation qui peuvent donc facilement être traduites en règles normatives pour la production. En ce qui concerne la perception, en revanche, on ne peut pas nier que la variation régionale constitue un véritable défi. À titre d’exemple, le schwa est bien plus fréquent (mais pas catégorique) dans le Sud de la France (cf. Pustka 2007) et très rare (mais non exclu) au Québec (cf. Côté 2012).