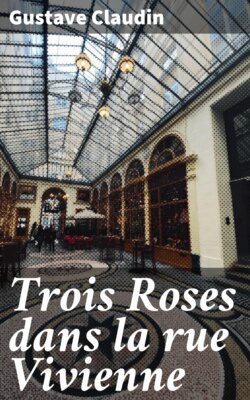Читать книгу Trois Roses dans la rue Vivienne - Gustave Claudin - Страница 3
PRÉFACE
ОглавлениеLes romanciers, aujourd’hui plus que jamais, se divisent en deux classes. Nous avons ceux qui, planent et ceux qui rampent, ceux qui contemplent les étoiles et ceux qui regardent le ruisseau. On réussit beaucoup à présent en regardant le ruisseau, La culture du laid semble remporter sur celle du beau. Cet être collectif qui s’appelle le public a comme une prédilection pour les monstres et une aversion pour les héros.
S’il en est ainsi, c’est parce que certaine écrivains admirablement doués font un déplorable usage de leur talent. Ils disposent de facultés puissantes, et ne s’en servent que pour exalter et mettre au premier plan des turpitudes qu’ils devraient taire ou flétrir.
Que dirait-on de l’Académie des beaux-arts, qui ayant à choisir un sujet de composition pour les jeunes gens qui se disputent le prix de Rome, reproduirait l’histoire, et les convierait à peindre sur leur toile une borne de la rue, salie par les ordures que les balayeurs n’ont pas encore enlevées?
Il y a des esprits baroques qui au tort de méconnaître la vérité ont ajouté celui de ridiculiser le paradoxe lui-même. Ils sont là tout prêts à prouver qu’un artiste peut dépenser autant de talent à peindre ces ordures, qu’à représenter la colère d’Achille ou la clémence d’Auguste. Il serait temps de ne plus tolérer ce défi jeté au bon sens, et de signifier aux comparses qu’en adhérant à cette grossière erreur, ils se proclament plus sots et plus niais que ceux aux dépens desquels ils se proposent de rire.
Malgré les suffrages de ces aveugles et de ces fanfarons de corruption, il ne faut point hésiter à combattre ces tendances funestes qui insultent à tous ceux qui ont eu du génie, et que dans un accès de fureur contre ce qui est beau, auguste et grand, on avait résumé par ce cri: Homère, à Chaillot!
On sait où conduisent ces abominables insanités. Un jour, des forcenés brûlent les bibliothèques, non comme le Calife d’autrefois pour chauffer un bain, car on ne se baigne pas dans ce monde-là, mais par pur vandalisme et pour ramener à des temps préhistoriques.
Mais, me dira-t-on, pourquoi ces lamentations figurent-elles dans la préface d’un ineffensif roman, imaginé par un esprit qui n’a ni la force ni la prétention de faire la leçon à ses semblables, ni l’espérance de modifier les opinions de personne? Elles y ont trouvé place afin de prévenir le lecteur que les personnages mis en scène sont absolument étrangers aux milieux dans lesquels se déroulent les romans à grand succès, écrits par les gens de talent, qui persistent, ainsi que je l’ai dit, à explorer le ruisseau. J’ai essayé, infructueusement sans doute, de rendre intéressants des personnages honnêtes, et de prouver que la vertu, analysée avec impartialité, pouvait, même à un point de vue purement romanesque, et sans tomber dans la berquinade, soutenir la comparaison avec le vice, à la condition toutefois qu’on n’eût pas pour ce dernier des condescendances aveugles.
Depuis le paradis terrestre le vice et la vertu sont en présence. Ils ont tour à tour prévalu; mais, si j’en crois ce que j’ai lu et ce que je vois, le vice avec son fruit défendu a conservé l’avantage. La pauvre vertu méconnue a dû lui céder le pas, et s’effacer humblement devant lui
On a partout pour lui une indulgence qui ne va pas jusqu’à le récompenser, mais qui fait souvent plus que l’absoudre. Les poëtes, les romanciers et les conteurs ont pour lui des prédilections déplorables. Ils l’appellent sans cesse à leur secours pour en parer les héros de leurs rêves. Si par hasard et par un timide remords de conscience, ils veulent réparer leurs torts et leur froideur pour la vertu, ils perdent toute leur verve dès qu’ils la font apparaître, et semblent la traiter comme Cendrillon. C’est ainsi que les choses se passent en littérature, à la grande joie des lecteurs qui préfèrent de beaucoup un personnage chargé de crimes à un héros comblé de toutes les vertus.
Mais, dira-t-on, il n’y a pas que la liltérature. A côté d’elle, notre état social comporte des institutions, oeuvre des moralistes et des sages, et opposant une sorte de contre-poids aux entraînements irréfléchis de l’imagination.
Je le sais bien. Nous avons des institutions que j’ai la prétention de connaître, et c’est précisément en les méditant que j’ai pu apprécier à quel degré la cause de la vertu avait été sinon trahie, tout au moins abandonnée par elles. Qu’on me permette de justifier par un fait indéniable la parfaite exactitude de mon assertion.
Dans notre état social la vertu a sa fête marquée sur le calendrier. Une fois par an l’Académie s’assemble solennellement sous la coupole de l’Institut, pour la célébrer et l’honorer dans sa manifestation la plus pure et la plus éclatante. Les immortels mettent leurs habits à palmes vertes et lisent d’éloquents rapports sur les dévouements héroïques et inconnus qui se sont produits dans les cabanes, les mansardes et les chaumières. On décerne an plus digne et au plus méritant le prix fondé par le vertueux M. de Montyon, c’est-à-dire une médaille d’or de trois mille francs. C’est un spectacle très-touchant que de voir apparaître l’élu. Presque toujours c’est un pauvre vieillard vaincu et courbé par le travail et les années, qui vient, timide et tremblant, remercier son apologiste d’avoir discerné son mérite dans le coin obscur et ignoré où il avait langui pendant si longtemps.
Le nom du couronné est publié par les journaux. Tout le monde le lit et personne ne le retient. L’élu s’en retourne clans sa province, il reçoit les félicitations de ses voisins, puis il rentre dans sa profonde obscurité.
Voilà bien en réalité tout ce que notre société fait pour la vertu. J’ai entendu dire, par des esprits très-droits, que c’était assez. Je le veux bien, mais je me demanderai pourquoi, quand on n’accorde qu’une médaille de trois mille francs à une créature du bon Dieu qui a mérité le paradis, on donne chaque année une somme de cent mille francs au cheval de course qui arrive le premier dans le prix de Paris. J’avoue qu’entre ce superbe animal et l’être vertueux en question, il n’y a pas de comparaison à établir. J’avoue enfin qu’en présence d’une contradiction aussi choquante, aussi inique, je me surprends à couvrir de mon indulgence la fille légère et privée de conseils, qui, interpellée par le vice qui lui donne des diamants tout de suite, et la vertu qui lui promet une médaille de trois mille francs en échange de trente ans de dévouement et d’abnégation, sourit au vice et envoie promener la vertu.
On m’objectera que la vertu est austère, et que les récompenses qu’elle peut nous valoir doivent demeurer austères comme elle. Je serais de cet avis si nous avions les mœurs farouches de la Sparte de Lycurgue, si nous mangions du brouet noir, s’il fallait un tombereau attelé de deux chevaux pour transporter une somme de quarante sous. Mais notre milieu social n’a rien de commun avec ce rigorisme. Je crois donc pouvoir affirmer que rien ne serait perturbé, si à l’avenir on donnait un peu moins au cheval vainqueur dans le prix de Paris, et un peu plus à l’élu du prix Montyon; les chevaux n’en courraient pas moins vite dans l’arène et beaucoup de jeunes filles feraient moins de faux pas dans la vie.
Si je suis dans l’erreur, je serais heureux qu’un contradicteur voulût bien me le prouver. Il me rendrait un service dont je le remercie d’avance.
Le roman, c’est son but devrait donc, partout et toujours, plaider la cause de la vertu, et non pas chanter avec autant de fracas et de bonne humeur les prouesses, les exploits et les gentillesses de ceux qui la trahissent.
C’est pour cela que dans les Trois Roses de la rue Vivienne, j’ai cru devoir protester contre le charme et le prestige qu’on accorde à de fausses idoles qu’il serait temps de renverser de leur piédestal, puisque j’ai reproché à la jeunesse du jour d’avoir perdu toute son originalité, et d’avoir substitué aux élégances spirituelles de nos pères des distractions d’un goût suspect et en réalité peu récréatives. Soyons nous, et n’imitons personne, et persuadons-nous bien de cette vérité que les ridicules que nous croyons éviter sont infiniment moins grands que ceux dans lesquels il est de mode de tomber. Vous êtes de formes opulentes, ô madame! ne cherchez pas à maigrir, et ne vous condamnez pas au plus sévère et au plus dur des régimes pour peser quelques grammes de moins. Et surtout souvenez-vous que si vous avez moins de poids, vous avez plus de rides. Le remède est donc pire que le mal.
En réalité, je ne suis pas un moraliste en colère, et ce que j’ai écrit, loin d’être hostile aux jeunes gens, n’est au contraire qu’un témoignage de sympathie. Pour me résumer, je demande qu’un nouveau comte d’Orsay apparaisse à l’horizon, et vienne se poser parmi nous en arbitre de l’élégance. Il est temps qu’il arrive si Paris veut conserver le privilége de donner le ton au monde civilisé. Venez, prince, sortez du nuage qui nous dérobe votre distinction. Au nom du bon goût, délivrez-nous des ordures qu’on persiste à prendre pour des perles. Délivrez-nous surtout de ces monstres prétentieux qu’on rencontre partout, et que notre mauvais génie semble avoir déchaînés pour gâter nos fêtes, assombrir nos promenades et offenser nos regards. Vite à l’œuvre, ô mon prince, car le mauvais goût l’emporterait si vous tardiez à lui porter ce coup fatal que saint Michel sut trouver pour le démon.
Ainsi soit-il!