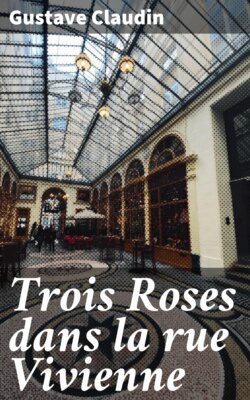Читать книгу Trois Roses dans la rue Vivienne - Gustave Claudin - Страница 6
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеIl y avait un festin fort gai dans un atelier de modistes de la rue Vivienne. Mme Talexis, la patronne, ayant à ses côtés sa première demoiselle de magasin, et entourée de toutes ses apprenties, fêtait le trentième anniversaire de la fondation de sa maison.
Au dessert, Mme Talexis rappelait avec émotion à son auditoire féminin que c’était par son travail qu’elle était arrivée à son éminente position. Elle racontait qu’elle avait débuté par être une simple ouvrière, puis, qu’à force d’assiduité et de courage (elle n’osait point ajouter de talent), elle était parvenue à inspirer confiance à une cliente riche qui lui avait prêté l’argent nécessaire pour acheter le fonds de sa maîtresse et lui succéder.
Mme Talexis participait tout à la fois de la maîtresse de pension et de la matrone. Elle était arrivée à ce nombre de printemps qui ne permet plus d’assigner un âge à la femme. En réalité, elle avait dépassé la cinquantaine; mais, quand elle était habillée, et qu’elle était venue par artifice au secours de tout ce qui lui manquait, elle n’était point disgracieuse. Elle avait été mariée. Son mari avait disparu sans laisser de traces. Elle était bonne pour ses apprenties et pour toutes les personnes de sa maison. Comme modiste, elle faisait école, et, quand une jeune fille sortait de chez elle pour s’établir, la débutante avait bien soin de mettre sur son enseigne: Élève de Mme Talexis. Elle se montrait, indulgente pour celles qui l’entouraient et toujours disposée à attribuer leurs fautes à la fatalité.
Elle était aidée dans la direction de son magasin par sa première demoiselle, qui s’appelait Mlle Scabieuse. C’était son bras droit, sa coadjutrice. Mlle Scabieuse possédait des doigts de fée; elle passait pour la plus habile modiste de tout Paris. Mlle Scabieuse se donnait quarante-cinq ans; laide à ravir, elle avait le nez rouge, un peu de moustache à la lèvre, des faux cheveux abondants, des bagues à tous les doigts, et une tabatière dans laquelle elle puisait sans cesse, le soir, pour se tenir éveillée. Elle avait renoncé à s’établir, imitant ces maîtres clercs de notaire qui s’éternisent dans leur étude et ne veulent point devenir tabellions.
Le festin se prolongeait, et la conversation était fort animée. Les jeunes modistes, un peu excitées par les divers toasts portés en l’honneur de leur maîtresse, bavardaient comme des pies borgnes. Mme Talexis prenait part à leur gaieté, et se contentait de leur dire:
— Riez bien ce soir, petites folles; mais demain, vous travaillerez,
Après un petit moment de silence, la patronne se recueillant, ordonna à ses convives de remplir leur verre et de porter une dernière santé.
— Buvons, dit-elle, à la vénérable dame qui, il y a trente ans, m’a prêté la somme nécessaire pour m’établir et à laquelle je dois l’honnête aisance que je possède.
Cette proposition fut accueillie avec empressement; on but en l’honneur de la bienfaitrice.
En ce moment, le facteur vint à passer, et remit à l’adresse de Mme Talexis une lettre contenant sur l’enveloppe cette mention: Très -pressé.
Mme Talexis ouvrit la lettre et lut ce qui suit:
«Ma bonne madame Talexis,
«J’ai été heureuse autrefois de vous rendre
«service; je viens à mon tour vous en demander
«un: ce serait de vous charger de trois
«jeunes orphelines qui vous seront présentées
«par le maire de ma commune.
«Je vous prie de leur apprendre l’état de modiste,
«de veiller sur elles et de les protéger de
«votre mieux contre les dangers auxquels les
«exposent leur jeunesse et leur beauté. Je me
«charge des frais d’apprentissage.
«J’attends de vous cette bonne action; je vous
«remercie d’avance, et je vous prie de toujours
«compter sur mon amitié.
«CORISANDE D.»
Après avoir lu cette lettre, les yeux de Mme Talexis se remplirent de larmes. Quand elle fut revenue de son émotion, elle dit à celles qui l’entouraient:
— Voici une lettre de ma bienfaitrice, de la personne à la santé de laquelle nous venons de boire. Elle me demande un service; je n’ai rien à lui refuser; je vous annonce, mesdemoiselles, que, demain, vous verrez arriver trois nouvelles apprenties confiées à mes soins.
Les modistes se regardèrent et semblèrent se réjouir de cette nouvelle.
En effet, le lendemain, on vit arriver un brave homme de la campagne, accompagné de trois petites filles; c’était le maire de Jouarre; les trois enfants étaient les filles de la Gritte. L’aînée s’appelait Louise, la seconde Marguerite, et la plus jeune Noémie. Elles avaient été élevées dans une maison religieuse, où elles étaient restées près de quinze ans.
Mme Talexis accueillit cordialement ce digne homme et le chargea de dire à la personne de la part de laquelle il se présentait, qu’elle se chargeait volontiers de ces trois orphelines, et qu’elle était heureuse de trouver ainsi l’occasion de lui prouver sa profonde reconnaissance.
Cela dit, le maire embrassa Louise, Marguerite et Noémie, salua Mme Talexis et se retira.
Aussitôt Mme Talexis pria ses nouvelles apprenties de se rendre avec leurs bagages à la mansarde du sixième étage, qu’elle leur destinait pour chambre. Dès le lendemain, elle les. installa à son comptoir, et, à titre d’essai, les pria d’assembler quelques rubans.
Les pauvres petites, tout effarouchées, tremblaient devant elle. Sans échanger une parole; sans lever la tête un seul instant, elles travaillèrent toute la journée. Le soir, une première modiste vint examiner ce qu’elles avaient fait, et le trouva bien; ce premier encouragement les rassura un peu,
Plusieurs longues journées s’écoulèrent, sans qu’elles osassent adresser la parole aux autres jeunes filles qui travaillaient à la même table. Elles écoutaient leur bavardage sans le comprendre, par la raison qu’il se rapportait à des choses dont elles n’avaient jamais entendu parler.
Mme Talexis, sans qu’on sût pourquoi autour d’elle, s’intéressa beaucoup aux nouvelles venues, bien qu’elles fussent incapables de lui rendre le moindre service.
Elles ne savaient encore rien du métier qu’on se préparait à leur enseigner. Il fallait voir les grands yeux qu’elles ouvrirent, lorsque, pour la première fois, on confia à leurs mains novices les fleurs, les plumes et les rubans avec lesquels les modistes font les chapeaux. La modiste, par état, est condamnée à un cours de coquetterie. Sa mission frivole est d’atténuer la laideur de celles qui ne sont pas jolies, et d’aiguiser les charmes de celles qui sont belles. C’était là, pour elles, des idées qui troublaient leur petite cervelle. Mme Talexis, avec une sollicitude marquée, prenait la peine de leur dégrossir les doigts et de leur déniaiser l’esprit au plus vite.
Dans l’atelier, cette prédilection fut remarquée et excita la jalousie de leurs compagnes, que la patronne traitait bien plus durement; mais leur jalousie devint encore plus grande, lorsque Mme Talexis eut dépouillé Louise, Marguerite et Noémie de leurs habits mal faits, pour y substituer de jolies robes à la mode du jour. Ce fut comme un coup de théâtre, et Mme Talexis, qui était, par profession, blasée sur la grâce et la beauté dont elle avait vu passer tant d’échantillons devant ses yeux, fut émerveillée de la transformation. Il était défendu d’être aussi. ravissantes et aussi gracieuses que l’étaient ces pauvres petites: on eût trouvé plus facilement une hérésie dans le Pater, qu’un défaut dans leur personne.
Louise, l’aînée, était grande; sa taille souple avait des ondulations de roseau. Elle avait la peau blanche, des cheveaux d’ébène qui tombaient jusqu’à terre en boucles soyeuses et brillantes; des yeux bleus languissants et à demi voilés par de longs cils. La rêverie était l’expression dominante de. sa physionomie.
Marguerite, la seconde, avait des cheveux blond-cendré, qui contrastaient avec de beaux yeux noirs, doux comme du velours; Ses joues étaient légèrement colorées, non pas de ces nuances criardes que les coquettes et les comédiennes obtiennent à l’aide de procédés bien connus, mais de cet incarnat que la nature ne donne qu’aux roses et au corail. Ajoutez à cela des dents à rendre les écrins jaloux, des pieds de Cendrillon, un regard hautain et la tournure d’une infante.
Noémie était un type tout différent de ses deux sœurs. Elle avait des cheveux dorés qui brillaient comme un papillon d’or dans un filet; une peau blanche comme la neige et de petites dents taillées pour broyer des millions. Il suffisait de la regarder pour pressentir en elle une de ces petites révoltées qu’il faut laisser nu-tête, tant elles paraissent résolues à jeter leur bonnet par. dessus les moulins. Lorsqu’une cliente du vrai ou du demi-monde ne trouvait point son chapeau assez réussi, Mme Talexis appelait Noémie et le lui plaçait sur la tète. La coquette se sen tait aussitôt désarmée et acceptait le chapeau, oubliant hélas! qu’elle le séparait du petit être charmant qui l’avait égayé de son sourire. Aussi, Mme Talexis avait surnommé Noémie son champignon.
Mme Talexis, sans se rendre compte du sentiment qu’elle éprouvait, était très-préoccupée du sort de ses nouvelles pensionnaires. Il lui semblait qu’elle leur devait un surcroît de sollicitude. Leur beauté merveilleuse l’inquiétait beaucoup. Elle prévoyait l’impossibilité où elle serait de disputer cette proie aux don Juan du jour; car don Juan a laissé sa monnaie parmi nous. Si ces successeurs n’ont point son prestige, ils ne sont pas moins pernicieux pour les victimes qu’atteignent leurs séductions. Elle ne se dissimulait point que, pour conserver intactes les brebis qu’on lui avait confiées, il fallait renforcer les bons principes qu’on pouvait leur avoir inculqués de quelques duègnes sévères et de beaucoup plus de verrous à leur porte. Absorbée par cette préoccupation, il lui échappait quelquefois des paroles comme celles-ci: «Le ciel s’est trompé ; pourquoi n’a-t-il pas donné à des princesses la beauté qu’il a prodiguée à pleines mains à ces pauvres enfants? »
Elle savait, de longue date, que le diable est très-malin, et n’ignorait pas qu’une jeune fille n’a pas toujours la force de préférer l’obscurité et les privations de la vertu aux tentations du vice qui répondent si bien aux vagues aspirations d’un cœur adolescent. Mme Talexis avait passé le temps des orages et appris à ses dépens tout ce qu’il y a d’imposture et d’hypocrisie dans les promesses généreuses que la passion arrache à ceux qui en subissent le joug. Mais elle savait aussi combien il était difficile de faire entendre efficacement ces vérités à des cerveaux de dix-huit ans, encore dépourvus de la sagesse qu’il fallait pour les apprécier. Ces réflexions la troublaient à ce point, qu’elle aurait voulu pouvoir enfermer, le soir, ses trois pensionnaires dans sa caisse, avec son argent. Le monde est ainsi fait. On cadenasse, on met sous clef une somme d’argent, mais on laisse paître les vierges en liberté. Le loup arrive, il les croque, et tout est dit. Le code pénal punit, il est vrai, le rapt; mais qui ne sait que les enlèvements de cette nature sont toujours consommés dans des conditions qui les soustraient à l’application de la loi?
En femme d’expérience, Mme Talexis pensa qu’elle devait observer le caractère de ses nouvelles pensionnaires et voir si ces pauvres petites, auxquelles la nature semblait avoir tendu un piège en les créant si belles, ne portaient point en elles une chance quelconque de salut. Elle résolut donc de les abandonner à elles-mêmes, de ne les contredire en rien, de chercher à discerner enfin, si cela était possible, dans leur langage et dans leurs actions, l’indice de leur tempérament et de leurs aspirations. Elle voulut suivre, dans toutes ses phases, la transformation que la vie parisienne allait leur faire subir, comment peu à peu ces petites paysannes incultes se pervertiraient, et comment, enfin, l’esprit allait leur venir. De cette façon, elle serait là, vigilante et toujours debout, prête à repousser le diable s’il devenait trop entreprenant.
Louise ne lui causait pas d’inquiétudes. Elle avait remarqué que c’était une nature grave, repliée sur elle-même, très-soucieuse, qui plus est, d’accomplir ses devoirs religieux. Louise allait à la messe, disait matin et soir de longues prières et ne prenait jamais part aux conversations frivoles. En sa qualité d’aînée, elle prétendait même exercer une sorte de domination sur ses deux sœurs. Avec les clientes, elle était d’une politesse glaciale. Il fallait qu’elle se contînt pour ne point hausser les épaules devant les baronnes et les marquises, lorsqu’elles se miraient dans la glace pour essayer leurs chapeaux. Elle ne s’était montrée aimable et gracieuse qu’une seule fois, envers une religieuse entrée dans le magasin avec une petite pensionnaire. A moins de changement subit ou d’apparition fatale d’un prince Charmant, venu de régions inconnues, il n’y avait donc rien à redouter de celle-là.
Marguerite était aussi très-réservée, mais très-coquette, éprise de toilettes et de parures, laissant deviner qu’elle regrettait de voir destinés à d’autres les colifichets élégants qui sortaient de ses mains. Elle recevait assez froidement les bourgeoises et les bonnes mères de famille, mais quand apparaissait une grande dame, descendant de son carrosse et précédée d’un valet de pied, alors elle devenait radieuse et daignait sourire. Il n’était sortes d’attentions, de prévenances et de flatteries qu’elle ne prodiguât à la nouvelle venue. Elle fraternisait avec elle et semblait dire qu’elle était aussi de ce monde-là. Mme Talexis l’avait surnommée la belle incomprise. Marguerite, loin de la contredire, était enchantée de cette raillerie. Quand on lui prédisait qu’un jour elle serait marquise et que ses camarades broderaient ses armoiries sur des mouchoirs, elle acceptait la prédiction et faisait des vœux pour qu’elle se réalisât. Elle aimait la musique et par-dessus tout la musique d’opéra.
Sa sœur Noémie n’avait pas les mêmes goûts. C’était un diable, un démon en révolte perpétuelle contre Louise. Celle-là aimait tout, les drames de l’Ambigu et la musique de l’Opéra, les opérettes et les chansons de Thérésa. Pendant le jour, alors qu’on ne l’observait pas, elle laissait son ouvrage pour lire les journaux. Elle connaissait le nom de toutes les comédiennes, le titre des pièces et les cancans des coulisses. Elle était au courant des plaisirs d’été et d’hiver imaginés à Paris pour distraire les fainéants. Elle parlait à tort et à travers, critiquant ceci, approuvant cela, bien qu’elle ne sût absolument rien. Elle était heureuse de vivre, de bavarder et de rire; c’était un petit démon, dans toute l’exubérance de la jeunesse et de la santé, qui se moquait à tout propos de la gravité de Louise et de la fierté de Marguerite.
Mme Talexis était effrayée de ses malices et de ses curiosités. Elle redoutait tout de sa nature bouillante, et peut-être bien parce qu’elle la pressentait vouée à la chute, c’était celle-là, des trois, qu’elle préférait. Elle aimait à l’entendre déraisonner et bâtir des châteaux en Espagne; car Noémie ne doutait de rien et paraissait convaincue qu’une brillante destinée l’attendait.
La beauté de ces trois jeunes filles fut bientôt connue dans tout le quartier. Les passants s’arrêtaient devant le magasin pour les regarder. Jamais, dans sa plus grande vogue, la belle limonadière du café du Bosquet n’attira autant d’admirateurs. Il y avait toujours un groupe de curieux devant la maison. Ils feignaient, pour cacher leur dessein, de regarder les chapeaux et les rubans. Paris est la ville des badauds. Il suffit d’un rien pour décider les passants qui circulent par centaines dans ses rues, à se grouper et à fixer les yeux sur le même point. Le premier s’arrête, le second imite le premier, puis les autres, avec la discipline des moutons de Panurge, font absolument la même chose. Cette fois, du moins, il y avait un motif pour qu’il en fût ainsi. Les flâneurs, le nez collé sur les vitres, couvaient du regard l’atelier de la modiste, et les suppositions malveillantes allaient leur train. Les vieillards paraissaient aussi agités que les jeunes gens à la vue de ces têtes délicieuses, qui bientôt furent connues sous le nom «des trois roses de la rue Vivienne.»
Ces importunités irritèrent Mme Talexis, qui fit cette réflexion, que si on regardait énormément ses ouvrières, on n’achetait néanmoins pas plus de chapeaux. Elle craignit même que cet attroupement continuel n’éloignât ses clientes et ne diminuât le produit de ce que, dans le commerce et l’industrie de Paris, on nomme le pas de porte. Elle prit un parti héroïque: derrière les chapeaux et les coiffures exposés dans la montre, elle fit établir des petits rideaux d’un taffetas blanc impénétrable. De cette façon, elle mit ses ouvrières à l’abri de ces mille regards tous entachés de ce gros péché que saint Paul appelle la concupiscence des yeux. Les modistes lui surent gré de cette précaution, qui leur épargnait l’investigation brutale et malséante d’une infinité de monstres et de butors qui semblaient vouloir se brûler à la lueur de leurs yeux, comme des insectes à la flamme d’une chandelle.
Malheureusement, la réputation de beauté des jeunes modistes était si solidement établie, que l’application des petits rideaux ne découragea point les passants. Ils restaient là, groupés, et attendant qu’on écartât le voile pour prendre ou placer un objet dans la montre. Alors, pour disperser ces importuns, on avait recours à toute espèce de ruses. Tantôt un garçon de magasin dressait une échelle pour nettoyer les glaces et les cuivres de la devanture; ou bien il arrivait avec de l’eau pour laver le trottoir et donner un peu de fraîcheur. Mme Talexis appelait cela la première sommation.
Il arrivait quelquefois que d’aimables flâneurs, tout infatués d’eux-mêmes et se croyant irrésistibles, entraient dans le magasin pour faire une acquisition. Ils ne se décidaient à rien, et, pour prolonger l’entretien, hésitaient entre un chapeau rose et un chapeau bleu. Mais ce procédé ne leur valait aucun profit, car à peine avaient-ils trahi leur indécision, que Mme Talexis intervenait avec son autorité de matrone, renvoyant son ouvrière et faisant poliment comprendre aux importuns d’avoir à prendre un parti, d’acheter tout de suite, ou de continuer leur promenade. On aurait difficilement trouvé un cerbère plus maussade et une duègne plus décourageante que Mme Talexis, quand il s’agissait d’éconduire un coureur d’aventures; elle le harcelait de monosyllabes qui mettaient fin à tout dialogue, et le malheureux, pris au piège, battait en retraite, gauchement, sous les regards moqueurs de l’atelier.
Sous aucun prétexte, Mme Talexis n’eût envoyé Noémie en course. Pour les deux autres, elle y voyait moins d’inconvénient. Louise était glaciale, Marguerite fière et dédaigneuse à ce point, qu’elle croyait déroger quand elle parlait à un inconnu.
Pour les distraire, elle les conduisait au spectacle le dimanche; mais il aurait fallu apporter le rideau de taffetas blanc de la devanture, pour le dresser devant la loge, par la raison qu’à chaque entr’acte, toutes les lorgnettes étaient braquées sur les trois jeunes filles. Les coureurs d’aventures, voyant des femmes seules, devenaient plus hardis; on les voyait rôder aux alentours comme des âmes en peine.
L’un affectait un air sentimental, et soupirait à fendre l’âme; un autre prenait des attitudes triomphantes, persuadé qu’on allait le trouver irrésistible.
Mme Talexis était là pour déjouer toutes ces simagrées. Elle n’avait pas de peine à démontrer à ses modistes que ces messieurs étaient autant de farceurs qui, chaque soir, où qu’ils fussent, jouaient la même comédie et simulaient la même passion.
Elle s’acquittait à merveille de ce rôle de chien de berger; elle observait tout, voyait tout, prévoyait tout. Un soir, un jeune homme, qui paraissait étranger, fit remettre à Marguerite un énorme bouquet contenant sa carte. Il lui demandait un rendez-vous. Mme Talexis prit le tout, et alla le porter à l’officier de police de service. Le noble étranger se tint tranquille et borna sa vengeance à foudroyer de son regard la duègne qui troublait ses bonnes fortunes à venir.
Quand cette patronne modèle avait des commandes qui, par leur importance, la forçaient à exiger de ses ouvrières un surcroît de travail, elle les récompensait de leur peine. Un certain dimanche de juin, on ne put terminer que vers cinq heures du soir des parures destinées à un mariage. Mme Talexis, trouvant qu’il était trop tard pour conduire ces demoiselles à la campagne, fit apprêter un petit dîner fort délicat, et, en attendant, les emmena respirer un peu place de la Bourse.
C’était là une bien médiocre distraction, car on ne se doute pas de ce qu’est par un dimanche d’été la place de la Bourse, alors que tout le monde est parti pour la campagne. Ce coin si actif et si remuant de. Paris est désert et silencieux comme le jardin des Capulets. Les boutiques et les magasins sont fermés; le monument grec, lui-même, est abandonné ; on se demande ce qu’il fait au milieu de cette solitude. Ce temple païen, dont, pendant la semaine, les portiques et les galeries extérieures sont animés par une foule fiévreuse, ahurie, que le démon des affaires semble emporter, prend une physionomie triste et ridicule. Le concierge qui le garde profite de cet instant pour exposer sur une des marches les quelques pots de fleurs qu’il cultive et pour les arroser. Il procède d’ordinaire à cette opération dans le négligé le plus galant. Il est en manches de chemise, coiffé d’une calotte de velours et chaussé de pantoufles en tapisserie; on voit cela d’ici. On se demande comment il se peut qu’un temple que n’aurait point dédaigné le maître des dieux, en soit arrivé, à cette heure désolée, à tomber au pouvoir d’un être prosaïque et burlesque, qui méconnaît sa grandeur, insulte à ses proportions, et se comporte comme s’il se trouvait dans une échoppe de savetier.
L’ensemble de la place n’est pas moins triste à voir. A la porte de chaque maison se tiennent les malheureuses concierges, qui, retenues à leur poste, en sont réduites, pour prendre l’air, à s’exposer à la réverbération chaude de l’asphalte. On croit entendre chacune d’elles s’écrier comme Phèdre:
Que ne suis-je assise à l’ombre des forêts!
Les quelques arbres plantés autour du monument paraissaient rabougris et fanés; les grilles qui les entourent semblent en faire les prisonniers de la végétation. On devine que toutes ces maisons tatouées à l’extérieur d’enseignes de toutes dimensions et de toutes couleurs sont abandonnées, et on se refuse à admettre que la vie reprendra le lendemain dans ces parages absolument morts.
Il fallut, pour ce jour-là, se contenter de cette monotone promenade, qui ne charma point du tout ces pauvres petites demoiselles. Combien mieux auraient-elles aimé entendre chanter les fauvettes, cueillir des bluets dans les blés, attraper des papillons et courir dans la prairie! Pour les consoler de leur désappointement, on leur promit de les conduire, le dimanche suivant, à Ville - d’Avray, dîner près des étangs. La partie eut lieu. On dîna dans un jardin, au milieu d’un bosquet converti en salle à manger, et en face de cette mare d’eau décorée du nom d’étang, que Corot a reproduite trois cents fois sur ses petites toiles.
Le dîner fut très-gai, mais tout se gâta vers le dessert. Mme Talexis se fâcha sérieusement contre Noémie, qui ne se montrait point assez courroucée des regards que fixaient trop longtemps sur elle de jeunes étourdis. Louise se joignit à sa patronne pour accabler la pauvre petite de ses reproches et lui prédire qu’elle finirait mal si elle se prêtait à de telles inconvenances. Noémie fit la moue comme Esméralda, et ne dit plus un mot.