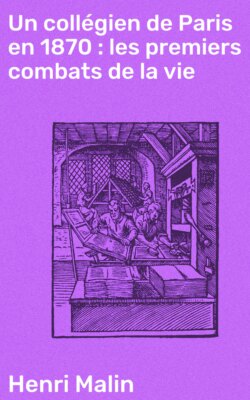Читать книгу Un collégien de Paris en 1870 : les premiers combats de la vie - Henri Malin - Страница 10
ОглавлениеUN RENDEZ-VOUS SUR LE CHAMP DE BATAILLE
J’éprouvai pourtant un vif plaisir à revoir Paris et notre intérieur. Le brave Aschuler nous reçut sur le seuil; ses traits me parurent ravinés par le chagrin que lui causait la mort de son fils. Les yeux agrandis, le regard sombre, il se concentrait dans sa douleur.
Il embrassa Annette avec une effusion paternelle qu’il ne lui avait pas témoignée jusqu’alors; une seule larme coula dans le sillon de ses joues et il dit:
«Ma pauvre enfant! quel malheur!»
Celle-ci s’abattit dans ses bras, en sanglotant, suffoquee par une crise nerveuse.
Alors, intentionnellement peut-être, Aschuler la tutoya pour la première fois, comme pour lui faire comprendre que la communauté de leur infortune rapprochait leurs deux cœurs endoloris.
«Tu l’aimais donc bien!» fit-il.
Et cette familiarité d’une délicatesse naïve remuait l’âme de la malheureuse fiancée.
Harassés par une journée d’émotions, nous ne prîmes qu’un léger repas et nous nous couchâmes de bonne heure, mes parents et moi. Mais Annette s’enferme dans la cuisine avec Aschuler.
La.porte de ma chambre était vitrée et elle donnait en face de la cuisine, si bien que, de mon lit, j’apercevais la lumière de la lampe et que j’entendais quelques mots de leur conversation.
Je m’assoupis tout de suite; mais je dormis mal. Je me réveillai vers une heure; Aschuler et Annette s’entretenaient encore. Il racontait l’enfance de son fils, combien il était intelligent, et comme il trottait gentiment quand il allait à l’école avec son petit béret sur la tête et sa gibecière sur le dos! Et Annette demandait: «Est-ce qu’il était grand? Est-ce qu’il portait les cheveux longs?»
Vers trois heures, je me réveillai de nouveau; ils étaient toujours là. Sans doute l’Alsacien avait retrouvé des effets dans un sac de voyage que je lui avais vu, car il disait:
«Tiens, voilà des mouchoirs à lui, je te les donne; et puis un vieux porte-monnaie, et puis des livres, je te donne tout, mon enfant. Ah! il aurait été bon pour toi; il t’aurait bien aimée, ma pauvre fille!»
Et, jusqu’au jour, ils parlèrent ainsi du défunt, remuant des souvenirs, le faisant revivre entre eux deux, rappelant les projets inutilement rêvés et le bonheur qui les attendait, s’il eût vécu.
Quand je me levai, je vis sortir de la cuisine Annette, les yeux gros de larmes, et Aschuler, dont la voix émue tremblait un peu.
Et comme ma mère et mon père, à qui je contais la chose, les grondaient, leur conseillaient de se reposer, ils répondirent qu’ils ne se sentaient pas fatigués et que cette longue causerie, quoique triste, leur avait fait du bien.
Par la suite, tous les deux cherchèrent les occasions de parler de l’absent. A tout propos, Aschuler, en s’adressant à Annette, commençait sa phrase en disant: «Quand Charles il venait me voir...» ou: «Si Charles il était là...», si bien que nous songions sans cesse au brave garçon, autant que s’il eût été au milieu de nous.
Le lendemain de notre retour, à la première heure, c’était le 17 septembre, Jules Faget vint me voir.
Nous causâmes de l’association des Pupilles.
«C’est très sérieux, m’affirma-t-il, et on est libre de se faire tuer là aussi bien qu’ailleurs. En conséquence j’adhère, j’adhère même fortement. Les Prussiens viennent nous voir, je veux leur présenter mes hommages.»
J’entretins immédiatement mes parents de mon projet.
Ma mère refusa d’abord; puis, sur les instances de mon père, elle finit par consentir.
Je crois qu’il la rassura en lui disant que cette association n’était qu’un jeu d’enfants, sans dangers réels, et que le meilleur moyen d’empêcher un coup de tête de ma part serait de laisser mon activité se dépenser de cette façon.
J’embrassai ma mère pour la remercier, et, comme les «Pupilles parisiens» avaient leur première réunion dans la journée, je dis à Jules que je m’y rendrais avec lui.
Il vint me chercher après le déjeuner et nous partîmes.
Paris présentait alors un aspect curieux. Au centre de la ville, sur les boulevards et sur les places où nous passions, dans les jardins publics, partout où un peu d’espace permettait un déploiement d’hommes, des soldats et des gardes nationaux faisaient l’exercice. Les commandements brefs des officiers instructeurs se croisaient dans l’air, du matin au soir, avec des appels de clairon.
Et, malgré soi, on se sentait un peu troublé, en songeant que beaucoup de ces braves gens ne savaient pas encore manier un fusil et que, le lendemain peut-être, ils auraient à tenir tête à une armée solide et bien aguerrie.
Ailleurs, on s’occupait des vivres; dans tous les locaux vides, même dans les monuments, on entassait la farine, le blé, les conserves de viande et les caisses de comestibles.
Le Luxembourg et le bois de Boulogne, transformés en colossales bergeries, regorgeaient de bestiaux. Aurais-je jamais pu croire que là où j’avais joué tout petit, au milieu de ces arbres qui ont vu courir autour d’eux tant d’enfants rieurs, un jour, j’entendrais les moutons bêler et les bœufs mugir? Ah! les pauvres bêtes douces et tristes, à l’œil inquiet, comme elles semblaient regretter les vertes prairies lointaines!
Après une promenade sommaire, Jules m’emmena rue Soufflot, au premier étage d’un café dont la salle avait été mise à la disposition des Pupilles.
Ils étaient là, une quarantaine environ, déjà en séance.
Nous nous asseyons côte à côte; et, tout de suite, je constate que cette assemblée délibérante n’est pas mal organisée; elle donne l’illusion d’un parlement en miniature.
Il faut voir avec quelle assurance le président provisoire rappelle à l’ordre les interrupteurs, et comme il agite sa sonnette pour obtenir le silence!
Les «orateurs inscrits» montent à la tribune avec une solennité un peu comique, l’air ravi. Quelques-uns esquissent avant de parler un sourire discret, comme s’ils n’osaient pas encore se prendre au sérieux; d’autres, au contraire, se figurent que «c’est arrivé », et montrent la gravité d’un sénateur.
Leurs discours signifient qu’il n’y a pas d’âge pour les braves, et que, lorsque la patrie est en péril, les jeunes doivent contribuer aussi bien que leurs aînés à l’effort commun de la défense.
Ces préliminaires terminés, on aborde les statuts dont les articles sont votés; on nomme un comité exécutif, sorte de ministère, et l’association des Pupilles parisiens est fondée.
Mais il reste le président définitif à élire, quelqu’un propose de réserver ces importantes fonctions à celui des membres qui, le premier, accomplira une action d’éclat sur un champ de bataille.
Cette motion qui soulève l’enthousiasme est acceptée, et l’on passe aux inscriptions.
Nous choisissons, Jules et moi, la section des ambulances, afin de nous rapprocher le plus possible des postes périlleux. Mais, pendant que nous signons, à l’autre bout de la salle deux individus me dévisagent, chuchotent, haussent les épaules, me provoquent du regard, me soufflettent, en quelque sorte, d’un sourire ironique et dédaigneux.
Qu’est-ce que cela signifie?
Hélas, je les reconnais bien vite; ce sont des camarades du collège. Ils se souviennent du jour où, de moi-même, j’ai juré de prendre un fusil et de courir à la frontière en compagnie de Dorval, de Verriez et de Loubin. Seul je n’ai pas tenu cette solennelle parole. Et ils vont peut-être m’accoster, me faire honte en public! N’ont-ils pas promis tous de mettre en affront celui de nous quatre qui faillirait à son serment, à quelque endroit qu’ils le rencontreront?
«Dieu m’est témoin, me dis-je intérieurement, que ce n’est pas de ma faute!»
Pourtant, je rougis; je ne sais comment me soustraire à leurs yeux mauvais, tandis qu’au fond la rage m’exaspère.
Mais que font-ils? ils s’approchent de la tribune; l’un deux, Besnard, réclame la parole, monte sur l’estrade et prononce:
«Messieurs, permettez-moi de vous demander si vous croyez pouvoir accepter au milieu de vous quelqu’ un qui, après avoir juré publiquement de s’engager, a manqué à son serment?
— Non! non!» crie-t-on de toute part.
Alors Besnard raconte la scène du collège; puis il reprend:
«Eh bien, il y en a un, parmi les quatre, qui a été en villégiature au bord de la mer, tandis que ses trois camarades se battaient comme de vieux soldats, étaient emmenés prisonniers en Allemagne, s’évadaient au péril de leurs jours, et rentraient en France où ils demandaient à s’engager dans les francs-tireurs! Et celui qui s’est dérobé de cette façon ose se présenter ici!»
Des voix s’élèvent aussitôt:
«Il n’en faut pas! à la porte le lâche! nommez-le! nommez-le!»
Et Besnard ajoute:
«Je lui laisse la pudeur de se retirer ou le courage de se nommer.»
A ces mots, une fureur désespérée m’empoigne; je saute à la tribune en m’écriant:
«Ce courage, je l’aurai! C’est de moi qu’il s’agit! Je m’appelle Fernand Gridennes!
Aussitôt une huée formidable couvre ma voix:
«A la porte! pas de capons parmi nous! qu’il s’en aille!... enlevez-le!»
Jules pâlit... pour moi, murmurant: «Comment va-t-il se tirer de là ?»
Il m’est impossible de placer un mot de plus. Alors le président agite sa sonnette et dit:
«Messieurs, tout accusé a le droit de se défendre. Je vous prie de faire silence et d’écouter les explications que va vous donner M. Gridennes.»
Lorsqu’on s’est tu un peu, je raconte ce qui s’est passe chez moi: les entretiens que j’ai eus avec mon père; le refus de ma mère, et son attaque dont j’ai été la cause par mon insistance; puis l’accident du Crotoy, où je faillis périr moi-même en la sauvant.
«Vous le voyez, messieurs, ajoutai-je, j’ai tout essayé. Quand j’ai connu votre projet d’association, j’en ai parlé à mes parents. Ils ont consenti à ce que j’en sois, parce qu’ils se figurent que cette association ne sera qu’un amusement. Mais, pour ma part, je compte m’y conduire en homme et en brave. Je viens donc vous réclamer un poste de péril; je viens tenir mon serment parmi vous. Vous ne pouvez pas douter de mon courage, sans l’éprouver. Je vous apporte mon sang et ma vie que je n’ai pu mettre à la disposition des autres; vous n’avez pas le droit de les refuser, puisque c’est à la France que je les offre.»
Ces paroles produisirent un certain effet; l’assistance commença à me montrer quelque faveur.
«Vous parlez comme défunt Napoléon le Grand», me glisse Jules.
Alors, m’adressant à Besnard, je lui dis:
«Quant à vous, monsieur, qui me faites cet affront, et qui, sans vous renseigner, m’avez appelé lâche, je vous somme de montrer votre bravoure; et pour cela, je vous donne rendez-vous, au premier coup de canon, sur le champ de bataille, pour ramasser les blessés sous la fusillade.
— Ça c’est tapé ! me dit Jules en venant me serrer la main. Je ne l’aurais pas trouvé, moi!»
Cette fois, des applaudissements retentissent; tout le monde crie: «Bravo! très bien!» et chacun demande à Besnard:
«Est-ce convenu? Acceptez-vous?»
Besnard, pâle et interdit, étonné surtout de ce revirement, finit par dire:
«Oui... naturellement.... J’accepte!»
Je me gardai bien de raconter cet incident chez moi. Le soir même, lorsque mes parents me questionnèrent sur l’association, j’achevai de les rassurer en leur disant:
«Je crains que les Pupilles parisiens fassent plus de bruit que de besogne.»