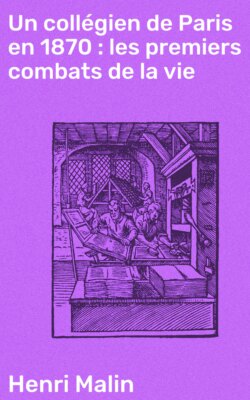Читать книгу Un collégien de Paris en 1870 : les premiers combats de la vie - Henri Malin - Страница 9
ОглавлениеVOYAGE ACCIDENTÉ
On était alors au 15 septembre; l’ennemi ne se trouvait plus qu’à quelques lieues de Paris; avant quatre ou cinq jours, il assiégerait la capitale; il ne serait plus possible d’entrer ni de sortir.
Mon père fut d’avis que ma mère demeurât au Crotoy avec Henriette. Du moins il le disait, mais je devinais bien qu’au fond il lui aurait été pénible de se séparer d’elle dans un pareil moment.
Ma mère aussitôt se récria; mon père lui dit:
«Mon devoir, tu le penses bien, est de rester à Paris.
— Et le mien, répliqua ma mère, de ne pas te quitter.»
Et comme elle ne voulait pas non plus s’éloigner de nous, elle poursuivit, énergique:
«Là où tu seras, je serai avec mes enfants!»
Il fut donc convenu que nous nous en retournerions immédiatement.
Le lendemain matin, l’express nous emportait à toute vitesse.
Nous allâmes d’une seule traite d’Abbeville à Amiens. Là, le train s’arrêta cinq minutes; et nous. rencontrâmes des voyageurs qui arrivaient de Paris.
Alors, vite chacun descendit de son wagon et interrogea avidement les nouveaux venus, qui furent entourés, pris d’assaut.
La plupart de ces derniers donnaient des renseignements très vagues; mais d’autres, désirant paraître bien informés, se montraient affirmatifs ou grossissaient les faits.
«Ils sont à tel endroit, disaient-ils.
— On s’est battu à tel autre.
— Ils tirent sur les voyageurs.
— La voie est coupée.
— Tous les ponts ont sauté.»
Ce qui tourmenta vivement mon père, ce fut l’insistance que mirent quelques-uns à prétendre qu’on n’entrerait plus dans Paris et que nous ne dépasserions point Creil ou Chantilly. Il avait à Paris, ou Aschuler nous attendait, ses capitaux et de gros intérêts; ou irions-nous munis d’une somme insuffisante? Et puis, déjà inscrit sur les contrôles de la garde nationale, mon père tenait à être présent, à ne pas avoir l’air de déserter.
Il s’informa auprès de tout le monde; le chef de gare, lui-même, ne répondait de rien. Néanmoins le signal du départ fut donné ; et personne ne put dire exactement où nous allions.
En temps ordinaire, le train aurait filé directement sur Paris; mais le service était désorganisé. Des mouvements de troupes se produisaient sur la ligne, et l’on nous garait de longs quarts d’heure, pour laisser la place à des régiments qui se dirigeaient vers la capitale, enfermés dans des wagons à bestiaux, où les soldats chantaient à tue-tête.
Des heures s’écoulèrent ainsi; à partir de Clermont, la marche du train devint absolument insupportable; il stationnait presque à chaque gare, parfois même en plein champ; on disait les Prussiens à quelques kilomètres seulement; le mécanicien craignait une surprise: un pont détruit par eux, la voie coupée, les rails enlevés; pour éviter un accident, il fallait avancer avec une extrême prudence et attendre les ordres.
Parfois, dans un arrêt trop long, au milieu de la campagne, des gens descendaient sur la voie et disaient:
«Ça y est, nous n’irons pas plus loin!»
Un coup de sifflet retentissait; les employés criaient: «En voiture!» — Alors chacun remontait à la hâte et l’on repartait.
Le train avait trois grandes heures de retard. En approchant de Creil, les précautions redoublèrent; des paysans prétendaient avoir vu des Prussiens dans les bois. Une anxiété profonde envahissait les voyageurs; nous pénétrions dans la zone dangereuse. Néanmoins nous allions quand même.
A ce moment, le soleil se couchait à notre droite dans un ciel doré ; une douce fraîcheur nous apportait le parfum des mousses et des feuilles mortes. Les oiseaux se disputaient des gîtes sous les branches et leurs pépiements querelleurs emplissaient les frondaisons rougeoyantes des arbres. On entendait dans la campagne le roulement des voitures de ferme qui passaient lentement sur les routes. Comme il eût été bon de se promener dans cette paix sereine du soir tombant!
Tout à coup une rumeur courut d’un bout du train à l’autre, des têtes apparurent aux vasistas et des voix hélèrent:
«Les voilà ! les voilà !»
Nous nous étions levés pour mieux voir.
Alors j’aperçus, sortant des bois, un soldat habillé en drap sombre, coiffé d’un casque à pointe; puis un second, puis un troisième; une vingtaine se présentèrent ainsi, le fusil sur le bras, le doigt sur la gâchette, prêts à faire feu à la moindre alerte, comme un chasseur à l’affût.
IV
LA DÉTONATION RETENTIT (P. 57)
C’étaient des éclaireurs sans doute.
Subitement l’un d’eux visa le train; la détonation retentit et une balle frappa les parois du compartiment voisin; puis d’autres coups partirent.
Le train redoubla de vitesse, parut fuir, ainsi qu’une bête traquée, en sifflant éperdument, à travers les bois et les villages.
Nous arrivâmes à Creil; on nous annonça que la ligne était coupée du côté de Chantilly et qu’on tenterait de gagner Paris par Pontoise.
Nous atteignîmes bientôt cette ville. La brume tombait lentement sur la campagne; les coteaux et les bois s’estompaient, se fondaient dans une teinte grise qui s’accentuait.
A Pontoise, le train stoppa une minute à peine, car l’autorité militaire attendait que nous fussions passés pour faire sauter les ponts derrière nous.
Nous repartîmes; en traversant l’Oise, je vis de la troupe qui gardait les quais à distance, pour empêcher la circulation.
A quelques centaines de mètres du fleuve, la voie tourne; je me mis à la portière et je fixai les yeux sur le pont que je distinguais encore. Tout à coup, une gerbe de pavés et de cailloux jaillit très haut dans un nuage de poussière, et une formidable explosion se répercuta longuement dans la vallée. Les wagons furent ébranlés, les vitres vibrèrent et ce fut tout.
Le dernier train, à l’abri des surprises maintenant, courait vers Paris.
La nuit venait; le paysage disparaissait dans l’ombre croissante; là-bas, sur ma gauche, une grande lueur rouge rayait l’horizon.
«Qu’est-ce que c’est que cela? demandai-je à mon père; on dirait une aurore boréale.
— Non, me répondit-il: ce sont des bois qu’on essaye d’incendier pour que les Prussiens ne puissent s’y cacher.»
Bientôt, il y en eut d’autres sur ma droite; elles formaient dans le ciel des taches d’un rouge grisâtre, où l’on devinait une fumée épaisse.
Et ces détonations sourdes qui éclataient par moments, ces incendies de plusieurs hectares, ces coups de sifflets prolongés que notre train jetait dans la nuit comme un appel apeuré, tout cela avait quelque chose de sinistre qui me serrait le cœur.
Paris qui, le mois d’avant, était encore la grande ville ouverte à tous, un des rendez-vous les plus attrayants du monde entier, Paris brûlait ses forêts, coupait ses routes, détruisait ses ponts, s’isolait enfin du reste de la terre. Et c’était à Paris que nous allions.
Enfin, nous franchîmes les remparts; et tout de suite j’eus l’impression qu’une lourde porte de bronze se refermait sur nous.
Ceux qui entraient dans cette fournaise ne pouvaient, en effet, prévoir ce qu’ils deviendraient au milieu des événements terribles qui allaient s’accomplir.