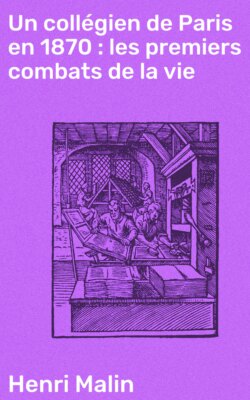Читать книгу Un collégien de Paris en 1870 : les premiers combats de la vie - Henri Malin - Страница 8
ОглавлениеANGOISSES DIVERSES
Le lendemain, ma mère se sentait mieux; mais elle avait une grande lassitude; et, par instants, elle poussait de gros soupirs, comme un enfant qui a longuement pleuré.
Mon père m’annonça qu’il allait nous conduire au Crotoy pour quelques semaines.
Sur un geste de déception qui m’échappa à cette nouvelle, il ajouta:
«Surtout ne parle pas d’engagement; il faut d’abord que ta mère se remette. La guerre ne fait que commencer; à votre retour il sera temps encore de te produire; à ce moment-là tu agiras si tu veux. Je trouverai moyen, sans que ta mère en souffre trop, de donner satisfaction à tes sentiments patriotiques, qui t’honorent et que je respecte. Et tu feras ton devoir, comme les autres.
— Vous me le promettez? interrompis-je.
— Je te le promets, mais à une condition.
— Dites, mon père!
— Tu vas être seul avec ta mère là-bas; je te la confie. Tu vois combien elle est nerveuse; le médecin m’a averti que présentement un coup de tête de toi peut la rendre très malade, lui être fatal, même. Tu tiens en quelque sorte sa santé entre tes mains, je dirais presque sa vie. Évite donc tout ce qui lui causerait de la peine ou de la contrariété. Par conséquent, aucune allusion à ton désir de t’engager; aie l’air d’avoir renoncé à ce projet, pour qu’elle soit tranquille. Quand tu reviendras, elle sera plus forte; nous recauserons de cela; et, je te le répète, je m’arrangerai pour que tes intentions se réalisent et que, si jamais tu rencontres tes camarades, tu n’aies pas à rougir devant eux.
J’aimais trop ma mère pour ne pas consentir à ce délai, puisqu’il y allait de son existence.
Je sautai au cou de mon père pour le remercier et je lui dis:
«C’est entendu, comptez sur moi....»
Quarante-huit heures plus tard, nous étions au Crotoy.
Mon père nous installa dans un chalet; puis il revint à Paris, où des intérêts urgents l’obligeaient à rester avec Aschuler.
Et nous passâmes là six longues semaines durant lesquelles j’éprouvais d’inexprimables angoisses en me voyant condamné, devant la marche envahissante de l’ennemi, à une inaction qui me rendait honteux et me mettait la rage dans le sang.
Chaque matin, avec l’entêtement de l’espoir, je courais aux nouvelles chez le libraire et à la mairie où l’on affichait quotidiennement les dépêches. J’en revenais le plus souvent le cœur brisé par l’annonce d’une défaite et la douloureuse constatation que les Prussiens s’avançaient vers Paris, méthodiquement, comme une tache maudite qui s’étend toujours.
Mais dans ces luttes acharnées, nous ne succombions que devant la supériorité du nombre; et des prodiges de vaillance furent accomplis par nos troupes, formées la plupart du temps avec précipitation, et inaccoutumées au dur métier de la guerre.
Annette, très inquiète, suivait les péripéties du régiment de Charles, le 9e cuirassiers. Un jour elle apprit qu’à la bataille de Reichshoffen, ce régiment avait été détruit dans la charge héroïque qu’il exécuta par trois fois à travers les masses ennemies.
La pauvre fille s’affala sur une chaise, hébétée de douleur, gémissant: «Il est mort! Il est mort!»
Pour avoir une certitude, je demandai à mon père de tenter des démarches, afin de savoir ce que le brave garçon était devenu.
Mon père me répondit par une lettre dans laquelle il écrivait: «Le père Jean a reçu un avis du ministère de la guerre. On n’a pas retrouvé le corps de son fils, mais cela ne signifie rien; les cadavres étaient si nombreux qu’il a fallu les enterrer pêle-mêle, sans prendre le temps de dresser les actes de décès. Charles est donc bien mort. D’ailleurs un de ses camarades, qui a survécu à l’horrible hécatombe, a déclaré avoir vu Charles déjà blessé, perdant beaucoup de sang, recevoir un coup de sabre sur la tête et rouler sous les pieds des chevaux.
«Le vieil Aschuler, disait encore mon père, est profondément affecté ; mais il demeure stoïque. Il murmure constamment: — «Mort, tout de suite, au commencement, c’est triste! Ah! il a dû bien se battre!» Il reste l’œil fixe et sec, l’air stupide, poussant par moments de formidables soupirs qui se prolongent et s’éteignent dans une plainte sourde.»
Annette éplorée prit le deuil, jurant qu’elle ne se marierait pas; qu’elle conserverait éternellement intact le souvenir de son fiancé.
Sa douleur émut le pays. Dans les rues du Crotoy, quand elle passait habillée de noir, les paupières rouges, les yeux brillants de larmes et doucement hagards, la tête songeuse, inclinée sur la poitrine, chacun la contemplait avec compassion, et l’on disait: «C’est la fiancée du cuirassier de Reichshoffen!»
Lorsque se produisit le foudroyant désastre de Sedan, où une armée de cent mille Français fut cernée par deux cent quarante mille Prussiens, et emmenée prisonnière en Allemagne, je ne pus retenir un cri de douleur; et je me dis à moi-même:
«Cette fois, il faut que je parte!
Et j’écrivis à mon père une lettre le suppliant de me laisser rentrer seul.
«Il me semble, lui disais-je, qu’une seconde mère, plus malheureuse que la première, me reproche mon inertie et m’appelle sans cesse.»
Il me répondit qu’il viendrait me chercher la semaine suivante.
J’avais envoyé également un mot à Jules Faget pour le prier de me donner des renseignements sur ce qui se passait à Paris.
Il m’adressa une longue lettre dans un style aussi imagé que sa conversation.
«Ici, me racontait-il, nous nous préparons à une défense... carabinée. Nos visiteurs seront reçus... à la porte. On leur offrira sur les bastions un festin, où il y aura des pruneaux et des bombes glacées. Après quoi, nous les reconduirons à coups de fourchettes à Berlin pour les faire trinquer là-bas une dernière fois à la santé des Français.
«Quant à papa, il travaille nuit et jour; il a inventé deux machines vraiment épatantes: un ballon dirigeable destiné à surveiller l’ennemi; puis un canon lançant des bombes infernales qui, en éclatant au milieu d’un corps d’armée, tueront cinq mille hommes d’un coup.
«Il se dépêche, pour terminer ses plans avant l’arrivée des Prussiens. Il ira voir prochainement le ministre de la guerre qui n’aura plus qu’à procéder à la construction des machines.
«Je dois vous aviser que plusieurs jeunes gens de notre âge parlent d’organiser une association de pupilles qui participeraient à la défense de Paris, en offrant leurs services à l’autorité militaire J’ai l’intention de m’en mettre. Voilà votre affaire. Dépêchez-vous de revenir; nous causerons de tout cela.»
Ce que je retins surtout de la lettre un peu naïve de Jules, ce fut ce projet d’une association de pupilles.
«Puisque ma mère, à aucun prix, ne veut que je m’engage, pensai-je, j’entrerai dans l’association des pupilles. De cette façon je ne quitterai pas ma famille, et je pourrai tout de même rendre quelques services.»
Mais un accident très grave vint, à quelques jours de là, jeter mon cœur dans une angoisse terrible.
C’était une après-midi, vers quatre heures; nous prenions notre bain habituel, pendant qu’Annette, toujours très triste, amusait de son mieux ma sœur sur la plage.
Il y avait peu de monde; ma mère, qui commençait à nager, s’exerçait à quelques pas de moi.
Je la suivais des yeux en songeant à mes projets, quand une grosse vague de fond lui arriva en pleine poitrine au moment où elle voulait se redresser.
Elle eut le visage inondé, suffoqua, perdit pied, se débattit et disparut sous l’eau.
Je me précipitai vers elle; mais, encore novice en natation, je ne pus avancer assez vite; je la vis confusément revenir à la surface, la chevelure dénouée, les bras tendus, criant au secours.
J’activai mes mouvements, mêlant mes appels aux siens, balancé par les vagues qui me la montraient tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de moi. La distance qui me séparait d’elle diminuait à peine et le flot nous emportait tous les deux vers la haute mer.
Bientôt la fatigue me gagna; mais je luttais quand même, désespérément, tandis qu’une foule de réflexions me torturaient l’esprit.
Je me demandais avec angoisse si j’arriverais à temps pour la sauver, si j’aurais la force de la soutenir jusqu’à ce qu’on vînt à mon aide, si enfin, nous n’allions pas périr l’un et l’autre! J’entendais derrière moi des cris lointains; et, instinctivement, pour mesurer l’espace qui nous séparait de nos sauveteurs, je tournai la tête, sans cesser de nager.
En une seconde, j’entrevis des gens que notre péril effrayait; ils s’agitaient comme dans un cauchemar; et ils me parurent au bout du monde.
Annette affolée se démenait sur la plage avec Henriette dans les bras, en criant: «Au secours! ils se noient là-bas! vite! vite!...»
Les promeneurs accouraient de toutes parts; des marins se précipitaient vers le rivage, avec des cordes, des bouées et sautaient dans une barque.
Alors, je repris courage; je calculais qu’il fallait bien trois minutes avant qu’ils fussent près de nous. Trois minutes, c’étaient trois siècles! d’ici là, ne sombrerions-nous pas?
Ma mère allait à la dérive maintenant, presque inerte; sa tête s’enfonçait, puis ressortait. Je me rapprochais d’elle, mais le reflux me la disputait, l’éloignait de moi chaque fois que je croyais la saisir —J’étais à bout d’énergie.
Enfin, je parvins à l’atteindre, à lui toucher le bras avec une main; alors mes doigts s’agrippèrent après elle au point de lui entrer dans la chair comme autant de crochets.
Je tentai de lui parler pour lui donner de la force; je haletais tellement qu’aucun mot ne sortait de ma bouche. Mes membres tremblaient, épuisés par des efforts surhumains. Une sorte de vertige me montait au cerveau; je m’évanouissais lentement; et pourtant je la serrais toujours, car je percevais derrière moi un clapotis de rames.
III
J’ÉTAIS A BOUT D’ÉNERGIE (P. 48)
Tout à coup, l’eau m’envahit la figure: nous coulions à pic, comme dans une chute, au point que je me demandais si nous n’allions pas toucher le fond de la mer. En même temps, un bruit de cascade m’emplit les oreilles; et, en cette seconde terrible, une foule d’idées traversèrent mon esprit. Je pensai que nous étions perdus et je songeai à l’affliction de mon père apprenant la fin tragique de sa femme et de son fils.
Bientôt aux affres terribles de la suffocation, succéda une sorte d’anéantissement presque agréable de l’être; puis toute sensation s’éteignit en moi....
Après un certain temps dont je ne pus apprécier la durée, une chaleur grandissante emplit peu à peu mon corps, un souffle réconfortant pénétra dans mes poumons. Je soulevai mes paupières. J’étais couché dans mon lit. Un médecin me tenait le poignet dont les battements lui avaient annoncé un retour à la vie.
Tout d’abord, je ne comprenais pas; subitement la mémoire des faits me revint et une angoisse terrible me tortura le coeur. Je voulus parler; mais ma langue, que le docteur avait sans doute tirée hors de la bouche pour faciliter l’entrée de l’air par la gorge, me cuisait. J’articulai pourtant avec effort:
«Ma mère!... Où est-elle?
— Votre mère va aussi bien que vous, répondit le docteur, ce ne sera rien.
— Dites-moi la vérité », insistai-je.
A ce moment, j’entendis une voix qui faiblement criait:
«Mon fils! mon enfant! je veux le voir!...
— Je veux voir ma mère», dis-je à mon tour, en essayant de m’asseoir.
Annette, un peu remise, m’apporta une robe de chambre dans laquelle on m’enveloppa, et, soutenu par le docteur, j’arrivai près de ma mère; elle me tint embrassé longuement sans pouvoir prononcer une parole. On m’installa à côté de son lit dans un fauteuil; et pendant des heures nous restâmes ainsi, sentant nos forces renaître, heureux de nous retrouver comme après une longue absence.
Mon père, prévenu par dépêche, était là le lendemain matin; il me pressa contre son cœur et, les yeux pleins de larmes de joie, il me dit:
«Tu as sauvé ta mère, mon Fernand; sans toi, j’étais veuf, j’étais désespéré pour toujours!»
A l’idée qu’il avait été sur le point de la perdre, ce fut entre eux deux comme une nouvelle affection pleine de prévenances et de petits soins qui me touchaient.
Quant à moi, je me sentis grandi à leurs yeux. A partir de cet instant, en effet, je devins pour mon père un ami, une sorte de confident intime de ses craintes et de ses espérances, et, pour ma mère un protecteur sur lequel elle pouvait compter.