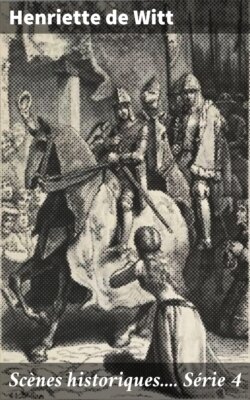Читать книгу Scènes historiques.... Série 4 - Henriette de Witt - Страница 4
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеC’était le 15 septembre 1380, dans la bonne ville de Paris; aux alentours de l’hôtel Saint-Pol les passants s’arrêtaient, le visage triste et les larmes dans les yeux; plus d’un s’enquérait auprès des gens du roi, allant et venant dans les cours, de la santé du bon prince Charles V, roi de France, qui, disait-on, se mourait sans remède dans sa maison. Chacun savait que depuis longues années, et lorsqu’il était encore duc de Normandie, le roi portait au bras une petite fistule, que lui avait établie un médecin des plus habiles qui fussent jamais, lequel lui avait été envoyé d’Allemagne par son oncle, l’empereur Jean, pour le guérir d’une grande maladie dont il était détenu. En ce temps-là on avait dit, parmi les gens bien informés, que le prince avait été empoisonné d’un venin subtil par le roi de Navarre, Charles le Mauvais, son beau-frère. Tant était que, lorsqu’il avait été remis en figure d’homme, que ses cheveux et ses ongles étaient repoussés et que ses forces étaient revenues, le savant médecin qui avait fait ce miracle avait dit, avant de retourner en son pays: «Lorsque cette petite fistule cessera de couler et sèchera, vous mourrez sans point de remède, et vous aurez quinze jours au plus de loisir pour aviser et penser à l’âme.» Le roi, disait-on, voyant que la petite fistule séchait, avait aussitôt pris son temps pour ses dévotions et pour vaquer à ses affaires, puis, le mal augmentant et lui couché dans son lit, il avait fait appeler ses frères, les ducs de Berry et de Bourgogne, ainsi que son beau-frère, le duc de Bourbon. Quant à l’aîné des princes de son sang, le duc d’Anjou, le roi lui avait ordonné de rester à l’armée qui se préparait contre le duc de Bretagne, car il le savait ambitieux, avide et dur au pauvre peuple; aussi ne voulait-il lui confier ni son royaume, ni son fils, le dauphin Charles, pour lors âgé de onze ans, lequel pleurait à grosses larmes à côté du lit de son seigneur et père.
Les princes étaient debout autour du roi, qui. portait déjà la mort sur son visage. Cependant sa voix était ferme encore et son courage paraissait assuré, car il avait dès longtemps accoutumé de faire peu de cas des souffrances du corps, ayant eu, sa vie durant, si faible et pauvre santé, qu’il avait dû traîner et endurer bien des fois pour accomplir son royal devoir. «Mes beaux frères, leur dit-il, par ordonnance de nature, je sais bien et je connais que je ne puis longuement vivre. Je vous remets et je vous recommande Charles, mon fils; usez-en comme de bons oncles doivent user de leurs neveux; acquittez-vous-en loyalement et le couronnez comme roi après ma mort aussitôt que vous le pourrez, et le conseillez en toutes ses affaires, car toute ma confiance est en vous. L’enfant est jeune et d’un esprit léger. Il sera nécessaire de le mener et de le gouverner par bonnes doctrines, et de lui enseigner et faire enseigner tous les devoirs royaux qu’il devra remplir; mariez-le en si haut lieu, que le royaume en vaille mieux. Cherchez pour son mariage en Allemagne, afin que les alliances y soient plus fortes. Vous avez entendu comment notre adversaire d’Angleterre s’y veut et doit marier; c’est tout pour avoir plus d’alliances. J’ai eu longtemps un maître astrologue qui disait que Charles mon fils aurait en sa jeunesse grands périls et sortirait de grandes aventures: ce dont j’ai plusieurs idées et imaginations, et ne sais comment cela pourrait être, sinon du côté de Flandre, car, Dieu merci, les affaires de notre royaume sont en bon point. Le duc de Bretagne est un homme cauteleux et mauvais; il a toujours eu le cœur plus anglais que français: c’est pourquoi tenez toujours en affection les nobles et les bonnes villes de Bretagne; par ce moyen vous briserez ses menées. Faites le seigneur de Clisson connétable de France; tout considéré, je n’en sais pas de plus propre que lui. Quant aux aides du royaume de France dont les pauvres gens sont si accablés et grevés, usez-en selon votre conscience et les ôtez le plus tôt que vous pourrez, car ce sont choses, bien que je les aie maintenues, qui m’attristent fort et me pèsent au cœur; mais les grandes guerres et les grandes affaires que nous avons eues de tous côtés m’y ont obligé pour avoir l’argent nécessaire.»
La voix du roi s’affaiblissait, malgré son grand courage, et le dauphin Charles, dont il avait constamment tenu la main, tout, en parlant, sentait la sueur froide couler le long de ses doigts. Le duc de Bourbon, qui avait le cœur plus tendre et facile à émouvoir que les autres princes, s’empressa de lui apporter un breuvage que les médecins avaient préparé, car il craignait de le voir trépasser en cette même heure. Lorsque le roi eut bu, il demanda que la sainte couronne d’épines lui fût apportée du sanctuaire où elle reposait depuis que le roi Louis IX, de pieuse mémoire, l’avait reçue du prince d’Orient. Lorsque les prêtres et clercs entrèrent en sa chambre, apportant la sainte relique en un coffret d’or, le roi se souleva dans son lit et, ayant longtemps adoré la Passion de Notre-Seigneur, il demeura en prière, tandis que les chants de l’Église retentissaient autour de son lit. Lorsque les prêtres se furent retirés:
«Apportez-moi, dit-il, la couronne de France, que j’ai reçue de mon père en des temps mauvais, lorsque les Anglais tenaient grande partie du royaume.» On s’empressa d’aller quérir la couronne dans le trésor de Saint-Denis, et lorsqu’on l’apporta en grande hâte, car le roi semblait près de rendre l’âme, il la fit poser au pied de son lit. «Ah! précieuse couronne de France, dit-il, à cette heure si impuissante et si humble, précieuse par le mystère de justice renfermé en toi, mais vile, plus vile que toutes choses à cause du fardeau, du travail, des angoisses, des tourments, des peines de cœur, de corps, d’âme et des périls de conscience que tu donnes à ceux qui te portent. Ah! s’ils pouvaient d’avance les savoir, ils te laisseraient plutôt tomber dans la boue que de te porter sur leur tête!»
Le roi avait joint les mains, comme pour demander pardon à Dieu des fautes et des erreurs qu’il avait commises en portant cette couronne; lorsqu’il se releva: «Ouvrez les portes, dit-il; et laissez entrer tous venants, que je voie encore une fois mon peuple!»
L’appel du roi retentit de voix en voix jusque dans la rue et sur la place; les passants commençaient à s’amasser aux portes, se pressant pour entrer; les huissiers de la chambre royale furent contraints de résister au flot des affligés ou des curieux; en même temps tous les serviteurs de l’hôtel se hâtaient vers la chambre du roi, qui se trouva bientôt remplie. Le prince semblait sur le point d’entrer dans son agonie; il trouva cependant la force de se tourner vers la foule, disant: «Je sais bien, mes amis, que dans le gouvernement du royaume et en mainte occasion j’ai dû offenser les grands, les moyens et les petits, auxquels j’aurais dû être bienveillant et reconnaissant pour leurs loyaux services. Ayez donc merci de moi, je vous en prie, je vous demande pardon.»
Tous sanglotaient autour du lit; parmi les femmes qui avaient réussi à pénétrer dans la chambre, plusieurs s’étaient jetées à genoux, répétant le De profundis. Le roi reprit encore une fois la parole: «Ne pleurez point, mais réjouissez-vous, mes bons amis, mes loyaux serviteurs; dans une heure ce sera fini.»
La main du roi était demeurée sur la tête courbée du dauphin, toujours agenouillé auprès de son père, qui le bénit tout haut, à l’ouïe de son peuple, comme autrefois le patriarche Isaac avait béni son fils Jacob. «Plaise à Dieu, dit-il, d’accorder à mon fils Charles la rosée de la terre, l’abondance du froment, du vin et de l’huile; que sa famille lui obéisse, qu’il soit le seigneur de ses frères, que les fils de sa mère s’inclinent devant lui; qui le bénira sera béni, qui le maudira sera maudit.» Puis levant faiblement les bras: «Soyez bénis, dit-il, mes amis, et retirez-vous maintenant; priez pour moi, laissez-moi endurer en paix le dernier travail de la mort.» Il embrassa encore une fois le dauphin. «Emmenez-le, » dit-il faiblement. Comme l’enfant sortait tout en pleurs, le roi appela un de ses chapelains pour lui lire dans les saints Évangiles la Passion de Notre-Seigneur; puis, commençant d’agoniser, il ne tarda pas à rendre le dernier soupir entre les bras de son fidèle ami et bon serviteur, le sire de La Rivière.
Au moment où le bon Charles V, dit le Sage, avait dit adieu à son peuple et à ceux qui le servaient, un homme s’était glissé à travers la foule, comme pressé de sortir sans être remarqué. Ceux qui l’apercevaient disaient: «Ah! maître Gilles est en grande hâte d’échapper à la vue de la mort; cependant le roi, notre seigneur, lui a été bon maître et a bien des fois pardonné mensonges et voleries qu’il a commises en son hôtel!» Gilles ne prêtait pas l’oreille à ces propos; il était déjà parvenu jusqu’à une maison du quai Saint-Michel, dans laquelle se cachait le duc d’Anjou, venu à Paris contre le commandement du roi. Plusieurs serviteurs de la maison royale l’avaient constamment tenu informé des progrès de la maladie de son frère. Lorsqu’il avait vu celui-ci au dernier point, il avait quitté son apanage et son armée et s’était secrètement rendu à Paris. «Monseigneur, dit Gilles en soulevant la tapisserie qui fermait la chambre du duc, monseigneur le roi est à l’agonie et les prêtres sont autour de lui, chantant le Miserere.» Le duc appuya sa tête sur sa main et deux larmes de naturelle compassion jaillirent de ses yeux; elles ne tardèrent guère à être séchées. «Retourne, Gilles, dit-il, et m’informe du moment où mon seigneur et frère aura rendu son âme à Dieu!»
Gilles se préparait à obéir, lorsqu’un second serviteur, confidentdu duc d’Anjou, pénétra à son tour dans la chambre. «Monseigneur, dit-il, notre sire le roi est mort! — A cette heure, repartit le duc, hâtons-nous, sans quoi mes frères mettront la main sur les trésors, qui doivent être grands et magnifiques, et dont m’est besoin plus qu’à eux, ayant à conquérir mon royaume de Naples.» Car la reine Jeanne de Naples et de Sicile avait fait remise de ses États au pape Clément, demeurant pour lors à Avignon, lequel en avait doté le duc d’Anjou, etne cessait depuis lors de réunir soldats et argent pour prendre possession de son trône: ce dont tous ceux de Naples n’étaient consentants.
Les gardiens du trésor royal avaient cédé aux menaces et à l’autorité hautaine du prince le plus âgé qui fût du noble sang de France, bien que plusieurs fussent informés des précautions que le feu roi avait voulu prendre contre l’avidité du duc son frère; mais les princes morts, pour si grands qu’ils aient été, n’inspirent plus crainte ni effroi, comme ceux qui ont la puissance en leurs mains. Le duc d’Anjou avait fait accumuler en un lieu sûr les grands trésors du roi son frère, qui dépassaient toutes ses espérances, s’élevant, disait-on, à dix-neuf millions de livres tournois. Comme on revenait des funérailles du bon roi Charles, qui avait été enseveli à l’abbaye de Saint-Denis en grande pompe et cérémonie, avec son connétable messire Bertrand Duguesclin à ses pieds, ainsi qu’il l’avait lui-même ordonné, le duc d’Anjou eut vent qu’il n’était pas encore maître de tout ce qu’avait possédé le roi. On disait qu’un trésor était encore caché dans le château de Melun. Le duc s’avança avec colère vers le sire de Savoisy, chambellan et confident serviteur de Charles V. «Or sus, faux traître, lui cria-t-il, dis-moi à cette heure où est celé le trésor de mon frère que je sais à Melun et que tu comptais sans doute dérober à ton profit!» Le chambellan s’excusait, niant le trésor et la connaissance qu’il en avait. «Pour lors, cria le duc, qu’on appelle le bourreau et qu’il soit décollé à cette heure; nous verrons si l’approche de la mort lui ouvrira la mémoire et les lèvres.» Le bourreau n’était pas encore arrivé que le sire de Savoisy avait, comme les autres, cédé à la crainte. Le duc d’Anjou courut aussitôt à Melun pour s’assurer en personne du trésor, qui était considérable, consistant surtout èn vaisselle d’argent et d’or. Ainsi furent déjouées les prudentes intentions du roi Charles V: la discorde s’était mise parmi ses frères, et le duc d’Anjou s’emparait de cette première place qui lui avait été refusée. Cependant, un conseil ayant été réuni à la hâte des principaux du royaume qui se trouvaient présents, il fut décidé que la garde et la tutelle du jeune roi Charles VI resteraient aux mains des ducs de Bourgogne et de Bourbon, tandis que le duc d’Anjou demeurerait comme régent auprès du roi, son neveu, pour gouverner les affaires du royaume jusqu’à sa majorité. Tous décidèrent aussi que le petit roi serait sacré en la cathédrale de Reims, comme l’avaient toujours été les rois de France depuis Clovis.
Or ne se souciait pas d’autre chose le roi lui-même, depuis qu’il avait cessé de pleurer à Saint-Denis devant le tombeau de son père. Les enfants avec lesquels il avait été élevé, et qui appartenaient tous aux plus nobles maisons du royaume, se plaisaient à l’entretenir de la pompe et de la magnificence qui le devaient entourer à son sacre, comme aussi de la puissance et de la liberté qui lui écherraient alors en partage. Plusieurs d’entre eux avaient déjà présenté des demandes et requêtes, que le petit roi octroyait ou rejetait gravement, selon son humeur ou fantaisie du moment. «Quand irons-nous à Reims, monseigneur mon oncle? répétait-il souvent au duc de Bourbon, avec lequel il était familier et sans crainte. — Au premier jour, beau neveu, et lorsque vos oncles d’Anjou, de Berry et de Bourgogne se seront entendus sur le partage de la puissance dans votre royaume,» disait le duc, qui, étant moins grand seigneur que les frères du feu roi, n’avait rien à prétendre comme dotation ou apanage. Le petit roi disait à ses compagnons: «Quand je serai sacré et vraiment le roi, mon oncle de Bourbon me demandera tout ce qu’il voudra et je le lui donnerai.»
Cependant tous les grands princes étrangers qui relevaient de la noble couronne de France avaient été mandés en tous pays, ainsi que les seigneurs, barons et prélats du royaume, pour assister au sacre du roi en la ville de Reims. Tous ne vinrent pas qui auraient dû le faire; cependant la pompe était magnifique et la foule des seigneurs bien grande lorsque le jeune roi entra dans la cité de Reims, le samedi avant la Toussaint, six semaines après le jour où le roi Charles V avait rendu à Dieu son âme. Devant le roi sonnaient plus de trente trompettes, d’un son si clair que c’était merveille, si bien que le petit roi y prenait grand plaisir, ne sachant à cette heure ce qu’était fatigue ou mal de tête; il criait toujours aux musiciens de sonner plus fort. On passait au travers des bourgeois et du peuple de Reims qui tous criaient. «Noël!»
«Monseigneur, le roi est mort.»
Le petit roi était en prières dans la cathédrale; ses armes étaient placées devant lui; au pied de l’autel, à côté de lui, priait son frère,, encore tout enfant, trop jeune pour devenir chevalier, mais qui avait obtenu de passer la nuit dans l’église avec leurs compagnons. «Ne-dois-je pas, demain, porter au cortège la grande épée de l’empereur Charlemagne, cette Joyeuse dont il est parlé en toutes les chansons, tout comme si j’étais déjà grand et chevalier?» Le roi aimait beaucoup-son frère et avait demandé pour lui cette grâce; mais le petit prince avait grand peine à se tenir en repos, ayant achevé ses prières; il riait et faisait des tours qui ne convenaient point au saint lieu, si bien que son gouverneur se vit obligé de l’emmener vers la minuit; déjà le damoiseau d’Harcourt, qui était le plus âgé et le plus raisonnable parmi les compagnons du roi, s’était plaint plusieurs fois des folies du jeune duc: «Tais-toi, Louis,» avait dit le roi.
Lorsque le duc de Touraine ne fut plus dans l’église, le petit roi se rapprocha du damoiseau d’Harcourt, et tous deux s’entretinrent, comme enfants sages et bons compagnons, des grands faits d’armes et nobles actions de chevalerie qu’ils voulaient accomplir, leur vie durant, pour le service de Dieu et le soulagement des opprimés.
A la fin le roi s’endormit, la tête sur l’épaule de Godefroy d’Harcourt.. Tous deux étaient déjà bien fatigués lorsqu’il fallut se préparer pour la solennelle procession et cérémonie du grand jour. «J’aimerais mieux me reposer en mon lit,» pensait le petit Charles VI.
La cathédrale de Reims était magnifiquement parée et si fort remplie de toute noblesse, qu’on n’y pouvait tourner le pied. Le trône était couvert de draps d’or aussi riches qu’on avait pu trouver, et là seyait le jeune roi, qui venait d’être sacré de la sainte ampoule dont messire saint Remy avait naguère consacré Clovis, le premier roi qui fut en France. Il avait déjà conféré devant l’autel le très noble ordre de chevalerie à tous ses amis et compagnons, qui étaient assis à ses pieds sur des escabeaux parés de drap d’or.
Tout près du roi se tenait le nouveau connétable de France, messire Olivier de Clisson, aussi joyeux de visage qu’il pouvait l’être, étant de sa nature laid et mal bâti et ayant en outre perdu un œil dans un combat. Ce qui ne l’empêchait pas d’être illustre chevalier et grand guerrier, bien propre à la charge que le sage Charles ¥ lui avait confiée à son lit de mort.
A la porte de l’église, toute grande ouverte, se pressait le peuple, qui cria: «Noël!» lorsque son assentiment fut à haute voix demandé pour l’élévation au trône du roi Charles, sixième du nom. Les cris redoublèrent lorsque les hérauts annoncèrent au nom du roi qu’à l’occasion de cet avènement et élévation toutes les impositions, aides, gabelles, péages, subsides et autres choses mal vues dont le royaume de France avait été trop grevé, seraient acquittées, ôtées et supprimées, ainsi que le roi Charles V l’avait désiré à cette heure suprême où les souffrances des pauvres se dressent comme un remords terrible devant la conscience des princes. Tous étaient joyeux par tous états dans la ville de Reims, ce jour-là.
Le petit roi avait ôté le manteau royal qui l’accablait de son poids; il paraissait beau et bien fait, plus grand et plus robuste qu’il n’était d’ordinaire parmi les enfants de son âge, lorsqu’il prit place au banquet qui avait été préparé dans une grande salle en charpente élevée dans la cour du palais. L’archevêque qui avait sacré le roi et les prélats, qui étaient en grand nombre, s’assirent à la droite du prince; un siège avait été préparé à sa gauche pour le duc d’Anjou, à la suite duquel devaient se placer les autres princes; mais le duc de Bourgogne, réclamant les droits et les honneurs de premier pair de France, s’élança en avant sans rien dire et prit son siège à côté du roi, repoussant ainsi à la seconde place le duc d’Anjou, son aîné. Tous furent bien étonnés, mais nul ne réclama, et le duc, content d’avoir établi le rang de sa pairie, qui jusqu’alors n’avait passé qu’après celles de Normandie et de Flandre, se rendit si agréable au roi, que le petit prince se réjouit d’avoir ainsi changé de voisin.
«Mon bel oncle d’Anjou ne sait point être de si avenante humeur que mon oncle de Bourgogne, quand celui-ci le veut bien,» dit-il le soir à Godefroy d’Harcourt. qui assistait à son coucher.
Cependant les deux enfants étaient bien plus préoccupés du noble appareil dans lequel les premiers barons du royaume avaient servi e souper royal, à cheval sur leurs coursiers de parade et tout vêtus de drap d’or. «As-tu vu comment le sire de Coucy manœuvrait son destrier avec grâce, et le savait faire caracoler à travers les tables sans blesser ni heurter personne? disait le petit roi; je saurai chevaucher aussi bien que lui quand je serai grand; il l’emportait sur messire le connétable, sur messire l’amiral et même sur le sire de la Trémoille; son cheval ne bougeait non plus qu’un terme pendant la représentation des mystères. Je ne pouvais m’empêcher de le regarder et de l’admirer à tout moment.»
Le petit roi et ses oncles étaient revenus à Paris, où s’étaient célébrées de nouvelles fêtes. L’enfant s’apercevait, que le sacre n’avait guère accru sa liberté, et qu’il n’était vrai roi non plus qu’auparavant. Il s’en plaignait chaque jour à Godefroy d’Harcourt, qui disait sagement: «Vous êtes trop jeune, monseigneur, et vous ne sauriez vous gouverner vous-même, encore moins gouverner ce grand peuple. Le bon roi votre père a décidé que vous seriez majeur à quatorze ans, quatre ans plus tôt que ne l’ont été les rois vos prédécesseurs, et lourd sera déjà le fardeau pour vos épaules quand vous aurez encore pris deux ans d’âge. Ne voudrais-je pas, à quatorze ans, être chargé de veiller au bien et au mal des domaines de la maison d’Harcourt, qui sont petits et pauvres en comparaison du royaume de France. Prenez patience, monseigneur, votre temps viendra!»
Deux larmes jaillirent des yeux du petit roi.
«Tu as ton père, toi, Godefroy, dit-il d’une voix tremblante, et moi je n’ai que mes oncles, qui se disputent jusqu’en ma présence à qui gouvernera et moi et mon peuple, sans que personne fasse cas ou de mon bonheur ou de mon amour!»
Godefroy se rapprocha du jeune prince, timidement et comme s’il craignait d’être entendu. «Ils se disputent votre peuple, messire, dit-il, et, en se disputant, ils l’écrasent. On dit que monsieur le duc d’Anjou n’est point si pressé qu’il devrait l’être de tenir la promesse qui a été faite à votre sacre d’abolir les aides et gabelles!»