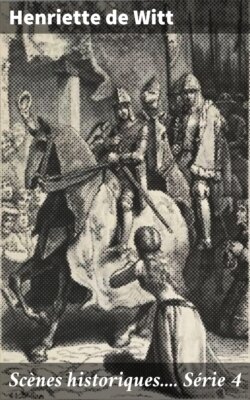Читать книгу Scènes historiques.... Série 4 - Henriette de Witt - Страница 6
CHAPITRE II
ОглавлениеL’un après l’autre, les vieux serviteurs du roi Charles V avaient été mis en disgrâce et renvoyés dans leurs maisons. Les princes se cherchaient entre eux constantes querelles, et les gens de guerre qu’ils entretenaient, étant mal payés et mal dirigés, pillaient les maisons des bourgeois dans la ville et celles des paysans dans la campagne. Les impôts étaient partout levés et perçus comme dans le temps passé ; on disait même que la rigueur des receveurs et la dureté des sergents allaient croissant. Le peuple commençait à s’agiter; on rencontrait par toutes les rues des rassemblements de gens des petits métiers, qui parlaient entre eux au lieu de se rendre à leur ouvrage, s’excitant les uns les autres par leurs paroles. En vain le prévôt des marchands et les riches bourgeois se mêlaient souvent aux groupes, cherchant à apaiser la colère de cette populace de Paris qu’on avait vue plus d’une fois redoutable. On leur répondait qu’ils parlaient bien à leur aise, étant riches et n’ayant jamais vu femmes et enfants jetés dehors par les sergents, et les meubles vendus pour payer la taille et les aides. Il en fallut venir à convoquer une assemblée populaire, à laquelle le prévôt fit un beau discours, exhortant tous les assistants à la patience: à cette heure où le jeune roi venait de rentrer en sa bonne ville de Paris, après son digne sacre, il ne tarderait guère à abolir les impôts excessifs, ainsi qu’il l’avait promis. Tout à coup un savetier se leva, bien connu dans le quartier des Halles, grand discoureur et beau diseur, plus accoutumé, disait-on, à boire et à parler qu’à tirer l’alêne ou à couper le cuir, et qui, en conséquence, avait plus d’une fois eu maille à partir avec les sergents.
«Nous n’aurons donc jamais de repos, s’écria-t-il, et l’avarice des seigneurs nous chargera donc toujours d’exactions contre nos droits? On nous demande plus que nous ne pouvons payer, on nous écrase jusqu’à en mourir; en outre, on nous méprise trop. A peine veut-on nous reconnaître la voix et la figure d’homme; on ne nous appelle point dans les assemblées des notables, et on nous dit avec arrogance que la terre ne doit pas se mêler au ciel. Nous leur donnons tout notre avoir, nous prions pour eux, et avec nos impôts ils ne songent qu’à se vêtir d’or et de perles et à se bâtir de beaux hôtels. On accable la bonne ville de Paris, cette mère des autres villes du royaume; mais il n’y a plus de patience à avoir: que tous les bourgeois, grands et petits, prennent les armes; il vaut mieux mourir que de vivre si misérables et endurer tant d’injures!»
Les paroles du savetier répondaient aux pensées de tous. En un instant l’assemblée fut dissoute; chacun criait: «Aux armes!» Trois cents hommes marchèrent vers le palais. «Allons parler au régent!» disait-on. Le trouble régnait aux alentours, les serviteurs du duc d’Anjou étaient grandement effrayés. Le prince avait conservé tout son calme. «Venez, chancelier, dit-il, allons ouïr leur requête; notre ami le prévôt est en plus grande crainte de ceux au nom desquels il parle que je ne le suis, moi, de qui ils se plaignent.» Tous deux montèrent sur la table de marbre qui est dans la grande salle du Palais de Justice, et bien leur en prit, car, à la suite des bourgeois armés, s’était précipitée une foule de peuple qui se pressait dans la salle, et bien eussent pu être étouffés sans remède le prince et le chancelier. A tout moment s’élevaient les cris et les plaintes d’une femme renversée et foulée aux pieds, d’un vieillard écrasé sous le poids de ses voisins qui le poussaient, afin de pouvoir avancer. A peine le prévôt pouvait-il parvenir à se faire entendre lorsqu’il commença sa remontrance au nom des Parisiens. Le duc d’Anjou souriait dans sa barbe, car il avait bientôt reconnu l’adresse du prévôt, qui semblait parler avec force, mais qui cherchait cependant à adoucir par ses paroles ceux qui l’avaient contraint de se mettre à leur tête. Les visages devenaient moins menaçants, les mains ne serraient plus si étroitement les armes, lorsque le duc prit à son tour la parole, amusant et séduisant le peuple par de beaux et affables discours. «Le roi ne peut rien décider sans conseil,» dit sévèrement le chancelier, qui reprocha aux Parisiens leur ingratitude envers les princes, qui avaient comblé leur ville de biens et de faveurs.
Les mécontents se retirèrent; le duc d’Anjou était tout fier de son succès. «Ils reviendront, mon frère; ils reviendront,» disait le duc de Bourgogne.
Ils revinrent, en effet, plus nombreux et plus violents que la première fois. Le prévôt se crut obligé, par le devoir de sa charge, d’avertir le régent que malheur en arriverait si le peuple ne recevait quelque satisfaction. On en délibéra au conseil du roi. Le duc de Bourgogne était plus résolu que le duc d’Anjou à soulager les pauvres gens du royaume de France, car la plus grosse part des aides et impôts ne tombaient pas dans ses coffres. Les confidents serviteurs du régent lui conseillaient de céder. «Ne craignez rien, monseigneur, disaient-ils, vous retirerez ce que vous aurez donné quand le tumulte sera apaisé et le peuple occupé d’autres affaires. A cette heure, il y a les juifs dont on pourra bien tirer quelque argent.» Le duc d’Anjou se mit à sourire: «Pour Dieu! dit-il, je n’avais pas pensé aux juifs! Arrangez cela sans bruit et que nul ne sache que j’y ai pris part ou profit.»
Le lendemain, les hérauts annonçaient dans toute la ville que les. subsides, aides et gabelles étaient abolis par lettres patentes du roi Charles VI.
Une cruelle expérience avait appris aux juifs à se méfier des concessions apparentes dont le poids était tant de fois tombé sur eux. Les plus avisés parmi les commerçants, cachés dans d’obscures demeures au fond de la Juiverie, fronçaient déjà les sourcils et serraient dans les retraites les plus sûres les objets précieux de leur trafic. «Israël pleure quand les Gentils se réjouissent!» disaient les femmes. Plus d’un avait eu la pensée de fuir. Où ce peuple malheureux pouvait-il porter ses pas? Partout la même avidité des grands et des puissants; partout la même haine populaire, la même violence et la même rapine. Quelques familles gagnèrent Rouen, où leurs frères résidaient en grand nombre. Ceux qui leur donnaient l’hospitalité secouaient la tête. «Rouen n’est point plus sûr que Paris à cette heure, disaient-ils; la tempête se va déchaîner en plus d’un lieu.»
Déjà, parmi les gens des petits métiers, circulaient des bruits funestes: les juifs avaient plus que personne profité des aides et des tailles si longtemps maintenues; ils avaient sous main affermé les impôts et s’étaient engraissés des dépouilles du pauvre peuple. Leurs maisons étaient remplies d’or et d’argent; il fallait faire rendre gorge à ces sangsues qui avaient sucé naguère le sang du Sauveur Jésus-Christ et qui dévoraient à cette heure les chrétiens. La populace écoutait les discours de quelques hommes de bonne apparence, bourgeois sans doute, venus de quelque quartier éloigné, car on ne les connaissait pas. Leurs chaperons étaient neufs, leurs habits propres; ils ne semblaient pas accablés par la misère.
Presque tous se trouvaient cependant en tête des bandes, qui ne lardèrent pas à s’élancer contre les maisons des juifs. Plus d’une semblait abandonnée, les vitraux étaient fermés et les malheureux habitants réfugiés dans les caves. La fureur des pillards les poursuivit dans les plus secrètes retraites. Les hommes qui avaient excité la populace ne semblaient pas avoir affaire des trésors; ils avaient coutume d’aller tout droit à quelque vieux coffre dont ils tiraient des papiers, criant en même temps: «Les enfants! les enfants! Il les faut sauver et arracher à la damnation éternelle!» Les mères pleuraient et se défendaient comme au jour du massacre des saints Innocents; plus d’une fut tuée en retenant ses enfants qu’on portait aux églises pour les faire baptiser.
Lorsque, le soir, les serviteurs du régent lui apportèrent les titres des dettes qu’ils avaient enlevés dans les coffres, des juifs ou les joyaux précieux cachés dans les ceintures des hommes et des femmes cruellement égorgés, ils ne manquaient pas d’ajouter à leurs récits: «Et il y a eu dix, vingt, vingt-cinq enfants baptisés à Saint-Séverin ou à Saint-Germain-des-Prés.»
Le duc pensait que c’était une bonne besogne bien faite pour la gloire de Dieu, et il n’était point trop pressé de mettre un terme au pillage.
Les juifs, désespérés, avaient fini par demander asile au Châtelet. Force fut au régent de consentir à la volonté du conseil du roi, qui prit ces malheureux sous sa protection et les rétablit dans leurs privilèges. «En cette manière, Nathan et Lévi ne sauront réclamer à monseigneur ce qu’il leur devait,» disaient les valets du duc d’Anjou. Celui-ci pensait que ses hommes avaient bien pu acquitter, en semblable façon, plus d’une obligation contractée envers les juifs: tous semblaient soudain devenus riches.
La fureur des pillards les pour survit dans leurs retraites.
Ce n’était pas assez cependant, et le trésor royal était vide. De tout côté chacun des princes tirait de l’argent par emprunt; par avances, par mille exactions diverses; les gens du roi n’étaient pas payés et pillaient à leur tour, tout en se lamentant sur la pauvreté
leur seigneur et maître. L’hôtel du petit roi était souvent embarrassé pour les objets nécessaires à la vie, nul des trafiquants qui fournissaient à sa dépense ne recevait d’argent. «Nous serons obligés de rétablir les aides et gabelles,» disait-on. Les états généraux furent convoqués, qui refusèrent d’autoriser des impôts qui écrasaient le peuple. Le régent s’adressa aux états particuliers de chaque province, afin d’obtenir des subsides. Quelques-uns cédèrent. Paris demeura intraitable. Rouen suivit violemment son exemple. «Les libertés de la province! les libertés de la province!» criaient les bourgeois et le peuple rassemblés sur les places et dans les rues: «A bas les aides et les gabelles!»
Les Rouennais criaient et s’emportaient, mais les traitants et les receveurs trônaient à tous les carrefours et dans les halles, rétablissant partout les bureaux de recettes qui avaient été un instant fermés. On se réjouissait encore dans la ville du beau don que le nouveau roi venait d’octroyer à son peuple en mémoire de son très digne sacre, et on disait: «Il est bon fils de notre bien-aimé roi Charles le Sage, qui jamais n’oublia qu’il avait été longtemps duc de Normandie et qui a légué son cœur à sa bonne ville de Rouen.» Cependant les sergents recommençaient leurs exactions avec plus de rigueur que jamais. En un seul jour, dix familles misérables, qui avaient compté sur l’abolition des impôts, avaient été jetées hors de leurs logis; on commençait à s’exciter dans tous les quartiers. Le 26 février 1381, au point du jour tardif, à la lueur incertaine encore du soleil d’hiver, la populace se jeta sur les bureaux des receveurs et traitants, chassant les uns, massacrant sur leurs registres ceux qui cherchaient à les défendre, pillant ou dispersant l’argent contenu dans les coffres, et se ruant en même temps sur les maisons des juifs. A neuf heures, toutes les chaînes étaient tendues dans les rues; les gens des métiers s’étaient réunis et tous couraient à l’hôtel de ville pour délibérer sur les affaires de la cité. A la tour du beffroi sonnait sans relâche la cloche de la commune. «Normands, venez! Normands, venez!» disait-elle; et ses appels sinistres retentissaient comme un glas funèbre à travers les rues et les places toutes couvertes d’une foule pressée. On pleurait et on tremblait dans plus d’une maison, car la terreur avait gagné tous les bourgeois riches et paisibles. «Peuple en furie est le plus cruel des maîtres!» répétait-on.
La femme et les filles du maire, Robert Deschamps, cherchaient à le retenir. «N’allez pas à l’hôtel de ville, répétaient-elles. Vous n’y sauriez faire aucun bien et vous y pourrez laisser votre vie! Plus d’un vous déteste pour la justice que vous avez rendue contre lui, qui s’arrangera pour se venger sans qu’on sache d’où vient le coup.» Et comme le magistrat se refusait à leurs prières, alléguant son devoir et les serments qu’il avait prêtés, Mme Deschamps le supplia à mains jointes, et pour l’amour du bonheur qu’ils avaient eu ensemble en mariage, de ne pas manquer pour le moins de faire appeler ses douze pairs et ses douze prud’hommes, afin que, escorté des trente-deux sergents dans le costume de leur office, il pût au moins imposer aux furieux qui se précipitaient par les rues comme des taureaux prêts à frapper de leurs cornes. «Qu’on fasse au moins prévenir maître Jean Legras, disait-elle; il saura où se sont réfugiés les prud’hommes, car ils ont coutume de se rassembler chaque soir en sa boutique pour deviser des affaires du jour.»
Le maire souriait amèrement, cherchant à dégager sa robe des mains qui la retenaient. «Jean Legras est à cette heure caché dans le coin le plus reculé de sa maison, entre ses ballots de drap, dit-il, et tous les pairs et prud’hommes en font autant! N’avez-vous pas entendu tout à l’heure ce que m’est venu dire le gardien de la geôle, que toutes les portes sont forcées et ceux qui y étaient retenus par jugement et en châtiment de leurs fautes déjà relâchés, faisant de leur pis en la cité ? Non, non, j’irai à l’hôtel de ville tout seul, moi qui marchais naguère en la cour du roi à l’égal des comtes, et je ferai de mon mieux pour faire comprendre à ces insensés que dure sera la verge dont ils seront tantôt battus pour les punir de leur rébellion; car plus fort est notre sire le roi qu’une populace en furie, et point ne sert de se soulever contre la volonté des princes par des crimes qui méritent la mort!»
Dame Deschamps gisait sur son lit à demi évanouie, et les amis de Robert Deschamps avaient eu fort à faire pour le faire esquiver au milieu de la foule qui encombrait l’hôtel de ville, et qu’il avait vainement voulu haranguer.
A cette heure il était caché dans les caves du drapier Legras, dont il parlait tantôt à sa femme; il était tapi entre deux balles énormes de drap dont le sort préoccupait maître Legras plus encore que celui du maire, lorsque, d’une chambre haute de sa maison, il aperçut le flot populaire qui prenait la direction de sa demeure en criant: «Un roi! un roi! il nous faut un roi! notre roi à nous! Peu nous importe le roi de Saint-Denis, le roi de Paris; le roi de France et tous ses conseillers ne sauraient faire un peuple, le peuple peut se faire un roi, le roi de Rouen, le roi des Normands!» Et quelques voix ajoutaient: «Jean Legras! Jean Legras! c’est lui qui sera notre roi pour faire et ordonner notre volonté !»
Jean Legras, tout tremblant, descendit dans sa boutique. «S’ils ne me trouvent à leur bon plaisir, ils pilleraient et détruiraient tout,» pensait-il.
Au moment où le drapier descendait son escalier de chêne, noirci par l’âge et soigneusement ciré, il se retourna vers sa fille, âgée de seize ans à peine, depuis deux ans orpheline de sa mère, brave et digne femme qui l’avait pieusement et sagement élevée.
«Guillemette, dit-il, reste enfermée en la chambre, auprès de ta tante, et, pour bruit que tu entendes, n’aie garde de bouger. Je ne sais ce qu’ils vont faire de moi, mais au moins voudrais-je sauver le plus grand trésor que j’aie en ma maison!»
Guillemette fit un signe de tête; elle ne pouvait pas parler, tant elle pleurait, mais au travers de ses larmes elle entendait les genoux du drapier qui s’entre-choquaient en descendant, et son pas qui retentissait plus lourd que jamais sur les marches.
«Mon pauvre père, se disait-elle, il pense à moi, mais il n’est pas bien résolu en son esprit, et ne sait ce qu’il va dire à ces furieux. S’ils lui font du mal, je ne lui survivrai pas, mais je me jetterai au milieu d’eux pour mourir avec lui. Quand j’aurai dit mes prières avec ma tante, je reviendrai en cette chambre, afin de mieux entendre ce qui se passera!»
La populace en délire se précipitait dans la boutique, sous les sombres arcades formées par les étages supérieurs. Déjà les pièces de drap étalées à la devanture avaient été arrachées. Parmi les furieux absorbés par leur colère ou leur vengeance s’était glissé plus d’un pillard qui se promettait de faire profit en cette bagarre. Le peuple criait: «Il nous faut un roi! notre roi! Or sus, Jean Legras, laisse là ta boutique et ta draperie!»
Guillemette regarda par la fenêtre, malgré la défense de son père, et vit celui-ci, pâle et tremblant, monter dans une charrette qu’avaient amenée les émeutiers. Tout alentour de ce grossier char royal, on avait jeté des lambeaux de drap arrachés aux pièces qui encombraient le magasin du drapier.
«Bien a pris à mon père d’avoir caché aux caves et greniers ses plus belles marchandises, pensait-elle; mais je donnerais des deux mains tout ce que contient la maison pour le voir revenir ici sain et sauf!»
Dans toutes les demeures des bourgeois, le long de la rue et sur le parcours de la multitude forcenée, ceux qui avaient osé mettre le pied hors de la porte ou la tête à la fenêtre reconnaissaient Jean Legras et disaient: «Voilà ce qui lui est venu de son amour de jaser et de blâmer rois et princes! C’était en sa boutique que grondaient chaque soir les pairs et prud’hommes; à cette heure il ne sait plus s’il a le cœur dans sa poitrine ou s’il est descendu dans ses souliers!»
C’était dans l’aitre de l’église Saint-Ouen, auprès de la croix, que la populace avait élevé un trône: quatre morceaux de bois recouverts avec le drap écarlate fabriqué par Jean Legras lui-même et destiné à faire des chaperons. Les plus robustes hissèrent le drapier sur cet échafaudage. Le malheureux, plus mort que vif, répétait tout bas ses prières en songeant à sa fille, demeurée seule en sa maison avec une vieille tante paralytique et une servante qui mourait de peur. «Que le Seigneur Dieu garde ma Guillemette!» murmurait-il.
«Sire! criait-on autour de lui, nous périssons sous les aides et gabelles qui nous ont été injustement imposées; ne veux-tu pas que toutes ces charges damnables soient abolies, comme l’avait ordonné à son lit de mort le roi Charles le Sage?»
Jean Legras hésitait; il avait souvent crié contre les impôts, en sa boutique ou dans son parloir, mais il se sentait bien petit seigneur, en dépit de son trône et de sa couronne, pour contredire à lui seul les conseils du roi.
La populace s’irritait de son silence. «Abolis-tu? abolis-tu?» hurlait-on autour de lui; et le pauvre drapier murmura d’une voix faible: «J’octroie l’abolition des impôts!» Un seul cri s’éleva, pénétrant jusqu’au fond des plus pauvres demeures, et réjouissant plus d’un cœur ignorant et faible: «Plus d’aides, plus de tailles, plus de gabelles! Les Normands sont libres et francs de toute servitude. Vive le roi Jean Legras!»
Guillemette, à sa fenêtre, saisit à la volée le nom de son père; elle se pencha plus avant par l’ouverture, craignant d’entendre des menaces de mort se joindre à ce nom chéri. «Non, ce sont des applaudissements; on crie: Vive le roi Jean Legras!» répéta la jeune fille à sa tante, et la vieille paralytique secoua tristement la tête. «A cette heure ils lui font fête, marmotta-t-elle; mais ce sont cris qui nous coûteront cher!»
D’autres cris s’élevaient, empreints d’une fureur sauvage. Les hommes et les femmes en délire qui entouraient le trône improvisé avaient dit à leur souverain et à leur esclave: «Sire, que ferons-nous de tous ces receveurs, traitants, usuriers qui nous ont opprimés et sucés si longtemps? Que ferons-nous de tous ces juifs qui s’engraissent aux dépens des chrétiens et qui payent si cher le régent de Paris pour les laisser, séjourner en notre pays?» La foule hurlait: «Justice! justice!»
Jean Legras était de plus en plus troublé ; il tremblait de tous ses membres et ses dents se heurtaient dans sa bouche lorsqu’il laiss a échapper ces mots: «Faites justice!»
Point ne fut besoin de quérir le bourreau de la ville, qui prudemment s’était réfugié dans l’église Saint-Maclou; cent exécuteurs de la sentence royale s’élancèrent par les rues et les places, fouillant les maisons des traitants, mettant le feu aux demeures où se tapissaient les usuriers juifs ou chrétiens. Le sang coulait dans les ruisseaux et les bras des furieux étaient rouges lorsqu’ils reparurent devant l’église Saint-Ouen, serrant de plus près le trône de Jean Legras. Les cadavres roulaient dans la Seine sous le vieux pont de Mathilde.
«Par la merci de Dieu! nous sommes délivrés des maires, pairs et prud’hommes, comme aussi de leurs sergents! criaient ceux qui revenaient en foule, affluant par toutes les avenues. Il nous ont opprimés d’année en année, se relayant sans cesse pour faire le mal. A cette heure ils se sont enfuis comme une volée d’arondeaux et nul ne saurait où les chercher pour les amener à leur tour en notre prétoire. On saura bien les retrouver un jour, quand ils ne craindront plus pour leur peau et commenceront à s’enquérir de leurs richesses; mais point ne serait-ce justice s’ils n’étaient châtiés en ce jour de liberté et de vengeance, eux qui ont fait condamner en leur tribunal tant d’innocents; leurs demeures sont là dans les plus belles rues de la ville, grandes et bien bâties, remplies de vaisselle d’or et d’argent, de belles tapisseries et de riches étoffes; ils n’ont eu ni cœur ni entrailles pour les pauvres; les pauvres ne seront-ils pas une fois maîtres en leur logis? Ordonnez, sire, ordonnez que justice soit faite! — J’ordonne!» balbutia Jean Legras.
«Sainte Marie, les voici!» cria Guillemette toujours à sa fenêtre; et elle se retira de quelques pas, cachant son pâle visage derrière le volet à demi fermé. Dans la rue du Grand-Pont, dans la rue Damiette, dans la rue des Gantiers, les forcenés, hache en main, accomplissaient leur œuvre de destruction sur les boiseries sculptées, sur les fines dentelles de pierre des fenêtres et des portes, sur les vitraux enchâssés dans des lames de plomb et formant d’élégants dessins. Les pioches atteignaient même les murailles et le feu secondait les efforts des démolisseurs.
Avant que les flammes eussent gagné du terrain, on avait aperçu plus d’un homme, plus d’une femme se glissant à la dérobée le long des murailles, un fardeau sur le dos ou des paquets dans les bras; les beaux meubles et les riches vaisselles des grands bourgeois n’étaient pas tous destinés à périr sous la hache ou sous l’incendie; les misérables chaumières des pillards recélèrent ce soir-là de précieux trésors.
Nul n’avait touché à la maison de Jean Legras, qui n’était si riche ni si grand marchand que la plupart de ceux dont les demeures avaient été abattues, sans quoi sa dignité d’un jour n’eût peut-être pas suffi à la protéger.
Guillemette s’était réfugiée à côté du fauteuil de sa tante; la paralytique avait fait un suprême effort, soulevant ses membres raidis, pour entourer de ses bras l’enfant frémissante. Les deux femmes murmuraient leurs prières. Le temps leur parut long avant que les cris cessassent aux environs de leur retraite. La foule s’était de nouveau rassemblée autour du trône où son élu se sentait mourir.
Les odieux traitants avaient disparu, les beaux hôtels des grands bourgeois n’insultaient plus à la misère du peuple; ceux qui avaient réussi à s’en échapper encombraient les églises et les cimetières, cherchant un asile auprès de Dieu et des morts. A la porte du majestueux monastère de Saint-Ouen, la pensée vint naturellement aux émeutiers de s’en prendre à ces moines orgueilleux, fiers de leurs privilèges, prétendant à haute et basse justice et ayant plus d’une fois eux-mêmes fait dresser des gibets. «Justice! justice!» criait-on autour de Jean Legras.
Le drapier hésita moins longtemps que de coutume; il avait eu naguère maille à partir avec le frère trésorier du monastère pour une fourniture de drap dont celui-ci n’avait pas été satisfait et qu’il avait refusé de payer le prix convenu. «Faites justice!» dit-il assez haut.
Le peuple ne l’écoutait pas. Déjà les lourdes portes du couvent avaient cédé sous le poids des barres de fer, sous les coups de hache et de pioche; la multitude se précipitait dans les salles, au réfectoire, dans les appartements particuliers de l’abbé. Celui-ci était agonisant, et les moines, pâles et blêmes, mais courageux dans leur dévouement, défendaient le repos de leur supérieur mourant.
Quelques forcenés s’ouvrirent un passage jusqu’au lit de mort. L’abbé Guillaume le Mercher gisait là sur une couche de cendres en signe de pénitence. Les coups de pied des furieux dispersèrent ce lit funèbre.
«Levez-vous! levez-vous! criaient-ils; venez avec vos moines en l’aitre de l’église; le roi de Rouen veut vous parler à vous et à vos moines, sans quoi vous allez tous mourir!»
L’abbé fit un geste de souverain mépris; il était à cette heure sur le point de répondre à un maître plus puissant et plus terrible que le peuple déchaîné lui-même; la compassion pour ses frères, tremblants autour de lui, ne l’avait pas abandonné.
«Soutenez-moi,» dit-il aux moines qui se pressaient autour de lui, et le mourant se releva pour se traîner jusqu’au trône de Jean Legras. Celui-ci ne prononçait pas les sentences et se bornait à les confirmer. Quelques hommes de loi de bas étage, aigris par l’insuccès né de leur mauvaise conduite, s’étaient mêlés aux émeutiers et dictaient les réclamations et les demandes: «Moines, plus de baronnies, plus de hautes justices, plus de baillis, plus de gibets, ou vous êtes morts. Le parlement de Paris vous a donné raison contre nous, parce que vous étiez riches et puissants et que nous étions, nous, pauvres et faibles; mais cette fois c’est nous qui rendons la justice; renoncez sur l’heure aux énormes dépens dont on nous a, par grand tort, grevés à votre profit; sinon, les coupe-têtes sont là, qui sauront faire leur devoir aussi bien que le vôtre et sans avoir depuis si longtemps pratiqué.»
L’abbé fit un signe: il demandait une plume. A peine sa main, glacée déjà par la mort, pouvait-elle tracer les lettres de son nom; il signa cependant, car il était pressé de s’en aller mourir. Le peuple poussait encore des cris féroces, lorsque les moines rentrèrent dans leur monastère à demi détruit et ravagé.
Les prêtres chargés de la garde du trésor de Notre-Dame étaient aussi à cette heure fort inquiets. Quelques bourgeois et gens de métier, plus instruits que le commun peuple dont se composait en grande partie la foule, avaient eu l’idée de courir à la cathédrale. Les prêtres et les serviteurs de l’archevêché s’étaient formés comme une pieuse milice autour du trésor de Notre-Dame, entourant de leur faible protection les reliques et les châsses, par-dessus tout la châsse de saint-Romain, qui sortait une fois chaque année du saint lieu pour donner la vie à un condamné. A côté de la châsse reposait la charte aux Normands enfermée dans un coffre d’or: elle avait naguère assuré la liberté aux Normands; à cette heure elle devait confirmer leurs nouveaux privilèges; la cathédrale fut envahie comme l’avait été le monastère.
Impossible était de se défendre: les prêtres furent bientôt repoussés, les chanoines du chapitre traînés à la suite de la précieuse charte.
La charte royale était sortie de son coffre; tous devaient la contempler en honorant le monarque qui l’avait accordée à son peuple, non sans quelque difficulté ; quatre bourgeois, la tête nue, soutenant un coussin d’or, élevaient parfois le précieux parchemin au-dessus de leur tête, afin de mieux montrer au peuple, qui s’empressait autour d’eux, le grand sceau de cire verte sur lequel était représenté Louis X, assis sur son trône, tenant son sceptre et son épée de justice.
Derrière les bourgeois, les chanoines, pâles et défaits, furent brusquement arrêtés en face du trône de Jean Legras. La populace semblait s’être calmée, dans cet intervalle de ses violences; on eût peut-être épargné les chanoines, si plusieurs d’entre eux n’avaient eu dans la population des ennemis secrets ou avoués, qui voyaient l’heure de la vengeance venue pour eux.
Déjà étaient ouvertes les prisons de l’official, où se trouvaient détenus ceux qui avaient commis quelque faute envers l’Église; le tribunal ecclésiastique était démoli; les chanoines devaient à leur tour payer leur dette à l’insurrection: on leur arracha les trois cents livres de rente dont ils jouissaient sur les halles de Rouen, et, comme plusieurs des vieillards semblaient accablés par le chagrin, on riait dans la foule en disant:
«Plaie d’argent n’est pas mortelle et le vénérable chapitre saura bien acquérir d’autres richesses!»
Les gens mal intentionnés marmottaient:
«Et nous saurons bien les en empêcher!»
«Silence! criait-on, silence!»
Les trompettes sonnaient, un espace au pied du trône avait été dégagé de la foule qui le couvrait; un échafaud avait été dressé à la hâte.
Thomas Poignant, bailli d’Harcourt, y monta bientôt, poussé par une grande crainte, car les insurgés le menaçaient d’abattre ses mai sons de la place de l’Abbaye, s’il ne lisait sur-le-champ, et de façon à ce que tous pussent l’entendre, le texte de la précieuse charte aux Normands.
Il demandait une plume.
Le pauvre bailli tremblait de tous ses membres, sa voix était mal assurée. «Plus haut! plus haut!» cria-t-on lorsqu’il commença de lire.
Au-dessus de ses accents indistincts retentissaient les tintements de la cloche de la commune. Depuis soixante-deux heures, toutes les cloches des églises et monastères étaient restées muettes; seule la cloche de la commune appelait le peuple, non à la prière et aux saints offices, mais à la démence, au pillage et au meurtre. Elle semblait redoubler ses efforts dans le grand silence qui s’était établi autour de Thomas Poignant.
Le bailli avait repris quelque courage. Les unes après les autres, toutes les promesses royales assurant les franchises de Ja province furent proclamées, comme elles l’avaient été, soixante-sept ans auparavant, aux oreilles d’un peuple qui n’en comprenait pas toutes les expressions, mais qui savait que ses libertés étaient depuis longtemps protégées par cet acte royal. «Jurez! jurez! criait-on de toutes parts, fidélité à la charte des Normands!»
Le premier, Jean Legras, dut prêter serment; on lui avait ôté sa couronne en signe de respect. Tous ceux qui n’avaient pas été massacrés parmi les officiers de la couronne furent traînés à sa suite, les chanoines tout tremblants, les maires de Saint-Ouen, de Sainte-Catherine, du Mont-des-Malades, de Bonnes-Nouvelles et tous les autres, les avocats, les bourgeois, et derrière eux tous les gens de petits métiers et le menu peuple, enivré de son triomphe, levaient la main en promettant de vivre et de mourir dans la dévotion aux droits de la province.
Pendant que s’accomplissait la cérémonie du serment, un avocat sans causes, perdu de dettes et de réputation, qui avait fort contribué à exciter la fureur du peuple, se glissa derrière le trône de Jean Legras, de nouveau revêtu de la pesante couronne dont il lui tardait de se débarrasser; il murmura quelques paroles à l’oreille du roi d’un jour.
A cette voix, qu’il reconnaissait comme ayant plus d’une fois présenté les conseils les plus violents et les plus perfides, Jean Legras tressaillit: il avait en haine et mépris ce Gilles Martel, originaire d’une famille honnête, dont il faisait le chagrin et la honte, et qui avait eu l’an passé l’audace de lui demander la main de sa fille Guillemette. Il n’avait pas encore abandonné ce fol espoir, car il disait derrière l’épaule du drapier:
«Messire beau-père, ne croiriez-vous pas que, pour sauver nos têtes et nos biens qui sont à cette heure en grand péril... (Jean Legras ne put s’empêcher de sourire à la pensée des biens de Gilles Martel), vous feriez sagement de faire jurer ici, à tous ceux, qui ont souffert en leurs corps et en leurs bourses pendant ces trois jours de la justice du peuple, qu’ils renoncent à toute idée de réparation et de vengeance? Ce serait sous peine de mort qu’ils refuseraient de prêter aujourd’hui serment. Ce sera précaution sage, car leur tour viendra, et nous serons alors fort menacés, vous le premier, messire beau-père, car vous avez tout bien voulu et commandé.»
Jean Legras secouait la tête, comme un homme qui sentait d’avance son danger, et ne se croyait pas bien assuré d’y échapper. «De si saintes gens ne voudraient pas violer leur serment, répéta Gilles Martel; faites jurer, faites signer!»
Les tabellions étaient là, qui reçurent toutes les signatures; les dernières furent écrites à la lueur des torches, et si difficiles à lire que plus d’un des signataires se promettait de ne pas reconnaître son sceau et sa main.
La nuit venue, les chanoines reprirent en liberté le chemin de leurs demeures; tous les moines étaient rentrés dans leurs monastères. Les riches bourgeois, dont les maisons avaient été détruites et pillées, se glissaient l’un après l’autre hors des églises et des cimetières, cherchant un refuge chez des amis ou des parents dont les biens avaient échappé à la fureur de la populace. Jean Legras descendit de son trône, toujours entouré de ses gardes, et fut solennellement reconduit à sa boutique.
Guillemette apparut sur le seuil; son inquiétude avait redoublé son courage naturel; elle fit un pas vers son père et le reçut dans ses bras, enlevant la lourde couronne, signe de son humiliation, et le forçant de s’asseoir sur une chaise à oreillers qu’elle avait descendue à cet effet de la chambre de sa tante.
Elle lui essuyait le front, sans s’inquiéter des assistants; quelques-uns l’admiraient tout haut, quelques-uns criaient: «Noël pour la princesse Guillemette!»
Mais la fatigue commençait à gagner les plus forcenés; le drapier s’était relevé, entourant sa fille de ses bras, rouge de colère et redoutant pour elle les insultes de la populace. «Il ne faut pas courroucer notre roi!» dirent les mieux intentionnés. Déjà les rangs s’étaient éclaircis. La foule s’écoulait peu à peu, la boutique se trouva vide.
Guillemette s’élança vers les volets, qu’elle ferma; puis, tirant derrière elle la porte, elle la verrouilla avec soin. «Venez souper, mon père, dit-elle, ma tante vous attend en sa chambre, à demi morte de peur. Quand vous serez reposé, nous aviserons...» Le drapier avait laissé retomber sa tête sur sa poitrine; il chancelait lorsqu’il se leva pour suivre Guillemette. «Je suis un homme perdu! un homme perdu!» murmurait-il.