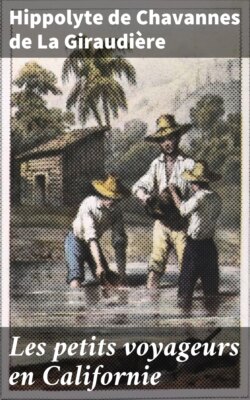Читать книгу Les petits voyageurs en Californie - Hippolyte de Chavannes de La Giraudière - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TRAVERSÉE DU HAVRE A NEW-YORK.
ОглавлениеSix semaines plus tard, M. Canton, Vincent et Arthur descendaient du wagon qui les avait conduits de Paris au Havre, où ils devaient s’embarquer pour New-York; car M. Canton, pour gagner du temps, s’était décidé à se rendre à San-Francisco par l’isthme de Panama. Ce chemin est beaucoup plus court que celui que suivent les bâtiments qui font le tour de l’Amérique méridionale et doublent le cap Horn. Ce dernier trajet est, en effet, de vingt-huit mille kilomètres, et exige une navigation de cinq à six mois. Par l’isthme de Panama, au contraire, la distance à parcourir est presque de moitié moins longue, et de plus un service de bateaux à vapeur l’abrège encore par la régularité dé la marche des paquebots.
M. Canton aurait pu trouver au Havre un navire qui l’eùt transporté à Panama en droiture, comme disent les marins; mais il préféra se rendre d’abord à New-York pour y retenir sa place sur le bateau à vapeur qui fait le service entre l’isthme de Panama et San-Francisco. Sans cette précaution, il eût été exposé à séjourner pendant plusieurs mois dans l’isthme, par suite de l’excessive affluence des voyageurs. En passant par New-York, il avait le très-grand avantage d’assurer ses places au siége même de la compagnie américaine des paquebots sur l’océan Pacifique.
Ce fut le 1er mars 1849 que M. Canton et ses deux fils s’embarquèrent sur l’Albany. C’était un magnifique navire de six cents tonneaux, appartenant à la marine américaine, et qui faisait habituellement le trajet entre le Havre et New-York. Quoique l’Albany ne fût pas spécialement destiné au transport des passagers, comme les paquebots, il avait sur l’arrière une dunette divisée en plusieurs petits cabinets qui contenaient chacun deux lits placés l’un au-dessus de l’autre, une armoire à plusieurs rayons, des porte-manteaux, un lavabo garni de tous ses accessoires, une chaise et un pupitre pour écrire. Ces cabinets, dont le vrai nom est cabines, étaient rangés des deux côtés d’une chambre assez spacieuse dans laquelle s’ouvraient leurs portes. Cette chambre servait de salle commune pour les passagers et les officiers du bâtiment; c’était à la fois le salon et la salle à manger.
M. Canton choisit une cabine pour lui seul, et installa Vincent et Arthur dans celle qui se trouvait à côté de la sienne.
Comme le navire devait partir pendant la nuit, à l’heure de la marée, et que ses enfants étaient très-fatigués, parce qu’ils avaient passé la nuit précédente en chemin de fer, M. Canton les conduisit à bord de l’Albany vers les neuf heures du soir, et leur conseilla de se coucher. Arthur et Vincent auraient bien voulu jouir du spectacle si nouveau pour eux que leur offrirait l’appareillage du navire qui les portait; mais leur père leur représenta qu’ils ne verraient pas grand’chose puisqu’il ferait nuit, et qu’il pourrait leur arriver quelque accident au milieu des manœuvres multipliées d’un appareillage nocturne. «Vous avez d’ailleurs, ajouta M. Canton, un tel besoin de sommeil, que vous dormez debout.»
Arthur et Vincent entrèrent dans leur cabine, et se récrièrent aussitôt sur son exiguïté. «Nous ne pourrons jamais nous déshabiller là-dedans, dit Arthur, nous n’avons pas seulement la place de nous retourner!
— Je le crois bien, répondit M. Canton, si vous ne commencez pas par ranger tous ces paquets que vous avez laissés au milieu de votre appartement. Videz-moi ces deux sacs de nuit et votre malle, casez-en le contenu dans votre armoire et sur vos tablettes, accrochez vos habits au porte-manteau, et quand votre malle et vos sacs seront vides, mettez-les à la porte de votre cabine, où je les ferai prendre par le mousse, qui les serrera jusqu’à notre arrivée à New-York.»
Nos deux jeunes gens se mirent aussitôt à l’ouvrage. Arthur fouillait dans la malle et tendait à son frère les objets qu’il en retirait. Celui-ci, d’après leur volume et leur nature, tâchait de leur trouver une place convenable; car il ne s’agissait pas uniquement de les loger, mais aussi de les arranger de manière à ne pas être obligé de déplacer vingt objets pour atteindre celui dont son frère ou lui aurait besoin. Au bout d’une heure de travail, Vincent, après avoir plusieurs fois changé son système de distribution, était non-seulement parvenu, à son grand étonnement, à caser les chemises, les bas, les mouchoirs, les chaussures, avec un ordre qui eût fait envie à la maîtresse de maison la plus difficile, mais à réserver plusieurs petits coins pour les livres, les boîtes et tous ces riens auxquels les écoliers attachent tant de prix, et qu’ils appellent pompeusement leurs affaires.
Quand cet emménagement fut terminé, et quand la cabine fut débarrassée de la malle, du sac de nuit et de deux ou trois paquets, Vincent et Arthur s’y trouvèrent presque à l’aise, et après avoir fait leurs prières du soir, ils se couchèrent dans les deux espèces de tiroirs superposés qui tiennent lieu de lits dans les bâtiments, et où ils se trouvèrent beaucoup mieux qu’ils ne l’avaient cru avant de s’y étendre.
Pendant quelques minutes ils causèrent de choses et d’autres, mais bientôt Arthur cessa de répondre à une question de son frère: il s’était endormi. Alors Vincent souffla la bougie et ne tarda pas à faire comme Arthur.
Ils dormaient encore d’un profond sommeil lorsqu’ils furent éveillés par la voix de leur père, qui leur disait:
«Hé bien! hé bien! est-ce que vous comptez dormir jusqu’en Amérique? Levez-vous vite si vous voulez dire adieu à l’Europe.
— Nous sommes donc partis? demanda Arthur.
— Sans doute, puisque la beauté du temps nous permet seule de voir encore la côte de France.
— Voilà une agréable manière de voyager, dit Vincent. On dort très-tranquillement dans un bon lit, et l’on fait route sans s’en apercevoir... Vite, Arthur, levons-nous, et allons voir ce qui se passe là-haut.»
En prononçant ces paroles, Vincent sauta lestement par terre. Mais en mettant le pied sur le plancher, il perdit l’équilibre, et n’eut que le temps, pour ne pas tomber, de s’accrocher des deux mains au rebord de son lit.
«Ho! ho! dit-il, il parait que je n’ai pas encore le pied marin! Etant couché, je croyais tout bonnement que c’était mon lit qui était en pente, mais c’est le navire tout entier. Ainsi, Arthur, défie-t’en quand tu te lèveras; car j’ai manqué de l’apprendre aux dépens de mon front.»
Les deux frères, quoique les mouvements du navire légèrement incliné fussent très-moelleux et peu sensibles, éprouvèrent une certaine difficulté à vaquer au soin de leur toilette. Arthur en passant son pantalon trébucha et trouva fort à propos la cloison pour le soutenir. Cet apprentissage de la vie maritime amusa, du reste, beaucoup nos jeunes gens, à qui chaque faux pas fournissait le sujet d’une plaisanterie ou d’un éclat de rire.
Quand ils furent habillés, ils sortirent de leur cabine, et ne trouvèrent dans la salle commune qu’un domestique qui mettait sur la table des tasses et tout ce qui était nécessaire pour prendre le thé. Ce domestique leur dit que M. Canton se promenait sur le pont. A peine eurent-ils mis le pied hors de la chambre, qu’ils virent leur père au milieu d’un groupe de passagers. Vincent et Arthur coururent vers lui et l’embrassèrent. M. Canton présenta ses enfants à ses compagnons de voyage, parmi lesquels se trouvait une dame. La physionomie franche et ouverte de nos jeunes gens prévint chacun en leur faveur, et la dame surtout leur témoigna un intérêt marqué.
Après avoir satisfait aux devoirs de la politesse et répondu convenablement à plusieurs questions qu’on leur adressa, les deux frères se retirèrent un peu à l’écart, et se mirent à promener autour d’eux leurs regards curieux et surpris, et à se communiquer mutuellement leurs impressions.
La première chose que leurs yeux cherchèrent, ce fut le Havre et le rivage qu’ils venaient de quitter. Pendant quelques instants, ils ne virent de tous côtés que l’immense Océan. En vain interrogeaient-ils les profondeurs de l’horizon, ils n’y découvraient çà et là que de longues traînées de nuages qui semblaient reposer sur la mer. Enfin Arthur découvrit une petite ligne grise qui se détachait dans le sud-est, et eut beaucoup de peine à la faire apercevoir à Vincent. Celui-ci, trompé par la direction que suivait le navire, qui courait dans le nord-ouest, prétendit que la terre ne devait pas se trouver de ce côté-là, mais derrière le bâtiment, qui s’en éloignait, et il voulut persuader à Arthur que ce qu’il prenait pour la terre n’était qu’une bande de nuages.
Cette discussion aurait peut-être duré longtemps, si M. Canton, qui se rapprocha de ses fils, ne l’eût terminée en donnant raison aux yeux perçants d’Arthur, et en expliquant à Vincent la route que tenait le navire.
«Quand vous voudrez la connaître, ajouta M. Canton, vous n’aurez qu’à jeter un coup d’œil sur la boussole, qui se trouve là-bas devant le timonier, et son aiguille vous l’indiquera toujours d’une manière certaine.»
Vincent et Arthur employèrent la première journée qu’ils passèrent à bord à examiner le navire et à se rendre compte de la disposition et de l’effet des voiles. Tout ce qu’ils observaient était pour eux un sujet d’étonnement et d’admiration. Ce qui les frappait le plus, c’était de voir avec quelle facilité, quelle précision une masse pareille obéissait à la main du timonier comme un cheval bien dressé. Trois ou quatre fois le navire vira de bord, et ce fut un spectacle saisissant pour nos deux jeunes gens que celui que leur offrirent les trois pyramides de voiles superposées que soutenait la triple mâture du bâtiment, pivotant avec leurs vergues. L’évolution de toutes ces voiles, exécutée par quelques matelots qui maîtrisaient avec autant de rapidité que d’aisance la force immense contenue en elles, cette évolution, dis-je, parut à Arthur et à Vincent la plus grande preuve de la puissance humaine dont ils eussent encore été témoins.
Je regrette bien, chers lecteurs, que les limites que je dois m’imposer ne me permettent pas de vous raconter en détail, et jour par jour, comment les deux frères employèrent leur temps pendant la traversée du Havre à New-York. Sans parler de toutes les choses qu’ils apprirent, grâce aux explications que leur donnèrent M. Canton et le capitaine du bâtiment, qui s’exprimait parfaitement en français, ils se familiarisèrent avec le grand art de la navigation et parvinrent à se former une idée générale, et cependant exacte, de la construction d’un navire, du mécanisme de son gréement, de l’effet de ses voiles, de ses diverses allures, des procédés par lesquels le capitaine et ses officiers dirigent leur route et estiment les distances parcourues.
Arthur et Vincent n’avaient jamais vu ni mer ni navires avant d’arriver au Havre; ils en étaient, par conséquent, à leur première traversée, et cependant, bien loin de ressembler à ces voyageurs qui ont fait presque le tour du monde sans se rendre compte de la merveilleuse machine qui les a transportés à travers l’Océan, Arthur et Vincent, en touchant au sol américain, savaient tout ce que doit savoir en marine un homme qui n’en fait pas son métier.
Le trente-deuxième jour après leur départ de France, le navire jeta l’ancre dans la baie de New-York, l’une des plus belles, des plus vastes et des plus sûres de l’univers; le navire qui s’engage dans cette baie en franchissant le détroit de Narrows, par lequel elle communique avec l’Océan, jouit d’un coup d’œil ravissant. Il s’avance ayant à droite et à gauche une campagne verdoyante parsemée de fermes, de maisons de plaisance et de gros villages. Les arbres qui ombragent les côtes semblent, à une certaine distance, descendre jusque dans les eaux de la baie. Devant lui se dressent les clochers de la capitale des Etats-Unis, et, tout à fait dans le fond, les bords escarpés de l’Hudson, rivière importante, qui, au moyen de quelques travaux de canalisation, met la ville de New-York en communication avec le lac Érié et le lac Ontario.
Pendant le peu de jours que M. Canton fut obligé de séjourner à New-York pour assurer ses places sur les paquebots de la mer Pacifique et attendre le départ du bateau à vapeur de Chagres, il consacra quelques heures à visiter New-York avec ses fils. Arthur et Vincent admirèrent la régularité de cette ville populeuse et florissante, dont la plupart des rues se coupent à angle droit. En voyant ses entrepôts, ses immenses magasins, ses édifices vastes et élégants, ses maisons monumentales, les montagnes de marchandises que chargeaient ou déchargeaient une multitude de navires sous tous pavillons, ils ne pouvaient comprendre comment cette cité, qui, d’après ce que leur disait leur père, n’était, il y a moins de cent ans, qu’une agglomération de constructions en bois séparées par des rues sales et étroites où se pressait une population s’élevant à peine à vingt mille personnes, ils ne pouvaient comprendre, dis-je, comment cette cité avait pu, en si peu d’années, prendre un tel accroissement, changer si complétement d’aspect, et devenir un des ports les plus importants du monde ntier.
Mais la chose qui trompa singulièrement les prévisions d’Arthur et de son frère, quand ils débarquèrent en Amérique, ce fut non-seulement de rencontrer une ville qui ne différait en rien des villes européennes, et dont les habitants, habillés comme à Paris, paraissaient avoir la même manière de vivre que les négociants du Havre, mais de rencontrer, dans une rapide excursion à la campagne, les mêmes arbres, les mêmes fruits, les mêmes animaux domestiques qu’en Normandie. Nos jeunes gens s’étaient imaginé qu’en mettant le pied de l’autre côté de l’Atlantique ils allaient se trouver dans un monde entièrement nouveau, et ils se demandaient s’ils étaient bien réellement à près de huit mille kilomètres des rivages de France.
Il est certain qu’un examen plus attentif et plus approfondi leur eût fait apercevoir que, quoique située sous un climat qui ne diffère pas sensiblement de celui de la France, la partie du continent américain où ils étaient descendus avait des productions, une agriculture et une physionomie qui lui étaient propres; mais pour saisir ces nuances d’un premier coup d’oeil, jeté, pour ainsi dire, en courant, il aurait fallu des esprits plus mûrs et plus habitués à l’observation que ceux d’Arthur et de Vincent.