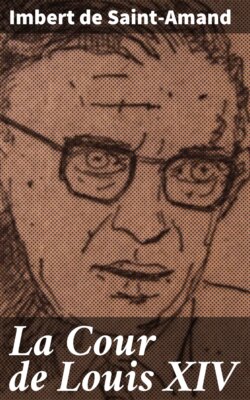Читать книгу La Cour de Louis XIV - Imbert de Saint-Amand - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Avant de rappeler le rôle que les femmes de Versailles ont joué, il faut dire quelques mots du théâtre sur lequel leurs destinées se sont accomplies et montrer par quelle transformation miraculeuse un endroit triste et sombre, plein de sables mouvants et de marécages, sans vue, sans eau, sans forêt, fut façonné, pour ainsi dire, à l'image du Grand Roi, et devint une merveille, objet de l'admiration du monde entier. Comme ces grands fleuves qui, à leur source, sont à peine un petit ruisseau, l'existence du palais destiné à tant de splendeur commença dans les proportions les plus modestes.
C'est en 1624 que Louis XIII fit bâtir à Versailles un rendez-vous de chasse sur une éminence où il y avait auparavant un moulin à vent. En 1627, dans une assemblée de notables tenue aux Tuileries, Bassompierre reprochait au roi de ne pas achever les bâtiments de la couronne, et il disait à ce propos:
«L'inclination de Sa Majesté n'est point portée à bâtir; les finances de la chambre ne seront point épuisées par ses somptueux édifices, si ce n'est qu'on veuille lui reprocher le chétif château de Versailles, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité[1].»
[Note 1: Voir, sur les origines du palais, le curieux et savant ouvrage publié par M. Le Roi sous ce titre: Louis XIII et Versailles.]
En 1651, huit ans après la mort de son père, Louis XIV, alors dans sa treizième année, vint pour la première fois à Versailles. Il s'attacha dès lors à ce séjour, et quelques années plus tard il le choisit pour y donner des fêtes magnifiques. Au mois de mai 1664, il y fit célébrer les Plaisirs de l'île enchantée, divertissements empruntés au poème de l'Arioste, à l'exécution desquels concoururent Benserade et le président de Périgny pour les récits en vers, Molière et sa troupe pour la comédie, Lulli pour la musique et les ballets, le machiniste italien Vigarani pour les décors, les illuminations et les feux d'artifice.
Le 7 mai, première journée des fêtes, il y eut une course de bagues en présence des deux reines[1], dans un cirque de verdure élevé à l'entrée de ce qu'on nomme aujourd'hui le tapis vert.
[Note 1: Anne d'Autriche et Marie-Thérèse.]
Le jeune Louis XIV, vêtu d'un costume où tous les diamants de la couronne resplendissaient, représentait le paladin Roger dans l'île d'Alcine. Après le tournoi, dont il fut le vainqueur, Flore et Apollon arrivèrent, pour le féliciter, sur des chars que traînaient les nymphes, les satyres, les dryades. Au banquet, le Temps, les Heures, les Saisons, servirent les convives, abrités, sous des bosquets de lilas, de muguets et de roses. Le lendemain, 8 mai, on représenta, sur un théâtre élevé au milieu de la même allée, la Princesse d'Élide, pièce dans laquelle Molière jouait les rôles de Lyciscas et de Moron. Le 9, ballet dans le palais d'Alcide, avec feu d'artifice qui en simulait l'embrasement; le 10, course de têtes dans les fossés du château; le 11, représentation des Fâcheux, de Molière; le 12, loterie où se trouvaient des ameublements, des pièces d'argenterie, des pierres précieuses, et, le soir, le Tartuffe; le 13, le Mariage forcé; le 14, départ du roi et de la cour pour Fontainebleau.
Versailles n'était pas encore la résidence royale; mais Louis XIV venait de temps en temps y passer quelques jours, parfois quelques semaines, surtout quand il voulait éblouir les yeux et fasciner les imaginations par l'éclat de ces fêtes pompeuses qui ressemblaient à des apothéoses.
Le 14 septembre 1665, il y eut à Versailles une grande chasse, où la reine, Madame Henriette d'Angleterre, Mlle de Montpensier, Mlle d'Alençon, chassèrent en costume d'amazones; et, au mois de février 1667, un carrousel qui recula les bornes de la magnificence.
La Gazette a soin de nous décrire le cortège des dames de la cour, «toutes admirablement équipées et sur des chevaux choisis, conduites par Madame, avec une veste des plus superbes, et sur un cheval blanc houssé de brocart, semé de perles et de pierreries.» Après l'escadron féminin apparaissait le Roi-Soleil, «ne se faisant pas moins connaître à cette haute mine qui lui est particulière qu'à son riche vêtement à la hongroise, couvert d'or et de pierres précieuses, avec un casque ondoyé de plumes, et à la fierté de son cheval, qui semblait plus superbe de porter un si grand monarque que de la magnificence de son caparaçon et de sa housse pareillement couverte de pierreries[1].» Venaient ensuite: Monsieur, frère du roi, en costume de Turc, puis le duc d'Engien, habillé en Indien, puis les autres seigneurs, qui formaient dix quadrilles.
[Note 1: Gazette de 1667.]
Le 10 juillet 1668, nouvelles réjouissances: dans la journée, représentation des Fêtes de l'Amour et de Bacchus, paroles de Quinault, musique de Lulli, et de Georges Dandin, joué par Molière et par sa troupe; le soir, festin et bal; à 2 heures du matin, illuminations. Le pourtour du parterre de Latone, la grande allée, la terrasse et la façade du palais étaient décorés de statues, de vases, de candélabres éclairés d'une manière ingénieuse, qui les faisait paraître comme enflammés à l'intérieur. Les fusées des feux d'artifice se croisaient au-dessus du château, et, lorsque toutes ces lumières s'éteignaient, dit Félibien en terminant le récit de la fête, on s'aperçut que le jour, «jaloux des avantages d'une belle nuit,» commençait à poindre.
Le 17 septembre 1672, la troupe du roi représentait les Femmes savantes de Molière, qui furent, dit la Gazette, «admirées d'un chacun.» Du 8 février au 19 avril 1674, Bourdalouc prêchait le carême à Versailles; le 11 juillet, on y jouait le Malade imaginaire de Molière, mort l'année précédente; au mois d'août, il y avait une série de grandes fêtes. Félibien fait une description saisissante de la nuit du 31 août 1674, où l'on vit tout à coup, sous un ciel sans étoiles et du noir le plus sombre, un ruissellement inouï de lumières. Tous les parterres étincelaient. La grande terrasse qui est devant le château était bordée d'un double rang de feux espacés à deux pieds l'un de l'autre. Les rampes et les degrés du fer à cheval, tous les massifs, toutes les fontaines, tous les bassins resplendissaient de mille flammes. De l'Italie était venu cet art pyrotechnique, ce mélange de feux, de fleurs et d'eau, qui faisait ressembler le parc au jardin d'Armide. Les rives du grand canal étaient ornées de statues et de décorations d'architecture, derrière lesquelles on avait disposé un nombre infini de lumières qui les faisaient paraître transparentes. Le roi, la reine et toute la cour étaient sur des gondoles richement ornées. Des bateaux remplis de musiciens les suivaient, et l'écho répétait les sons d'une harmonie magique.
A partir de l'année suivante, de grands travaux, commencés par Levau et Dorbay, continués par Jules Hardouin Mansart, furent entrepris à Versailles, où Louis XIV voulait fixer sa résidence définitive. Quels motifs le déterminaient à renoncer à ce château de Saint-Germain où il était né, à ce château si admirablement situé, d'où l'on découvre un si beau fleuve, un si vaste et si magnifique horizon? Rien ne manque à Saint-Germain, ni les arbres, ni l'eau, ni la vue. L'air y est vif et salubre, et, du haut de la terrasse adossée à la forêt, on contemple un des panoramas les plus variés et les plus majestueux du globe.
Si Louis XIV avait dépensé pour embellir et agrandir le vieux château,--celui qui existe encore,--et le château neuf,--celui qui était situé en face de la Seine et qui fut détruit sous Louis XVI,--la moitié des sommes dépensées pour Versailles, quel incomparable palais, quelles merveilles aurait-on admirés! Que n'aurait-on pas pu faire du château neuf de Saint-Germain,--il n'en reste aujourd'hui que le pavillon Henri IV,--de ce château si élégant, dont les escaliers paraissaient de loin comme des arabesques en relief incrustées sur le flanc de la colline, et dont les cinq terrasses successives, ornées de bosquets, de bassins, de parterres de fleurs, descendaient jusqu'à la Seine? Comment préférer à une telle résidence, à un tel paysage, un manoir obscur sans perspective, entouré d'étangs fangeux, sur un terrain où, au lieu d'être favorisé par la nature, il fallait la tyranniser, la dompter à force d'art et d'argent?
Était-ce, comme on l'a dit, la vue lointaine du clocher de Saint-Denis, dernier terme de la grandeur royale, qui rendait Saint-Germain antipathique à Louis XIV? Ce clocher, qui semblait lui dire à l'horizon: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris, contrariait-il l'ivresse de vie et de toute-puissance qui débordait en lui?
Cette pensée pusillanime nous semble indigne du Grand Roi. Nous inclinons plutôt à croire que ce qui éloignait Louis XIV de Saint-Germain, c'était le souvenir du temps où, chassé de Paris par les troubles de la Fronde, il fut transporté nuitamment dans le vieux château. Sans doute il n'aimait pas voir, de sa fenêtre, cette capitale qui avait insulté son enfance.
S'arracher à un souvenir importun, effacer complètement, même dans la pensée, les derniers vestiges des actes de rébellion contre l'autorité royale, choisir une résidence qui n'était rien pour en faire le plus radieux des palais, se complaire dans cette transformation comme dans le triomphe de la puissance, de l'orgueil, de la force de volonté, tout créer soi-même: architecture, jardins, fontaines, horizon, contraindre la nature à plier sous le joug et à s'avouer vaincue, comme la révolution: tel fut le rêve de Louis XIV, et ce rêve il le réalisa.
De 1675 à 1682, les travaux de Versailles se poursuivirent avec une étonnante activité. On acheva les grands appartements du roi et l'escalier dit des Ambassadeurs. On construisit la galerie des Glaces, à l'endroit où une terrasse occupait le milieu de la façade, du côté des jardins. On ajouta au château l'aile du midi, dite aile des Princes. On termina, à droite et à gauche, les bâtiments qui bordent la première cour avant le château, et qu'on désigne sous le nom d'ailes des Ministres. On éleva la grande et la petite écurie.
Enfin, en 1681, on transporta la chapelle sur l'emplacement actuel du salon d'Hercule et du vestibule qui se trouve au-dessous. Le 30 avril 1682, l'archevêque de Paris, François de Harlay, bénit la nouvelle chapelle, et, le 6 mai suivant, Louis XIV s'installa définitivement à Versailles[1].
[Note 1: Si l'on veut se rendre compte des agrandissements de Versailles, on n'a qu'à regarder le tableau de Van der Meulen, qui est dans l'antichambre du roi (salle N° 121 de la Notice du Musée, par M. Soulié). Ce tableau, qui porte le N° 2145, représente Versailles tel qu'il était avant les travaux ordonnés par Louis XIV.]
Le roi s'établit au centre même du palais. Le salon dit oeil-de-Boeuf[2] était alors divisé en deux pièces: la chambre des Bassans, ainsi nommée parce qu'elle contenait plusieurs tableaux de ce maître,--c'est là qu'attendaient les princes et seigneurs admis au lever du souverain,--et l'ancienne chambre de Louis XIII, où Louis XIV coucha de 1682 à 1701. A côté de cette chambre était le grand cabinet, où se faisaient les cérémonies du lever et du coucher, où le roi donnait audience au nonce et aux ambassadeurs, où il recevait le serment des grands officiers de sa maison[3]. La salle suivante[4] était alors séparée en deux. La partie la plus rapprochée de la chambre du roi se nommait le cabinet du Conseil,--c'est là que Louis XIV prit avec ses ministres les plus grandes décisions de son règne;--l'autre se nommait le cabinet des Termes ou des Perruques.
[Note 2: Salle N° 123 de la Notice du Musée.] [Note 3: Salle N° 124 de la Notice. Cette pièce devint la chambre à coucher de Louis XIV, et c'est là qu'il mourut.] [Note 4: Salle du Conseil (N° 125 de la Notice).]
La reine et le dauphin eurent leur logement, l'une au premier étage, l'autre au rez-de-chaussée, dans la portion méridionale de l'ancien château de Louis XIII, celle qui domine l'orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Les appartements de la reine aboutissaient, par le salon de la Paix, à la galerie des Glaces, le chef-d'oeuvre du nouveau Versailles. A l'autre extrémité de la galerie commençaient, avec le salon de la Guerre, les salles désignées sous le nom de grands appartements du roi, pièces d'apparat et de réception, portant des noms mythologiques: salle d'Apollon, de Mercure, de Mars, de Diane, de Vénus.
Le gouverneur du palais et le confesseur du roi logèrent dans l'aile du nord, celle qu'a depuis reconstruite l'architecte Gabriel. Au-delà de l'emplacement où est la chapelle actuelle, on plaça les princes de Condé et de Conti, le gouverneur des enfants de France et un bon nombre de grands officiers et de chapelains. Dans la grande salle du midi, les enfants de France et la famille d'Orléans habitèrent en face des jardins. Enfin, les secrétaires d'État, ministres de la maison du roi, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, s'installèrent dans les deux corps de bâtiment devant lesquels s'élèvent aujourd'hui les statues d'hommes célèbres. L'ensemble de ces immenses constructions, subdivisées à l'infini dans l'intérieur, servait d'habitation à plusieurs milliers d'individus.
Versailles était achevé. A part très peu de modifications, il offrait l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Du côté de la ville, le monument, quoique grandiose, est disparate. Son architecture composite, le contraste qui se fait remarquer entre la brique et la pierre, entre le château primitif et ses immenses accroissements, a quelque chose qui étonne. De l'autre côté, celui du parc, tout, au contraire, est majestueux, régulier, empreint d'une harmonie parfaite. Cette façade ou, pour mieux dire, ces trois façades, ayant ensemble trois cent soixante-quinze ouvertures sur le jardin; ce corps de bâtiment où habite le maître, et qui fait saillie au milieu d'une longue ligne droite; ces ailes qui semblent se reculer, comme pour garder une respectueuse distance; ces bosquets façonnés en murailles de verdure, ces bassins encadrés dans des marbres précieux, dépendant du palais, dont ils sont le complément, tout cela frappe l'esprit et les yeux d'un véritable saisissement.
Jamais peut-être la splendeur d'un palais ne s'est mieux identifiée avec la grandeur d'un homme.
L'idole est digne du temple, le temple digne de l'idole. Il y a toujours dans les monuments quelque chose d'immatériel, de moral, pour ainsi dire, et ils empruntent leur poésie à la pensée qui s'y rattache. C'est, pour une cathédrale, l'idée de Dieu. C'est, pour Versailles, l'idée du Roi. La mythologie, comme on en a fait la juste remarque, n'est plus qu'une allégorie magnifique dont Louis XIV est la réalité. C'est lui partout, lui toujours. Les héros, les divinités de la fable, ne font que lui prêter leurs attributs ou se mêler à ses courtisans.
En son honneur, Neptune fait jaillir de toutes parts les eaux qui se croisent dans les airs en voûtes étincelantes. Apollon, son symbole favori, préside à ce monde enchanté, comme le dieu de la lumière, l'inspirateur des Muses; le soleil du dieu paraît s'humilier devant celui du roi: Nec pluribus impar. La nature et l'art s'unissent pour célébrer par un hosanna perpétuel la gloire du souverain.