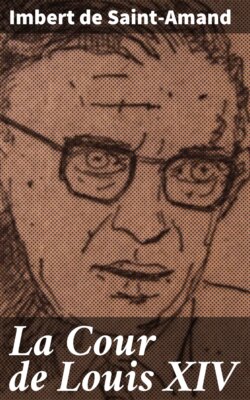Читать книгу La Cour de Louis XIV - Imbert de Saint-Amand - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
La profonde impression que Versailles m'avait produite pendant les jours de la Commune est loin de s'être affaiblie depuis ce moment. Des circonstances bien imprévues ont fait occuper les appartements de la reine par la direction politique du ministère des Affaires étrangères. Ma modeste table de travail a été, une année, placée au bout de la salle du Grand-Couvert, en face du tableau qui représente le doge Imperiali s'humiliant devant Louis XIV, et j'ai eu le temps de réfléchir sur les péripéties étranges, sur les caprices du sort, par suite desquels les employés du ministère dont je fais partie étaient, pour ainsi dire, campés au milieu de ces salles légendaires.
Les cinq pièces qui composent l'appartement de la reine ont toutes une importance historique. A chacune se rattachent les plus curieux souvenirs. Vous montez l'escalier de marbre. A droite est la salle des gardes de la reine. C'est là que, le 6 octobre 1789, à 6 heures du matin, les gardes du corps, victimes de la fureur populaire, défendirent avec tant de courage, contre une bande d'assassins, l'entrée de l'appartement de Marie-Antoinette. La salle suivante est celle du Grand-Couvert. C'est là que les reines dînaient solennellement, en compagnie des rois; ces festins d'apparat avaient lieu plusieurs fois par semaine, et le peuple était admis à les contempler. Non seulement comme reine, mais déjà comme dauphine, Marie-Antoinette se soumit à cette bizarre coutume. «Le dauphin dînait avec elle, nous dit Mme Campan dans ses Mémoires, et chaque ménage de la famille royale avait tous les jours son dîner public. Les huissiers laissaient entrer tous les gens proprement mis. Ce spectacle faisait le bonheur des provinciaux. A l'heure des dîners, on ne rencontrait dans les escaliers que de braves gens qui, après avoir vu la dauphine manger sa soupe, allaient voir les princes manger leur bouilli et qui couraient ensuite, à perte d'haleine, pour aller voir Mesdames manger leur dessert.»
Après la salle du Grand-Couvert est le salon de la Reine. Le cercle de la souveraine se tenait dans cette pièce, où l'on faisait les présentations. Son siège était placé au fond de la salle, sur une estrade couverte d'un dais dont on voit encore les pitons d'attache dans la corniche en face des fenêtres. C'est là que brillèrent les beautés célèbres de la cour de Louis XIV, avant que le roi allât s'emprisonner dans les appartements de Mme de Maintenon. C'est là que le président Hénault et le duc de Luynes venaient sans cesse causer avec cette aimable et bonne Marie Leczinska, en qui chacun se plaisait à reconnaître les vertus d'une bourgeoise, les manières d'une grande dame, la dignité d'une reine. C'est là que Marie-Antoinette, la souveraine à la taille de nymphe, à la marche de déesse, à l'aspect doux et fier digne de la fille des Césars, recevait, avec cet air royal de protection et de bienveillance, avec ce prestige enchanteur dont les étrangers emportaient le souvenir à travers l'Europe comme un éblouissement.
La pièce suivante est, de toutes, celle qui évoque le plus de souvenirs. C'est la chambre à coucher de la reine, la chambre où sont mortes deux souveraines: Marie-Thérèse et Marie Leczinska; deux dauphines: la dauphine de Bavière et la duchesse de Bourgogne;--la chambre où sont nés dix-neuf princes et princesses du sang, et parmi eux deux rois, Philippe V, roi d'Espagne, et Louis XV, roi de France;--la chambre qui, pendant plus d'un siècle, a vu les grandes joies et les suprêmes douleurs de l'ancienne monarchie.
Cette chambre a été occupée par six femmes: d'abord par la vertueuse Marie-Thérèse, qui s'y installa le 6 mai 1682, et y rendit le dernier soupir, le 30 juillet de l'année suivante;--ensuite par la femme du Grand Dauphin, la dauphine de Bavière, qui y mourut le 20 avril 1690, à l'âge de vingt-neuf ans; puis par la charmante duchesse de Bourgogne, qui s'y établit dès son arrivée à Versailles, le 8 novembre 1696, y mit au monde trois princes, dont le dernier seul vécut et régna sous le nom de Louis XV, et y mourut le 12 février 1712, à l'âge de vingt-six ans;--puis par cette infante d'Espagne, Marie-Anne-Victoire, qui était fiancée avec le jeune roi de France, et qui demeura là, depuis le mois de juin 1722 jusqu'au mois d'avril 1725, époque où le mariage projeté fut rompu;--ensuite par la pieuse Marie Leczincka, qui s'installa dans cette chambre le 1er décembre 1725, y donna naissance à ses dix enfants, y habita pendant un règne de quarante-trois ans, y mourut le 24 juin 1768, entourée de la vénération universelle;--enfin par la plus poétique des femmes, par celle qui résume en elle les triomphes et les humiliations, les joies et les douleurs, par celle dont le nom seul inspire l'attendrissement et le respect, par Marie-Antoinette. C'est là que vinrent au monde ses quatre enfants et qu'elle faillit mourir à la naissance de sa première fille, la future duchesse d'Angoulême. Une antique et bizarre étiquette autorisait le peuple à s'introduire, en pareil cas, dans le palais des rois. La galerie des Glaces, les salons, l'oeil-de-Boeuf, la chambre de la reine, étaient envahis par la foule. Marie-Antoinette, manquant d'air respirable, perdit connaissance pendant trois quarts d'heure. Quand elle revint à elle, Louis XVI lui présenta la princesse qui venait de naître:
«Pauvre petite, dit-elle, vous n'étiez pas désirée, mais vous n'en serez pas moins chère. Un fils eût plus particulièrement appartenu à l'État; vous serez à moi, vous aurez tous mes soins, vous partagerez mon bonheur et vous adoucirez mes peines.»
Ce fut là aussi que virent le jour les deux fils du roi et de la reine martyrs: l'un, né le 22 octobre 1781, mort le 4 juin 1789; l'autre, né le 27 mars 1785, connu sous le nom de duc de Normandie, et qui devait plus tard s'appeler Louis XVII.
Dans cette chambre mémorable à tant de titres, commença l'agonie de la royauté française. Marie-Antoinette y dormait le matin du 6 octobre 1789, quand elle fut réveillée par l'insurrection. Au fond de la chambre, dans le panneau où est actuellement le portrait de la reine par Mme Lebrun, une petite porte conduisait aux appartements du roi. C'est par là que la malheureuse souveraine s'échappa pour aller chercher un refuge auprès de Louis XVI, pendant que les émeutiers assassinaient les gardes du corps. Quelques instants après elle quittait Versailles, qu'elle ne devait jamais revoir. Depuis lors, aucune femme n'occupa les appartements de la reine. Le théâtre subsiste, les décors sont à peine modifiés; mais il faut faire sortir de la poussière du temps les acteurs, les actrices surtout.
L'année que j'ai passée dans ces salles encore si pleines de leur souvenir m'a donné la première idée du travail que je publie aujourd'hui. Que de fois j'ai cru apercevoir, comme autant de gracieux fantômes, les femmes illustres qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont pleuré dans ce séjour! Je voudrais me rendre un compte minutieux du rôle qu'elles y ont joué, mentionner avec précision les appartements qu'elles ont habités, montrer en détail l'existence qu'elles menaient, indiquer, pour nous servir d'une expression de Saint-Simon, ce qu'on pourrait appeler la mécanique de la vie de la cour.
Je veux essayer l'histoire du château de Versailles lui-même par les femmes qui l'ont habité depuis 1682, époque où Louis XIV y fixa sa résidence, jusqu'au 6 octobre 1789, jour fatal où Louis XVI et Marie-Antoinette le quittèrent sans retour. Le sanctuaire de la monarchie absolue devait être également son tombeau.
Ni les nièces de Mazarin, ni la Grande Mademoiselle, ni les duchesses de La Vallière et de Fontanges, ne doivent être considérées comme des femmes de Versailles. A l'époque où ces héroïnes brillèrent de tout leur éclat, Versailles n'était pas encore la résidence officielle de la cour et le siège du gouvernement.
Nous ne commencerons donc cette étude qu'en 1682, année où Louis XIV, quittant Saint-Germain, son séjour habituel, s'établit définitivement dans sa résidence de prédilection.
Pendant plus d'un siècle,--de 1682 à 1789,--combien de curieuses figures apparaîtront sur cette scène radieuse! Que de vicissitudes dans leurs destinées! que de singularités et de contrastes dans leurs caractères! C'est la bonne reine Marie-Thérèse, douce, vertueuse, résignée, se faisant aimer et respecter de tous les honnêtes gens. C'est l'orgueilleuse sultane, la femme à l'esprit étincelant, moqueur, acéré, l'altière, l'omnipotente marquise de Montespan.
C'est la femme dont le caractère est une énigme et la vie un roman, qui a connu tour à tour toutes les extrémités de la mauvaise et de la bonne fortune, et qui, avec plus de rectitude que d'effusion, avec plus de justesse que de grandeur, a eu du moins le mérite de réformer la vie d'un homme dont les passions avaient été divinisées: Mme de Maintenon. C'est la princesse Palatine, la femme de Monsieur, frère du roi, la mère du futur Régent, Allemande enragée, invectivant sa nouvelle patrie, représentant, à côté de l'apothéose, la satire, exhalant dans ses lettres les colères d'un Alceste en jupon, rustique, mais spirituelle, plus impitoyable, plus caustique, plus passionnée que Saint-Simon lui-même; femme étrange, au style brusque, impétueux, au style qui, comme le dit Sainte-Beuve, a de la barbe au menton, et de qui l'on ne sait trop, quand on le traduit de l'allemand en français, s'il tient de Rabelais ou de Luther.
C'est la duchesse de Bourgogne, la sylphide, la sirène, l'enchanteresse du vieux roi; la duchesse de Bourgogne, dont la mort précoce fut le signal de l'agonie d'une cour naguère si éblouissante.
Sous Louis XV, c'est la vertueuse, la sympathique Marie Leczinska, le modèle du devoir, qui joue auprès de Louis XV le même rôle respecté, mais effacé que Marie-Thérèse auprès de Louis XIV. C'est l'intrigante, la femme-ministre, la marquise de Pompadour, vraie magicienne, habituée à tous les enchantements, à toutes les féeries du luxe et de l'élégance, mais qui restera toujours une parvenue faite pour l'Opéra plutôt que pour la cour.
Ce sont les six filles de Louis XV, types de piété filiale et de vertu chrétienne: Madame Infante, si tendre pour son père; Madame Henriette, sa soeur jumelle, morte de chagrin à vingt-quatre ans pour ne s'être pas mariée suivant son coeur; Madame Adélaïde et Madame Victoire, inséparables dans l'adversité comme dans les beaux jours; Madame Sophie, douce et timide; Madame Louise, successivement amazone et carmélite, qui, dans le délire de l'agonie, s'écriait: «Au paradis, vite, vite! au paradis, au grand galop!»
C'est Mme Dubarry, déguisée en comtesse et destinée par l'ironie du sort à ébranler les bases du trône de saint Louis, de Henri IV, de Louis XIV. Puis après le scandale, sous le règne qui est l'heure de l'expiation, c'est Madame Élisabeth, nature angélique et essentiellement française, montrant, au milieu des plus horribles catastrophes, non seulement du courage, mais de la gaieté; c'est la princesse de Lamballe, gracieuse et touchante héroïne de l'amitié; c'est Marie-Antoinette, dont le nom seul est plus pathétique que tous les commentaires.
Dans la carrière de ces femmes, que d'enseignements historiques, et aussi que de leçons de psychologie et de morale! Qui ferait mieux connaître la cour, «ce pays où les joies sont visibles mais fausses, et les chagrins cachés mais réels;» la cour, «qui ne rend pas content et qui empêche qu'on ne le soit ailleurs[1]!»
[Note 1: La Bruyère, De la Cour.]
Les femmes de Versailles ne nous disent-elles pas toutes: «La condition la plus heureuse en apparence a ses amertumes secrètes qui en corrompent toute la félicité. Le trône est le siège des chagrins, comme la dernière place; les palais superbes cachent des soucis cruels, comme le toit du pauvre et du laboureur, et, de peur que notre exil ne nous devienne trop aimable, nous y sentons toujours par mille endroits qu'il manque quelque chose à notre bonheur[1].»
[Note 1: Massillon, Sermon sur les afflictions.]
Un portrait de Mignard représente la duchesse de La Vallière avec ses enfants: Mlle de Blois et le comte de Vermandois. Elle est pensive et tient à la main un chalumeau, à l'extrémité duquel flotte une bulle de savon avec ces mots: Sic transit gloria mundi, «Ainsi passe la gloire du monde.» Ne pourrait-ce pas être la devise de toutes les héroïnes de Versailles?
Combien auraient pu dire comme Mme de Sévigné, riche aussi, honorée, adulée, heureuse en apparence: «Je trouve la mort si terrible, que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines dont elle est semée. Vous me direz que je veux donc vivre éternellement? Point du tout; mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien mieux aimé mourir entre les bras de ma nourrice; cela m'aurait ôté bien des ennuis, et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément[2].»
[Note 2: Mme de Sévigné, lettre du 16 mars 1672.]
La princesse Palatine, Madame, femme du frère de Louis XIV, écrivait à propos de la mort de la reine d'Espagne: «J'entends et je vois tous les jours tant de vilaines choses, que tout cela me dégoûte de la vie. Vous aviez bien raison de dire que la bonne reine est maintenant plus heureuse que nous, et si quelqu'un voulait me rendre, comme à elle et à sa mère, le service de m'envoyer en vingt-quatre heures de ce monde dans l'autre, je ne lui en saurais certes pas mauvais gré. [1]»
[Note 1: Lettres de la princesse Palatine, 20 mars 1689.]
Mème avant l'heure des grandes humiliations où il faudra descendre l'escalier de marbre de Versailles pour ne plus le remonter, Mme de Montespan cachait dans «son triomphe extérieur un fond de tristesse» [2].
[Note [2]: Mme de Sévigné, lettre du 31 juillet 1675.]
La rivale qui, contre toute attente, devait la supplanter, Mme de Maintenon, écrivait à Mme de La Maisonfort: «Que ne puis-je vous donner mon expérience! que ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore les grands et la peine qu'ils ont à remplir leurs journées! Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on aurait eu peine à imaginer? J'ai été jeune et jolie; j'ai goûté les plaisirs; j'ai passé des années dans le commerce de l'esprit; je suis venue à la faveur, et je vous proteste, ma chère fille, que tous les états laissent un vide affreux.»
C'est encore Mme de Maintenon qui disait à son frère, le comte d'Aubigné:
«Je n'y puis plus tenir, je voudrais être morte.»
C'est elle qui, résumant les phases de sa carrière si surprenante, écrivait à Mme de Caylus, deux ans avant de mourir: «On rachète bien les plaisirs et l'enivrement de la jeunesse. Je trouve, en repassant ma vie, que, depuis l'âge de trente-deux ans, qui fut le commencement de ma fortune, je n'ai pas été un moment sans peine, et qu'elles ont toujours augmenté[1].»
[Note 1: Lettres de Mme de Maintenon à Mme de Caylus, 19 avril 1717.]
Les femmes du règne de Louis XV ne fournissent pas moins de sujets aux réflexions philosophiques. Pendant que leur char de triomphe s'avance au milieu d'une foule de flatteurs, leur conscience leur souffle à l'oreille de cruelles paroles. Semblables à des actrices qui ont devant elles un public fantasque et versatile, elles craignent toujours que les applaudissements ne se changent en huées, et c'est avec un fond de terreur que, malgré leur aplomb apparent, elles continuent à jouer leur triste rôle.
Les favorites des rois ne semblent-elles pas se réunir toutes pour s'écrier avec saint Augustin: «O mon Dieu! vous l'avez ordonné, et la chose ne manque jamais d'arriver, que toute âme qui est dans le désordre soit à elle-même son supplice. Si l'on y goûte certains moments de félicité, c'est une ivresse qui ne dure pas. Le ver de la conscience n'est pas mort; il n'est qu'assoupi. La raison aliénée revient bientôt, et avec elle reviennent les troubles amers, les pensées noires et les cruelles inquiétudes[1].»
[Note 1: Massillon, Panégyrique de sainte Madeleine.]
La jeune duchesse de Châteauroux, qui passe du matin au soir «comme l'herbe des champs», résume dans sa courte carrière toutes les misères et toutes 1es déceptions de la vanité. A l'apogée de sa faveur, Mme de Pompadour est plongée dans la mélancolie. Sa femme de chambre, Mme du Hausset, confidente de ses perpétuels soucis, lui dit avec une commisération sincère:
«Je vous plains, madame, tandis que tout le monde vous envie.»
Et la marquise, blasée de faux plaisirs, tourmentée par de vraies souffrances, prononce cette parole si amère:
«La sorcière a dit que j'aurais le temps de me reconnaître avant de mourir. Je le crois, car je ne périrai que de chagrin.»
A peine descendue dans la tombe, la pauvre morte est oubliée de tous. La reine elle-même en fait la remarque, lorsqu'elle écrit au président Hénault: «Il n'est non plus question ici de ce qui n'est plus, que si elle n'eût jamais existé. Voilà le monde; c'est bien la peine de l'aimer.»
Les destinées des héroïnes de Versailles ne sont pas seulement intéressantes au point de vue moral; elles ont, sous le rapport de l'histoire, une importance, pour ainsi dire, symbolique. Certaines de ces femmes résument, en effet, toute une société, personnifient toute une époque. Mme de Montespan, la beauté superbe, la grande dame fière de sa naissance, de son esprit, de ses richesses, de sa magnificence, la femme qui, par ses terribles railleries, se fait craindre autant qu'admirer, à ce point que les courtisans disent ne pas oser passer sous ses fenêtres, parce que c'est passer par les armes; la fastueuse Mme de Montespan, que les anciens auraient représentée en Cybèle portant Versailles sur son front, n'est-elle pas comme une incarnation de cette France altière et triomphante de l'apogée du règne de Louis XIV, de cette France qui ressuscite les pompes du paganisme et enveloppe dans des nuages d'encens le souverain radieux dont elle est idolâtre? Mais l'orgueil de la favorite sera châtié, et, pour elle de même que pour le roi, les humiliations succéderont aux triomphes.
Les rayons du soleil n'ont plus la même splendeur, l'astre-roi qui décline a perdu l'ardeur de ses feux: Mme de Maintenon apparaît. Avec sa nature et son style tempérés, son respect pour les convenances et pour la règle, sa piété mêlée d'un peu d'ostentation, elle est le symbole vivant de la nouvelle cour.
Après Louis XIV, la Régence; avec la Régence, le scandale. La duchesse de Berry[1], si fantasque, si capricieuse, si passionnée, n'est-elle pas l'image de cette époque?
Avec Louis XV, il y a comme une diminution graduelle de prestige et de dignité, dont la duchesse de Châteauroux, la marquise de Pompadour, Mme Dubarry, sont en quelque sorte les symboles vivants. Et cependant, même alors, il y a encore çà et là des moeurs patriarcales, des sentiments vraiment chrétiens, des caractères qui honorent la nature humaine. La reine Marie Leczinska en est la personnification; elle et ses filles conservent à la cour les dernières traditions des convenances. Enfin vient Marie-Antoinette, la femme qui représente, dans la plus saisissante et la plus tragique de toutes les destinées, non seulement la majesté et les douleurs de la monarchie, mais toutes les grâces et toutes les angoisses, toutes les joies et toutes les souffrances de son sexe.
Trop souvent, en étudiant l'histoire, on y rencontre le scandale; mais on y trouve aussi un enseignement. Ce ne sont pas surtout les femmes vertueuses qui s'écrient: «Vanité, tout est vanité.» Ce sont les coupables qui sortent de leurs tombes et, se frappant la poitrine, font amende honorable devant la postérité.
[Note 1: Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans, fille du Régent, épousa en 1710 le duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, et devint veuve dès 1714; elle mourut en 1719, à l'âge de vingt-quatre ans.]
Ces beautés, qui jettent un éclat passager sur la scène du monde, s'évanouissent comme des ombres; semblables à l'herbe des champs, elles passent du matin au soir, et l'histoire, instruite par leur exemple, devient une sorte de morale en action.
Le présent volume est consacré aux femmes de la cour de Louis XIV. Si la jeunesse, à laquelle nous dédions cette édition spéciale, y trouve quelque intérêt, il sera suivi de plusieurs autres.