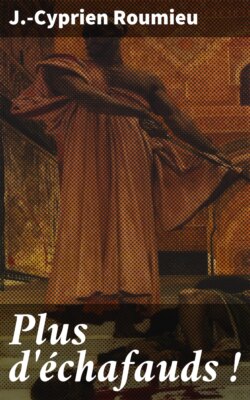Читать книгу Plus d'échafauds ! - J.-Cyprien Roumieu - Страница 7
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеDE L’INVIOLABILITÉ DE LA VIE DE L’HOMME ET DE
L’ILLÉGITIMITÉ DE LA PEINE DE MORT.
«Il n’est pas permis à l’homme, être créé,
«de détruire dans son semblable l’œuvre d’une
«création semblable à la sienne.»
M. VICTOR DE TRACY.
L’homme à peine en possession de la vie abusa de ce don précieux. Être créé, il osa porter sur son semblable une main impie, et le berceau de la terre fut souillé de sang. L’antiquité la plus reculée nous apparaît avec le sauvage attirail des tortures, et l’escorte plus hideuse encore des sacrifices humains. Le monde en vieillissant n’a point perdu sa tache originelle; et malgré le progrès des lumières, malgré l’adoucissement des mœurs, les chefs des nations ont conservé dans leurs mains le glaive homicide comme attribut de leur justice, et sur leurs fronts comme symbole de leur puissance un diadème ensanglanté. Des milliers d’années se sont écoulées sans que ces hécatombes humaines, ces boucheries de chaque jour aient excité dans les cœurs ni étonnement ni murmure; les peuples accouraient à ces cruelles exécutions avec une curiosité avide comme à un spectacle; et les magistrats, créatures faillibles, qui livraient au bourreau un être doué de la vie, demeuraient impassibles sur leurs chaises curules, sans inquiétude et sans remords.
Tout à coup une voix s’est fait entendre qui a osé demander compte aux sociétés de tous les âges du sang qu’elles ont versé. Cette voix généreuse a contesté à l’homme le droit d’immoler son semblable, et elle n’a vu dans l’illégitime emploi de sa force qu’une usurpation sacrilége des droits de la divinité. Jamais rayon électrique n’eut plus de rapidité ni plus de puissance. Toutes les ames se sont émues, toutes les consciences se sont ébranlées, un doute insurmontable est venu glacer tous les cœurs. La société subitement réveillée de son assoupissement léthargique est devenue elle-même l’écho du cri révélateur. Poursuivie d’affreux souvenirs, embarrassée de tant de cadavres inutilement mutilés, elle s’est demandé avec amertume: «La peine de mort est-elle légitime?... » Et dans les angoisses de l’incertitude elle attend une solution. Semblable à ce fanatique insensé, victime d’un féroce enthousiasme, qui après avoir frappé l’ennemi de sa foi d’un fer qu’il croyait sacré, sent tout à coup son ame atteinte d’un doute terrible, et consulte sa conscience devenue sévère avec l’anxiété de la crainte et du désespoir.
C’est donc l’illégitimité de la peine de mort qu’il faut démontrer. Cette gravé et importante question une fois résolue trancherait toutes les autres; car il n’y a d’utile et de licite que ce qui est juste, et la peine de mort, a dit M. Charles Lucas avec un accent prophétique, ne survivrait pas de nos jours à la démonstration de son illégitimité.
Mais il est douloureux de le dire: presque tous les philosophes, orateurs ou publicistes qui se sont occupés de la peine de mort, soit pour en réclamer l’abolition, soit pour en demander le maintien, ont reculé devant la question philosophique, c’est-à-dire du droit et de la justice. Ils ont affecté de la considérer comme une question vaine et oiseuse, et, la reléguant dédaigneusement dans le domaine de l’idéologie, ils se sont livrés à l’examen exclusif de la question des faits ou de l’utilité.
En 1791 et en 1830, époques à jamais mémorables de nos deux grandes révolutions, deux discussions solennelles ont été soulevées au sein de nos assemblées législatives. Tous les orateurs entendus, à quelques rares exceptions près, ont accordé à la société le droit d’infliger la peine de mort; seulement ils lui en ont contesté l’usage. Presque aucun ne s’est occupé de la justice intrinsèque de cette peine, en un mot de sa légitimité. Bien plus, le 11 novembre 1830, à la tribune nationale de France, du peuple le plus civilisé de la terre, au dix-neuvième siècle enfin, M. Dumon, rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à la réforme de plusieurs articles du Code pénal, n’a pas craint de proférer ces étranges paroles: «La commission approuve
« que le projet conserve la peine de mort.
«Elle n’a point soulevé la question de la légitimité
«de cette peine; question redoutable qui trouble la
«conscience et embarrasse la raison, mais que résout
«contre les doutes de la philosophie et les scrupules
«de l’humanité la pratique de tant de peuples et de
«tant de siècles.»
Quoi! cette question redoutable trouble votre conscience et embarrasse votre raison! Quoi! elle inspire des doutes à la philosophie et des scrupules à l’humanité ! et pour étouffer les importunes clameurs qu’elle fait naître, au lieu de l’aborder franchement afin de l’examiner et de la résoudre, vous fuyez lâchement devant elle, et vous vous retranchez dans la pratique des siècles et des nations! Eh, bon Dieu! ne savons-nous pas que c’est le sort de toutes les grandes vérités d’être contestées; qu’il n’est point d’institutions barbares, de coutumes atroces que la sanction des peuples et des siècles n’ait autorisées. Votre conscience, dites-vous, est troublée, un doute pénible torture votre ame. Eh bien! le plus simple bon sens, la plus vulgaire raison vous crient qu’il faut en sortir, que l’incertitude, en pareille matière, est un intolérable supplice aussi cruel que le remords. Hâtez-vous donc, et, loin de recourir à un indigne subterfuge, à une misérable défaite, osez descendre sur le terrain brûlant ou l’humanité vous entraîne, et venez sonder avec courage et loyauté les profondeurs de cette immense question. Ah! quand il s’agit d’appliquer la peine de mort, cette peine terrible et irréparable, il faut tenir la hache d’une main sûre, il faut une foi robuste, une conviction plus qu’humaine: car si le moindre doute sur sa légitimité pouvait naître un instant dans l’ame du législateur qui la prononce ou des magistrats qui l’infligent, et si malgré ce doute elle continuait à subsister, toutes les idées de justice seraient bouleversées; la société tout entière se soulèverait indignée, et, confondant dans un même anathème législateurs, juges et bourreau, elle briserait avec horreur dans leurs mains homicides le glaive dont sa crédule confiance les avait armées.
Parmi les écrivains qui ont traité la question de l’illégitimité de la peine de mort, se place au premier rang M. Charles Lucas, philantrope vertueux dont le zèle éclairé a rendu de si grands services à la réforme pénitentiaire. A lui la gloire d’avoir le premier nettement posé cette question et de l’avoir victorieusement résolue. Regrettant qu’on se fût borné trop long-temps à examiner si la peine de mort était nécessaire pour savoir si elle était juste, et qu’on eût ainsi toujours conclu son injustice de son inutilité, il a voulu, lui, prouver d’abord son injustice pour s’occuper ensuite de son inutilité, certain que, l’injustice une fois démontrée, la peine de mort inutile ou nécessaire ne pouvait plus se maintenir. Noble pensée qui honore tout à la fois l’écrivain qui l’a conçue et le siècle qui l’a inspirée!
«Que l’injustice de la peine de mort se démontre,
«dit M. Lucas, et bientôt on verra tomber les échafauds.
«Le jour où cette démonstration deviendrait
«claire et évidente pour tous, est-il une tribune libre
«en Europe, et serait-ce celle de France, où un ministre
«osât au nom du pouvoir dispenser d’un devoir
«de morale naturelle les douze jurés, les cinq
«juges et le bourreau nécessaires à chaque exécution
«de la loi?»
L’excellent ouvrage de M. Lucas a dû faire une vive impression sur les esprits; sa voix chaleureuse a dû remuer plus d’une conscience, et opérer plus d’une conversion. Personne mieux que moi ne peut témoigner de la puissance de ses paroles, car elles ont porté dans mon ame des flots de lumière, et comme une révélation soudaine elles ont changé ma conviction. Toutefois, plusieurs écrivains distingués n’ont pas approuvé son système de l’inviolabilité de la vie de l’homme, et l’ont combattu, avec force; ils l’ont combattu mais non réfuté ; et ce qui doit surprendre de la part d’adversaires aussi habiles, c’est qu’après avoir pris M. Lucas corps à corps et avoir rompu avec lui plus d’une lance en l’honneur de je ne sais quel principe, ils ont laissé là tout à coup la question qui avait allumé leur verve et n’ont pas dit un seul mot pour prouver la légitimité de la peine de mort; ils se sont réfugiés, comme d’usage, dans la question de l’utilité.
Mais je me trompe, parmi les adversaires de M. Lucas il en est un qui a entrepris cette tâche difficile; c’est un étranger, un Espagnol, M. Silvela, écrivain méthodique et consciencieux. Persuadé, comme M, Lucas, que dans cette grave théorie la question du juste et du droit dominait celle de l’utile, il a dit lui-même: «La question de la peine de mort ne
«sera vraiment résolue, les doutes qui s’élèvent dans
«quelques esprits ne seront dissipés, les alarmes des
«cœurs scrupuleux ne seront calmées, que lorsqu’on
«aura mis en évidence le principe de la légitimité de
«la peine de mort; que lorsqu’on aura. prouvé que
«ce droit est bien un de ceux conféras au législateur.»
Et partant de ce principe, M. Silvela a lui-même entrepris de prouver la légitimité de cette peine, et de réfuter le système de M. Lucas. Comme dans cette réfutation M. Silvela rappelle, pour s’en armer, Les principaux argumens des autres adversaires de M. Lucas, il en résulte que tout ce qui a été dit de fort, de concluant, de logique et de spécieux sur une matière aussi importante se trouve renfermé dans la partie de leurs ouvrages où ces deux auteurs se sont livrés avec conviction et bonne foi à cette lutte philosophique.
Nous allons donc présenter au lecteur une analyse rapide, mais scrupuleuse et impartiale des deux systèmes que MM. Lucas et Silvela ont développés. Il sera curieux et intéressant de suivre ces deux écrivains et de voir comment, d’un même point de départ, ils ont pu arrivera des résultats, si contraires, et en venir à proclamer, l’un, l’inviolabilité de la vie de l’homme, et l’autre, la légitimité de la peine de mort. Un haut enseignement ressortira de ce contraite; la vérité y apparaîtra dans toute sa lumière, et si quelque doute pouvait encore être resté dans les ames honnêtes, il sera invinciblement dissipé.
Écoutons d’abord M. Lucas.
«L’existence répandue dans le monde n’est sacrée et inviolable que dans l’homme, parce que dans l’homme seul elle revêt un caractère de personnalité.
...... «Pour qu’il y ait attentat, dans l’individu, envers l’existence, don du créateur, il faut que le créateur ait attaché ce don à l’individu, que l’individu se le soit approprié, en un mot qu’il ait rendu cette existence à lui personnelle; autrement, sans la personnalité, la jouissance dans l’individu de l’existence qui l’anime n’est qu’un envoi en possession provisoire; tel est l’animal qui pour cette raison ne connaît point l’avenir.
.....«Nul droit dans l’animal ne se conçoit donc, pas même un droit à l’existence; car c’est au nom de Dieu, et non au nom de l’animal, que s’est réclamé le respect et qu’a tenté de s’imposer le devoir. Il faut donc arriver à un être qui ne soit plus, pour ainsi dire, un simple canal où circule l’existence, mais qui, doué de liberté et de raison, l’attire et l’arrête en lui, se l’approprie et la revête d’un caractère de personnalité. Alors nous concevrons un droit à l’existence dans l’être qui s’en sera ainsi emparé ; alors le respect dû à l’existence sera double, car on devra à la fois la respecter et comme don de Dieu et comme propriété de l’être. Or, cet être, c’est l’homme...
..... «Ainsi, des plus simples données de l’observation nous élevant aux plus hautes généralités conçues par la raison, nous pouvons séparer en deux le domaine de l’existence, savoir: celui de l’impersonnalité, ou des choses inanimées et animées, et celui de la personnalité ou de l’homme. L’existence répandue en ce monde n’a donc qu’un asile inviolable et sacré, c’est l’homme. Elle n’est donnée en propre qu’à lui; elle l’a choisi seul pour son sanctuaire.
«Mais l’homme n’a pas seulement droit à l’existence; il y a en nous, en effet, outre l’existence en vertu de laquelle nous sommes, un mode d’existence qui nous fait être de telle façon plutôt que de telle autre. Nous avons donc droit, non-seulement à l’existence que Dieu nous a donnée, mais encore à la forme sous laquelle nous l’avons reçue. Exister et exister tels que nous avons été faits, tel est notre droit. Or, nous avons été faits libres, actifs, intelligens; donc notre liberté, notre intelligence, notre activité nous appartiennent au même titre que l’existence qui les revêt. Tel est le domaine de la personnalité : l’existence sans laquelle il n’y a point d’être; la liberté , l’intelligence et l’activité sans lesquelles il n’y a pas d’homme. Voilà l’homme de Dieu, l’homme de la création, la partie sacrée et inviolable de nous-mêmes. Voilà ce que Dieu nous a fait et ce que nous avons en conséquence le droit d’être.»
De ces principes fondamentaux que l’auteur développe avec l’irrésistible ascendant de l’éloquence et de la logique, il tire des conclusions nettes, vigoureuses et précises qu’il faut absolument voir dans son beau travail, et dont nous ne pouvons présenter ici que la substance décolorée.
«... L’homme et la société en tant que collection d’hommes, ayant le droit et le devoir d’exister peuvent et doivent faire tout ce qui est nécessaire à leur conservation. Si l’homme est impuissant à défendre son existence attaquée, la société vient à son secours et lui prête l’appui de sa force immense. Mais cette intervention de la force de la société doit avoir des limites: cette force n’est intervenue que pour garantir le droit, pour le protéger; la limite naturelle où elle doit s’arrêter, c’est à la garantie du droit qu’elle a été appelée à défendre.
Du reste, l’homme n’a aucun droit sur l’existence qui est un don de Dieu; il n’a droit ni sur la sienne, ni à plus forte raison sur celle de son semblable. Le droit connu sous le nom de droit de légitime défense dérive, non point de ce que, dans un cas donné, nous avons un droit sur l’existence d’autrui, mais de ce que, dans aucun cas, nous ne pouvons perdre notre droit à la nôtre. L’impérieux devoir de notre conservation nous prescrit de nous défendre contre qui nous attaque: si dans la lutte le meurtrier succombe, ce n’est point que nous ayions attenté à son existence, mais c’est parce que nous avons défendu la notre contre son usurpation sacrilége. Mais cet état violent et hors de nature cesse avec le danger. Aussitôt que nos jours ne sont plus menacés et que l’assassin est désarmé, nous devons respecter à notre tour l’inviolabilité de son existence, car nous ne pourrions la lui ravir qu’en violant nous-mêmes un droit dont l’abus de la force a bien pu momentanément le dépouiller, mais qu’il retrouve tout entier dans son impuissance.
Ainsi donc, si je suis attaqué par un brigand, et qu’au moment de la lutte la société intervienne par ses gendarmes qui se joignent à moi et tuent l’assassin prêt à me tuer moi-même, tout est légitime dans l’intervention. Mais si l’assassin est désarmé et terrassé par moi au moment où la société intervient, sa force auxiliaire ne doit pas aller plus loin que ma force personnelle. Le droit à l’existence devient inattaquable dans l’agresseur désarmé, et le tuer dans cet état ne serait plus protéger ou exercer mon droit à l’existence, mais en usurper un sur la sienne. Après que la force a servi de garantie au droit, il faut que le droit serve de frein à la force.
Vainement la société prétendrait-elle que comme force sociale elle a une mission spéciale à remplir que n’a nullement la force individuelle; qu’elle a non-seulement l’ordre matériel à rétablir, mais encore l’ordre moral à protéger et à défendre, et qu’en conséquence elle a le droit de donner la mort alors que l’individu ne l’a plus, d’abord à titre de droit de défense, parce que le péril social, loin de cesser avec le péril individuel, est précisément celui qui le suit; ensuite à titre de pénalité, parce qu’elle doit frapper le coupable alors même qu’elle n’a plus à craindre l’ennemi; en d’autres termes, parce que la mort est non-seulement le droit de sa défense contre le péril, mais encore la peine de sa justice contre le crime.
Ces considérations ne prouvent nullement que la peine de mort soit dans les mains de la société l’arme d’une défense légitime; car, encore un coup, lorsque la société frappe l’agresseur, il est désarmé ; que dis-je? quand la société dresse l’échafaud, l’assassin a été arrêté, enchaîné, interrogé, jugé, condamné ; et, bien qu’après son arrestation il y ait encore alarme sociale, il n’y a pas ce péril pressant, inévitable, qui légitime la mort donnée à l’agresseur comme le seul moyen de sauver sa propre existence.
«Un homme m’attaque, dit M. Pastoret, je ne peux me défendre qu’en le tuant, je le tue; pour que la société fasse de même, il faut qu’elle ne puisse faire autrement.»
Quant à la mission pénale de la société, il faut faire ici une importante distinction. Si l’on veut parler d’une justice de prévoyance, de répression et d’amendement, certes ce droit de la société est incontestable; mais loin que la peine de mort en soit l’instrument nécessaire, elle ne peut apparaître dans son exercice que comme un cruel obstacle et un insurmontable empêchement. Mais s’il est question d’une justice pénale proprement dite, c’est-à-dire qui ait pour objet de punir les coupables et de châtier dans leurs personnes la perversité de leurs actes, non-seulement la société ne saurait y trouver le droit d’infliger la peine de mort, mais il faut dire qu’une semblable justice n’appartient pas même à la société, car où en aurait-elle puisé l’initiative, lorsque nul part en ce monde ne peut se rencontrer un tel pouvoir?
Dieu seul lit au fond des consciences. Pour punir, il est nécessaire d’embrasser trois élémens, savoir l’intention de l’agent, le rapport de l’acte avec la loi morale violée, une peine extérieure entièrement correspondante aux degrés de criminalité de l’agent et de l’acte; or, il n’est donné à l’homme de les connaître que par approximation. La justice pénale qu’il exercera ne sera donc qu’une justice faillible, puisqu’il ne saisit pleinement ni l’intention, ni la loi; ce ne sera qu’une justice incomplète, puisque, alors même qu’il verrait sans nuage et la loi et l’intention, il ne trouverait pas dans le monde extérieur matière à reproduire la criminalité de l’acte dans une traduction fidèle.
A un autre titre encore, la justice humaine peut et doit s’avouer incomplète; car, outre la sanction politique ou sociale qui est de son essence, la loi pénale écrite par la société admet nécessairement trois autres sanctions: la sanction religieuse, la sanction populaire et la sanction naturelle qui règlent nos rapports envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes; or, ces trois sanctions sont anéanties, et l’heureux équilibre de leur harmonie est rompu, lorsque là justice sociale, élevant la prétention d’être à elle seule toute la justice, s’arroge le droit de dresser des échafauds.»
Quelque concluant que soit cet admirable système dont nous ne présentons ici qu’une faible analyse, M. Silvela n’en a point été du tout ébranlé. Toutefois, après avoir rendu un loyal hommage aux nobles inspirations qui ont guidé la plume de M. Lucas, il déclare qu’il n’entreprendra pas lui-même une réfutation qu’il croit au-dessus de ses forces, mais que d’autres écrivains ayant rempli victorieusement cette tâche il se bornera à l’office de rapporteur, et citera textuellement ce qu’ils ont dit de plus convaincant à ce sujet.
Une pareille réserve de la part d’un homme aussi habile que M. Silvela ne fait peut-être pas moins d’honneur à sa conscience qu’à sa modestie.
Voyons cependant quels sont les auteurs qu’il oppose à M. Lucas. Ce sont MM. de Broglie, Urtis et Rossi; voici les argumens qu’il leur emprunte:
«Une fin de non-recevoir, dit M. de Broglie, est encore plus courte; la peine de mort, dit-on, est illégitime, attendu que la vie de l’homme est inviolable et sacrée.
«La vie de l’homme est inviolable et sacrée! Veut-on dire par-là qu’elle le soit dans tous cas indistinctement? Dès lors plus de droit de défense, plus de droit de guerre; aucun philosophe n’a été jusque là.
«Veut-on dire que la vie de l’homme est inviolable et sacrée, mais pour le législateur seulement? Pour lors, cela se résume à annoncer que la peine de mort est illégitime, attendu qu’elle n’est pas légitime. C’est manifestement trancher la question par la question.
«..... Nous demandons pourquoi les dons de Dieu à l’homme, et entr’autres la vie, sont inviolables dans l’homme?
«Qu’ils soient tels, est-ce là une vérité d’intuition immédiate? est-ce un axiome?
a Alors pourquoi y a-t-il doute? pourquoi y a-t-il contradiction entre M. Lucas et les législateurs de tous les pays? Y a-t-il doute sur la question de savoir si la ligne droite est la plus courte entre deux points, ou si tout événement provient d’une cause?
«Si ce n’est pas un axiome, si ce n’est pas une vérité évidente par elle-même, d’où la dérive-t-on? où sont les preuves?»
«Voilà bien des questions adressées à M. Lucas, ajoute M. Silvela; a-t-on répondu d’une manière, satisfaisante? tant s’en faut.»
Ecoutons un autre adversaire du système de M. Lucas.
«Il est pourtant des moralistes, dit M. Urtis, qui s’obstinent à attaquer la peine de mort sous le rapport de la justice et du droit.
«La vie de l’homme, disent-ils, est inviolable, parce qu’elle est un don du Créateur.
«Craignez alors d’écraser la vipère; refusez la chair des animaux pour nourriture, car c’est aussi le Créateur qui leur a donné la vie.
«Quelle comparaison, me dites-vous! Dans l’homme seul l’existence revêt un caractère de personnalité, elle n’est sacrée que chez lui.
«Et qui vous autorise à faire cette distinction? Comment savez-vous que Dieu n’est jaloux que de son plus parfait ouvrage, et qu’il livre tous les autres à vos caprices destructeurs?»
Voilà encore une question qu’on vous adresse, dit M. Silvela: «Qui vous autorise à faire cette distinction? » Mais elle est aussi restée sans réponse.
Enfin M. Rossi combat en ces termes l’illégitimité de la peine de mort:
....«Qu’y a-t-il dans la peine de mort qui la rende intrinsèquement illégitime, immorale?
«La justice sociale est un devoir; la peine en est un élément, un moyen nécessaire, et par conséquent légitime. La peine est une souffrance, la privation d’un bien. Tout bien peut donc offrir matière à pénalité, à moins qu’une raison spéciale ne s’y oppose. Le bien qu’enlève la peine capitale est la vie corporelle; y a-t-il là un motif particulier qui rende illégitime en soi ce moyen de punition?
«L’existence est strictement personnelle; c’est la personne elle-même. L’homme la reçoit, il ne la donne pas.
«Si l’on conclut de là que le suicide est illicite, que le meurtre est un crime très grave, nous n’en disconvenons point. Si l’on veut en outre en conclure que l’existence est absolument inviolable, ce n’est qu’une affirmation; où en est la preuve?»
C’est pour la troisième fois, ajoute encore M. Silvela, que pareille demande est inutilement adressée à M. Lucas.
«Ainsi, s’écrie-t-il avec un accent de triomphe, MM. de Broglie, Rossi et Urtis s’accordent à dire à M. Lucas: «Où sont vos preuves? vous n’en avez pas; vous ne prouvez pas l’illégitimité de la peine de mort.»
Eh quoi! dirai-je à mon tour à M. Silvela, sont-ce bien les argumens de MM. Broglie, Urtis et Rossi qui vous ont prouvé l’invraisemblance et le néant du système de M. Lucas? De bonne foi peut-on supposer que si vous n’eussiez pas été courbé déjà vous-même sous le joug de fer du vieux préjugé, ces faibles argumens eussent pu entraîner votre conscience et déterminer seuls votre conviction? Quoi! vous demandez des preuves, des preuves palpables et matérielles, sans doute, d’une vérité morale et philosophique! Avez-vous donc oublié que M. Lucas a tracé nettement lui-même cette difficulté de sa position, et qu’il l’a résolue avec cette puissance de raisonnement qui le caractérise?
Forcé de reconnaître que même sur le terrain de l’utile, c’est-à-dire des faits, une démonstration rigoureuse était, sous certains rapports, très difficile à produire, parce qu’avec de l’opiniâtreté et de la mauvaise foi on restait toujours, jusqu’à un certain point, maître d’y échapper, il a voulu aborder premièrement la question du droit, et à cet effet il s’est placé sous l’invocation de ces lois éternelles du juste et de l’injuste qui ne changent ni ne varient, afin que la vérité qui est une, une fois bien saisie, pût s’imposer et se faire prévaloir.
Mais ce triomphe de la vérité sur l’erreur, de la justice sur l’abus de la force, de l’humanité sur la barbarie, M. Lucas n’a point pensé qu’il pût être l’œuvre d’un jour. Sans doute en physique, en mathématique, en métaphysique même il existe des vérités d’intuition immédiate, des axiomes d’une telle évidence, qu’ils n’ont pas besoin de démonstration.
Mais en morale et en philosophie en est-il toujours ainsi? Ces sciences sublimes n’ont-elles pas particulièrement pour bases la conscience et la raison de l’homme? Or, ce double sanctuaire de la partie immatérielle de notre être est-il toujours régi par des principes immuables, et peut-il offrir à l’analyse expérimentale, comme le font les sciences exactes et naturelles, cette fixité, cette infaillible évidence qui n’admettent ni doute ni examen? Non, assurément. L’esprit de l’homme est accessible à l’erreur, sa raison est souvent obscurcie par les ténèbres de l’ignorance et du préjugé ; et sa conscience, écho de Dieu même, mais écho souvent infidèle, ne suit pas toujours invariablement les saines inspirations du devoir. On la voit confondre, dans un culte idolâtre, le bien avec le mal, la vertu avec le crime, et consacrer pendant de longues années des pratiques monstrueuses, qui plus tard doivent exciter en elle repentir, dégoût et horreur. Nous l’avons déjà dit, quelles coutumes inhumaines, quels usages barbares n’ont pas eu la sanction des peuples et des siècles? Et de nos jours encore, combien d’absurdes et révoltantes pratiques ne sont pas on honneur dans ces vastes portions de la terre où le flambeau de la civilisation n’a point pénétré!
Pour que le voile de l’erreur se déchire, pour que la vérité triomphe, que d’incroyables obstacles il lui faut surmonter! Tout s’oppose à sa marche naissante; ignorance, orgueil, fanatisme, tout lui est entrave et empêchement. L’homme lui-même, insensé qu’il est, se montre rebelle à son empire; il repousse sa vive lumière qui l’éblouit; son bienfaisant éclat l’importune; il ferme ses yeux, bouche ses oreilles, abrutit son intelligence, endurcit sa sensibilité et s’opiniâtre ainsi à méconnaître les avantages d’une abolition nécessaire ou d’un changement réparateur. Les sacrifices humains, le supplice des prisonniers ont long-temps souillé les mœurs des nations sans que ces actes abominables parussent offenser en rien les idées de devoir et de religion. L’esclavage, cet odieux abus de la force, a été consacré par le long assentiment des peuples les plus civilisés de la terre, et il n’a dû sa chute complète qu’à l’établissement du christianisme. Le combat judiciaire, cette sanglante parodie de la justice, cette amère dérision connue sous le nom de jugement de Dieu, le combat judiciaire n’a pu être aboli en France qu’avec des peines infinies, et l’ordonnance célèbre de saint Louis qui le prohiba fut accueillie avec la plus grande défaveur. Enfin, à une époque éminemment éclairée, où tout tendait au progrès et au perfectionnement, le système pénitentiaire qui fait aujourd’hui la gloire et le bonheur des États-Unis de l’Amérique n’a pu s’y impatroniser qu’après de longues épreuves et de pénibles difficultés, et dans les prisons mêmes, où devaient surtout éclater les bienfaits de son influence, on n’a pu l’établir qu’après effusion de sang !
Tel est l’esprit humain auquel il est permis d’appliquer ce que M. Guizot dit de l’esprit du pouvoir: «La vérité s’y glisse lentement, et quand elle y entre, ce n’est pas pour y régner aussitôt. Il refuse long-temps de la croire: forcé de la croire, il refuse long-temps de lui obéir.» Mais, ajouterons-nous, quand une fois l’heure de la conviction est venue, quand la lumière a pénétré pour ainsi dire dans tous les pores du peuple, qu’elle s’est mêlée à sa substance, alors le besoin de la réforme long-temps différée devient impérieux et irrésistible, et il est aussi impossible de refuser d’y satisfaire qu’il a été difficile d’en faire sentir la nécessité. C’est ce qui arrive pour la peine de mort. Long-temps l’abolition de cette peine fut considérée comme un rêve, une chimère, une risible utopie, comme un crime même dans certains lieux; et cependant aujourd’hui toutes les nations s’agitent en sa faveur, toutes les ames honnêtes la désirent, et le cri révélateur qui a proclamé l’inviolabilité de la vie de l’homme, a trouvé dans le monde entier un écho inextinguible, un immense retentissement. Ah! pouvait-on ne pas reconnaître que pour un juge faillible c’est une sacrilége audace, une effrayante responsabilité que d’anticiper sans mandat sur les décrets de la Providence, et de renvoyer à Dieu, privé de la vie, le cadavre d’un être qu’il a animé de son souffle immortel; que le premier coup de hache qui termine dans le sang une existence matérielle n’est que le premier anneau d’une invisible chaîne, d’un mystérieux avenir; car l’homme n’entre pas tout entier dans la tombe et il y a pour lui quelque chose encore par-delà l’échafaud.
Mais où sont vos preuves? disent nos adversaires. De quelle démonstration mathématique faites-vous résulter l’illégitimité de la peine de mort?
Voici notre réponse:
Si du temps de Socrate et de Platon, lorsque l’esclavage ne choquait ni la religion ni les mœurs, l’un ou l’autre de ces philosophes avait élevé la voix contre cette odieuse coutume, invoquant à l’appui de sa requête généreuse les éternelles lois du juste et de l’injuste et les droits sacrés de l’humanité, et que quelque contradicteur scrupuleux fût venu froidement lui dire: Vous affirmez que l’esclavage est un illégitime abus de la force; mais ce n’est point là un axiome d’une évidence irréfragable, une vérité d’intuition immédiate. Où sont vos preuves? fournissez vos preuves; car, sans une démonstration de fait exacte et rigoureuse, nous ne pouvons vous croire, la pratique des siècles et des peuples étant contre vous. L’illustre philosophe n’eût-il pas été fondé à repondre: Que me parlez-vous de pratique des siècles, de preuves matérielles! vous êtes des barbares! Je demande l’abolition d’une coutume abominable qui vous ravale au rang des bêtes féroces et dont la nature a horreur. J’invoque ce qu’il y a de plus saint dans les lois divines et humaines. S’il vous faut d’autres preuves, sophistes insensés et cruels, cherchez-les dans votre cœur et dans votre conscience; honte et malheur à vous si elles n’y sont pas! Sans doute, le contradicteur opiniâtre aurait dédaigneusement souri à cette réponse, traitant Platon ou Socrate de philantrope et de rêveur. Et cependant plus tard, l’humanité a vu briller le jour de son triomphe, l’esclavage a été aboli. Qui tenterait aujourd’hui de le rétablir?
Eh bien! pour vous aussi, partisans de la peine de mort, tel sera nôtre langage.
Si la démonstration de M. Lucas ne peut vous satisfaire; si l’invocation des lois éternelles du juste et de l’injuste vous trouve sourds; si vous êtes insensibles au cri de la nature, à la grande voix du progrès, à la marche entraînante de la civilisation, qui sont des preuves aussi; enfin, si vous pouvez vous garantir de ce doute terrible qui plane sur le monde comme un fantôme et s’est attaché à toutes les ames comme un remords rongeur; hommes stoïques et scrupuleux, descendez en vous-mêmes, consultez bien votre raison pure de tout alliage, libre de tous préjugés, et ces preuves qui vous manquent encore, vous les trouverez dans vos cœurs et dans vos consciences, car c’est là que Dieu les a déposées. Ah! vous seriez trop à plaindre si elles n’y étaient pas!
Du reste, ainsi que nous l’avons annoncé, de tous les auteurs qui ont combattu M. Lucas, et qui, au dire de M. Silvela, ont si victorieusement réfuté son système, aucun n’a fait le moindre effort pour donner à son tour la preuve directe de la justice et de la légitimité de la peine de mort; tous se sont réfugiés, comme leurs devanciers, dans la question de l’utilité commune, de la nécessité.
M. Silvela s’en plaint avec amertume. Il leur reproche d’avoir désespéré d’établir cette preuve; d’avoir, comme Alexandre, tranché le nœud gordien; et c’est, de son aveu, un bien triste moyen, en fait de raison, que la supercherie du héros de Macédoine.
Cependant, ajoute-t-il, la question est inévitable; là gît la difficulté : il doit être possible de s’en tirer autrement.
..... «Qu’importe que le législateur déclare, par la bouche du juge, que la mort de tel ou tel individu est utile au plus grand nombre? La victime choisie aura le droit de lui dire: Législateur, ma mission n’est point celle d’être offert en holocauste à l’utilité du plus grand nombre ni de tous. Je ne suis point venu au monde, comme le Christ, pour la rédemption du genre humain; je n’ai reçu de la nature d’autres devoirs que celui de ma conservation. Ce n’est point dans l’utilité des autres, c’est dans mon utilité à moi qu’il faut venir chercher l’origine de mes devoirs..... C’est dans les lois de mon organisation, lois qui sont pour moi les lois suprêmes, les seules pour moi irrécusables, incontestables; c’est là, dis-je, qu’il faut trouver la justice de ma destruction.
«Avec quelle inconcevable légèreté n’a-t-on pas passé sur de telles difficultés, sur des réclamations aussi fondées!
«Il n’y a qu’un moyen de répondre à une pareille argumentation, c’est de fournir à ce même individu qui parlait tout à l’heure la preuve qu’il réclame; c’est de lui prouver d’une manière directe et primitive que dans les lois même de son organisation, nous trouvons la légitimité de la peine qui le condamne à mort.»
Et M. Silvela entreprend de fournir cette preuve. S’il ne le fait pas, à notre avis du moins, d’une manière concluante, il est juste de dire qu’il remplit sa tâche consciencieuse avec la loyauté et la noblesse qui distinguent son talent.
«L’utilité de chacun, l’utilité individuelle si intimement liée à l’utilité commune...
«..... Il nous est moralement permis d’employer à notre destruction les moyens qui atteignent le mieux le but de notre conservation.»
Tels sont les principes qui servent de base à son système; suivons-le dans les développemens.
«Se conserver et se détruire, considérés comme des signes abstraits, sont deux images d’une opposition absolue; mais se conserver et se détruire, considérés comme des faits tels qu’ils existent dans tous les êtres organisés, chez les hommes comme chez les animaux, ne sont ni exclusifs l’un de l’autre, ni d’une opposition absolue, puisqu’au contraire ces êtres ne se conservent que par les mêmes moyens qu’ils se détruisent.
..... «Considéré comme un être moral, l’homme ne peut user de ses facultés physiques, quoiqu’il ait la possibilité d’en user dans toute leur étendue: il en est qu’il ne convient pas à l’être moral d’employer. Considéré comme être raisonnable, il ne peut rien faire bénévolement et sans cause ou sans motif. Mais lorsque son motif d’agir est juste, conforme à la raison, tout lui est permis, même de se détruire, c’est-à-dire de consentir à perdre la vie. Eh! que pourrait-il donc s’il ne pouvait cela, puisque pour lui vivre n’est autre chose qu’user ses forces vitales, et les perdre par l’usage? Vivre n’est point acquérir ou conserver; vivre c’est dépenser, user, et dans ce genre de dépense comme dans tous les autres, nous ne devons être ni avares ni prodigues. La sobriété dans l’usage des plaisirs n’est une vertu que parce que c’est par elle que nous faisons de la vie le meilleur et le plus long usage possible.
«Il semble donc, d’après cela, qu’un pacte, bien qu’il puisse renfermer la condition de notre destruction lente ou instantanée, est non-seulement un droit pour nous de le faire, mais même il devient un devoir de le contracter toutes les fois que cette condition du juste motif se trouve suffisamment établie; c’est-à-dire, si, en exposant ainsi notre vie par les chances de cette condition, nous ne le faisons que pour mieux conserver notre existence.
«..... Ce pacte se réduit à ce peu de mots: Vous respecterez mon existence, vous la défendrez; de mon côté, j’agirai de même envers vous. Consentons réciproquement à être détruits, si nous privons injustement de la vie un de nos semblables.»
«..... Et qu’on ne dise pas qu’il est possible de former ce pacte avec tous ses avantages et sans cette condition. La réponse est facile à cette observation beaucoup trop philantropique. Il me faut votre vie pour garantie de la mienne; tel est le cri de l’humanité..... Cette menace de mort était ma garantie, c’était mon droit; il m’appartient comme tous mes autres droits que vous n’avez pas la faculté d’anéantir.
«Reconnaissons donc comme juste tout ce qui est nécessaire, et concluons de tout cc qui vient d’être dit que nous avons, mais seulement d’une manière conforme à la raison le droit de nous détruire.....
«..... Mais non-seulement les individus peuvent donner en garantie leur vie, qui est leur véritable,. leur seule propriété, et à laquelle se rapportent toutes les autres, la société le peut aussi en tant que société.....
«..... Si un homme est injustement attaqué, comment peut-il satisfaire au devoir de sa conservation, s’il ne lui est pas permis d’employer le seul et unique moyen que la nécessité mette dans ses mains? A-t-on jamais accusé de meurtre l’homme qui, repoussant une injuste agression, devient l’homicide de l’assaillant? Et comment l’homme injustement attaqué aurait-il acquis le droit de tuer l’assaillant, si celui-ci n’eût perdu le droit à sa propre existence? Impossible de concevoir, en morale comme en raison, deux droits opposés existant simultanément. Par le fait de l’agression, l’assaillant a perdu indubitablement le droit à la vie, et voilà pourquoi on peut la lui ôter sans crime.
«Et maintenant, si l’assaillant perd le droit à la vie par le fait d’une injuste agression, pense-t-on qu’il puisse le recouvrer par l’accomplissement de son crime?
«...... La société poursuit le criminel, et si elle trouve dans son crime tous les caractères d’une perversité noire, toutes les données capables d’établir la présomption la plus fondée qu’il y a incompatibilité entre l’existence de l’assaillant et la vie de tous les autres citoyens, la société a le droit d’agir envers celui qui, comme nous venons de le voir, a perdu tout droit à la vie, de la même manière que nous agirions nous-mêmes.
«..... Le principe, qu’on doit s’abstenir de tuer l’assassin désarmé, doit être renfermé dans de justes limites. Il faut suspendre l’exécution de la mort lorsqu’il vient de céder à une force matérielle supérieure à la sienne, jusqu’à ce qu’on puisse établir, par l’examen des motifs qui le décidèrent au crime, par les circonstances enfin, toutes les garanties morales qui doivent concourir au jugement qui le détruit ou lui conserve la vie. L’accusé doit être entendu: voilà son droit; la société doit juger avec justice, avec indulgence même: c’est son devoir.»
Je ne sais si je m’abuse, mais il me semble que tous ces raisonnemens sont plus brillantés que solides, plus spécieux que convaincans; et si quelque chose a droit de surprendre, c’est qu’un homme aussi capable que M. Silvela ait pu se laisser séduire par leur prestige mensonger.
Et d’abord, ce qui frappera le lecteur le moins attentif, c’est qu’après être parti de l’utilité individuelle et de l’utilité commune intimement liées ensemble, pour en faire découler le principe de la légitimité de la peine de mort, attendu, dit M. Silvela, que l’homme et la société ont le droit d’employer à leur destruction les moyens qui atteignent le mieux le but de leur conservation, cet auteur est forcé, en se résumant, de déclarer qu’il faut reconnaître comme juste tout ce qui est nécessaire; en sorte qu’oubliant ses prémisses, et au lieu de prouver le droit et la justice sans s’inquiéter de l’utile, il se voit réduit à conclure la justice de l’utilité et de la nécessité. D’un autre côté, que dire de cette étrange définition des, mots se conserver et se détruire, et de l’application plus étrange encore que M. Silvela en fait aux hommes et à la société ? Quoi! parce que «l’être se conserve par la nutrition, et que la nutrition est le résultat d’une digestion, de l’effort d’un organe qui, tout en décomposant d’autres substances pour l’assimilation, s’affaiblit par son action et finit par se détruire à force de s’affaiblir,» vous en concluez que l’homme peut aussi, pour assurer sa conservation, affaiblir ses forces vitales, les perdre par l’usage, dépenser sa vie et enfin consentir, dans un cas donné, à subir la mort! et la légitimité de cette peine vous paraît suffisamment justifiée par le motif juste et conforme à la raison qui détermine l’homme à exercer ce droit-devoir que vous lui attribuez de se conserver et de se détruire, ou soit de se détruire pour se conserver!
En vérité, ce n’était pas la peine de descendre des hautes régions de la morale et de la philosophie pour arriver à une pareille argumentation; et il valait encore mieux, à mon sens, reléguer la question de la légitimité de la peine de mort dans le domaine des questions vaines et oiseuses que de chercher à la résoudre par ces singulières distinctions à coup sûr bien plus extraordinaires que les distinctions de personnalité et d’impersonnalité sur lesquelles on a vainement tenté de déverser le ridicule et le mépris.
Oui, sans doute, l’homme a le droit de se conserver; il en a non-seulement le droit, mais le devoir; et si, dans le cas de légitime défense, il tue l’assassin qui l’a attaqué, ce n’est point en vertu d’un absurde droit de destruction, mais en vertu du devoir de sa conservation. Une fois sa vie sauve, une fois l’agresseur désarmé, l’état de légitime défense n’existe plus, il n’y a plus de droit à l’existence en péril.
Que l’assassin ait consommé ou non son lâche forfait, il doit compte à la société de cet acte d’usurpation sacrilége; la société, grâce au ciel, n’est point désarmée contre lui. Infliction d’une peine immédiate et certaine en rapport avec la perversité de l’action et la criminalité de l’intention de l’agent; exemple de répression salutaire dans la menace de cette peine pour quiconque serait tenté de violer le même devoir; et moyen d’amendement dans l’exécution de cette peine pour la personne même du condamné ; voilà les élémens légitimes de pénalité que la société possède, et ils peuvent suffire à sa conservation. La mort, comme peine, n’appartient qu’à Dieu; la société ne saurait l’infliger sans crime quand bien même elle lui serait nécessaire; et dans son intérêt matériel, on peut dire qu’elle ne le doit pas; car la peine de mort a des inconvéniens immenses que nous ne tarderons pas à signaler, et il est notoire qu’elle ne remplit qu’une faible partie des conditions que la société doit rechercher dans un châtiment.
L’éternelle erreur des partisans de la peine de mort, et de M. Silvela en particulier, est de s’imaginer que cette peine est un remède souverain, une panacée universelle qui seule peut guérir toutes les plaies sociales, et assurer l’existence individuelle et collective de toutes les classes de citoyens. De là, ces prétendus pactes et contrats entre la société et les membres qui la composent; de là, ces farouches paroles: «Il me faut votre vie pour garantie de la mienne;» comme si la société était un ramassis de vils brigands, de féroces assassins stipulant entre eux dans la prévision et avec la conscience de leurs forfaits à venir; comme si la menace de la mort devait suffire pour étouffer dans les cœurs le germe des coupables pensées, des furieuses passions; comme si enfin, lorsque malgré la terrible menace, un attentat était commis, il suffisait pour rétablir l’ordre et calmer l’alarme d’envoyer une victime humaine à l’échafaud comme à un sanglant abattoir.
En résumé, l’on peut dire qu’il n’existe que deux cas de légitime défense pour l’homme et pour la société ; le premier est l’attaque d’homme à homme dont nous venons de parler plus haut; le second est l’attaque de peuple à peuple, c’est le cas de guerre. Dans l’un comme dans l’autre de ces cas, une impérieuse nécessité peut forcer l’homme ou le peuple à donner la mort à ceux qui attaquent leur existence; mais nous avons vu que c’est là plutôt un devoir de leur conservation qu’un droit sur l’existence de leurs agresseurs. L’homme ou la société n’ont pas plus le droit de tuer l’assassin désarmé qu’un peuple n’aurait le droit de mettre à mort le peuple ennemi qu’il aurait réduit par la force des armes. Vainement alléguerait-on, comme M. Silvela, que l’existence de l’assassin est incompatible avec celle de la société au sein de laquelle il a porté l’épouvante; une semblable incompatibilité peut aussi exister entre deux peuples voisins; et certes, l’on n’ira pas jusqu’à dire que l’un des deux pourrait puiser dans la victoire le droit d’immoler l’autre de sang-froid, et de chercher une atroce sécurité dans l’extermination de son adversaire. Je n’entends pas assurément assimiler le lâche assassin à un ennemi loyal, quoique acharné ; mais il s’agit de réfuter ce principe d’une prétendue incompatibilité qu’invoque M. Silvela, et la fausse application qu’il fait du droit de légitime défense; et l’on voit que, même en partant de données eu apparence exactes et rigoureuses, il est facile, lorsqu’on force les conséquences, de tomber dans l’absurde.
M. Silvela consent, il est vrai, si l’assassin est arrêté vivant sur le théâtre de son crime, qu’il n’y soit pas immédiatement égorgé. Il exige des lenteurs, des formes, un examen préalable des motifs et des circonstances avant de l’abandonner au bourreau. C’est quelque chose, sans doute; mais, dans sa touchante sollicitude, comment cet auteur n’a-t-il pas compris qu’aussitôt qu’il met la balance dans la main des hommes pour y peser l’intention de l’agent, le rapport de son action avec la loi morale violée et la peine extérieure qui convient aux degrés de criminalité de l’agent et de l’acte, il ne s’agit plus uniquement des pouvoirs conférés à la société pour punir et se conserver, mais du domaine de la conscience, du domaine de l’avenir, de ce droit redoutable de vie et de mort que Dieu seul peut avoir sur ses créatures, et que toute la puissance des hommes ne peut s’arroger sans usurpation et sans sacrilége.
Si du moins les partisans de la peine de mort présentaient à l’appui de leur système quelques faits concluans d’où pût jaillir en leur faveur l’autorité de l’expérience, leur cruelle insistance et leur aveuglement extraordinaire pourraient s’excuser. Mais non; courbés sous le joug de la routine, préoccupés d’une insurmontable terreur qui offusque leur jugement, ils se hâtent de crier pour le maintien d’une peine qu’ils croient nécessaire à leur sûreté ; ils la proclament légitime pour étouffer la voix de leur conscience alarmée; mais les voit-on du moins s’enquérir du bien qu’elle a pu faire, du mal qu’elle a pu produire? non; ils ne s’en inquiètent pas du tout. Et cependant, si nous regardons en arrière, si nous lisons dans le passé, quel cœur ne se briserait à l’aspect de ces sanglans sacrifices si inutilement prodigués, de ces hécatombes humaines dont l’origine se perd dans la nuit des âges, et qui semblent n’avoir été si long-temps offertes à ces divinités insatiables, que la crédulité populaire encense sous les noms d’intérêt et de nécessité, que pour attester plus énergiquement au monde l’inefficacité de la peine de mort.
Eh quoi! hommes impitoyables, ne voyez-vous pas que c’est en vain que vous vous baignez dans le sang? Ah! si du moins la mort que vous prodiguez avec une si incroyable assurance bannissait du sein de la société les meurtres et tous les attentats qui la désolent, si du moins elle en diminuait le nombre; peut-être, malgré l’illégitimité de cette peine, consentirions-nous à nous voiler la face, et à subir, dans l’intérêt de la société elle-même, un châtiment barbare qui révolte la nature et l’humanité. Mais quand, près des échafauds en permanence, nous voyons les assassinats se multiplier; quand nous voyons dans vos mains homicides la balance de la justice incertaine et le glaive de la loi sans vertu; quand nous voyons le peuple dépravé par vos exécutions sanguinaires, esclave comme auparavant de ses passions, de l’ignorance, de l’abrutissement et de la férocité; oh! qu’il nous soit permis d’élever la voix pour crier anathème! qu’il nous soit permis de proclamer l’insuffisance et l’illégitimité de la peine de mort; qu’il nous soit permis de vous demander compte, au nom de l’humanité gémissante, de chaque goutte d’un sang qu’il ne vous appartenait pas de répandre pour le bien de la vertu même, et qui fut versé par vous dans le seul intérêt du crime, sans nécessité comme sans mandat.
Oui, sans nécessité, et c’est là le nouveau terrain où doit triompher la noble cause que je défends. L’illégitimité de la peine de mort étant démontrée, il me reste à prouver son inutilité.
Cette démonstration sera superflue pour ceux qui, adoptant la bannière de M. Lucas, jugeraient la peine de mort illégitime, car, de l’aveu même de nos adversaires, la question du juste et du droit domine ici celle de l’utile; et, le jour où la peine de mort sera universellement reconnue, tous les échafauds doivent tomber.
Mais nous n’espérons pas d’impossibles prodiges: la vérité, même avec l’appui de la conscience, pénètre lentement dans les cœurs. Quelque nombreuses que soient les conversions, il restera long-temps encore des hommes craintifs et de bonne foi qui, s’obstinant par un scrupule de faiblesse superstitieuse à laisser de côté la question du juste, se réfugieront pour s’étourdir dans la question de l’utilité et de la nécessité.
C’est là qu’il faut les suivre; c’est dans ce dernier retranchement de leur erreur opiniâtre qu’il faut les forcer.
Ainsi, réunissant en faisceau les divers argumens que nous aurons présentés en faveur du double système, nous pourrons interpeller tous nos adversaires et leur dire; aux uns: respectez la vie de l’homme, car elle est inviolable et sacrée et la peine de mort est illégitime; aux autres: la peine de mort n’est ni nécessaire ni utile, il ne faut pas tuer!
Mais avant de prouver l’inutilité de la peine de mort, disons un mot de son immoralité.