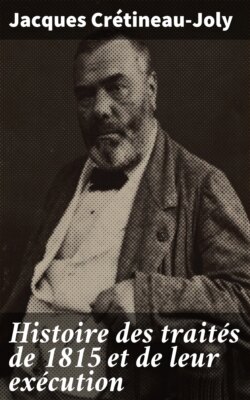Читать книгу Histoire des traités de 1815 et de leur exécution - Jacques Crétineau-Joly - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеTable des matières
Retour de Louis XVIII. — Intrigues de Gand et de Paris. — MM. de Talleyrand, Fouché, Pasquier et l’abbé Louis, ministres. — Situation de la France après la bataille de Waterloo. — Caractère de la seconde invasion. — Animosité des étrangers contre la France. — Causes du licenciement de l’armée de la Loire. — Portrait de Fouché. — Les proscriptions. — Ce que les alliés veulent faire de la France. — Le duc d’Angoulême et le général Castanos dans le Midi. — Premières mesures des puissances à Paris.
Le désastre de Waterloo, cette grande calamité nationale, que la révolution et l’empire agonisant sous le canon des puissances coalisées léguèrent à la monarchie légitime comme un souvenir d’héroïsme pour eux et de honte pour elle; le désastre de Waterloo n’a plus besoin d’être expliqué. Les trahisons de la fortune, celles des hommes, les indécisions des généraux, la fatalité qui du front de Bonaparte passa si vite dans l’âme de ses lieutenants; les passions révolutionnaires, venant à chaque secousse, par l’organe de la chambre des représentants de 1815, apporter une entrave ou une difficulté de plus aux ordres de Napoléon; le cercle d’autorité se rétrécissant sans cesse sous la main impérieuse des partis; les misérables calculs des uns, l’enthousiasme sans avenir des autres, tout cela ne rentre pas dans le cadre que nous traçons à cet ouvrage.
Sans vouloir revenir sur tant de faits encore mal éclaircis, mal appréciés et livrés depuis vingt-sept ans aux ardeurs d’une polémique provocatrice, nous n’avons pas à dire dans cette histoire les fautes commises en 1814, fautes que Louis XVIII ne devait pas recommencer après les avoir condamnées avec tant de royale franchise, après les avoir expiées par un exil que l’abandon des uns, que la trahison des autres, que la mésintelligence ou l’incurie de ses amis ne surent même pas rendre utile ou glorieux à la patrie.
Pour forcer le roi à se jeter dans les bras de la révolution d’habiles intrigants avaient mis en jeu tous les ressorts. Ici, dans le château même des Tuileries, ils faisaient vibrer le sentiment de la vieille nationalité française; ils démontraient au roi qu’il serait beau à lui, le sceptre et l’épée de justice à la main, d’attendre dans son palais l’usurpateur impérial qu’un complot de quelques séides ramenait à Paris.
Le roi, accablé par toutes les souffrances morales et physiques, se sentait ou voulait se laisser croire digne petit-fils d’Henri IV et de Louis XIV. Il s’endormait au milieu des rêve d’un dévouement monarchique; mais là, tout à côté de ces mêmes Tuileries, on tenait un autre langage, on faisait d’autres vœux, on s’arrêtait à d’autres projets.
La peur régnait dans les conseils de la couronne; elle s’était assise au chevet des courtisans qui, rassurés par les promesses de Fouché et par les prédictions de Barras, l’ancien directeur, se révoltaient à l’idée seule de compromettre la vie du prince. On le plaçait dans une situation dangereuse peut-être, mais cette situation faisait éclater aux yeux de tous ce courage qui sied si bien à la royauté et qui plaît tant aux Français. Dans cette hypothèse il fallait s’associer à sa destinée; il fallait se condamner à mourir au pied d’un trône que, dans onze mois d’erreurs ambitieuses, de faux calculs, de rêves impossibles ou d’absurdités constitutionnelles, ils avaient sapé et perdu.
On intrigua pour donner du courage parlementaire à Louis XVIII; il en eut en face des grands corps de l’état réunis autour de lui dans le péril commun. On intrigua ensuite pour le forcer à déserter le poste d’honneur où, la veille encore, il jurait de mourir en roi. A Gand on intrigua de toutes façons, tantôt contre M. de Blacas, tantôt pour M. Fouché ; et tandis que l’armée de Napoléon expirait dans une dernière étreinte avec l’Europe, on intriguait pour savoir sur quel lambeau de papier on assurerait l’avenir de la monarchie et du pays.
Le roi était enfin sur le territoire français, et à Cambrai comme au château d’Arnouville, l’une de ses dernières étapes pour arriver à Paris, on intriguait encore. Fouché voulait se rendre nécessaire. Ministre de l’empereur pendant les Cent-Jours, il aspirait à conserver le pouvoir; sans transition, sans amende honorable, il se présentait, lui le régicide, lui le révolutionnaire, lui le traître à la république, au directoire et à l’empire, comme le lien qui pouvait réunir dans le même faisceau la monarchie tempérée et la révolution convertie aux idées d’ordre et de conservation.
Cette intrigue était si habilement ourdie que le duc de Wellington et le prince de Talleyrand d’un côté, que les exaltés de l’autre, y donnaient tous la main. L’esprit astucieux de Fouché avait séduit les candeurs royalistes, et Louis XVIII, qui avait plus d’amour-propre que de jugement, se complaisait dans la pensée qu’il allait lutter de finesse et de roueries politiques avec cet homme dont les mains étaient teintes du sang de Louis XVI.
En 1814 le roi commençait ainsi son préambule d’ordonnance constitutive de la charte:
«La divine Providence, en nous rappelant dans nos états après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations.» Pour donner à ses sujets une traduction moins mystique de ces grandes obligations que la divine Providence lui imposait, il chargeait les abbés de Talleyrand, de Pradt, de Montesquiou et Louis de les commenter. Par une de ces dérisions que les historiens acquièrent le droit de flétrir, ces quatre hommes, engagés dans les saints ordres, étaient à un degré plus ou moins prononcé des apostats.
Talleyrand, évêque d’Autun, avait renoncé à l’Eglise pour contracter un mariage ridicule, même aux yeux du monde.
L’abbé de Pradt avait abandonné son diocèse de Poitiers, et, aumônier du dieu Mars, ainsi que se qualifiait ce prélat mythologique en faisant allusion à son maître Napoléon qui l’avait créé archevêque de Malines, il vivait dans une atmosphère fort peu canonique.
L’abbé de Montesquiou était un vieux constituant, un vieux membre des comités royalistes, et que nous avons vu ministre de l’intérieur en 1814, sous la férule du protestant Guizot, son secrétaire général. Il n’avait pas, comme l’abbé Louis, servi de diacre à M. de Talleyrand au milieu de la cérémonie révolutionnaire du Champ-de-Mars le 14 juillet 1790; mais comme lui il possédait le moins possible les vertus qui font les bons prêtres.
Cependant c’était à ces quatre ecclésiastiques que le soin des affaires de la première Restauration avait été confié ; celles de la seconde rentraient de plein droit dans les attributions de l’oratorien Fouché. Le régicide de 1793 s’en était emparé par droit d’intrigue. Avec M. Pasquier pour collègue et M. Decazes pour préfet de police, le prince de Talleyrand, Fouché et l’abbé Louis allaient opposer aux besoins moraux de la société un refus de concours dont le cynisme spirituel de Louis XVIII et la béate confiance de Charles X ne surent pas préserver la France.
Le roi venait de faire sa rentrée dans la capitale; triste rentrée que la joie du peuple accueillit encore, car elle arrachait le pays aux dernières misères que chacun prévoyait, mais elle ne pouvait cicatriser la plaie faite à l’honneur national. Ce n’était plus cet élan de 1814 courant au devant du comte d’Artois et de Louis XVIII, et saluant leur retour comme un gage de bonheur public. Il y avait eu tant d’espérances déçues, tant de fautes politiques accumulées presqu’à plaisir autour des Bourbons, tant de manifestations insolites, tant de favoris et de courtisans élevés sans motifs légitimes aux grandeurs ou à la fortune, tant d’hésitation chez les uns, tant de perfidie chez les autres, et parmi les royalistes vraiment dignes de diriger les affaires, un si profond découragement en face de toutes les concessions faites dans les choses et de toutes les réactions annoncées dans les mots, qu’à l’aspect de cette seconde Restauration, plus miraculeuse que la première, on se prenait à douter de l’avenir.
On doutait surtout de Louis XVIII. On ne pouvait se persuader que ce prince, dont les espérances, peut-être mal traduites par les faits, n’avaient pas vu sans un certain plaisir l’aurore de la révolution, arriverait dans sa vieillesse avec assez de royale énergie pour fermer des plaies que ses mains avaient contribué à ouvrir. Les royalistes repoussaient d’instinct la charte octroyée; les impériaux, formés par Napoléon au despotisme militaire et administratif, ne songeaient à la respecter que lorsque, dédaignés par la cour, ils pourraient s’en faire un levier d’opposition en se liguant avec la bourgeoisie, qui, dans ce nouveau mode de gouvernement, pressentait sa puissance future. L’enthousiasme de 1815 venait donc plutôt de la haine portée à Bonaparte que de la confiance dans les Bourbons.
La position de la France était bien difficile et bien cruelle. L’armée, qui avait si follement trahi ses serments afin de courir avec son ancien empereur les chances d’une bataille désespérée contre l’Europe, se retirait humiliée et anéantie derrière la Loire. Une alliance avec la Vendée en armes pouvait seule lui donner assez de consistance et d’appui moral pour mourir dans un dernier combat. A la vue des maux qui fondaient sur la patrie, l’armée eut l’intelligence de ce qui lui restait à tenter.
Un vieux prestige, d’immortels souvenirs avaient été évoqués par les conspirateurs du 20 mars. Elle y avait cédé avec une déplorable facilité, et, sans avoir le repentir de son parjure, elle sentait profondément le besoin de conserver la nationalité française. Elle était encore sous les armes, ne songeant plus qu’à défendre le territoire; mais abandonnée à la fois et par Napoléon déjà captif des coalisés, et par cette misérable chambra des représentants de 1815 dans le sein de laquelle ne s’agitaient que des avocats, que des ambitieux de bas étage, que des dupes ou des instruments de Fouché, elle n’osait pas croire à la loyauté de son épée, la dernière foi du soldat.
Il n’y avait plus de gouvernement central, plus d’administration, plus rien de ce qui constitue un état. La France, dont toutes les frontières étaient violées, se voyait envahie par onze cent mille étrangers qui, dans l’espace de moins de seize mois, accouraient par droit de conquête fouler à deux reprises ce sol sur lequel la division seule des esprits les empêchait de trouver un tombeau.
A la première invasion, c’était la guerre aux ambitieux caprices de Napoléon qu’ils faisaient, la guerre à un homme. En le chassant de victoire en victoire des bords de la Bérésina jusqu’aux portes de Paris, ils avaient profité tantôt de ses succès, tantôt de leurs revers, tantôt des négociations diplomatiques ouvertes entre deux batailles, tantôt de ses concessions forcées et de l’agonie de la France pour se débarrasser d’un soldat dont l’existence, comme souverain, était un fardeau pour eux tous. Cette guerre à un homme achevée, l’Europe n’avait voulu, sous les inspirations d’Alexandre de Russie, que se montrer bienveillante envers la France; elle l’avait traitée en généreuse ennemie, lui laissant le droit de se choisir un monarque. Elle se contentait de demander une paix qui alors était dans les vœux des peuples comme des rois, des généraux comme des armées.
Mais lorsque la nouvelle du débarquement de l’île d’Elbe tomba comme la foudre sur les souverains et les ministres qui, au milieu des carrousels et des fêtes du congrès de Vienne, se partageaient les peuples et faisaient une nouvelle carte politique de l’Europe, il y eut un moment de stupéfaction indéfinissable; de toutes les bouches il s’échappa presque aussitôt un cri de colère contre les Bourbons. Les rois accusaient Louis XVIII de n’avoir pas su régner: les uns parlaient de poser la couronne de France sur une autre tête, et ils regrettaient tout haut que le duc d’Orléans ne fût pas légitime; les autres demandaient le partage immédiat du royaume, et voulaient que l’Europe lui réservât après la bataille le sort de la Pologne.
A la suite de leur célèbre déclaration du 10 mars 1815, les hautes puissances déclarèrent
«unir tous leurs efforts contre Bonaparte et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou s’y réuniraient dans la suite, afin de les mettre hors d’état de troubler la tranquillité de l’Europe, la liberté et l’indépendance des nations.»
Chacune des hautes puissances s’engageait à tenir constamment en campagne cent cinquante mille hommes «jusqu’à ce que, est-il dit dans leur déclaration, Bonaparte soit mis hors de la possibilité d’exciter des troubles et de renouveler des tentatives pour s’emparer du pouvoir suprême.»
Toutes ces mesures étaient prises contre Napoléon. Rien n’était fait en faveur de Louis XVIII et de sa dynastie, qui, par une étrange confusion d’idées et de projets, apparaissait pourtant comme une des signataires de l’acte du 25 mars. Bonaparte était l’ennemi de l’Europe, l’Europe le mettait au ban des nations; mais la cause des Bourbons n’en était pas pour cela moins ébranlée.
A la suite même de ce traité, l’Angleterre proposa et fit admettre une restriction qui, sous l’enveloppe des formes diplomatiques, révèle parfaitement les intentions des monarques. Il y était dit:
«Quel que soit le vœu qu’ils doivent former pour voir sa majesté très chrétienne rétablie sur le trône et quel que soit le désir des alliés de concourir simultanément à un événement si heureux, ils se croient obligés de déclarer, même par la considération de ce qui est dû aux intérêts de S. M. T. C., qu’il est bien entendu que l’intention des alliés n’est pas de poursuivre la guerre dans la vue d’imposer à la France un gouvernement particulier.»
Avant leur victoire de Waterloo telle était la pensée des monarques. Quand Louis XVIII, comme il le disait avec tant de spirituelle vérité, eut volé son trône pour la seconde fois, les hautes puissances consacrèrent ce vol légitime par leur adhésion; mais elles se tenaient en défiance du roi, de ses adversaires et surtout de ses amis. Les actes diplomatiques constatent cette espèce de répugnance que des causes de toute nature, que de tristes réalités ou d’absurdes calomnies rendent aujourd’hui plus palpable que jamais. Les Bourbons se sont imposés aux étrangers par l’autorité seule de leur droit; mais ils n’ont jamais été imposés à la France par les puissances coalisées. Au congrès de Vienne, le 25 mars 1815, elles déclaraient clairement leurs intentions. Le 26 septembre de la même année, lorsque tous les événements sont accomplis, lorsque Louis XVIII est rétabli sur son tronc et le jour même où M. de Richelieu prend le pouvoir, le duc de Wellington, écrivant au général Dumouriez, pensionnaire du cabinet de Saint-James, lui explique en ces termes la position du souverain, celle de la France et pourquoi il a épousé les intérêts de Fouché.
«A mon arrivée à Paris, dit le général en chef de la coalition, je savais que les alliés n’étaient pas du tout déterminés en faveur du roi; que les.... ne voulaient pas la restauration; que l’armée et les assemblées ne voulaient pas de lui; qu’il se trouvait quatre provinces en rébellion ouverte et des autres, y incluse la ville de Paris, très froides Il m’était très clair que si je n’intéressais pas Fouché à la restauration du roi, sa majesté aurait été obligée de rester à Saint-Denis, du moins jusqu’à l’arrivée des souverains, ce qui aurait en tout cas nui à son autorité et à sa dignité s’il eût jamais remonté sur son trône. Donc j’ai conseillé à sa majesté de prendre Fouché à son service, afin de pouvoir rentrer avec dignité et sans efforts de la part des alliés, et je suis parfaitement certain qu’il doit sa restauration tranquille et dignifiée à ce conseil. Je crois aussi que les courtisans étaient satisfaits et ont applaudi l’arrangement le jour qu’il a été adopté, qu’ils l’ont blâmé aussitôt qu’ils ont joui des effets. Ils ont tout de suite commencé à intriguer contre Fouché et contre le ministère. Fouché s’est peut-être mal conduit en quelques circonstances, mais pas la moitié si mal qu’on l’a dit et qu’on le croit. Au contraire, je sais que ce sont les courtisans qui ont publié son dernier rapport au roi. Enfin vous en voyez le résultat dans le renvoi de tout le ministère formé avec l’approbation de toute l’Europe et dans le moment le plus critique de la négociation. Je crois que le roi était content de Fouché.
La seconde invasion n’offrait donc plus le même caractère que la première. Le retour de l’île d’Elbe, accompli d’une manière si funestement prodigieuse, avait dans les provinces remué la lie révolutionnaire dont, pendant ses dix années de règne, l’empereur sut si admirablement comprimer les exagérations. Les haines de parti à parti fermentaient; les souverains, effrayés de ces tendances qui pouvaient corrompre les dispositions de leurs sujets, dont on avait peut-être trop flatté les intérêts de liberté afin de les pousser en masse contre Napoléon, ne se présentaient plus à la France vaincue avec l’habile générosité de 1814. Les princes alliés étaient maîtres de nos places fortes, de nos arsenaux, de nos villes maritimes, du cours des fleuves et du territoire qu’un sublime effort aurait pu seul délivrer. Ils avaient de longues vengeances à satisfaire, de grandes terreurs à calmer, de pénibles précautions à prendre contre cet élan militaire, dont les champs de bataille de Ligny et de Waterloo venaient d’être les témoins. A tout prix il fallait affaiblir la France, afin de donner la paix au monde.
Par les généraux ou par les commissaires attachés à ses armées la France avait souvent abusé de la victoire. Elle avait levé sur les peuples vaincus d’immenses contributions de guerre, changé les lois d’un pays, substitué une dynastie à une autre et fait violence à des régions qui, par un simple décret, se voyaient tout à coup forcées de renoncer à leur langue maternelle, à leurs mœurs et à leurs usages pour être incorporées à l’empire.
Ces souvenirs tout récents dominaient les intelligences. La Prusse surtout, dont Blucher, avec son vieil instinct populaire, avait su si profondément remuer les universités et les sociétés secrètes, la Prusse, si souvent abattue sous nos aigles et qui croyait toujours voir planer sur sa tête l’image désolée de sa belle reine morte de désespoir patriotique, la Prusse se montrait sans pitié. L’Angleterre tenait prisonnier à bord d’un de ses vaisseaux le géant qui, pour consommer sa ruine, s’était tour à tour jeté sur l’Espagne et sur la Russie; mais cette victoire d’un grand peuple sur un grand homme, victoire achetée par tant d’incommensurables sacrifices, ne suffisait pas au cabinet de Londres. L’empereur captif et remis par l’Europe à la garde de l’Angleterre pouvait bien satisfaire l’amour-propre britannique; ce n’était pourtant pas assez pour lui.
Le gouvernement anglais sait par expérience les bénéfices de toute sorte que l’on peut escompter après un triomphe, et il se les accorde tous. La gloire pour lui est sans doute quelque chose; mais, avant même cette gloire, il doit faire passer ses intérêts mercantiles, son désir d’agrandissement et décolonisation, qui a encore un but commercial. Dans la situation de 1815, à ces combinaisons réunies venait s’en joindre une dernière qui les effaçait toutes: c’était la France qui n’avait plus de Jeanne d’Arc pour chasser les Anglais, la France vaincue qui allait recevoir des lois, et la Grande-Bretagne, qui, forte de sa vieille haine, s’apprêtait à les dicter.
A côté de ces deux puissances, ne cachant ni leurs répulsions, ni leurs espérances, se groupaient la Russie, l’Autriche et les états secondaires qui, soit comme alliés, soit comme ennemis de la révolution et de l’empire,avaient tous de graves plaintes à faire prévaloir, des sévices de plus d’un genre à jeter dans le plateau de la balance. La Russie, par l’absence de ses armées à Waterloo, perdait sur l’esprit de ses coalisés une partie de l’influence dont la position personnelle du czar et les immenses services rendus par ses bataillons dans les dernières campagnes l’avaient investie en 1814. Alexandre s’était vu à cette époque l’arbitre du destin, et le Grec du bas empire, ainsi que Bonaparte le nommait sur le rocher de Sainte-Hélène, avait déployé dans ces circonstances décisives une magnanimité de désintéressement que la France doit reconnaître.
Son exemple avait entraîné les autres souverains; mais les temps étaient changés, et la colère l’emportait sur la générosité. L’Angleterre et la Prusse dirigeaient les conseils des monarques. L’Autriche, qu’une alliance de famille attachait à Napoléon, mais que l’irritation de son armée vaincue par le même homme depuis Marengo jusqu’à Wagram, poussait aux moyens extrêmes, faisait cause commune avec les exagérations de la victoire. La Bavière, la Saxe, les Pays-Bas, le Wurtemberg, la Sardaigne et toutes les principautés de la confédération du Rhin se montraient aussi âpres que la Prusse et l’Angleterre.
Ce fut dans ces dispositions que les alliés se présentèrent aux portes de Paris. Au milieu de leurs discours d’apparat ou de leurs actes officiels, on proclamait bien encore que Bonaparte seul était l’ennemi de l’Europe; que, lui abattu, il n’y avait plus de motifs pour guerroyer contre un pays dont les malheurs étaient aussi grands que le courage; mais cette mansuétude dans les paroles trouvait vite un contrepoids dans les actions.
L’empereur Napoléon se voyait mis dans l’impossibilité de nuire. Sa famille était rayée du livre des rois; elle rentrait dans sa riche obscurité, n’ayant eu besoin que de naître pour la mériter, et en restant toujours là. Mais il fallait, par toutes les humiliations réservées à la défaite, arracher du cœur de la France ce souvenir des récentes victoires qui, à un jour donné, pouvait se réveiller plus vivace que jamais. Il fallait surtout museler le lion révolutionnaire dont l’Europe avait pendant si longtemps entendu les rugissements autour de ses capitales. La cause des Bourbons, la cause des rois légitimes presque abandonnée au mois de mars 1815 comme un an auparavant, la pondération même et l’intérêt des gouvernements ne passaient qu’après ce principe d’hostilité, après la guerre que les puissances appelaient la consécration de la paix.
Il fut résolu qu’avant tout débat politique ou financier sur l’interprétation du traité de 1814, qu’au dire des alliés celui de 1815 devait régulariser seulement, on s’occuperait des débris de l’armée. Au nombre de cinquante mille hommes à peu près ils se trouvaient réunis derrière la Loire, sous le commandement du maréchal Davoust, prince d’Eckmühl.
Au 4e volume de l’Histoire de la Vendée militaire, nous avons dit avec quel désintéressement de parti les royalistes de l’Ouest offrirent de confondre leurs enseignes avec celles de la république et de l’empire pour préserver le sol français de la honte d’une seconde occupation. Nous avons cité l’ordre du jour de Davoust, qui, le 11 juillet 1815, recommande à l’armée d’être aussi française que les Vendéens. Cet ordre du jour et les faits qui lui avaient donné naissance étaient connus aux quartiers-généraux des souverains étrangers; on y savait que l’armée de Waterloo était condamnée à l’impuissance tant qu’elle agirait au nom des Jacobins, mais qu’isolée, démoralisée, sans organisation, sans appui, sans argent, elle pouvait cependant rencontrer un admirable levier en se ralliant aux Vendéens et aux Chouans.
Par le traité du congrès de Vienne, à la date du 25 mars 1815, Louis XVIII faisait partie de la coalition de l’Europe contre Bonaparte. Roi exilé, il y apportait son contingent de quatre-vingt mille hommes. Les plénipotentiaires français à Vienne avaient compté sur l’Ouest; l’Ouest ne leur fit pas défaut: il occupa plus de soixante mille impérialistes, qui à Waterloo auraient sans contredit changé la face des choses. Mais au mois de juillet 1815 la Vendée, toujours monarchique, ne croyait pas devoir sacrifier l’honneur national à des nécessités de position. Elle parlait de s’unir franchement, sans arrière pensée, à l’armée que les hasards de la guerre poussaient vers ses départements.
On laissait au ministère de MM. de Talleyrand, Fouché et Pasquier le soin de punir cette susceptibilité nationale. Les alliés, de leur côté, se chargeaient d’obtenir directement la dissolution immédiate de l’armée. C’était porter deux coups à la fois, et enlever aux provinces et au trône l’espérance d’être protégés contre les vexations.
Préliminairement à toute négociation diplomatique, le comte de Nesselrode, au nom de l’empereur Alexandre, remit au ministère une note dans laquelle il était dit «que la convention de Vienne, du 25 mars, avait été dirigée contre Bonaparte, ses adhérents et particulièrement contre l’armée française, dont l’ambition désordonnée et l’esprit insatiable de conquêtes avaient plusieurs fois troublé l’Europe; que Bonaparte était aux mains des alliés; que le roi de France avait pris certaines mesures pour rendre impuissants les efforts des factions. Il ne restait plus dès lors que l’existence de l’armée qui menaçait la tranquillité générale. Déterminé, continuait le ministre russe, par le besoin de la paix universelle, l’empereur de Russie et ses alliés font une condition impérative du licenciement de cette armée, autant dans l’intérêt de sa majesté très chrétienne que pour le repos des peuples.»
La pensée des souverains est aussi clairement exposée que peut le faire un acte diplomatique. C’est l’intérêt de la monarchie, le repos des peuples, la paix qu’on invoque; et, soyons justes, l’armée, après avoir, le 15 juillet, arboré la cocarde blanche dans ses cantonnements de la Loire, ne songeait pas encore à réparer ses déplorables erreurs. Par un aveuglement sans exemple, elle donnait gain de cause au désir de réaction que les étrangers manifestaient contre elle. Mécontente, indisciplinée, honteuse de sa défaite, et ne voyant l’avenir que sous de sombres couleurs, elle se prêtait avec un morne désespoir aux démonstrations les plus insensées. Rebelle par le fait, et surtout rebelle contre la France (car c’était la France qui allait expier sa folle trahison et son enthousiasme pour l’empepereur, enthousiasme alors peut-être encore plus fou que sa trahison), elle se révoltait à l’idée seule desonlicenciement. Elle abhorrait les Bourbons, et elle ne voulait pas que les Bourbons répudiassent ses services et son dévouement problématique; elle avait déserté leur drapeau, et elle les accusait de n’avoir pas confiance en sa foi.
Cet état de choses n’était pas tenable. Louis XVIII consulta le maréchal Gouvion Saint-Cyr. son ministre de la guerre. Gouvion, vieux soldat de la république, n’hésita point à seconder les désirs des alliés. Il fut décidé en principe que l’armée serait dissoute. Mais le prince de Talleyrand et le maréchal Gouviou, qui avaient d’abord pensé à s’en faire une sorte d’appui éventuel, n’osèrent pas contre-signer une ordonnance spécialement relative au licenciement. Il entrait dans la politique de M. de Talleyrand de laisser toutes choses traîner en longueur. Pour satisfaire au vœu impératif des coalisés on promulgua le décret rendu à Lille le 23 mars 1815 lorsque Louis XVIII abandonnait la France. Ce décret de dissolution, contresigné par le comte François de Jaucourt, se fondait sur la trahison inouie dont une partie de l’armée s’était rendue coupable, principalement à Grenoble avec le colonel Labédoyère, et à Lons-le-Saulnier avec le maréchal Ney.
Le prince d’Eckmühl céda le commandement au maréchal Macdonald, qui établit son quartier-général à Bourges. Ce dernier opéra aussi lentement que possible la désorganisation des vieilles et dernières bandes de la révolution et de l’empire. C’était tout ce qui restait à la France de vingt-trois ans de guerre et de conquêtes.
Ces légionnaires, que l’esprit de parti a cru flétrir en les surnommant les Brigands de la Loire, comme la Convention espérait déshonorer les Vendéens aux yeux de l’Europe en les appelant des Brigands et des Chouans, ces légionnaires se retirèrent dans un calme qui eut bien sa dignité. Généraux, officiers, simples soldats, ils n’avaient, pour la plupart que la demi-solde ou la retraite que leur garantissait le gouvernement. Beaucoup se voyaient sans asile, quelques-uns même sans famille, d’autres sans pain. La république et l’empire les avaient habitués à cette vie militaire qui, en pays conquis, ne procède que trop par le pillage et par la confiscation. En se retirant par toutes les routes de France ils mirent un orgueil bien entendu à respecter les propriétés et à n’étaler leur douleur que par des larmes amères. La royauté plus tard fit un appel à leur patriotisme. Ils revinrent sous l’étendard de la monarchie, et les débris de Waterloo, incorporés dans la garde, donnèrent à tous l’exemple de la subordination et du dévouement.
Dans la note que le comte de Nesselrode avait remise à M. de Talleyrand, afin de lui imposer la dissolution de l’armée, il est dit que «le roi de France a pris certaines mesures pour rendre impuissants les efforts des factieux.» Ces mesures, annoncées par des protocoles, se résumaient en proscriptions individuelles.
A leur premier retour à Paris, les Bourbons avaient, sans bénéfice d’inventaire, accepté la France telle que la révolution la laissait; ils s’étaient fait gloire de n’y ramener que des Français de plus, et ils avaient espéré gouverner en n’apportant aucun changement dans les positions acquises. Dans les rangs de l’armée, de la magistrature et de l’administration, cette sagesse conciliatrice avait rencontré d’innombrables approbateurs. Des généraux, des juges, des préfets, des fonctionnaires de l’empire, une imperceptible minorité de cinq ou six personnes avait cru devoir à Napoléon l’honneur d’une retraite volontaire; nul autre ne s’était démis. La Restauration avait adopté avec confiance toutes ces fidélités. Les régicides eux-mêmes furent protégés par cette loi d’oubli général que s’imposait la monarchie.
Vingt-un ans s’étaient écoulés depuis l’horrible condamnation de Louis XVI. L’échafaud ou le temps avait dévoré une partie de ses juges-bourreaux, l’autre restait debout; mais relégués dans la foule, inconnus à la nouvelle génération, ils portaient avec un certain effroi le remords de leur crime. L’empereur les avait tenus à distance. Seulement à des hommes exceptionnels, comme Cambacérès, Carnot et Fouché, il avait accordé une amnistie morale que de grands talents semblaient légitimer.
Dans leur exil les Bourbons avaient bien eu le temps de méditer leur vengeance, et l’orateur anglais Edmond Burke, en 1799, dans ses OEuvre posthumes sur la Révolution francaise, leur avait tracé un plan de justice dont en 1814 ils eurent la générosité de se départir. En 1799 Burke prévoyait une restauration, et il écrivait.
«Il faut pourtant que justice soit faite; il faut des exemples pour consolider la paix et la sûreté publiques: ceux sur lesquels ils doivent tomber sont très remarquables. On ne les punira pas pour avoir offensé les lois civiles et politiques, ni pour s’être révoltés contre les lois de l’État, mais pour avoir violé les lois de la nature. Dans cette liste sont compris tous les régicides, tous ceux qui ont porté sur leur roi des mains sacriléges....., tous ceux qui ont commis de sang-froid des meurtres, et particulièrement les juges des tribunaux révolutionnaires, qui se raillaient insolemment de tous les principes de l’équité naturelle, et même de leurs prétendus droits de l’homme. Pas un seul de cette bande ne doit échapper à un châtiment proportionné à ses crimes.
«Mais aucun d’eux, quel qu’il puisse être, ne doit être puni qu’après une procédure instruite conformément à la loi...
«Avec ces précautions, le procès de ces brigands sera une des premières choses dont il faudra s’occuper. Si on néglige cette mesure, avant un an le gouvernement sera de nouveau renversé.»
Telle était la prophétie que la réflexion et la connaissance des hommes inspirait au grand publiciste anglais Elle se vérifia à la lettre; mais en 1814 les Bourbons ne crurent pas devoir y ajouter foi. On leur parla de livrer aux tribunaux les seuls régicides qui avaient repoussé l’appel au peuple. Ils refusèrent. En 1815 les régicides entraient dans la conspiration; ils y entraient avec leurs vieilles passions démagogiques.
Il n’y avait donc pas eu de réaction, d’arbitraire, pas même de justice distributive en 1814. Mais lorsque Bonaparte fut arrivé à Lyon, ramené par les conspirateurs du 20 mars, auxquels l’incurie, les maladresses ou la complicité secrète des ministres de Louis XVIII faisaient si beau jeu, il rouvrit l’ère des proscriptions. Par un décret impérial du 12 mars 1815, décret qui ne se trouve pas dans les recueils officiels, parcequ’aucun de ses adhérents n’osa le contre-signer, il frappa le prince de Talleyrand, Louis de La Rochejaquelein, MM. de Sèze, de Vitrolles, Bellart, Lainé et plusieurs autres.
Les Cent-Jours s’achevèrent dans le sang ou dans les hontes constitutionnelles; puis il resta à Louis XVIII un devoir à remplir. L’opinion publique dénonçait partout des traîtres ou des conjurés; elle en voyait dans l’armée, dans l’administration, dans toutes les classes de la société. Pour la plupart des fonctionnaires la foi due au serment n’avait été qu’un jeu. Les uns s’étaient affiliés de longue main au complot dont Hortense de Beauharnais, le duc de Bassano, le comte Lavalette, Fouché, Savary, duc de Rovigo, et des généraux en activité de service tenaient les fils. Les autres avaient accepté avec joie le gouvernement impérial, dont la veille encore ils flétrissaient l’usurpation. Un fait seul prouve jusqu’à quel point on se joua à cette époque de la sainteté des serments.
Le 8 mars 1815, le maréchal Soult, ministre de la guerre de Louis XVIII, adressait à l’armée un ordre du jour qui commence ainsi:
«Soldats, cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de toute l’Europe un pouvoir usurpé, dont il avait fait un si fatal usage, Bonaparte est descendu sur le sol français qu’il ne devait plus revoir.
«Que veut-il? la guerre civile. Que cherche-t-il? des traîtres? où les trouverait-il? serait-ce parmi ces soldats qu’il a trompés et sacrifiés tant de fois en égarant leur bravoure? serait-ce au sein de ces familles que son nom seul remplit encore d’effroi?
«Bonaparte nous méprise assez pour croire que nous pouvons abandonner un souverain légitime et bien aimé pour partager le sort d’un homme qui n’est plus qu’un aventurier; il le croit,l’insensé ! et son dernier acte de démence achève de le faire connaître.»
Le 26 du même mois, dix-huit jours après, le maréchal Soult allait faire aux Tuileries sa cour à cet homme, et le 11 mai il acceptait les fonctions de major-général de son armée.
Bonaparte avait proscrit les royalistes; le roi à son tour devait proscrire les bonapartistes. C’était la guerre des représailles, une espèce de peine du talion que les vainqueurs ne savent pas s’épargner.
Du point de vue où nous nous plaçons pour juger les hommes et les partis, nous croyons qu’il ne devait pas convenir à Louis XVIII de frapper d’un exil plus ou moins long les conspirateurs qui venaient de jeter l’Europe sur la France. Lorsqu’un gouvernement ne se sent pas assez fort pour tuer dans les vingt-quatre heures les traîtres à la patrie, il faut qu’il se condamne à chercher des moyens plus conciliateurs, et surtout qu’il ne proscrive jamais. La proscription est une peine relative: elle ulcère et ne corrige pas; elle envenime les haines et crée chez l’étranger des ennemis qui, n’ayant rien à ménager, rien à compromettre, deviennent dangereux, parceque souvent, pour témoigner leur reconnaissance de l’hospitalité reçue, ils mettent à son service leurs passions, leurs talents, et quelquefois même l’amour qu’ils ont voué au système qui les a perdus. Nous verrons en effet plus tard les réfugiés de Bruxelles organiser des complots pour placer la couronne de France sur la tête du prince d’Orange.
Au mois de juillet 1815, ces réflexions, nées de l’expérience, ne se faisaient point. Peut-être même étaient-elles impossibles avec un ministère sans foi politique et dans une société qui marchait si rapidement vers sa ruine. Le parti royaliste appelait la vengeance sur les têtes coupables. L’esprit des provinces s’exaltait au spectacle même de cette terrible occupation dont elles étaient les victimes: au nom de la justice, elles invoquaient des punitions exemplaires. Les plus audacieux étaient, comme toujours, les plus intelligents, car ils savaient qu’une révolution qui a peur de son principe ou de ses amis, et qui tâtonne au lieu de pousser jusqu’au bout, doit mourir de consomption dans les langes mêmes de son berceau.
La presse était ardente, infatigable; royaliste ou révolutionnaire, elle combattait avec acharnement, tantôt par des pamphlets, tantôt par ses journaux. Le jacobinisme, dispersé ou apprivoisé par Fouché, ne trouvait plus de défenseurs que dans la presse; la royauté triomphante n’osait pas écouter ceux que l’ambition ou la fidélité lui donnait.
Le Journal des Débats s’écriait:
«N’est-il pas permis de rappeler à ces rois, dans les justes mains desquels reposent aujourd’hui les destinées du monde civilisé, que la guerre légitime qu’ils ont livrée à Bonaparte n’était pas seulement dirigée contre un homme dès lors déchu de sa gloire historique, et devenu l’automate docile des factieux, mais contre ses adhérents qu’ils n’ont jamais manqué de colloquer avec lui dans leurs déclarations; qu’ils ont combattu en Bonaparte le chef d’un parti destructeur qui mine sourdement les états, mais qu’ils n’ont pas dû penser que ce parti, si varié dans ses ressources, si actif dans ses entreprises, et si indifférent sur ses moyens, fût tombé avec l’idole méprisable qu’il avait encensée quelques jours, en se réservant de la briser lui-même; que le seul moyen de sauver l’Europe enfin, c’est de sauver la France; et qu’on ne peut sauver la France sans y comprimer par des mesures imposantes la faction antisociale qui ose y méditer avec sécurité de nouveaux malheurs pour le genre humain.»
Le vicomte de Châteaubriand lui-même, président du collége électoral du Loiret, cet homme d’un si beau génie et d’un cœur si français, venait, dans ce langage qui n’appartient qu’à lui seul, s’exprimer ainsi devant le roi:
«Sire, lui disait-il le 5 septembre 1815, vous avez deux fois sauvé la France. Vous allez achever votre ouvrage. Ce n’est pas sans une vive émotion que nous venons de voir le commencement de vos justices. Vous avez saisi ce glaive que le souverain du ciel a confié aux princes de la terre pour assurer le repos des peuples; vos mains royales ne s’étaient levées jusqu’ici que pour absoudre les coupables et pour répandre des bénédictions; mais, en sentant tout ce que cet effort a dû coûter au cœur du roi, en pleurant avec votre majesté sur des hommes qui n’auraient pas pleuré sur nous, nous ne nous sommes pas dissimulé que le moment était venu de suspendre le cours de votre inépuisable clémence.
«La France envahie, déchirée, vous demande justice à genoux. Vous la lui devez, Sire; vous la devez à ce peuple qui le soir, avant de rentrer dans la chétive demeure où il partage sa couche avec le soldat étranger, se console en criant: Vive le roi! vous la devez à cette foule qui, lorsqu’elle vous a vu aux balcons de vos palais, oublie tous les maux d’une guerre suscitée par le tyran et par ses complices; vous la devez à ces habitants des campagnes qui ne possèdent plus que le drapeau blanc dont ils ont orné les fenêtres de leurs chaumières dépouillées; à ces paysans qui accouraient la nuit au bord des chemins où vous deviez passer pour s’assurer que leur père était revenu et que la patrie serait sauvée.
«Sire, cette justice, malheureusement trop nécessaire et que vos peuples réclamaient de toutes parts, ne fait qu’ajouter à l’éclat de votre bonté.
«Vos sujets racontent, avec des larmes de reconnaissance et d’admiration, tout ce que vous avez fait pour la France, et votre sévérité paternelle est mise au premier rang de vos bienfaits.»
De tous les points de la France le même cri se faisait entendre. Cette unanimité royaliste, provoquant des réactions légales, rencontrait dans le conseil des monarques une approbation sans limites. Lord Clancarty écrivait au baron de Gentz: «Il faut frapper toutes les têtes de la conspiration, autrement l’Europe n’en a pas pour une année.»
Afin d’appuyer ces paroles, les alliés s’exprimaient ainsi par l’intermédiaire des ministres des quatre cours. «L’Europe avait exigé, dans un but de paix et de repos, que Napoléon fût confié à la garde des quatre puissances signataires du traité de Chaumont. L’Europe pouvait également exiger certaines rigueurs ou certaines mesures de précaution contre les partisans de sa dynastie.»
Le prince de Talleyrand avait passé à travers trop de révolutions pour s’identifier complétement avec un parti. Sa raison toujours railleuse, même dans les plus graves circonstances, refusait de s’associer à cet enthousiasme de vengeance dont il pressentait froidement l’inutilité ; mais Fouché n’était pas auprès des puissances étrangères et des royalistes dans une position aussi indépendante que le président du conseil. Fouché avait été ministre de Bonaparte pendant les Cent-Jours. Il avait accepté les décrets de proscription rendus à Lyon; il fallait, pour se réhabiliter, qu’il donnât des gages en sens contraire; Fouché n’était pas homme à les refuser.
Fils d’un capitaine de la marine marchande de Nantes, il s’était fait oratorien, et, à l’âge de vingt-cinq ans, il avait été nommé préfet des études au collège de cette ville. La révolution le surprit dans ce modeste emploi. C’était un esprit profondément égoïste, et qui n’estimait les autres qu’autant qu’ils pouvaient servir à son élévation. Fouché saisit de suite que, dans cet incompréhensible mouvement d’idées et de passions, sa raison, toujours froide, devait ouvrir une large voie à ses ambitieuses espérances. Il y entra en se précautionnant d’avance contre toute espèce d’enthousiasme; il se rangea du côté des plus forts, c’est à dire des plus audacieusement criminels. Régicide au premier chef, régicide qui, selon ses propres paroles, s’étonnait «qu’on pût énoncer à la tribune, dans cette question, d’autre opinion contre le tyran que celle d’un arrêt de mort,» il eut tous les vices sanglants de la Montagne sans une des vertus négatives de la Gironde. Les ardentes inspirations de Danton, les systématiques atrocités de Robespierre, les turpitudes même de Marat, rien de tout cela ne lui avait répugné. Il approuvait tout par son silence ou par ses exemples. Lorsque la réaction de thermidor arriva, Fouché se mit à développer le nouveau caractère d’intrigue auquel il ne renoncera plus.
Il s’assigna un autre rôle: il se fit l’homme de police, le bravo de tous les pouvoirs qui osèrent l’employer, l’exécuteur des basses œuvres de toutes les constitutions qui le prirent à son service; mais il ne fut plus cruel par nécessité ou par instinct; il le devint par esprit de conservation, pour se perpétuer aux affaires et se rendre indispensable. A partir de ce jour, une révolution nouvelle s’opéra dans ses habitudes. Il s’improvisa le protecteur de ceux qu’il avait persécutés, il les fit attaquer par des scribes à ses gages, il les poursuivit par ses agents, tout en se réservant le droit d’étaler une générosité de circonstance, ou de faire preuve d’une humanité qui le séparait de la tourbe des Jacobins.
Chez Fouché ces beaux sentiments n’existaient qu’à la surface; mais intrigant toujours en défiance du présent et cherchant sans cesse à assurer sa position dans l’avenir, il laissait triompher ou tomber autour de lui les hommes et les gouvernements, sans s’inquiéter d’autre chose que de savoir ce que la victoire des uns ou la chute des autres devait lui rapporter. Il n’y avait en lui qu’une seule passion, mais cette passion pouvait aussi bien le rendre capable de vertus apparentes que de crimes réels. Il aimait à dominer, non pas pour imposer ses idées ou pour donner l’essor à une pensée ambitieuse, Fouché ne s’élevait pas si haut; la soif du pouvoir s’apaisait en lui aussitôt qu’il pouvait grossir sa fortune ou briser les hommes dont il s’était fait un marchepied.
Son visage blafard et ridé, ses traits impassibles, ses yeux d’un fauve ardent, son corps long et menu qui semblait accuser la débilité de son courage, rien, dans cette nature révolutionnaire, ne trahissait alors de sanglants appétits. Devenu duc d’Otrante par la grâce de l’empereur Napoléon et s’oubliant assez pour se croire aristocrate par droit de naissance , Fouché s’était peu à peu dépouillé de son écorce démagogique. Il n’était jacobin que lorsque sa position était menacée. Quand il pressentait ce danger, il faisait rugir le lion populaire que, par ses agents secrets, il savait museler ou lâcher à propos; mais il avait perdu le goût du sang, et ne se montrait plus que le Scapin de la révolution dont le prince de Talleyrand était le Moncade.
Ayant la main dans toutes les conspirations, les enfantant ou les déjouant, les dirigeant ou les égarant, selon ses intérêts du moment, Fouché se donna au meilleur marché possible une réputation d’habileté policière qui survit à toutes ses trahisons. Il traversa l’Empire, toujours suspect à Napoléon, toujours entre une prison d’état et une apothéose, puis quand la Restauration s’installa, Fouché, en disgrâce, comprit qu’avec le temps il lui resterait encore quelque chose à faire. Il s’entoura des émigrés auxquels il avait eu l’air de rendre d’insignifiants services. Avec ses souvenirs implacables, il menaça de révélations fâcheuses ceux dont, à une autre époque, il avait acheté l’indiscrète fidélité ; il se présenta comme l’homme nécessaire, et mettant un pied dans le camp des bonapartistes, un autre dans celui des Bourbons, il attendit les événements, faisant peur à tous les partis de la mauvaise queue révolutionnaire qu’il évoquait à son heure. Avant les Cent-Jours Fouché avait conspiré en faveur de Napoléon. Quand l’exilé de l’île d’Elbe fut de retour à Paris, Fouché noua une autre intrigue; il s’adressa tantôt à Gand, tantôt aux cabinets étrangers, qui de loin, se laissaient prendre aux ressources de ses fourberies. Ministre de l’empereur, il joua, corrompit ou annihila ses serviteurs les plus dévoués. Il s’imposa aux alliés, qui l’imposèrent à Louis XVIII, et il revint seul victorieux d’une campagne où tout le monde avait été battu.
A l’école de la Convention et du Directoire, Fouché avait appris à organiser la terreur. En 1815 on lui demandait des listes de proscription; il les rédigeait avec M. Decazes, son subordonné, avec le baron Pasquier, ministre de la justice et de l’intérieur par intérim, que secondaient MM. Guizot et de Barante, secrétaires généraux de ces départements. Au milieu des fêtes que ce vieillard préparait à Mlle de Castellane, sa jeune fiancée, il n’oubliait rien de son métier de proscripteur. Il provoquait les royalistes à demander quelques gouttes de sang, et sous main il offrait à ses anciens complices des passeports ou des secours. C’était toujours la même tactique, toujours le même égoïsme; mais toujours aussi la même insouciance pour les intérêts du pays. Il avait fait naître l’idée de mettre en jugement ou de bannir les conspirateurs du 20 mars. Il présenta au conseil des ministres une première liste sur laquelle plus de cent noms étaient inscrits. Parmi ces noms, il y en avait de si ignorés et qui valaient si peu la peine d’une insertion au Moniteur que le prince de Talleyrand ne put s’empêcher de dire au proscripteur en titre: «Votre liste contient beaucoup trop d’innocents.» Ce jeu de mots força Fouché à la refondre, et le 24 juillet 1815 une ordonnance royale traduisit devant les conseils de guerre compétents dix-neuf personnages. Le maréchal Ney, les généraux Drouet d’Erlon, Laborde, Brayer, Lefèbvre-des-Nouettes, Gilly, Mouton-Duvernet, Grouchy, Clausel, Bertrand, Debelle, Cambronne, Drouot, Ameil, les deux frères Lallemand et Labédoyère. Savary, duc de Rovigo, et le comte Lavalette complétaient cette première liste.
La seconde se composait de trente-huit individus qui devaient abandonner Paris dans les trois jours et se mettre à la disposition du ministre de la police. C’étaient le maréchal Soult, les généraux Alix, Excelmans, Vandamme, Lamarque, Lobau, Piré, Dejean fils, Hullin, Fressinet, Carnot, les colonels Marbot, Bory-Saint-Vincent, les ducs de Bassano, de Padoue, les comtes Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Boulay de la Meurthe, Thibaudeau, Réal, Merlin de Douai, Defermon, Garnier-de-Saintes; MM. Félix Lepelletier, Méhée-Latouche, Barère, Garreau, Bouvier-Dumolard, Durbach, Félix Desportes, Arnault, Harel, Dirat, Mellinet, Pommereul, Cluys, Courtin, Forbin-Janson fils aîné et Lelorgne-Dideville.
Tous les principaux instigateurs du 20 mars ne se trouvaient pas sur cette table de proscription. De grands coupables en avaient été écartés par Fouché, soit à titre de confidents passés, soit en qualité de complices futurs.
Cette ordonnance était tellement contraire à toutes les idées d’équité qu’on ne peut s’empêcher de remarquer que les hommes réputés les plus criminels avaient la chance d’éviter toute punition, puisque les tribunaux militaires pouvaient les absoudre, tandis que les moins coupables subissaient leur peine sans aucun espoir de recours. Mais, au milieu de tant d’accusés insignifiants, obscurs et que la haine personnelle des exécuteurs pouvait seule avoir désignés à l’exil, il y avait des hommes marquants, des collègues même de Fouché dans le ministère des Cent-Jours. Carnot était de ce nombre.
A la fin de leur carrière politique, ces deux membres de la Convention, qui avaient traversé tant d’événements et tant de crimes en y prenant une part si active, se rencontraient encore une fois dans un dernier jour de révolution. L’astuce de l’un triomphait de la probité que l’autre avait malheureusement plus d’une fois compromise par des ordres sanglants. Tous deux, républicains tant que la république les avait rendus les dominateurs de la France, ils avaient tous deux enseveli leur passion d’égalité sous des titres nobiliaires. Le comte Carnot écrivait ce jour là même au duc d’Otrante:
«Où veux-tu que j’aille, traître?»
Et le duc d’Otrante répondait:
«Où tu voudras, imbécile. «
Ces deux épithètes résument d’une manière si concise toutes les différences du patriotisme révolutionnaire que, malgré leur trivialité, il nous a paru instructif de leur accorder droit d’asile. Carnot fut exilé avec des Cluys, des Mellinet, des Dirat et des Lelorgne, espèces de comparses sans importance; mais à ces bannis Fouché réserva une fiche de consolation. Le gouvernement fit secrètement distribuer à tous une indemnité et d’abondants secours de Toute. Ce subside, accordé par la persécution aux persécutés, qui la veille se montraient sans pitié, est un des actes les moins connus et les plus extraordinaires de cette époque. Les persécutés étaient au nombre de cinquante-sept, dix-neuf qui devaient être livrés à la justice et trente-huit éloignés de France. Entre ces cinquante-sept, auxquels on adjoignit MM. Cauchois-Lemaire, Isidore Guyet, l’avocat Teste, agent spécial de police à Lyon pendant les Cent-Jours et depuis la révolution de juillet ministre de Louis-Philippe d’Orléans, on partagea une somme de quatre cent cinquante-neuf mille francs. Aux yeux de ces conspirateurs Tibère allait régner, et ils recevaient des fonds secrets de sa police les moyens d’abandonner la France qu’ils avaient compromise et ruinée.
Dans les registres du ministère de la police cette somme de quatre cent cinquante-neuf mille francs figure comme ayant été distribuée à ceux que la loi repoussait. A l’exception de cinq, tous acceptèrent cette étrange prime, qui pour quelques-uns s’élève au chiffre de vingt-cinq et de trente mille francs. N’est-ce pas une des plus tristes pages de l’histoire de la révolution qu’une pareille mansuétude qui paie ses ennemis, qui leur fournit d’abord les moyens de s’expatrier, et qui ensuite se laisse aveuglément jeter dans les filets d’une conspiration qu’ils vont tramer à Bruxelles.
Cette mansuétude restée jusqu’à ce jour secrète, ne surprit point ceux qui en étaient l’objet. Ils connaissaient à qui ils avaient affaire. Quand ce bizarre spectacle d’hommes également coupables ou également innocents, exilés ou acceptés par la Restauration, fut donné à la France, quand les généraux Grouchy, Clauzel, Gilly et Laborde se virent proscrits, et que le maréchal Davoust, ministre de la guerre du 20 mars, dont ils avaient exécuté les ordres, ne se trouva même pas inquiété, on se contenta de sourire à tant de contradictions manifestes et on prêta l’oreille aux demandes de l’étranger.
L’étranger avait décidé que la France rembourserait largement et surabondamment tous les frais de cette campagne et de l’occupation qui en était la conséquence. Les vainqueurs avaient des prétentions exorbitantes: les uns formaient le vœu de voir la France partagée et ses provinces frontières devenir le patrimoine des états voisins, en laissant douze ou treize départements du centre pour composer un nouveau royaume de Bourges. Les autres parlaient de la tuer moralement, et pour cela ils se préparaient à fomenter les vieilles dissensions de province à province, et à ressusciter le projet de fédéralisation républicaine que les Girondins avaient proposé. Les plus sages ou les moins ambitieux, ceux qui n’avaient aucun intérêt direct à effacer le royaume de la carte des nations, ou qui, comme l’empereur de Russie, sentaient la nécessité d’imposer à l’Angleterre un contrepoids, ne se montraient ni si acerbes ni si exigeants. Ils consentaient bien à affaiblir l’empire tel que Napoléon l’avait constitué, mais ils ne voulaient pas arriver au démembrement de la France monarchique. Tous s’accordaient pourtant à donner aux agitateurs qui, de Paris, avaient bouleversé le monde pendant vingt-cinq ans de révolution, une grande leçon de morale, dont par malheur la nation tout entière fut appelée à payer les frais.
L’idée d’un partage ou d’un dépouillement germait avec tant de force dans l’esprit des peuples et de leurs chefs, que sur tous les points il s’était élevé contre la France révolutionnaire un cri de réprobation universelle. Dans ce cri il y avait sans doute un sentiment bien prononcé de jalousie; mais la descente de Bonaparte sur les côtes de la Méditerranée et son dernier défi à l’Europe donnaient à ce sentiment une consécration si populaire, que le gouverneur-général des provinces rhénanes, Justus Gruner, adressa aux Allemands le manifeste suivant. C’était traduire par la parole imprimée les discours que le prince Blücher ne cessait de tenir à son armée:
«Braves Teutons! disait le gouverneur-général des provinces rhénanes, cette nation si longtemps fière de ses triomphes, et dont nous avons courbé le front orgueilleux devant les aigles germaniques, vient troubler encore le repos de l’Europe.
«Braves Teutons! un pays ainsi livré au désordre de l’anarchie menacerait l’Europe d’une honteuse dissolution si tous les braves Teutons ne s’armaient contre lui. Ce n’est plus pour lui rendre des princes dont il ne veut pas, ce n’est plus seulement pour chasser encore ce guerrier dangereux qui s’est mis à leur place, que nous nous armons aujourd’hui: c’est pour diviser cette terre impie que la politique des princes ne peut plus laisser subsister; c’est pour nous indemniser, par un juste partage de ses provinces, de tous les sacrifices que nous avons faits depuis vingt-cinq ans. Guerriers, cette fois vous ne combattrez pas à vos dépens.»
Ce langage avait si souvent retenti dans les bivouacs des armées coalisées qu’elles ne pouvaient plus renoncer à la pensée d’abandonner leur conquête, et que même on vit d’autres peuples accourir après la bataille pour tâcher d’enlever quelques membres à la proie abattue.
Peu de jours après l’abdication forcée de l’empereur et la rentrée de Louis XVIII, l’armée espagnole fit irruption sur le sol. Elle n’avait point pris part à la guerre qui finissait; ses frontières avaient été respectées, mais le général Castanos, le futur duc de Baylen, voulait la conduire à la curée, et faire expier au royaume des Bourbons les calamités que l’empire de Bonaparte avait fait peser sur la Péninsule. Quarante mille Espagnols s’avançaient donc dans cette intention bien avouée; ils pénétraient dans le midi.
Pendant son séjour à Gand Louis XVIII avait donné à son neveu, le duc d’Angoulême, des pleins pouvoirs pour armer et gouverner ces provinces fidèles. Retiré en Espagne après avoir bravement essayé de lutter contre l’usurpateur, le duc d’Angoulême avait reparu sur le territoire; mais déjà l’activité méridionale prenait les devants. Le zèle s’était organisé ; les gardes nationales étaient maîtresses du pays, le drapeau blanc flottait partout.
A la nouvelle que Castanos a franchi la frontière le duc d’Angoulême se hâte de rassembler le peu de gardes nationaux qui sont sous sa main, et il s’avance contre les Espagnols dont l’agression ne pouvait pas être motivée aux yeux des Bourbons. Le prince expose au général, qui se déclare si inopinément leur ennemi, l’injustice d’une pareille attaque; mais s’apercevant que ses paroles de conciliation demeurent sans effet, il retrouve dans son cœur quelque chose d’Henri IV et de Louis XIV; il s’écrie:
«Si l’armée espagnole fait un pas de plus sur notre territoire, à l’instant même j’appelle tout le midi aux armes; il entendra ma voix, et alors, général, ce sera à la garde de Dieu.»
Le parti royaliste était puissant et uni dans ces provinces; un seul mot du duc d’Angoulême lui donnait une heureuse impulsion. Castanos comprit que son armée disparaîtrait bien vite dans la tourmente qu’il venait provoquer; il rebroussa chemin.
Afin de bien faire comprendre leur pensée à Louis XVIII et à ses ministres, les alliés, qui avaient pour organe le duc de Wellington et le feld-maréchal Blücher, s’emparèrent, sur ces entrefaites, du gouvernement de la capitale et des positions militaires. Le baron de Müffling, un général prussien, fut nommé gouverneur de Paris; la garde nationale et la gendarmerie, même pour le service intérieur, n’eurent plus d’ordres à recevoir que de lui. C’était une violation manifeste de la convention du 3 juillet 1815 conclue à Saint-Cloud entre le baron Bignon, le général Guilleminot et le comte de Bondy, préfet de la Seine, d’unepart, le général Müffling et le colonel Hervey de l’autre. Par cette convention, qui règle la deuxième capitulation de Paris, il était stipulé :
«Art. 9. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale et par le corps de la gendarmerie municipale.
Art. 10. Les commandants en chef des armées anglaise et prussienne s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés les autorités actuelles tant qu’elles existeront.»
Mais dans la confusion d’un changement de règne, dans la désorganisation de tous les pouvoirs, en présence d’un empereur vaincu que ses ministres, que les représentants de la nation avaient presque fait appréhender au corps pour le livrer à l’ennemi, dans cette agitation fébrile que la honte d’un côté, que le remords de l’autre produisaient au milieu des masses maudissant ou glorifiant Bonaparte, repoussant ou appelant de tous leurs vœux le retour des Bourbons, la force seule devait être entendue. Les partis, au lieu de se rallier dans le péril commun, se divisaient avec un acharnement fatal. L’Europe répudiait Napoléon et sa dynastie. Au nom de la France, qu’on s’était bien gardé de consulter, le général Horace Sébastiani, le comte Doulcet de Pontécoulant, le marquis de Lafayette, le comte de Laforêt, le comte d’Argenson et Benjamin-Constant, toujours si mobile dans ses opinions, allaient au quartier-général des vainqueurs de Waterloo demander un monarque quel qu’il fût, à la condition qu’il n’aurait dans les veines ni du sang de Bourbon ni du sang de Français.
Ces six hommes, qui acceptaient cette odieuse mission et qui la remplissaient lorsque le drapeau blanc flottait déjà dans la plupart des provinces non occupées par l’étranger, avaient produit sur l’esprit des coalisés une déplorable impression; la capitale du royaume s’en ressentit. Les coalisés ne purent s’expliquer cette division si tranchée, ces haines si publiquement manifestées, lorsque le malheur devait les condamner toutes au silence, afin de réunir dans un même effort les volontés, les sacrifices, l’amour de la patrie et les dévouements. Les Anglais et les Prussiens virent que la France ne savait plus être une; ils profitèrent de ce désordre moral pour asseoir leur autorité et briser eux-mêmes la convention qu’ils avaient signée.
M. de Bondy, préfet de la Seine pendant les Cent-Jours, avait fait place au comte de Chabrol, qui reprenait les fonctions administratives abandonnées par lui depuis le 20 mars. L’hôtel-de-ville était envahi par les états-majors des armées qui, dans tous les dialectes, articulaient les plus extravagantes demandes. Ici l’on requérait de force des meubles, des logements, des tables servies, un luxe inoui; là, avec une brutalité qui trahissait un sentiment mal compris d’orgueil national, on exigeait impérieusement des contributions de guerre. M. de Chabrol résistait à ces ordres.
On menace de l’enlever et de le transporter dans la citadelle prussienne de Graudenz. Des soldats poméraniens font même irruption dans la salle où le conseil municipal délibérait. A la même heure d’autres étrangers se livraient au pillage des premières maisons du faubourg Saint-Marceau, comme pour provoquer cette population, la plus pauvre et la plus exaltée de Paris, à un soulèvement qui leur aurait offert l’occasion de combattre la France dans les rues mêmes de sa capital. Les places et les promenades publiques étaient transformées en camps. Des canons étaient braqués à toutes les issues, jusque sur le Carrousel, en face même des fenêtres du roi; et les artilleurs, toujours mèche allumée, n’attendaient que le signal de faire feu. Les allies parlaient de s’emparer des caisses de l’État, du trésor, de la banque et de toutes les administrations.
Repousser la violence par la violence n’était pas chose possible. Le gouvernement du roi, sans force morale, sans appui direct, ne pouvait en appeler qu’à la justice des souverains. Guillaume de Prusse et l’empereur Alexandre donnèrent des ordres pour faire cesser tous ces actes de colère. Au milieu de tant de luttes se renouvelant dans chaque administration, sous les yeux même de l’autorité impuissante, le maréchal Blücher manifesta l’intention de détruire le pont d’Iéna. Le nom de ce monument rappelait à la Prusse un immense désastre militaire.
C’était à la suite de ce triomphe que l’empereur Napoléon était entré à Berlin et qu’il avait enlevé l’écharpe et l’épée du grand Frédéric. Ces trophées de la victoire avaient été déposés dans l’église des Invalides et suspendus vers le centre de l’arche qui conduit au dôme. Lorsqu’en 1814 les alliés approchaient de Paris, on avait, sur un ordre du duc de Feltre, brûlé l’écharpe et l’épée de Frédéric II dans la cour de l’hôtel avec tous les drapeaux pris sur l’ennemi. Ces souvenirs s’étaient réveillés dans les cœurs prussiens, et leur irritation n’avait plus de bornes. Ils parlaient de rendre affront pour affront; ils espéraient se venger sur les monuments publics de la violation des tombeaux et de l’injure qu’ils avaient subie dans la mémoire de leur vieux Fritz, toujours chère à leurs cœurs.
Le pont d’Iéna était le monument désigné pour cette expiation. Les mineurs en creusaient déjà les piliers. Les instances du comte Molé, directeur-général des ponts et chaussées, avaient été à peu près sans effet. Lord Wellington répondait que lui et les autres généraux ne pouvaient apaiser l’exaltation des Prussiens, quand Louis XVIII, qui, à travers les petites passions de son esprit et les vices imparfaits de sa nature, avait cependant une magnifique idée de la dignité de son nom et de l’honneur français, s’adressa directement à l’empereur de Russie. L’intervention de ce roi descendant jusqu’à la prière toucha le cœur d’Alexandre. Le pont d’Iéna, qui joint les Champs-Élysées au Champ-de-Mars, était un point de communication stratégique trop important pour être livré à un vandalisme provocateur. Alexandre et le roi de Prusse donnèrent des ordres. Blücher renonça à son projet.
Les choses se passèrent ainsi: la lettre de Louis XVIII demandant au feld-maréchal prussien l’heure à laquelle il ferait sauter le pont, cette lettre où le roi annonçait qu’il se placerait dessus afin de périr en même temps, n’est donc qu’une forfanterie après coup dont la sagacité royale ne fut jamais responsable.