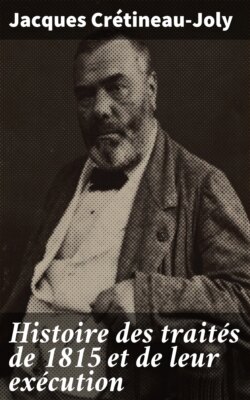Читать книгу Histoire des traités de 1815 et de leur exécution - Jacques Crétineau-Joly - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II.
ОглавлениеTable des matières
Situation des provinces envahies. — Commission française pour subvenir aux besoins des armées. — MM. Corvetto, Labouillerie, Portal et Dudon, commissaires. — Leurs conférences avec les étrangers. — Leur correspondance. — Note officielle de M. de Talleyrand. — Répartition de cent quatre-vingt-six millions. — Chiffre exact des étrangers sur le sol. — Rapport secret du baron Louis au roi. — Traités particuliers des puissances avec le gouvernement français. — Enlèvement des objets d’art au Louvre et sur les places publiques. — Inertie du ministère Talleyrand.
D’après les faits qui, dans les premiers jours de l’invasion de 1815, signalaient à Paris les ardentes colères de la coalition, il est facile de se faire une idée des désordres qui devaient éclater dans les départements occupés. Afin de subvenir aux besoins de son armée et de réchauffer le zèle de ses complices, Bonaparte avait en trois mois de règne épuisé les ressources du pays; en choses évaluables au trésor seulement, il avait consommé plus de six cents millions.
Lesimpôts en nature, les emprunts volontaires ou forcés ne suffisaient plus pour faire face à des nécessités renaissantes à chaque heure. Ce n’était pas assez de résister avec fermeté aux ordres souvent inconciliables et presque toujours impossibles des étrangers. Il fallait coordonner les dépenses pour établir une certaine régularité dans les sacrifices auxquels la nation était condamnée.
Le 9 juillet 1815, le lendemain même de la rentrée de Louis XVIII dans sa capitale, une commission fut formée par le ministère français; elle se composait du comte Corvetto, président, des barons Portai, La Bouillerie et Dudon, secrétaire, avec voix délibérative; M. Raymond Duprat, aujourd’hui membre de la chambre des députés, était à la tête des bureaux.
Le 24 juillet 1815, le prince de Metternich, le comte de Nesselrode, lord Castlereagh et le prince d’Hardenberg, ministres des quatre cours, adressèrent au prince de Talleyrand, président du conseil, une note officielle déterminant le mode de procéder.
«Les ministres, y lit-on, ont pris en mûre considération les ouvertures que le ministère du roi leur a fait parvenir par son excellence M. le baron Louis, dans le but de régulariser la marche de l’administration dans les pays occupés par les armées alliées. Ils sont trop pénétrés de la nécessité de prendre à cet égard les mesures les plus urgentes et les plus efficaces pour ne pas entrer avec empressement dans les vues qui ont dicté ces propositions. Ils croient donc que les dispositions suivantes, qui viennent d’être arrêtées, seront les plus propres à concilier les désirs du roi avec la situation où se trouveront les armées alliées pendant leur séjour en France:
«1° Pour prévenir les inconvénients qui résultent de l’incertitude où sont encore les armées alliées, relativement à leurs cantonnements, une ligne de démarcation déterminera les départements qui seront occupés par elles, et qui seront plus spécialement assignés à leur sustentation;
«2° Ces départements seront partagés entre les différentes armées, de manière à ce que chacune d’elles ait un rayon, et que, par conséquent, dans le même département, il n’y ait que des troupes de la même armée;
«3° Cependant dans ces différents rayons et en général dans tous les départements occupés par les alliés, on suivra un système uniforme pour toutes les affaires qui concernent l’administration, et se rapportent aux besoins des armées;
«4°Les autorités du roi seront immédiatement rétablies dans ces départements, et les préfets et sous-préfets remis dans l’exercice de leurs fonctions.
«5° Afin de protéger ces autorités, et d’assurer en même temps que, d’un côté, tout ce qui tient au service et aux besoins des armées alliées s’exécute avec exactitude, et que, de l’autre, celles-ci observent le plus grand ordre, il sera nommé des gouverneurs militaires pour les départements qui forment les rayons de chaque armée; mais ce ne sera que pour les objets qui concernent le service et la sûreté des armées que les préfets et autres fonctionnaires publics recevront les directions des gouverneurs militaires des puissances alliées.
6° Ces objets seront encore plus spécialement déterminés, mais l’entretien des différentes armées aura lieu sur des principes qui seront uniformément adoptés.
«7° Une commission administrative vient d’être établie à Paris, et se mettra aussitôt que possible en rapport avec la commission nommée par le roi.
«8° Des ordres ont été donnés pour que la rentrée des contributions en argent, dont plusieurs villes et départements ont été frappés, ne soit pas ultérieurement poursuivie, et qu’à l’avenir aucune contribution de ce genre ne soit demandée par des ordres isolés des intendants des différentes armées. Ces arrangements allant aussi loin que le permettent pour le moment aux alliés le soin de leurs propres armées et leur situation militaire, les soussignés se flattent que le ministère du roi y reconnaîtra le désir sincère qu’ils ont de contribuer au rétablissement de l’autorité royale, et à l’adoucissement des charges de la guerre autant que les circonstances leur en laissent la possibilité.
«Ils ont l’honneur d’assurer S. A. M. le prince de Talleyrand de leur haute considération.
«Paris, le 24 juillet 1815.
«Signé METTERNICH, NESSELRODE, CASTLEREAGH, HARDENBERG.»
Quatre Français étaient donc chargés de veiller aux intérêts des départements envahis et de régulariser toutes les réquisitions qui pourraient être faites par les puissances étrangères. A côté de cette commission, dont les pouvoirs n’étaient limités que par l’omnipotence des alliés, un conseil administratif avait été établi, ainsi que l’indique l’art. 7 de la note officielle du 24 juillet. Ce conseil, nommé par les souverains, se composait de M. Baldacci, ministre des conférences d’Autriche, du baron d’Altenstein pour la Prusse, de M. de Bulkakoff pour la Russie, et de M. Dunmore, commissaire en chef de l’armée anglaise.
La mission des délégués français était pénible et délicate surtout: ils avaient à lutter d’un côté contre des armées enivrées de leur triomphe, et qui, loin de leurs monarques, pouvaient avec impunité se livrer à tous les excès de la conquête. Ces armées se regardaient comme en pays ennemi, et elles ne demandaient pas mieux que de nous faire expier nos vingt-cinq années de victoires. De l’autre côté se trouvaient des compatriotes à protéger, l’honneur et les intérêts de la patrie à sauvegarder, mais aussi des plaintes de toute nature à entendre, des misères à soulager, des mesures énergiques à adopter, mesures qui, dans l’état d’affaissement de la France, devaient, même par leur salutaire sévérité, soulever les cœurs aigris et fomenter mille mécontentements secrets.
En mettant le pied sur le territoire dont l’ambition d’un homme leur avait deux fois ouvert les portes, les coalisés avaient espéré administrer le pays et le pressurer sans contrôle. Ils oubliaient déjà qu’il n’avaient fait la guerre qu’à Napoléon, et que Louis XVIII, par l’attitude hostile qu’avait prise la Vendée militaire, était entré dans l’alliance des peuples contre Bonaparte; ils oublaient encore que le 25 mars 1815 un traité conclu au congrès de Vienne faisait du fugitif de l’île d’Elbe l’ennemi commun, et que le roi avait été sollicité d’adhérer à cet acte des puissances contractantes.
Dans les premières conférences des commissaires français et étrangers ceux-ci ne cachèrent pas que la volonté des cours était de soumettre à leur administration les départements occupés. MM. Corvetto, Portai, Labouillerie et Dudon déclarèrent qu’ils devaient seuls être chargés de tout ce qui regardait le service; seulement ils promettaient d’employer à l’entretien des armées les produits de ces provinces. A l’appui de leurs justes demandes ils démontraient aux commissaires des puissances qu’avec leur système de contribution et de gaspillage, qui en était la conséquence nécessaire, le pays serait bientôt sans ressources aucunes et l’armée d’occupation elle-même privée de toute subsistance.
Ces raisons étaient concluantes; elles ne triomphaient cependant pas de l’obstination des alliés. Les commandants militaires disaient que toutes les sommes entrées ou devant entrer dans les caisses publiques appartenaient de droit aux monarques dont ils étaient les agents. On avait même préparé une si large voie aux abus que les chefs de l’armée changeaient jusqu’aux règles de l’administration.
Ainsi le comte d’Alopeus à Nancy saisissait tous les sels qui se trouvaient en fabrication dans les salines de l’Est; il osait plus, il faisait négocier à l’avance des bons pour deux millions de francs, admissibles en paiement de ces sels. Un gouverneur autrichien allait beaucoup plus loin, et une lettre écrite le 5 août 1815 par le baron Dudon au prince de Talleyrand l’informe que
«ce gouverneur ne se borne point à exiger la rentrée des contributions ordinaires, mais que dans les départements de l’Ain, du Jura, de l’Isère et du Montblanc, il veut encore contraindre les habitants à payer un emprunt forcé qui, par un décret impérial du 8 mai 1815, avait été exigé des plus riches contribuables de ces départements.
«Dans celui de l’Ain, par exemple, ils ont pris le rôle dressé par M. Baude, préfet, qui a exigé que les plus riches propriétaires souscrivissent des bons à un et deux mois de date. C’est le recouvrement de ces effets que l’intendant général autrichien veut faire poursuivre.
«En supposant, continue le baron Dudon, que les alliés aient le droit de prélever la dépense de leurs troupes sur le produit des contributions ordinaires établies par nos lois, on ne doit pas en conclure qu’il soit dans l’intention des souverains de donner suite aux mesures arbitraires que les agents de Bonaparte ont imaginées dans leurs départements. Celle dont il est question ici équivaut à l’établissement d’une contribution extraordinrire dont la note du 24 juillet suspend la poursuite.»
M. de Talleyrand, adoptant les propositions du commissaire français, s’opposa vivement à de semblables prétentions. Il déclara que rien ne devait entraver la marche des autorités françaises, et il écrivit à M. Dudon de veiller très attentivement à ce qu’il fût pourvu à la nourriture de l’armée ennemie; mais en même temps il lui enjoignit de s’opposer à tout enlèvement de fonds, et de n’obtempérer à aucune réquisition qui dépasserait les besoins journaliers des troupes.
Les commissaires adressèrent le 15 août 1815, des instructions très précises dans ce sens à tous les préfets. Ces instructions étaient ainsi conçues:
«MONSIEUR LE PRÉFET,
«Nous avons l’honneur de vous transmettre la copie d’une circulaire adressée par les ministres des souverains réunis à MM. les gouverneurs des départements occupés par les armées étrangères.
«Elle nous a été officiellement communiquée par le conseil administratif des alliés. Vous verrez que l’administration vous est remise sans restriction. Les produits de toute nature doivent rentrer dans les caisses du trésor royal; les dépenses ne seront plus faites que par les ordres des autorités françaises, et dans les formes de notre comptabilité.
«La remise de l’administration entre vos mains produira l’économie, qui résulte toujours de l’ordre et de la régularité ; mais les charges que les habitants auront à supporter seront encore considérables; il ne faut négliger aucune des ressources qui sont à votre disposition.
«S’il était frappé sur votre département des réquisitions de remonte, d’objets d’habillement et d’équipement, vous devez vous y refuser comme vous l’avez déjà fait. Cependant, lorsque les quantités requises seront pour des besoins urgents, vous devez satisfaire aux demandes qui vous seront adressées; il vous sera facile de distinguer quelles sont les réquisitions qui ne peuvent être différées, sur lesquelles les commissions établies à Paris ne donneraient pas de décisions négatives, d’avec celles qui peuvent être la matière de quelques discussions, et contre lesquelles, par conséquent, nous pouvons élever des réclamations. La quantité des objets requis est l’indice le plus sûr pour vous guider dans cette circonstance: ainsi, des fers nécessaires pour la consommation immédiate de la cavalerie, des cuirs pour réparer les chaussures d’une troupe en marche, ne peuvent être refusés; mais des réquisitions de trente ou quarante mille paires de souliers, de cent mille aunes de draps, sont susceptibles d’être examinées à Paris, soit parceque le pays ne serait pas en état d’y fournir, soit parceque les troupes ont déjà été pourvues de ces objets dans d’autres arrondissements.
«Les contestations qui se sont élevées entre MM. les préfets et les agents des armées alliées, nous ont engagé à vous donner ces nouvelles explications: vous sentirez, monsieur le préfet, combien il est essentiel d’éviter tout ce qui peut troubler la bonne intelligence avec les alliés, au moment où la remise de l’administration, retardée jusqu’à ce jour sous divers prétextes, va enfin vous être faite sans aucune restriction; ce qui donne lieu d’espérer que des arrangements encore plus importants seront bientôt rendus publics.»
C’était limiter l’arbitraire des généraux et donner à la résistance des autorités locales un point d’appui. Les préfets firent leur devoir; mais les chefs étrangers, exaspérés de cette activité et de cet accord qui paralysaient leur mauvais vouloir, se portèrent à de graves sé ices.
Le baron Alexandre de Talleyrand, préfet du Loiret; le marquis de Gasville, préfet de l’Eure, et M. Jules Pasquier, préfet de la Sarthe, furent enlevés presque au même moment et transférés en Prusse. Comme pour braver le ministère français même dans ses affections de famille, l’insolence de l’étranger s’était adressée au neveu du président du conseil, au gendre du chancelier d’Ambray et au frère du garde des sceaux. MM. de Goyon et Boula du Colombier, l’un préfet de l’Yonne, l’autre des Vosges, subirent le même sort.
Ces mesures de rigueur ne modifièrent cependant point les instructions données par le prince de Talleyrand aux quatre commissaires. Lorsque le baron Dudon vint lui annoncer cette nouvelle entrave, M. de Talleyrand, avec sa narquoise impassibilité, se borna à dire: «Eh bien! qu’est-ce que cela fait à vos affaires? J’aime beaucoup Alexandre Talleyrand, et il vaut mieux qu’ils aient enlevé celui-là qu’un autre. Je vous répète qu’il ne faut rien payer si vous le pouvez, payez le moins possible si vous êtes forcé, et surtout le plus tard possible.»
M. Dudon était parfaitement de cet avis. La pénurie du trésor ne permettait guère d’en adopter un autre.
Se sentant appuyé par le ministère qui, dans ce moment de crise, se montra courageusement national, les quatre commissaires voulurent se tenir à la hauteur des dangereuses fonctions dont la confiance du roi les investissait. C’était une guerre de tous les instants qu’ils avaient à soutenir, guerre de chicane ou d’envahissement, guerre qui, chaque jour, les plaçait en contact ou en hostilité avec des chefs militaires. Encore peu habitués à la victoire, ces chefs ne savaient pas, par une générosité au moins dans les formes, se faire pardonner les excès du triomphe. Les Prussiens étaient toujours et partout les plus hautains et les plus intraitables.
Entre autres preuves, nous citerons une note qui fit grande sensation dans le corps diplomatique: elle est adressée par M. Dudon à M. de Ribbentrop, intendant-général de l’armée prussienne, qui depuis longtemps parlementait avec. ce commissaire français pour faire établir les comptes de son gouvernement selon le chiffre qu’il présentait.
«J’ai émis, répondait M. Dudon à une lettre de cet intendant général, j’ai émis l’opinion que nous ne pouvions pas nous écarter des règles tracées par la note diplomatique du 1er septembre, et la question se réduisait alors à des termes fort simples. Une convention signée par les ministres de sa majesté le roi de Prusse, forme-t-elle un engagement pour les agents prussiens? Vous changez l’état de la question. Vous me parlez des décisions que vous avez prises personnellement, et vous ajoutez ces mots: «A ce sujet je dois vous faire observer qu’une armée victorieuse ne sera pas forcée de se soumettre à des conditions telles que vous les établissez.»
«Permettez-moi, Monsieur, de vous faire remarquer que je n’établis pas de conditions; que je déclare au contraire n’en pouvoir présenter aucune, mais que je suis obligé de me soumettre à celles agréées par nos gouvernements respectifs. Du reste, je ne crois pas que par l’expression d’armée victorieuse vous ayez voulu dire autre chose que la réunion des Anglais, des Autrichiens, des Prussiens, des Russes, des Saxons, des Bavarois, etc., etc. Eh bien! c’est précisément des conditions arrêtées entre ces puissances que je demande l’exécution.
«Je ne puis reconnaître à aucune des droits particuliers, puisque leur position vis-à-vis de la France est Je résultat de la coopération commune. Chargé en plusieurs occasions de stipuler les intérêts de mon gouvernement au-delà des frontières, je n’ai jamais parlé dans les négociations que de l’intérêt de tous les peuples dans le but de mettre fin à leurs divisions. J’ai tu avec soin les avantages passagers que donne ou enlève la fortune. On ne se conduit jamais mieux en politique quelorsqu’on n’écoute ni l’affection ni le ressentiment. Ce sera donc la dernière fois, Monsieur, que je releverai des expressions inutiles au développement des questions discutées.»
Au milieu de tous ces conflits et de ces correspondances où le beau rôle de dignité appartient encore à la France, le prince de Talleyrand, pressé de tous côtés, consentit à faire payer aux alliés une somme de cinquante millions. Cela avait été ainsi réglé le 10 août 1815, mais il était bien entendu que les réquisitions de toute espèce cesseraient à l’instant même. Toutefois le 24 du même mois, dans un document adressé aux ministres des quatre cours, M. de Talleyrand faisait entendre ses plaintes avec une autorité de paroles que les faits eux-mêmes venaient chaque jour confirmer.
«Les entraves qui gênaient la marche du gouvernement n’ont pas cessé, dit dans cette pièce officielle le président du conseil. Les autorités françaises n’ont pu reprendre la direction des affaires; les impôts ont été détournés des caisses royales dans celles des armées; des réquisitions exorbitantes pour l’équipement ont été frappées, les mesures de rigueur sont venues plus fréquentes; les préfets ont été enlevés à leurs fonctions. Dans les départements occupés par l’armée bavaroise les agents militaires ont déclaré qu’ils ne regardaient pas comme obligatoires pour eux des arrangements conclus sans l’intervention d’un ministre de leur souverain. Dans une partie du rayon de l’armée autrichienne les préfets ont eu la liberté de reprendre leurs fonctions et de diriger le recouvrement des impôts, mais les recettes ont été aussitôt arrêtées par des réquisitions de diverses natures étrangères à la subsistance journalière des troupes. Les agents prussiens ont jugé que le paiement des sommes promises par le gouvernement de Sa Majesté devait précéder la remise de l’administration aux autorités françaises. Ils continuent à percevoir les revenus courants. Le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne est donc encore entouré de difficultés qu’il avait été dans l’intention de toutes les parties d’éloigner. Leurs excellences reconnaîtront dès lors qu’il n’a pas été au pouvoir du ministère du roi de se procurer les fonds pour le paiement des premiers vingt-cinq millions puisqu’il ne peut disposer d’aucune des ressources des départements.
«Dans cet état de choses, il est néanmoins un principe que le ministère s’empresse de reconnaître. Il est juste que l’exécution des engagements réponde de son côté à celle qui a eu lieu de la part des puissances; le ministère du roi offre en conséquence de régler sur les bases de la convention du 10 août la somme proportionnelle à remettre à chacune des puissances qui aura rendu sans restriction et sans réserve l’administration des départements occupés par ses troupes.
«Il est une autre considération sur laquelle le ministère du roi ne peut s’empêcher d’insister; c’est la nécessité de surseoir à toute réquisition isolée d’habillement, et de faire régler de concert à Paris ce qui est relatif à ces sortes de demandes. La promesse de ne pas s’immiscer dans l’administration financière serait illusoire si l’on ne doit entendre par là que le recouvrement des impôts courants et si les chefs militaires conservent la faculté de frapper des réquisitions qui ne sont sous un autre nom que des contributions en argent. De pareilles mesures détruiraient celles que le gouvernement du roi pourrait prendre, car dans l’état d’épuisement où se trouve le pays, il n’est pas possible de faire percevoir concurremment les impôts et les contributions extraordinaires. Il arriverait ainsi que les ressources sur lesquelles le ministère aurait compté pour faire face à ses engagements envers les puissances alliées seraient absorbées par les prélèvements qu’auraient ordonnés les généraux pour l’habillement de leurs troupes.»
Le 1er septembre 1815, une autre somme de cinquante millions fut allouée aux étrangers par le ministère pour solde de deux mois. On leur compta le même jour cent trente six millions deux cent mille francs pour habillements, équipements et remonte. Une note du duc de Wellington au baron Louis explique ainsi la répartition de ces cent quatre-vingt-six millions deux cent mille francs.
La répartition des cinquante millions pour la solde est faite à raison de dix millions pour chacune des quatre grandes puissances et de dix millions entre les autres alliés proportionnellement à leur contingent dans l’armée. Celle des cent trente-six millions deux cent mille francs est établie à raison de cent vingt francs par homme.
Ce qui d’après le tableau formé par le baron Louis, ministre des finances, et communiqué à la commission française offre un effectif d’un million cent trente-cinq mille hommes, ainsi répartis par puissance:
Sur les cent trente-six millions deux cents mille francs payés par le trésor royal il avait été stipulé que l’on déduirait tout ce qui avait été pris par les armées alliées, tout ce qui leur aurait été antérieurement fourni, et qu’à partir de ce jour 1er septembre, il ne serait plus question de réquisition d’argent, de denrées ou de marchandises. Autant qu’il dépendit des souverains, des généraux en chef et des négociateurs, ces conventions furent aussi scrupuleusement observées que les circonstances le permirent.
Le baron Louis, ministre des finances, rendit compte au roi de cet ensemble d’opérations et de leurs résultats qui avaient coûté tant de travaux et de combats à la commission, et le 21 septembre, au moment même d’abandonner le pouvoir, le ministre disait dans son rapport en date de ce jour:
«Sire, les armées coalisées, en entrant sur le territoire, manifestèrent l’intention de prendre la direction de l’administration dans les départements qu’elles occupèrent successivement, et de faire percevoir à leur profit tous les revenus arriérés et courants; elles frappèrent en même temps des réquisitions considérables pour leur habillement; elles imposèrent aussi des contributions en argent sur les pays qui supportaient déjà des dépenses pour la subsistance des troupes.
«Les ministres de votre majesté se firent un devoir de réclamer contre de pareilles dispositions; ils offrirent de faire pourvoir à l’entretien des armées par les soins des agents français. Il était pénible de les rendre les instruments de mesures aussi onéreuses, mais il eût été dangereux de laisser les habitants sans défenseurs contre des autorités étrangères.
«Vous permîtes, sire, à vos ministres d’entrer en négociation sur cet objet; des notes furent échangées avec le cabinet des souverains des quatre cours réunies. Il fut convenu que les fonctionnaires français rentreraient dans le libre exercice de leurs emplois, et, qu’aucune contribution en argent ne serait plus exigée. Ces arrangements furent rendus publics. Cependant le bon ordre qu’on espérait voir renaître ne se rétablit que dans les départements occupés par l’armée russe; les agents de cette armée cessèrent, aussitôt la publication de la note du 24 juillet, insérée dans la Gazette officielle, d’intervenir dans les affaires administratives; il n’en fut pas de même dans le rayon des autres armées; rien n’était réglé par la note du 24 juillet sur la perception des revenus ordinaires de l’état; elle ne faisait pas cesser les réquisitions d’habillement; ainsi l’administration était encore paralysée, car on lui enlevait la disposition des caisses publiques et l’on exigeait d’elle qu’elle satisfît à des demandes énormes de diverses natures; les commandants militaires ne frappèrent plus, il est vrai, des contributions en argent, mais les réquisitions en draps, en cuirs, en objets manufacturés augmentèrent; on ne pouvait se procurer ces effets qu’en les achetant, les levées d’argent continuèrent donc sous un nouveau prétexte.
«Les ministres de votre majesté représentèrent aux ministres des cours réunies que les dispositions consignées dans la note du 24 juillet étaient insuffisantes pour atteindre le but qu’on s’était proposé, après plusieurs communications. Nous reçûmes, le 6 août, une note dans laquelle on établissait en principe que les départements occupés par les armées coalisées devaient subvenir à la subsistance et à la solde des troupes; ce dernier article était évalué pour deux mois à cinquante millions. On demandait que cette somme fût payée en deux termes, le premier le 25 août, le second le 15 septembre, en admettant en déduction les fonds enlevés des caisses publiques ou perçus de tout autre manière. On insistait en outre pour qu’il fût promptement satisfait aux réquisitions d’habillement et d’équipement faites par les généraux en chef; on ajoutait en terminant la note que dès que ces deux points seraient réglés les négociations s’ouvriraient sur les propositions définitives que les puissances alliées avaient à faire au gouvernement français.
«Vos ministres, sire, se soumirent à l’obligation de payer cinquante millions. Ils eurent soin de faire observer au cabinet des souverains alliés que cet arrangement n’était contracté que dans la supposition que la marche du gouvernement serait dégagée de toute entrave, et qu’il aurait la libre disposition de tous les revenus publics; quant à l’habillement, nous demandâmes l’état détaillé des réquisitions afin de pouvoir asseoir la répartition de cette dépense.»
A la suite de ces tristes considérations, le rapport du baron Louis, déposé aux archives du ministère des finances, annonce pourtant que, grâce aux soins de la commission, il a été possible d’amener les puissances à conclure divers traités particuliers avec la France. C’était un allégement aux charges qui pesaient sur le royaume, car les cours étrangères prises séparément cédaient avec plus de facilité aux démonstrations et aux chiffres de MM. Corvetto et Dudon. Ils discutaient sur de moins larges bases avec des têtes froides et que les irritations nées au sein d’une assemblée ne passionnaient plus.
Après avoir mûrement étudié ces préliminaires des négociations, on reste convaincu que les hommes d’état qui avaient accepté la mission de concilier tant d’intérêts rivaux entre eux, mais toujours ennemis contre nous, ont bien mérité du pays. Ces traités particuliers furent approuvés par des ordonnances spéciales du roi en date du 21 septembre.
La commission représentée par MM. de La Bouillerie et Dudon conclut encore, avec les ministres des puissances secondaires, diverses transactions dont le rapport du baron Louis rend compte au roi, puis vint le tour de la Russie. En remplacement des réquisitions qu’elle avait faites ou qu’elle se disposait à demander, les commissaires français et M. de Cancrin, intendant-général des armées russes, et aujourd’hui ministre des finances de l’empereur Nicolas, firent plusieurs traités moins onéreux pour la France. Un autre fut passé entre le baron Louis et le baron Bulow au nom de la Prusse. L’exemple de ces puissances décida la Bavière à faire comme elles.
La Bavière avait frappé pour dix-huit millions de contributions. «Il était impossible, dit le rapport au roi, de les faire exécuter dans le territoire très resserré qu’occupait cette armée. Cependant on employait déjà les exécutions militaires pour obtenir tout ce qu’il serait possible d’arracher aux habitants; tout allait être désorganisé lorsque la commission obtint du prince de Wrède de conclure un accord pareil à ceux de la Russie et de la Prusse. Les dix-huit millions demandés se réduisirent à sept millions cinq cents mille francs.»
Tandis que ces luttes, dont jusqu’à présent personne n’avait eu connaissance, se soutenaient dans le sein de la commission contre les cupidités de l’étranger, les Anglo-Prussiens envahissaient le Musée et dépouillaient la France des chefs-d’œuvre de sculpture et de peinture dont la conquête ou des traités solennels nous avaient rendus possesseurs.
En 1804 le pape Pie VII avait traversé les monts pour venir sacrer le consul qui se déclarait empereur. Le saint vieillard fut entouré d’hommages, et le pavillon de Flore, qui lui avait été assigné pour demeure, n’ayant pas d’assez vastes appartements pour contenir la foule des visiteurs, Napoléon choisit la galerie du Louvre. M. Denon en avait la garde. C’était lui qui était chargé d’accompagner le souverain pontife dans les monuments qu’il désirait voir. Ce fut encore lui qui l’introduisit au Louvre.
«Votre sainteté, lui dit-il, en pénétrant dans la galerie, apercevra peut-être des objets qui attristeront ses regards. — Eh quoi donc? demanda Pie VII. — Des tableaux, des statues, des objets d’art, répliqua M. Denon, ils étaient autrefois en Italie; quelques-uns même au Vatican.»
Le pape leva les yeux au ciel, et d’un air de prophétique résignation: «La victoire, répondit-il lentement, les avait portés en Italie. La victoire les a déposés ici. Qui sait où un jour elle les reportera?»
Onze ans étaient à peine écoulés, et des bataillons anglais et prussiens venaient, l’arme au bras, accomplir dans ce même Louvre la prédiction qui avait retenti sous ses voûtes.
La république et l’empire, en parcourant l’Europe, avaient pris, comme trophées de leurs conquêtes ou acquis par des traités, les plus beaux monuments des arts, les plus curieuses archives, enfin tout ce qui pouvait flatter l’orgueil d’une nation. L’Apollon du Belvédère, la Vénus de Médicis, les toiles de Raphaël, les chefs-d’œuvre de Michel-Ange, de Van Dick, de Rubens et du Murillo; les chevaux de Venise, le lion de Saint-Marc, le trésor des archives du Vatican, de Turin et de La Haye, tout cela se trouvait en notre possession. La Prusse avait contribué, ainsi que les autres peuples, à ce magnifique encombrement de toutes les merveilles du monde. L’heure des désastres sonnait. Nos armées n’avaient point épargné les humiliations aux puissances vaincues: triomphantes à leur tour, elles nous rendirent avec usure outrage pour outrage.
Ces affronts de nation à nation que l’on ne flétrit que lorsqu’on est vaincu, que l’on ne qualifie d’injustes qu’au moment où on ne les commet plus pour son propre compte, sont sans aucun doute de tristes calamités. Elles froissent l’orgueil des capitales et ne satisfont jamais l’ambition des rois ou des armées; mais à Paris, dans cette ville qui avait tant de légitimes motifs pour se regarder comme le centre des arts et le foyer des lumières, cet abus de la victoire, transformé en insulte faite publiquement, à plein soleil, en face de la garde nationale dont les bataillons se présentaient déjà pour protester les armes à la main, avait quelque chose de sauvage.
Le laisser-aller habituel de M. de Talleyrand, son égoïste apathie qui ne se réveillait que dans les crises imminentes, et qui ne se réveillait le plus souvent que par de malicieux propos longuement travaillés, ne permirent pas à l’indignation publique de prendre fait et cause. On parla à M. de Talleyrand des sentiments unanimes que cette spoliation faisait naître dans les masses. A toutes les observations il se contenta de répondre: «Ce n’est pas une affaire.»
Le prince de Talleyrand se trompait, et la poésie libérale et les souvenirs du peuple lui ont prouvé qu’avec notre esprit prime-sautier nous sommes toujours prêts à sacrifier les choses graves à des minuties que l’on prendra à tâche de nous faire regarder comme patriotiques.
A l’aide d’un bon mot M. de Talleyrand croyait avoir pourvu à tout; aussi lorsque le sculpteur Canova se présenta devant lui et demanda la déris ire permission d’entrer au Musée pour retirer les objets d’art qui devaient etre rendus au pape, le président du censeil ne se fit-il pas grâce d’une de ces paroles ne sont jamais des raisons. Canova s’annonçait comme l’ambassadeur du souverain pontife. «Oh! reprit le prince en souriant du bout des lèvres, ambassadeur? C’est emballeur que vous voulez dire.» Ce sarcasme tint lieu de toutes les satisfactions.
Ce n’était pas assez. Le président du conseil le sentit, et dans une note officielle il essaya de le démontrer à lord Castlereagh. Cette note développait le système dans lequel le ministère consentait à se renfermer, système que déjà MM. Corvetto, Portal, La Bouillerie et Dudon avaient outrepassé dans les courageuses résistances de la commission.
«Le ministre du roi, disait le prince de Talleyrand le 19 septembre 1815, a reçu la note que Son Exc. milord vicomte Castlereagh lui a fait l’honneur de lui adresser touchant les objets d’art qui appartiennent à la France; sa majesté, à qui cette note a été soumise, lui a ordonné d’y faire la réponse suivante:
«Son Exc. lord Castlereagh semble croire que les deux guerres de 1814 et 1815 sont de même nature, et que la seconde comme la première doit être terminée par un traité de paix; mais ces deux guerres sont de nature bien différente: la première était faite véritablement à la nation française, puisqu’elle était faite à un homme reconnu son chef par toute l’Europe, et qui disposait légalement de toutes les ressources de la France; la guerre étant faite à la nation, un traité de paix était nécessaire. En 1815, au contraire, ce même homme à qui l’Europe a fait la guerre n’était reconnu par aucune puissance; s’il disposait des ressources de la France, il n’en disposait pas légalement, et la soumission était loin d’être complète. C’est à lui seul et à la faction qui l’a appelé, et non à la nation que, d’après ses propres déclarations, l’Europe a fait la guerre. La guerre s’est donc trouvée terminée et l’état de paix rétabli par le seul fait du renversement de l’usurpateur, de la dispersion de ses adhérents et de leurs chefs. On ne voit donc point comment la guerre de 1815 pourrait être un motif valable pour changer l’état de choses établi par la paix de 1814. Son Exc. le vicomte de Castlereagh a, d’un autre côté, posé en fait que des objets d’art ne peuvent pas s’acquérir par la conquête. Le ministère du roi est bien loin de vouloir faire l’apologie d’aucune sorte de conquête: plût à Dieu que le nom ni la chose n’eussent jamais existé ! mais enfin, puisque c’est pour les nations une manière d’acquérir admise par le droit des gens, le ministère du roi n’hésite pas à dire avec conviction que la conquête d’objets inanimés, dont le seul avantage est de procurer des jouissances physiques, ou. si l’on veut, intellectuelles, est bien moins odieuse que celle par laquelle des peuples sont séparés de la société dont ils sont membres. Il y a à faire, relativement aux objets qui ont été successivement apportés en France, une distinction que l’on paraît n’avoir pas faite. Parmi les pays auxquels la France a renoncé en 1814, plusieurs appartenaient bien légitimement à elle ou au chef qu’elle avait, et parcequ’ils lui avaient été cédés: elle a donc pu disposer des objets d’art qui s’y trouvaient. Lorsqu’elle a renoncé à ces pays, elle les a restitués tels qu’ils étaient au moment de la restitution, et l’on ne voit point d’après quel droit les puissances voudraient aujourd’ hui réclamer des choses qui n’ont pas été comprises dans l’abandon que la France en a fait. Enfin d’autres objets d’art apppartientiennent encore à la France en vertu de la cession qui lui en a été faite par des traités solennels. Quant aux considérations morales développées dans la note de Son Exc. milord vicomte de Castlereagh, le ministère a toute raison de croire que le roi s’empresserait d’y accéder s’il pouvait ne suivre que son propre penchant; mais Son Excellence se trompe si elle pense que le roi soit aujourd’hui plus qu’en 1814 en position de le faire, et le ministère ne craint pas d’affirmer que si, comme il n’en doute pas, toute cession de l’ancien territoire, dans le cas où le roi y consentirait, lui serait imputée à crime, celle des objets d’art ne le serait pas moins, et serait peut-être plus fortement ressentie, comme blessant plus vivement l’orgueil national.»
A cette heure si difficile, lorsqu’on en appelait à l’équité de la diplomatie, on était à l’instant même à peu près assuré de voir surgir un homme de guerre. Lord Castlereagh ne pouvait alléguer que de mauvaises raisons; il laissa au duc de Wellington le soin de les présenter.
Ce dernier répondit «que, lors des conférences pour la capitulation de Paris, les négociateurs français avaient voulu faire insérer un article sur le Musée et sur le respect pour les monuments des arts; que le prince Blucher avait déclaré qu’il s’y opposait, attendu qu’il y avait dans le Musée des tableaux enlevés au roi de Prusse, et dont Louis XVIII avait promis la restitution. Le duc de Wellington avait ajouté qu’étant dans le moment de la capitulation comme le représentant des autres nations de l’Europe, il devait réclamer tout ce qu’on avait enlevé aux Prussiens; que, bien qu’il n’eût pas d’instructions relatives au Musée, ni une connaissance formelle de l’opinion des souverains sur ce point, il devait néanmoins présumer qu’ils insisteraient fortement sur l’accomplissement des promesses du roi de France, d’après l’obligation où ils étaient tous de faire restituer à leurs états les tableaux et statues qui en avaient été enlevés, contre l’usage des guerres régulières, pendant l’effrayante période de la révolution française. Les souverains ne pouvaient faire tort à leurs sujets pour satisfaire l’orgueil de l’armée et du peuple français, auxquels il convenait de faire sentir que, malgré quelques avantages partiels et temporaires sur plusieurs états de l’Europe, le jour de la restitution était arrivé, et que les monarques alliés ne devaient point laisser échapper cette occasion de donner aux Français une grande leçon de morale.»
Le pape Pie VII en donna une aux coalisés dont ils se gardèrent bien de profiter. Les manuscrits les plus précieux du Vatican avaient été transportés à Paris. Canova les réclama; mais alors se présentèrent des envoyés de l’université d’Heidelberg qui en revendiquèrent une partie. Ils disaient qu’elle avait été enlevée de leur ville, pendant la guerre de trente ans, par un duc de Bavière, qui plus tard en fit hommage au saint-siége. La réclamation de l’université était fondée; mais le commissaire romain désira en référer au souverain pontife. Le pape repondit:
«Les mêmes motifs qui accordent le droit aux puissances dépouillées par la France de reprendre les objets conquis par la force militent en faveur de la demande de l’université d’Heidelberg. Il faut donc se conformer aux règles de justice que les alliés viennent de faire triompher.
Avec un peu de résistance dans la forme, M. de Talleyrand pouvait arracher plus d’un de ces monuments de gloire artistique au vandalisme qui les brisait avant de les rendre à leurs anciens maîtres. Il n’en fit rien; il protesta seulement par son silence ou par une obséquieuse résignation. Cet homme d’état, dont le tact était si sûr, dont les prévisions, basées sur les plus petites passions de l’humanité, étaient par cela même si infaillibles, ne comprit pas qu’une aussi brutale agression contre nos musées frappait plus vivement au cœur le peuple de Paris que cent autres avanies plus importantes dans le fond.
Ce dépouillement du Louvre et de nos places publiques ne fut sans doute qu’un très minime accident dans l’histoire de l’occupation de 1815; mais les nations, la France surtout, ne s’arrêtent guère à un ensemble de faits: il ne reste dans leur mémoire que des épisodes. Les générations, qui se succèdent si rapidement, emportent avec elles dans la tombe les gloires qu’elles ont acquises, les malheurs qu’elles ont subis. Il ne surnage dans les masses que des événements isolés. Les récits contemporains les lèguent à la postérité comme un point de départ de l’époque que cette même postérité est appelée à juger. Le spoliation du Louvre et quelques arbres abattus dans le bois de Boulogne, changé par les alliés en un camp militaire, sont de ce nombre.
Les départements envahis, Paris lui-même, ont complètement oublié les douleurs de l’invasion et les pertes que l’occupation a fait souffrir; mais ce qui, par la poésie, par les mémoires et surtout par le journalisme, est resté vivace dans les âmes, c’est le Musée devenu la proie des barbares; ce sont toutes ces images populaires évoquées autour des chefs-d’œuvre qu’une lance prussienne brisait sur leur piédestal. M. de Talleyrand, qui avait l’esprit de l’avenir, n’aurait pas dû l’oublier.