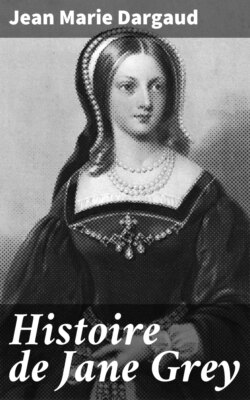Читать книгу Histoire de Jane Grey - Jean Marie Dargaud - Страница 4
CHAPITRE II.
ОглавлениеLe précepteur de Henri VIII, John Skelton.—Les humanistes d'Angleterre.—Leur faveur et leur influence.—Érasme.—Son portrait par Holbein.—Wolsey.—Henri VIII se déclare contre Luther et reçoit de Léon X le titre de défenseur de la foi.—Ambition de Wolsey.—Il console le roi des insultes de Luther.—Attaques de Skelton contre Wolsey et contre le clergé.—Henri, tout en les blâmant, s'amuse des satires du poëte.—Anne Boleyn.—Son séjour en France.—Son retour en Angleterre.—Sa beauté, sa grâce, son esprit.—Elle devient fille d'honneur de Catherine d'Aragon.—Elle est aimée de lord Percy et l'aime.—Portrait d'Anne.—Lord Percy épouse Marie Talbot.—Anne quitte la cour.—Elle y revient.—Amour croissant de Henri VIII.—Diplomatie d'Anne Boleyn.—Le roi la veut pour femme légitime.—Plan de divorce.—Négociation avec la cour de Rome.—Wolsey nommé légat.—Clément VII désigne un second légat, le cardinal Campeggio.—Système de temporisation entre les légats et le pape contre Henri VIII.
Le précepteur de Henri VIII avait été John Skelton qui ne lui avait pas enseigné le respect. Skelton, au fond, se moquait de la Bible et du sacré collège. Il était de bonne maison, et on le comprend à sa hardiesse. Prêtre, bouffon et poëte, il aimait la licence, et l'inspirait. Il n'admettait de lois que celles du rhythme. Il était effréné en tout le reste.
Dès le début de son règne, Henri VIII prit ses précautions avec Rome, et jeta au peuple les têtes d'Empsom et de Dudley, deux ministres des prévarications paternelles. Il était terrible et séduisant. Tandis que la reine se macérait, faisait de la tapisserie, écoutait des sermons et grondait ses filles d'honneur, lui, le roi, courait les tournois et les conciles épiscopaux, les joutes d'épée et de syllogisme. Son idéal multiple, c'était d'être tour à tour le prince Noir et le chevalier aristotélique, le serviteur des dames et le disciple de saint Thomas.
Il protégeait, enrichissait les humanistes. Il appelait Érasme, qui enferma dans une boîte de cèdre sa correspondance avec le monarque. Henri recevait à sa table Thomas Morus, qui expliqua saint Paul, Linagre qui commenta Horace et Virgile, Colet qui proposa de donner à Platon la moitié du trône qu'occupait seul Aristote dans le moyen âge. Skelton égayait les repas, Érasme les illustrait.
Presque tous ces humanistes d'Angleterre avaient passé les monts, et revenaient d'Italie. Ils rapportaient aux pieds de Henri VIII les souvenirs de la tradition et les tentatives de l'innovation. Ils racontaient Rome et les papes, Florence et les Médicis. Henri éprouvait une émulation de doctrine, d'audace et de luxe. Il voulait surpasser tous les princes et tous les pontifes du monde. Il prodiguait l'or et les encouragements à tous les arts.
Érasme était le dieu des humanistes, Holbein en fut le peintre. Henri aspirait à en être le roi. Il s'inclinait devant Érasme, car c'est Érasme qui décernait la célébrité.
Qui ne connaît Érasme, soit par ses œuvres, soit par le portrait d'Holbein? Le grand artiste a fixé dans une toile immortelle la personnalité du philosophe.
Cette toile (c'est celle du Louvre) retrace bien plus qu'un visage, elle retrace toute une âme. Érasme est en robe de chambre brune et en toque noire. Assis devant une table, il écrit avec un roseau taillé très-fin. La figure est de profil. Le regard est ferme comme la main, le nez est aigu comme la pointe du roseau. Le front renferme dans ses rides mille pensées; la bouche exprime dans ses plis mille prudences. Et cependant un diabolique esprit étincelle sous la peau, perce la circonspection, déborde les réticences et compromet ce sage trop pusillanime. Il n'ose aller au delà de la malice, et c'est sa honte; sa gloire eût été d'aller jusqu'à la conscience. Érasme alors serait le Voltaire du seizième siècle. Il n'est qu'Érasme, très-grand encore néanmoins.
Henri VIII régna ainsi pendant dix-huit années, depuis son couronnement, au milieu des hommages d'Érasme et des lettrés. Il était infidèle à Catherine d'Aragon sa femme, mais il gardait le décorum. Il gouvernait; il s'occupait un peu d'affaires et beaucoup de plaisirs; il s'abandonnait à ses ministres, surtout à Wolsey; il brillait à des entrevues splendides, négociait, combattait dans quelques rencontres, et se satisfaisait toujours.
Il avait la prétention d'être un Père de l'Église autant qu'un héros. Luther s'insurgeant, il attaqua ce lion de la théologie. L'Arminius de Wittemberg résista, riposta et asséna de rudes coups à son adversaire auguste. Mais Henri avait les apparences de la victoire. Le moinillon d'Allemagne était bafoué par les courtisans de Windsor, par Wolsey, par Fisher, par tous les cardinaux et par le pape. Deux exemplaires de l'Assertio magnifiquement imprimés et reliés furent remis solennellement par l'ambassadeur d'Angleterre au pape Léon X, qui accueillit ce précieux chef-d'œuvre en présence du sacré collège, avec une reconnaissance éloquente. Paul Jove, l'historiographe de Léon X, inscrivit ce mémorable événement dans ses annales. Sadolet et Bembo applaudirent à la réponse cicéronienne que le pontife avait faite à Henri VIII. Ce prince fut au comble de ses vœux. Lui, qui avait reçu la rose d'or de Jules II, il recevait de Léon X le titre de défenseur de la foi. Son obéissance n'eut plus de limites. Il se déclara le roi-lige du pape. Thomas Morus l'avertit qu'il allait trop loin, que le chef du catholicisme était aussi un souverain temporel, et qu'il convenait de ne pas abaisser le diadème d'Édouard le Confesseur devant la triple couronne de saint Pierre.
Henri VIII se frappa la poitrine, et soutint qu'il ne pouvait jamais être assez soumis à sa très-sainte mère l'Église. Il était aussi plein de déférence pour Catherine, sa femme, et pour Wolsey, son premier ministre.
Il y avait de quoi trembler, car Henri était plus inconstant que la courtisane, plus fantasque et plus soudain que le vent, plus mobile que la mer; sa parole était un jeu, son amour un sable mouvant qui engloutissait ceux qui s'y confiaient. N'importe, ni Rome, ni Catherine, ni Wolsey ne doutèrent du roi. C'était un si bon chrétien, un si bon mari, un si bon maître!
Wolsey lui-même, un homme de tant de pénétration, y fut trompé. Il crut ce qu'il espérait. Il s'enchanta de mille chimères. La plus obstinée de ses illusions était la tiare. Il la voyait dans la veille et dans le sommeil, dans les fêtes, à l'autel, dans ses charmilles de York-Palace ou de Hampton-Court, sous les ogives des cathédrales lorsqu'il officiait en grande pompe, ou dans les perspectives vastes des forêts lorsqu'il suivait les chasses royales.
Wolsey s'était insinué peu à peu dans l'esprit et dans les passions de Henri VIII.
Il était très-souple, très-savant, très-retors, très-poëte et très-théosophe. Ce fut Fox, l'évêque de Winchester, qui le donna au roi comme aumônier. Wolsey était dissolu et ascète, humble et orgueilleux, désirant toujours au delà de ce qu'il avait, mais par degrés; de sorte que son ambition, mesurée et sans bornes, haletante quoique réglée, alla toujours croissant, depuis le bonnet de laine qu'il portait chez son père l'éleveur de bétail jusqu'au bonnet de docteur, jusqu'à la mitre d'évêque, jusqu'au chapeau de cardinal, et enfin jusqu'à la tiare; accumulant de plus tous les pouvoirs civils, chancelier et premier ministre. La tiare était la seule de ses ambitions qu'il n'eût pas encore atteinte, et voilà pourquoi elle éclatait partout devant lui, pourquoi elle était partout le point lumineux de ses horizons, de ses calculs et de ses songes.
Au moment où Luther répondait aux insultes que lui avait lancées le roi par delà l'Océan, où le moine de Wittemberg, après avoir lu dans l'Assertio de Henri VIII ces outrages: Doctorculus, sanctulus, eruditulus! renvoyait à son superbe adversaire de stridents éclats de rire, des tonnerres de dialectique et d'éloquence mêlés d'objurgations, et s'écriait: «Mon roi, c'est le Christ; le roi d'Angleterre est un pourceau de thomiste, un menteur et un maraud;» à ce moment pénible, Wolsey enivra Henri VIII de flatteries. Son titre de roi, lui insinuait-il, était un hasard heureux, mais c'était le moindre de ses mérites. Homme incomparable, il était le prince des théologiens et des beaux génies. Henri se laissait convaincre facilement. Il était touché d'estime pour le goût de Wolsey. Il lui rendait éloge pour éloge. Accusait-on le luxe du cardinal? le roi l'approuvait hautement.
Selon Henri, Wolsey devait participer de son maître, avoir des gardes, des pages, des lords, des prélats pour serviteurs, des palais, des chevaux chargés d'or, un cortége de cinq ou six cents personnes autour de sa mule noire ou blanche, toute caparaçonnée de velours, tout étoilée d'escarboucles et de pierreries. Henri n'était pas mécontent. Son premier ministre méritait tout cela, seulement il écoutait parfois Skelton disant: «Le cardinal a passé aujourd'hui dans la cité. Quelqu'un s'étant informé si c'était le roi, une voix a répondu:
«Non, c'est trop brillant. Ce doit être M. le légat.»
Henri entendait cela, et ceci encore:
«C'est à peine si l'on pourrait compter les nombreux clients qui servent de cortége à Sa Grâce. Vous y trouverez des évêques, des abbés mitrés, des ducs, des comtes, des chevaliers, des juristes, des théologiens, des maîtres d'école, des valets de pied, des palefreniers. La procession est longue.—Ah! voici le cardinal, dit un homme du peuple;—c'est l'archevêque d'York, dit un autre;—c'est le légat a latere de notre très-saint-père le pape, dit un troisième.—Place, place à milord d'York, place au chancelier, place au légat, crient les valets de service: arrière, manants, ne voyez-vous pas la douce figure de Sa Grâce?»
Et ailleurs, c'est le cardinal qui parle:
«Ma demeure, dit-il, est somptueuse; l'or brille sur mes toits comme le soleil en plein midi; des arabesques en ronde bosse serpentent sur les murs, affectant les figures les plus fantasques; mes galeries, larges et spacieuses, ressemblent à des parterres; dans mes jardins protégés par d'épaisses murailles, des fleurs aux mille couleurs embaument l'odorat. J'ai des bancs ombragés de chèvrefeuille pour me reposer, des labyrinthes pour égarer mes pas; plus loin de vastes allées pour rêver à loisir. Voyez mon salon, quelles belles tapisseries! C'est la main d'un artiste qui en a dessiné les sujets: on dirait de la peinture! Quand vient l'heure du repas, ma table étale des mets exquis; je dîne dans une atmosphère de parfums; ma vaisselle est l'œuvre de ciseleurs habiles; je bois dans des coupes précieuses. Si je sors, deux croix d'argent me précèdent; devant moi marchent des valets une hache dorée sur l'épaule; on me contemple comme un saint quand je parais sur ma mule empanachée.»
Skelton, que M. Philarète Chasles a traduit avec l'originalité d'un créateur, est inépuisable sur les désordres du clergé: «Bâtiments royaux, domaines splendides, tours, tourelles, tourillons, salles, bosquets, palais qui fendent la nue, fenêtres à vitraux, tapisseries d'or et de soie, où l'on voit Mme Diane nue, Vénus la gaillarde prenant ses ébats, Cupidon le dard à la main, Pâris de Troie dansant avec Mme Hélène.... Ce sont là leurs maisons, leurs soins et leurs plaisirs, tandis que les églises négligées se vident et que les cathédrales sont en ruines.»
Selon Skelton, Wolsey encourage et résume en lui tous ces luxes, tous ces vices.
«Pourquoi ne vous voit-on pas à la cour? demande-t-on au poëte.—Pourquoi? C'est qu'il y a près du roi un homme plus grand que le roi, si élevé dans la hiérarchie de son arrogance, que l'on ne peut le regarder en face. Au conseil d'État, dans la chambre étoilée, savez-vous comment il se tient? Sa baguette frappe la table; toutes les bouches se ferment, nul n'ose prononcer un mot; tout fait silence, tout plie. Wolsey parle seul; nul ne le contredit; et quand il a parlé, il roule ses papiers en s'écriant:—«Eh bien! qu'en dites-vous, messeigneurs? Mes raisons ne sont-elles pas bonnes,—et bonnes,—et bonnes?» Puis il s'en va, sifflant l'air de Robin-Hood. C'est là l'homme qui nous gouverne, que la pompe et l'orgueil environnent de toutes parts, et qui, pour garder mieux le vœu de chasteté, ne boit que le fin hypocras, ne se nourrit que de gros chapons cuits dans leur jus, de perdrix, de faisans merveilleusement assaisonnés, et n'épargne ni femme ni fille. Belle vie pour un apôtre!»
Henri VIII feignait parfois de l'indignation, mais au fond il s'amusait de l'audace de son ancien précepteur, et il ne le faisait pas taire.
Wolsey, assuré de son ascendant sur Henri, vivait dans le mirage de la papauté. Il traitait les rois et les empereurs en égal, sans cesser un instant de préparer le jour où il les traiterait en supérieur. Il avait dans son oratoire un plan du Vatican, son futur château. Il s'y créait d'avance toutes les mollesses d'un épicurien, toutes les puissances d'un prêtre, tous les fastes d'un satrape, toutes les délices d'un sultan catholique, toutes les joies d'un demi-dieu.
Quelquefois, à travers son inextinguible cupidité des clefs, le cardinal rappelait son humble enfance, ses lents travaux, chaque échelon de cette échelle de Jacob qu'il avait gravi jusqu'à l'avant-dernier, lui, le pauvre écolier d'Oxford, le secrétaire de Fox, le précepteur des fils du marquis de Dorset! Il venait de loin. Ces moments de modestie étaient courts, et Wolsey, il est vrai, en sortait plus superbe qu'un Titan.
Il était le roi du roi, lorsque Anne Boleyn reparut en Angleterre. Nous avons laissé à Paris cette enfant d'un peu moins de huit ans alors. Elle avait accompagné avec son grand-père le duc de Norfolk et son père Thomas Boleyn la princesse Marie. Quand cette princesse, veuve de Louis XII, se fut unie au beau Suffolk et partit pour Londres, elle eut soin de recommander la petite Anne à la reine Claude, femme de François Ier. La reine fit avec le temps d'Anne Boleyn une de ses filles d'honneur.
Anne était d'une famille picarde, qui, après la conquête de Guillaume, se transplanta des environs de Péronne dans le comté de Norfolk.
Le bisaïeul d'Anne, Geoffroy Boleyn, fut lord-maire. Il avait amassé dans le commerce une immense fortune. Il obtint la main de la fille de lord Hastings. Son fils, William Boleyn, épousa la fille du comte d'Ormond, et son petit-fils, Thomas Boleyn, père d'Anne, épousa à son tour Élisabeth, fille du comte de Surrey, depuis duc de Norfolk. Voilà de grandes alliances.
Anne naquit et fut élevée au château de Blickling, dans le comté de Norfolk. Ses premiers compagnons dans les prairies de Blickling furent sa sœur aînée Marie, son frère George et le poëte Wyatt. Elle suivit son père dans le comté de Kent, au château de Hever, où Thomas Boleyn s'établit plus près de la cour. Anne avait dès lors une gouvernante française.
Elle vécut trois mois chez la reine Marie, femme de Louis XII, et huit ans soit chez la reine Claude, soit chez la duchesse d'Alençon, la sœur de François Ier.
Elle rentra en Angleterre à seize ans. Elle fut fort admirée. Ce n'est point en 1525 qu'elle quitta la France, comme le prétendent certains historiens, ni en 1524, à la mort de la reine Claude, qu'elle fut admise parmi les filles d'honneur de la duchesse d'Alençon. Car elle revit les foyers paternels de Hever à la fin de 1522, époque où, sur les instances de Thomas Boleyn, le cardinal Wolsey la fit admettre parmi les filles d'honneur de la reine Catherine, femme de Henri VIII.
Henri avait trente-deux ans. Il avait eu beaucoup de maîtresses, entre autres Élisabeth Blount, veuve de sir Gilbert Talbois, et Marie, sœur aînée d'Anne Boleyn. Anne n'eut d'abord que de la répulsion pour le séducteur de Marie. Le poëte Wyatt fut moins heureux encore que le roi. Car le roi du moins avait la haine d'Anne, et Wyatt n'eut que son amitié. Ce fut lord Percy, fils du comte de Northumberland, qui eut tout son amour.
Percy et Anne s'étaient avoué leur passion mutuelle, à York-Palace, chez Wolsey, dans une de ces fêtes où le cardinal prodiguait les fleurs, les lumières, l'or, les collations, toutes les magnificences. Les amants se cherchèrent dès lors et se rencontrèrent dans les soirées soit de Hampton-Court, soit d'York-Palace, soit de Greenwich. Bien plus, lord Percy, que son père avait attaché à la personne de Wolsey, profitait de toutes les affaires d'État qui amenaient le cardinal chez Henri VIII. Pendant que Wolsey s'entretenait d'administration, de finances ou de politique avec le prince, lui Percy, sous prétexte de rendre ses hommages à la reine Catherine, ne manquait pas l'occasion d'enchanter Anne et de s'enchanter lui-même par des confidences à voix basse, par les perspectives de leur bonheur, lorsqu'ils seraient l'un à l'autre, à la face de la cour et du monde. Le mariage serait leur Éden.
L'année 1523, dans ses deux premières saisons, fut l'aube riante de la vie d'Anne Boleyn.
Elle aimait, elle était aimée. Elle avait été fille d'honneur soit de la reine Claude, soit de Marguerite, la duchesse d'Alençon, qui plus tard fut reine de Navarre. Elle avait respiré cette fleur de civilisation française, dont elle emportait le parfum en Angleterre. Anne Boleyn avait plu à Marguerite, et Marguerite avait été adorée d'Anne. Il tomba des conversations de la princesse sur la fille d'honneur des étincelles d'esprit, des hardiesses de conscience et le goût de toutes les nouveautés. Anne profita vite à cette école de galanterie et de philosophie. Elle connut le roi chevalier, les jeunes seigneurs et les penseurs audacieux de Paris et de Nérac. Elle préluda par les escarmouches de Saint-Germain, de Chambord, de Fontainebleau et du Louvre, aux sérieux combats qui l'attendaient à York-Palace, à Hampton-Court, à Greenwich et à Richmond.
Elle fut la grâce de la France en Angleterre, la grâce moins insouciante et plus réfléchie.
Lorsqu'elle fut devenue fille d'honneur de Catherine d'Aragon, une reine ignorante, superstitieuse, hautaine comme il convenait à une fille de Ferdinand le Catholique et à une tante de Charles-Quint, Anne Boleyn ne succomba point à la monotonie castillane. Elle fut dans la cour de Catherine une sédition à elle toute seule. Elle eut des coquetteries pour plusieurs, et pour lord Percy de l'amour. Elle contait bien, elle se moquait encore mieux. Un mot lui suffisait pour graver à jamais un ridicule. Son ironie pleine d'imagination se jouait à tort et à travers à coups de pinceau.
Anne n'avait pas de pareille, soit pour sa mise assaisonnée très-habilement des modes de deux nations, soit pour sa danse aérienne, soit pour son accent d'une vibration légère ou tragique, selon l'heure. La voix d'Anne Boleyn avait des notes singulièrement électriques. Il en sortait des effluves ardentes qui donnaient la fièvre, ou des caprices de gaieté qui communiquaient l'ivresse. Nul ne restait froid auprès d'elle: nul ne l'aimait, nul ne la haïssait à demi.
Et, avec tant de dons, une mollesse de poses, ou un agrément de dignité, ou des fantaisies d'attitudes à rendre fous les plus sages. Les témoignages contemporains sont unanimes. Les portraits varient sans se contredire. Ils sont nombreux et quelques-uns d'Holbein. Ils m'ont tous paru plus délicats que celui de Windsor, un peu endommagé et massif.
Les cheveux châtains avaient poussé au roux. La physionomie était aussi mobile que la taille était souple. Anne avait le front élevé, le nez droit, les yeux brillants, la bouche railleuse, en tout un visage où, sous la fluctuation des sentiments, les rayons devaient succéder aux ombres. Ce visage rose comme le sein était ordinairement surmonté d'un béret de velours d'où retombaient des dentelles, des glands d'or et des perles sur un cou de cygne par la blancheur, par la flexibilité et par la ténuité.
Voilà Anne Boleyn.
Tout le monde fut frappé de cette beauté un peu provoquante, le roi plus que personne. Il devina dans lord Percy un rival, et ne le ménagea pas. Il chargea Wolsey de lui imposer un prompt mariage avec une autre que Anne Boleyn. Telle était la décision du roi. Wolsey eut une explication avec le jeune lord, qu'à sa grande surprise il trouva résolu dans son amour et tout frémissant de colère contre Henri VIII. Le cardinal manda aussitôt le comte de Northumberland, qui dompta son fils et le contraignit à épouser Marie Talbot, fille du comte de Shrewsbury. Ces deux pères, qui étaient de si grands seigneurs, furent dénaturés sans hésitation et sans remords. Plaire au roi n'était-il pas leur plus saint devoir? Après cette longue guerre civile entre les maisons d'York et de Lancastre, sous Henri VIII, qui avait hérité les deux roses réconciliées par les noces de Henri VII, la pente à l'obéissance était glissante, et les fronts les plus fiers se courbaient d'eux-mêmes à la servitude.
Lord Percy mena donc Marie Talbot à l'autel, au mépris de ses serments et malgré son cœur. C'est le 12 septembre 1523 qu'il accomplit solennellement ce crime contre Marie Talbot, contre Anne Boleyn et contre lui-même. Ce fut chez lui faiblesse; pour son père et son beau-père, ce fut abjection. Cette date de 1523 fixe avec certitude l'entraînement du roi vers Anne Boleyn.
La jeune Anne cessa d'être fille d'honneur de la reine Catherine. Thomas Boleyn, un autre père courtisan, s'empressa de quitter Greenwich. Il emmenait Anne dans son château de Hever. Il était désolé d'avoir manqué cette belle alliance avec lord Percy, le plus éclatant parti d'Angleterre, mais il contenait l'expression de son cruel désappointement. Anne, elle, indignée contre son amant, contre le roi et contre Wolsey, les maudissait tour à tour.
L'exil des Boleyn dura seulement quelques mois. Anne fut bientôt réintégrée dans ses fonctions de palais. Elle avait eu le temps de sécher ses larmes. Elle n'avait plus d'amour, elle n'avait que de l'ambition. Elle était prête à l'avenir qui allait se dérouler devant elle, lorsque son père fut nommé vicomte de Rochefort en passant de Hever à Greenwich.
Anne accepta de beaux présents du roi. Il se sentit encouragé et se hasarda plus loin. Mais il trouva une jeune fille invincible à ses audaces, comme à ses soumissions. Ce qui la rendait irrésistible, c'est qu'elle semblait, en refusant, lutter contre son propre amour autant que contre celui du roi. Quatre ans après les premiers stratagèmes de Henri, son goût était une passion effrénée. Anne avait attisé le feu sans se laisser atteindre. Elle avait dit à Henri VIII, comme autrefois Élizabeth Grey à Édouard IV: «Je serais heureuse d'être votre femme, mais je ne serai pas votre maîtresse.» Le roi croyait à la sensibilité d'Anne autant qu'à sa vertu inébranlable. Il la plaignait, il la respectait et il l'en aimait davantage. La jeune fille, cédant à l'émotion et ne cédant pas à la passion, avait irrité, exaspéré les sens du roi. En refoulant les désirs de Henri dans l'âme du prince, comme on comprime la poudre dans le canon d'une arme, elle avait lentement préparé une explosion terrible.
Henri est tout entier à sa convoitise d'Anne Boleyn, et cette convoitise est formidable. Elle s'est aiguisée par les retards. Il lui faut Anne enfin, et il l'aura. Qu'a-t-il obtenu jusque-là? des paroles; plus que des paroles, des complaisances, les avant-dernières faveurs peut-être. Mais il veut Anne elle-même, et il ne la veut pas comme maîtresse, il la veut comme femme légitime: il la veut sans cesse et à toujours. Ce n'est pas trop pour satisfaire les violents transports, les longues soifs dont il est consumé.
La volupté, voilà le fond de cet homme. Il y joint la théologie. C'est une belle science, à laquelle il s'est livré dès sa jeunesse. Elle aussi lui sera propice. Son amour est son unique pensée. Malheur à sa femme Catherine, puisqu'elle est un obstacle à cet amour. Et si Wolsey ne l'aide pas, si Rome le retient, malheur à Wolsey, malheur à Rome!
Son premier, son meilleur secours lui vient des Écritures. Dans quel état de péché il avait vécu! cela faisait frémir.
Le Lévitique a dit: «Tu n'épouseras pas la femme de ton frère.» Le Lévitique a dit encore: «Celui qui prendra la femme de son frère mourra sans postérité.»
Et saint Thomas, le plus grand des hommes, l'ange de l'école, saint Thomas, son ami, son guide, qu'il a médité dès l'enfance, saint Thomas a gravé ces mots sacramentels: «La loi du Lévitique sur le mariage et sur les degrés défendus est obligatoire. Le pape peut bien dispenser de la loi de l'Église, mais non des prescriptions du Lévitique, car ces prescriptions sont la loi des lois, la loi de Dieu.»
Quand il songeait à de telles autorités, Henri était glacé de terreur. Il était incestueux non moins que Catherine d'Aragon; et leur fille Marie était un fruit incestueux. Henri respirait l'inceste, il nageait dans l'inceste. Il avait, malgré le Lévitique, la femme de son frère Arthur. Il méritait d'être puni. Tous ses enfants, excepté un, étaient morts en bas âge. La prophétie du Lévitique l'avait déjà frappé. Elle s'accomplirait toute. Lui, Henri, mourrait sans postérité. Ah! il comprenait trop tard les scrupules de Warham, archevêque de Cantorbéry, contre ce mariage, les scrupules de son père Henri VII, qui lui conseilla dans ses derniers moments de rompre ce lien funeste. S'il passa outre, c'est son conseil qui l'entraîna. Il s'en repentait. Catherine, d'ailleurs, était vieille. Elle ne pouvait plus lui donner d'héritier et contenter par là le vœu de son peuple. Si elle le pouvait, cet héritier tardif serait retranché. Ne serait-il pas souillé de l'inceste paternel et maternel? Henri ne demeurerait pas plus longtemps ainsi dans l'opprobre et dans l'anathème.
Catherine était bornée et vertueuse; elle ne se faisait guère lire que des prières et la Vie des saints. Elle occupait toutes ses journées en matrone féodale. Elle assemblait des laines, travaillait à des ouvrages de tapisserie au milieu de ses filles d'honneur, ou bien elle filait comme la reine Berthe, rêveuse, au bruit des fuseaux et des rouets. Elle était dévouée à son époux, à la princesse Marie, à tous les devoirs; Henri le reconnaissait plus que personne. Il lui rendait justice. Il supporterait même cette monotonie, cet ennui des habitudes domestiques de la reine, il les supporterait; mais ce qu'il ne supportera pas, ce que sa tendresse même pour Catherine lui interdisait de supporter davantage, c'était l'inceste dans lequel ils étaient plongés l'un et l'autre. A ce mal, il y avait un remède douloureux, mais souverain, et ce remède, quoiqu'il lui en coûtât, il y aurait recours héroïquement. Il obtiendrait le divorce.
S'il n'eût pas eu déjà la pensée du divorce, les États de Castille, le premier président du parlement de Paris et l'évêque de Tarbes, depuis cardinal de Gramont, la lui auraient suggérée, en contestant la légitimité de la princesse Marie, à l'occasion des noces projetées entre elle et successivement Charles-Quint, puis François Ier, puis le duc d'Orléans, second fils du roi chevalier. Henri VIII ne fit pas jouer la comédie à l'évêque de Tarbes, comme l'a prétendu superficiellement un écrivain moderne, car, avant l'évêque de Tarbes, le premier président du parlement de Paris et les États de Castille, je le répète, s'étaient gravement prononcés.
Convaincu d'ailleurs, et pressé par sa passion bien autrement que par sa science, le roi se mit une seconde fois à l'œuvre. Il avait écrit un livre contre Luther; il en écrivit un pour saint Thomas d'Aquin et pour le Lévitique. Ces deux autorités prescrivaient au roi de réclamer le divorce, qui seul dénouerait, à la gloire de Dieu et à la satisfaction d'Anne Boleyn, le mariage incestueux de Catherine d'Aragon.
Le divorce! quand il se fut dit et redit ce mot, il ne cessa plus de se le redire. Ce mot fiévreux lui battait dans le cœur et dans les tempes. Il manda Wolsey et le lui cria sur tous les tons. Wolsey fut étourdi d'une telle responsabilité! Certes, il ne se souciait pas de Catherine, mais c'était une reine commode qui ne lui disputait ni le roi, ni le pouvoir. Le cardinal appréhendait un changement. Néanmoins, il fut entraîné par l'impétuosité de Henri. C'eût été trop risquer à la fois que de ne pas s'incliner devant le roi, devant saint Thomas d'Aquin et devant le Lévitique. Wolsey sembla persuadé par les arguments du prince théologien. Mais quand Henri eut déclaré qu'après le divorce il épouserait Anne Boleyn, le cardinal se précipita aux genoux de son maître, le suppliant de ne pas commettre une telle mésalliance. Henri dissimula. C'était beaucoup pour lui d'avoir enlevé la question du divorce. Il feignit d'entrer dans les vues de Wolsey. Il lui donna même la mission occulte de demander pour lui la duchesse d'Alençon, et, s'il n'était pas agréé par elle, la princesse Renée. Le cardinal partit pour la France. Il sollicita la main de Marguerite à Paris, et à Compiègne la main de Renée. Vains efforts! Marguerite et Renée, en nobles femmes qu'elles étaient, répondirent que, fussent-elles libres, jamais elles ne consentiraient à remplacer Catherine vivante. Elles ajoutèrent que leur parole était engagée. Marguerite, en effet, était promise au roi de Navarre, et Renée au fils du duc de Ferrare. Wolsey fut confondu. Son maître s'était moqué de lui. Si le cardinal avait ignoré que les princesses fussent enchaînées déjà, le roi le savait. Il l'avait aventuré méchamment dans ce rôle ridicule, et il en riait probablement avec Anne. Le cardinal eut l'air de ne pas deviner l'astuce de Henri, et il revint fort triste en Angleterre, quoique calme en apparence et même enjoué.
Il allait entamer avec la cour de Rome la négociation du divorce. C'était pour lui une nécessité. Wolsey se trouvait pris dans un dilemme à deux tranchants. S'il échoue, il sera la victime du roi; s'il réussit, il sera la victime d'Anne Boleyn.
«Je suis l'oiseau de jour, disait-il à l'un de ses confidents; si j'installe au chevet de Henri cet oiseau de nuit, il me supplantera.»
Le cardinal comptait sur les mois, sur les années, sur l'inconstance du roi, sur les mille incidents de la casuistique, de la politique et sur son étoile.
Le pape avec lequel il allait se concerter tendrait à peu près au même but que Wolsey et seconderait probablement le ministre dans les détours de ce labyrinthe inextricable, où l'un et l'autre essayeraient de tromper le Minotaure, sous beaucoup d'apparences de zèle, pour n'en être pas dévorés.
Ce pape était un Médicis, Clément VII, aussi poltron que Jules II était intrépide. Il avait échappé comme par miracle au siège et au sac de Rome. Frundsberg n'avait pu se servir de la chaîne d'or qu'il apportait à son cou pour étrangler le pape. Le terrible chef de lansquenets était tombé de son cheval de guerre, avant l'assaut de la ville éternelle.
Le connétable de Bourbon avait été frappé pendant l'assaut et il avait rendu le dernier soupir sur les marches de la cathédrale de Saint-Pierre. Le pape, qui l'avait tant redouté, le regretta. Il trembla plus convulsivement dans son palais à cette nouvelle et les clameurs d'une soldatesque sans chef montèrent plus menaçantes jusqu'à lui. «Sang! sang!» criaient à l'envi les Allemands et les Espagnols. Ils pillèrent tout. Ils violèrent les filles et les femmes. Ils massacrèrent les enfants à la mamelle, et les vieillards à l'agonie. Ils couchèrent avec leurs maîtresses d'une nuit sur les tapis des autels, sur les vêtements de pourpre des prélats, sur les soutanes blanches du vicaire de Jésus-Christ. Ils burent jusqu'à l'orgie dans les vases consacrés. Ils tentèrent de faire administrer le viatique à des chevaux malades. Ils crachèrent au visage des cardinaux, après les avoir dépouillés, et les promenèrent par les rues et les carrefours avec leurs barrettes et leurs robes rouges, sur des ânes et la face tournée vers la queue. Le jeune prince d'Orange nommé généralissime au milieu de ce chaos, rançonna le pape avant d'être lui-même chassé de Rome par la peste ainsi que ses bandits «plus diables, dit un contemporain, que les diables d'enfer.» Les Allemands de Luther avaient plus profané Rome que les Espagnols de la Vierge Marie, mais ils l'avaient moins ensanglantée. En un mot, ce que les uns osèrent en blasphêmes, les autres l'osèrent en atrocités; il y eut entre eux une émulation de férocités et de sacriléges.
Clément VII, évadé de Rome, se réfugia tout effaré d'horreur et de peur à Orviette. Il y fut encore prisonnier de Charles-Quint, mais avec plus de sécurité.
Ce fut là qu'il donna audience aux ambassadeurs et aux agents de Wolsey. Les plus éminents dans l'intrigue, Casale et Knight avaient les mains pleines et leurs instructions étaient de tout corrompre autour du pontife. Les prélats n'avaient jamais eu si grand besoin d'argent. Ils avaient été ruinés par les insatiables bandes du connétable de Bourbon. Knight avait offert une somme énorme au cardinal des Santi-Quatri, le favori du pape. Wolsey voulant tenir ce prélat à sa discrétion écrivait à Casale: «Tâchez d'avoir un entretien particulier avec lui et démêlez adroitement ce qui pourrait me le conquérir. Dites-moi s'il aurait envie de riches vêtements, de vases d'or, de chevaux.» Voilà ce qu'un cardinal tentait sur un cardinal pour l'amener doucement à la plus effroyable des simonies.
C'était au mois de décembre 1527. Les négociateurs anglais réclamaient du pape deux décisions rédigées d'avance par Fox, aumônier de Henri VIII. La première de ces décisions était la nomination de Wolsey comme juge suprême du divorce, la seconde était une conséquence de la première, c'est-à-dire l'autorisation conférée au roi de se remarier après la répudiation de Catherine.
Le pape hésita, distingua. Il était dans une odieuse alternative entre le roi d'Angleterre qui le menaçait sourdement d'un schisme et l'empereur Charles-Quint dont il était le captif et qui le menaçait d'une déposition. Clément VII était fils naturel de Julien de Médicis, et, les clefs étant incompatibles avec la bâtardise, Charles pouvait en effet les lui faire arracher honteusement par un concile, situation cruelle et qui explique bien les tergiversations du pape! Il penchait tantôt du côté du roi, tantôt du côté de l'empereur, selon les oscillations d'effroi qui lui venaient du mari ou du neveu de Catherine d'Aragon.
A travers des perplexités diverses, des rédactions, des rétractations, des amendements et des formules innombrables, Clément finit par décerner à Wolsey qui consulterait des docteurs de son choix, l'arbitrage souverain de toute la cause. Le cardinal deviendrait ainsi pape dans ce débat.
Wolsey fut épouvanté. Il ne désirait pas le divorce dont il redoutait si âprement les suites. Il ne pouvait cependant pas se récuser. Il était serf de cette glèbe de la faveur royale. Il était condamné à suer et à tracer en gémissant le dur sillon sous l'aiguillon redoublé de Henri.
Il dit au roi néanmoins qu'une sentence émanée de lui seul Wolsey, ne paraîtrait pas assez impartiale à l'Europe, qu'il serait opportun de faire nommer un autre légat, le cardinal Campeggio, par exemple. L'arrêt prononcé alors par un légat anglais et par un légat romain ne serait pas moins sûr et serait plus imposant. Il ajouta qu'il exigerait du pape une «pollicitation» ou promesse de ne jamais révoquer la commission des deux légats et une bulle décrétale qui confirmerait d'avance leur verdict, c'est-à-dire l'annulation certaine du mariage de Henri avec Catherine d'Aragon.
Le roi vit une bonne intention et une profonde politique dans ce stratagème inventé par Wolsey pour gagner du temps. Traîner les choses en longueur était aussi la préoccupation de Clément VII. L'intérêt du pape et du cardinal était le même; ils s'entendaient. Éviter le divorce par des retards, le tuer à doses de minutes et d'heures, tel était leur effort réciproque. Aussi Clément se hâta-t-il d'accorder Campeggio pour collègue à Wolsey. Mais ce fut sa seule précipitation. Le légat italien devait être comme eux l'homme des temporisations. Il se mit en route pour Paris où il n'arriva que le vingt-sixième jour depuis son départ. Il alléguait pour excuser ses lenteurs sa mauvaise santé. Il avait la goutte et mille autres infirmités dont il se proposait de faire autant de protocoles diplomatiques.