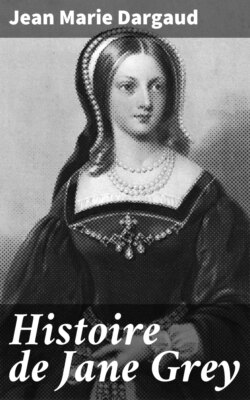Читать книгу Histoire de Jane Grey - Jean Marie Dargaud - Страница 5
CHAPITRE III.
ОглавлениеLa peste en Angleterre sous le nom de suette.—Relation du cardinal du Bellay.—Situation de la cour pendant la suette.—Henri VIII.—Anne Boleyn.—Wolsey.—Lettres, courriers du roi.—Visite de Henri à sa maîtresse (sept. 1528).—Le roi plus amoureux que jamais après le fléau.—Il poursuit son divorce.—Campeggio à Londres et Clément VII à Rome se jouent de Henri VIII.—Wolsey cherche vainement à concilier l'inconciliable.—Procès du divorce à Blackfriars.—Entrevue des légats et de Catherine d'Aragon à Bridewell.—La reine leur apprend son appel au pape.—Fureur de Henri VIII.—Traité de Clément VII et de Charles-Quint.—Voyage de Henri à Grafton.—Commencement des disgrâces de Wolsey.—Le docteur Cranmer à Waltham-Abbey.—Il trouve la solution des difficultés du roi.—Henri le confie au vicomte de Rochefort, père d'Anne Boleyn.—Cranmer conspire théologiquement contre la reine et contre le pape.
Pendant le voyage du cardinal Campeggio la peste s'abattit sur l'Angleterre qu'elle décima. Anne Boleyn n'était plus à la cour depuis le mois de mai (1528), quand le fléau commença à sévir au mois de juin.
C'était le roi qui, sur le conseil de Wolsey, avait arrangé le départ de Mlle de Boleyn. Le cardinal avait persuadé Henri. Il lui avait démontré la convenance d'une éclipse d'Anne, aux approches du grand jugement qui allait abolir le mariage du roi. Henri approuva son ministre, et, pour écarter tout prétexte de blâme, il avait ménagé l'éloignement momentané de sa maîtresse.
Anne, fort irritée de cette complaisance du roi pour Wolsey, se retira en protestant qu'elle ne reviendrait plus. Henri inquiet lui adressait de Hampton-Court message sur message, soit à Londres, soit à Hever.
Telle était la situation agitée des deux amants, lorsque la suette éclata. Le cardinal du Bellay, ambassadeur de France, écrivait le 18 juin: «La suée est une maladie survenue ici (Londres) depuis quatre jours, la plus aisée du monde pour mourir. On a un peu de mal de tête et de cœur; soudain on se met à suer. Qui se découvre un peu ou se couvre un peu trop, en deux, trois, ou quatre heures est dépêché sans languir.» Le 30 juin le cardinal du Bellay écrivait encore: «La Damoiselle (Anne Boleyn) est chez son père. Le roi s'en va changeant de logis pour cette peste: assez de ses gens en sont morts.... Depuis mes lettres, j'ai été averti que le frère du comte de Derby et un gendre du duc de Norfolk sont morts subitement chez M. le légat (Wolsey) qui s'est coulé par derrière avec peu de gens et n'a voulu qu'on sçeût où il allait pour n'estre suivy de personne. Le roi s'est arrêté à vingt milles d'icy.» Le 21 juillet M. du Bellay écrivait de nouveau: «Mademoiselle de Boleyn et son père ont sué, mais sont échappés. Le jour que je suai chez M. de Cantorbéry, dix-huit moururent en quatre heures. Ce jour-là, ne s'en sauva guères que moi qui ne suis pas encore bien ferme.... Les notaires ont eu beau temps deça: je crois qu'il s'est fait cent mille testaments.»
Plusieurs historiens ont accusé Henri VIII d'avoir complétement oublié Anne Boleyn pendant la durée de l'épidémie, tant il était absorbé par la terreur! Ces historiens, estimables du reste, n'ont eu qu'un tort, c'est d'avoir négligé les sources. Ils ont été, par ignorance, des calomniateurs. Henri est bien assez coupable de ses propres vices et de ses crimes avérés. Il n'est pas nécessaire de le flétrir à faux.
Il y a de lui, soit en français, soit en anglais, dix-sept lettres à sa maîtresse qui furent volées dans un coffret d'Anne Boleyn et expédiées à Rome par un des agents du pape. Copiées avec soin par M. Méon, elles ont été pendant dix-huit ans à la bibliothèque impériale, de 1797 à 1815, époque à laquelle toutes furent restituées à la bibliothèque du Vatican. On distinguera facilement à la vétusté de l'idiome ce qui dans ces lettres a été écrit en français par Henri VIII. Tout ce qui a été traduit est en langue moderne.
C'est dans ces confidences que la vérité est toute vive.
Or, la troisième de ces dix-sept lettres rassure Anne. Le roi y est fort tendre: «Une chose, dit-il, vous peut comforter. Peu ou nulle fame ont cette malady. Par quoy je vous supply, ma entière aymie, de ne avoir point peur, ny de nostre absence vous trop ennuyer, car, où que je soy, vostre suy.»
La quatrième lettre est fort curieuse. Elle précise la date où le goût du roi devint passion. En 1523, lorsque Henri fit manquer le mariage de Mlle de Boleyn avec Percy, elle lui plaisait, sans doute, mais il ne l'aima d'amour que depuis 1526 ou 1527, «ayant esté, écrit-il, en 1528, plus que une année attaynt du dart d'amours.»
Dans la douzième lettre, le roi se désole. Sa maîtresse a été malade; ce sera probablement un prolongement de séparation. La treizième lettre de Henri s'adresse à une convalescente presque guérie. Il la désire plus près de Hampton-Court dans une maison qu'il lui a choisie.
«Quant à votre demeure à Hever, je vous laisse libre de vos actions; vous savez quel air vous convient le mieux, mais je voudrais que ni l'un ni l'autre de nous deux n'eût besoin de cela, car je vous assure que le temps me dure bien. Suche est tombé malade de la suette, et c'est pour cette raison que je hâte cet autre messager. Je pense que vous êtes impatiente d'avoir de nos nouvelles comme nous le sommes d'en recevoir des vôtres. Écrite de la main de votre seul.
«H. Rex.»
On le sent, le roi n'abandonnait pas sa maîtresse. Il avait été la voir au mois de septembre (1528). Ce fut alors et sous les yeux de Henri qu'elle écrivit une lettre à Wolsey. Anne se réjouit de l'arrivée prochaine du cardinal Campeggio. Elle espère tout de lui et de Wolsey particulièrement.
«Je prie Dieu, monseigneur, de vouloir bien vous accorder pour longtemps la santé et cette prière n'est que de la reconnaissance! En effet tous les tourments que vous vous êtes infligés pour moi jour et nuit ne pourront jamais être récompensés de ma part qu'en vous aimant, après le roi, plus que tout autre.»
Henri prit la plume à son tour et traça ce post-scriptum:
«Celle qui vous écrit cette lettre n'a point de cesse que je n'y mette aussi la main. Je vous assure que nous souhaitons beaucoup tous deux vous voir et que nous éprouvons un véritable plaisir en pensant que vous avez évité la peste qui perd maintenant de sa violence, surtout envers ceux qui observent une diète rigoureuse, comme je ne doute point que vous ne le fassiez. Nous sommes un peu troublés de ne savoir point encore l'arrivée du légat en France. Nous comptons cependant que par votre zèle et votre activité (et avec l'aide du Tout-Puissant) nous serons bientôt rassurés là-dessus. Je ne vous en dis pas davantage pour le moment, si ce n'est que je prie Dieu de vous départir une aussi bonne santé et autant de bonheur que vous en souhaite,
«Votre affectionné maître et ami,
«Henry Rex.»
Après le départ du roi d'auprès d'elle, Anne écrivit une autre lettre au cardinal Wolsey.
Monseigneur, je remercie Votre Grâce dans toute l'humilité de mon pauvre cœur, pour votre lettre obligeante et votre magnifique présent, que je ne croirais jamais mériter sans votre indulgence. Vous m'en avez si pleinement gratifiée jusqu'à ce jour, que tant que j'existerai, je me regarderai comme celle de toutes les créatures qui doit le plus aimer et servir Votre Grâce après le roi: vous suppliant de ne jamais douter que je puisse avoir d'autres sentiments tant qu'il me restera un souffle de vie. Et quant à la maladie dont a été attaquée Votre Grâce, je remercie Dieu que les personnes, c'est-à-dire le roi et vous, pour la vie desquelles je n'ai cessé de former des souhaits, aient échappé au fléau de la peste, ne doutant pas que Dieu ne vous ait conservés tous deux pour de grandes raisons qui ne sont connues que de sa haute sagesse. Je désire beaucoup l'arrivée du légat, et je prie Dieu d'amener promptement cette affaire à une bonne fin. Alors, monseigneur, j'espère m'acquitter en partie des grandes peines que vous vous êtes données pour moi. En attendant, je vous supplie de recevoir l'hommage de ma bonne volonté, à défaut de celui de mon pouvoir qui doit provenir en partie de vous. J'adresse des vœux au ciel pour qu'il vous accorde une longue vie et la continuation de tous les honneurs. Écrite de la main de celle qui est entièrement
«Votre humble et obéissante servante,
«Anne Boleyn.»
Le roi, à cette époque, était comme Anne au mieux avec Wolsey, dont ils connaissaient l'ascendant sur Campeggio, et dont ils attendaient une sentence de divorce. Tous les nuages étaient dissipés. Wolsey n'était pas, mais paraissait réconcilié avec les amants. Henri n'avait jamais été si épris de sa maîtresse. Avant et après la peste, il lui envoyait des bijoux et des chevreuils; pendant l'épidémie il lui envoya des médecins, des messagers et des déclarations. Il vint même la visiter, et il y avait, il faut le redire, du danger à se déplacer: le fléau enlevait en trois ou quatre heures.
Quand la foudre éclate dans l'orage, les troupeaux effarés se dispersent, et ils se cachent la tête sous les buissons. L'homme, au contraire, prévoit et use de son intelligence, de son courage pour se disposer un abri. Ses précautions bien combinées, il se soumet plus paisible au destin. C'est ce qu'exécuta le roi.
Plus de deux mille personnes périrent à Londres en quarante-huit heures. Henri confina sa maîtresse sous les auspices de Thomas et de George Boleyn, un père et un frère dans leur château très-salubre de Hever, au milieu des prairies du comté de Kent. Il leur adjoignit Butts, le médecin en qui il croyait. Il lui nomma plus tard un coadjuteur. Butts, qui était l'Ambroise Paré des Tudors, eut ordre de s'enfermer à Hever avec Anne Boleyn, et de veiller assidûment sur cette jeune fille dont Henri se proposait de faire une reine.
Lui, partit de Hampton-Court avec sa femme Catherine, sa fille Marie, et se réfugia à quelques milles de Londres, de résidence en résidence, jusqu'à une résidence définitive que Wolsey avait préparée pour la famille royale et pour lui-même. Butts y manquait.
Henri y suppléa par d'autres médecins et par sa direction attentive. Il fut lui-même le médecin des médecins. Il prescrivit à tous et à toutes la diète et la chambre, à quelques-uns le lit. Il donnait l'exemple. Il complétait cette hygiène par la prière, par la lecture, par la confession, par les communions fréquentes. Il rédigea son testament en compagnie de Wolsey.
Son amour pour Anne Boleyn semblait suspendu, mais cette interruption, nous l'avons prouvé, ne fut pas réelle. Les messagers allaient et venaient du roi à sa maîtresse. Cet amour contenu ne fut que plus fort. Le poids du fléau en centuplait, par la compression, la profonde intensité. Au sortir de la crise, cet amour fera sauter Rome, si Rome tente de l'étouffer.
Dès que la peste diminua, le roi reprit son livre et ses citations des Pères, de saint Thomas et du Lévitique. C'étaient autant d'arguments contre son mariage avec Catherine d'Aragon et pour le divorce. Ses dispositions sont les mêmes qu'à la veille de l'épidémie, lorsqu'il écrivait à sa maîtresse:
«Mon petit cœur, cette lettre est pour vous avertir du chagrin que j'ai éprouvé depuis votre départ.... Je pense que votre bonté et la ferveur de mon amour en sont cause, car autrement je ne croirais pas possible qu'une aussi courte absence ait pu me causer tant de douleur. Mais maintenant que je vais vous joindre, mes peines disparaissent à moitié, et j'ai aussi une grande consolation à composer mon livre qui rentre dans mon amour. Aujourd'hui même j'y ai consacré plus de quatre heures, ce qui, outre un mal de tête, fait que je vous écris si peu, désirant surtout le soir me trouver dans les embrassements de ma mignonne....»
On ne peut citer textuellement les deux dernières lignes du roi. L'histoire dédaigne le scandale, pourvu qu'elle ait l'information exacte. Ici Henri VIII est Henri VIII. Son audace, quoique très-grande, a des bornes. Il éprouve des amours de casuiste et de moine comme François Ier des amours de chevalier et de soudard. Henri VIII est à coup sûr le moins entreprenant et le plus corrompu.
Au mois de mai 1529, à l'ouverture du procès royal, Henri écrivait à sa maîtresse: «La maladie de ce légat (Campeggio) a mis quelque retard à la visite qu'il se propose de vous faire; il ne manquera pas de réparer ce retard.»
Il se jouait à ce moment-là dans le monde un grand drame d'idées, le drame de la Réforme, au-dessus du drame privé de la cour d'Angleterre. La tragédie royale du divorce se rattacherait-elle à la tragédie universelle de la liberté humaine? l'affranchissement par Luther et les autres initiateurs entraînerait-il le schisme de Henri VIII, et ce tyran agiterait-il son drapeau contre Rome? telle était la question.
Campeggio, à Londres, se concertait astucieusement avec Wolsey. Tandis que les deux légats méditaient des délais interminables et ourdissaient des lenteurs fabuleuses, trois personnages aspiraient dans un tumulte intérieur à une conclusion.
Anne Boleyn avait toutes les ardeurs du trône. Elle enflammait Henri, elle l'enivrait par les filtres d'une coquetterie savante. Elle réservait certainement quelque chose. Elle ne lui livrait pas la dernière coupe des voluptés. Elle le rendait fou de convoitise.
Cette convoitise du roi était diabolique. Lui, un prince et un docteur, il était sensuel et orgueilleux. Il voulait triompher comme amant et comme théologien. Si Rome cède, à la bonne heure; si elle s'obstine, et que Henri en cherchant passionnément une femme, trouve par surcroît une tiare, il embrassera la femme d'une étreinte hardie, et ramassera la tiare qu'il rivera au-dessus de sa couronne. Il sera pape et roi. Il aura toutes les délices: le plaisir inextinguible et la domination absolue des âmes.
Catherine d'Aragon aussi brûlait d'impatience. Le cardinal Campeggio, qui souffrait de la goutte, fut reçu le 1er octobre 1528, par le duc de Suffolk. Le 22, il rendit une première visite au roi; le 27, il alla chez la reine avec Wolsey.
Campeggio avait pressé le roi de renoncer au divorce, et ne l'avait pas persuadé. Il insinua le couvent à la reine. C'eût été une solution admirable. Par cela seul, le schisme était conjuré. Catherine était bonne catholique, mais elle était meilleure Espagnole et meilleure mère. Sa fierté et sa tendresse se révoltèrent à la fois. «Non, milords, dit-elle aux deux légats, je ne déshonorerai volontairement ni moi, ni ma fille. J'ai été une fiancée vierge et une épouse pure. Depuis bientôt vingt ans je suis la reine respectée de cette île. Mon mariage s'est formé sous les auspices de Henri VII, mon beau-père, de mon père Ferdinand et de Jules II, le souverain pontife de la catholicité. Ce mariage est donc sacré. Jamais je ne consentirai soit à le rompre, soit à le dénouer; jamais je n'abdiquerai les titres qu'il me confère.»
Puis elle s'adressa particulièrement à Wolsey qu'elle croyait à tort l'instigateur du divorce: «Cardinal d'York, c'est vous que j'accuse.... J'ai été trop franche sur vous. J'ai approuvé Charles mon neveu de ce qu'il n'a pas favorisé vos brigues mondaines pour obtenir les clefs. Je n'ai dissimulé ni votre arrogance, ni vos exactions, ni vos désordres. Vous vous vengez maintenant de moi et de l'empereur. Vous vous vengez trop.» Le cardinal pouvait se justifier; il l'essaya, mais la reine se déroba vivement à des excuses qu'elle tenait pour autant de mensonges.
Le roi se montrait fort aimable. Il caressait Campeggio. Il lui offrit le riche évêché de Durham, et nomma chevalier l'un des fils du cardinal. Directement et indirectement, le roi sollicitait deux choses de Campeggio: une visite à lady Anne Boleyn, comme on l'appelait depuis peu, et la sentence du divorce.
Le rusé cardinal était tout prêt à complaire au roi, seulement il était si incommodé de la goutte, qu'il se voyait obligé d'ajourner toute courtoisie envers Mlle de Boleyn. Quant à la sentence du divorce, il se flattait qu'elle ne serait pas nécessaire.
Il la remettait de semaine en semaine. Henri s'irritait, s'emportait, puis il se calmait, lorsque Clément VII à Rome et Campeggio à Londres, disaient: «Un peu de patience, nous réservons au roi une surprise.» Or, quelle était cette surprise? Ils la laissaient deviner avec la ferme intention de manquer de parole au dernier instant. Le pape épiait l'occasion d'annuler le mariage du roi, et de lui en permettre un autre sans procès. Voilà ce qui leurait Henri. Voilà le mirage qui flottait pour lui à l'horizon, et qui se dissipa enfin.
Ne pouvant parvenir au divorce sans procès, il résolut d'y arriver par le procès. Il somma Wolsey et Campeggio de décider la question du divorce, comme ils y étaient autorisés par la pollicitation du pape, dont la bulle décrétale avait confirmé d'avance le jugement des légats.
Forcés dans les retranchements, inextricables pendant dix mois, de leurs manèges, de leurs stratagèmes et de leurs ambages, ils fixèrent au monastère de BlackFriars, et au 18 juin 1529, le lieu et la date de leurs assises ecclésiastiques.
Une salle fut préparée pour ces augustes et redoutables séances.
Les deux trônes surmontés de leurs dais dominaient tout. A la droite du trône du roi était le fauteuil de Campeggio, et à la droite du trône de la reine, le fauteuil de Wolsey. Les deux cardinaux avaient choisi pour coadjuteurs: Longland, évêque de Lincoln et confesseur du roi; Clerk, évêque de Bath; John Islip, abbé de Westminster, et John Taylor, maître des rôles. Le secrétaire de ce tribunal exceptionnel était Gardiner, et l'appariteur, Cook, un jurisconsulte, un humaniste et un commentateur biblique. Les avocats du roi étaient Trigonel et Peter, John Bell et Richard Sampson. Les conseillers de la reine étaient Warham, Fisher et Standish, trois évêques.
Les simples fauteuils des légats étaient moralement plus élevés que les trônes du roi et de la reine. Car, que représentaient les trônes? des sièges d'accusés ou de parties; et les fauteuils? des sièges de juges.
La cour se fonda dans la première séance. Le confesseur du roi présenta la pollicitation du pape. Campeggio la lut. Cette pollicitation était l'acte constitutif du tribunal des légats. Pleins pouvoirs leur étaient donnés. Mais la bulle décrétale par laquelle Clément VII s'engageait, dans l'hypothèse d'un arrêt de divorce, à casser le premier mariage du roi et à lui en permettre un autre, la bulle décrétale montrée à Wolsey et à Henri, où était-elle? probablement Campeggio l'avait brûlée. Le pape et lui s'étaient raillés du roi et ourdissaient artificieusement, à force de mensonges, de réticences, d'hypocrisies accumulées, une comédie d'intrigue devant l'Europe. Clément VII ne cherchait qu'à endormir et à duper Henri VIII, jusqu'au traité que le saint-père élaborait mystérieusement avec l'empereur.
La cour des légats était un piége flagrant pour Henri. Elle cita le roi et la reine à comparaître dans son enceinte.
La reine se présenta, le 18 juin 1529, et déclina la compétence des légats. Elle se présenta de nouveau le 28 juin. Le roi prit place sur son trône, elle sur le sien et les deux légats occupèrent leurs fauteuils. Les autres assistants étaient soit sur des chaises, soit sur des tabourets, soit debout.
Cook, qui remplissait les fonctions d'appariteur, appela le roi, et le roi répondit: «Me voici.» La reine fut appelée à son tour; elle descendit silencieusement de son trône, et, se rapprochant du trône du roi, elle en monta les degrés. Alors tombant à deux genoux devant Henri, et les mains suppliantes comme la voix, elle dit avec une inexprimable émotion: «Sire, pitié et justice, voilà ce que j'implore. Soyez pour moi, car tous ici sont contre moi. L'un des légats est votre chancelier, l'autre votre évêque de Salisbury. Je ne suis qu'une femme, seule, sans parents, sans amis, sur une terre étrangère. Je n'ai d'autre protecteur que vous. En quoi, monseigneur, ai-je pu vous offenser? Depuis plus de vingt ans j'ai presque oublié Dieu et ses saints, tant j'ai été absorbée en vous. Je n'ai mis aucune borne à ma tendresse, à mes complaisances. Vous avez eu de moi plusieurs enfants. Quand j'entrai dans votre couche, j'étais vierge, vous le savez, et je suis restée pure. Comment ose-t-on attenter à un mariage cimenté par votre père Henri VII, par mon père Ferdinand le Catholique et par le pape Jules II, de glorieuse mémoire? Nul n'a le droit de briser les liens qui nous unissent. Les légats sont mes ennemis, je les récuse. Sire, je ne veux que vous pour juge. Ah! soyez miséricordieux. Rendez-moi mes droits anciens, mes droits sur votre cœur, mes droits d'épouse, de reine et de mère. Si vous m'abandonnez, Sire, je n'aurai plus que Dieu. Ah! mon Seigneur, mon bien aimé Henri, pitié pour votre compagne fidèle, pitié et justice!»
Un frisson d'intérêt agita l'assemblée. L'impression produite par ces paroles fut électrique d'abord, mais Henri se taisant, cet auditoire de flatteurs se glaça peu à peu. La reine se releva tout éperdue de douleur, salua le roi, et, s'appuyant sur le bras de Griffith, un officier de sa maison: «Retirons-nous, dit-elle, mon cher Griffith, il n'y a pas ici d'équité.» Le trône de la reine demeura vide.
Le roi fut impassible. Il fit l'éloge de Catherine, rendit hommage à ses vertus, et déclara que sa conscience éveillée par de saints évêques l'avait jeté dans ces procédures. «Le Lévitique, ajouta-t-il, défend le mariage entre un frère et la femme de son frère. J'ai commis ce péché. Le même Lévitique menace de mort les enfants qui naîtront d'un tel mariage. Hélas! j'ai subi ce malheur. Tous les enfants hors un que m'a donnés Catherine, je les ai perdus. C'est que la loi de Dieu a été violée par mon mariage. Elle sera réhabilitée par mon divorce. Quelle que soit d'ailleurs la sentence de la cour, je m'y soumettrai.»
Les débats s'ouvrirent contre la reine, qui fut reconnue contumace. Les avocats du roi démontrèrent avec facilité que le mariage avait été consommé entre Catherine et Arthur, frère aîné de Henri. Comment ne pas admettre cette évidence? Catherine et Arthur avaient à l'époque de leurs noces quinze ans accomplis. Ils n'avaient eu qu'un toit et souvent qu'un lit pendant quatre mois, au château de Ludlow, dans le comté de Shrop. Il était naïf à la reine et à ses partisans de soutenir qu'elle était restée vierge; il était grossier et sauvage au roi de prouver le contraire. C'est cependant ce qu'il fit. Car plus son mariage serait déclaré incestueux, plus le divorce paraîtrait indispensable.
Il manda donc des témoins qui affirmèrent la co-habitation du prince Arthur et de Catherine. Robert, vicomte de Fitz-Water, Thomas, duc de Norfolk, et le chevalier Antoine Willoughby déposèrent avec serment que le lendemain des noces, le prince Arthur leur avait dit: «Milords, j'ai été cette nuit tout à travers l'Espagne.» Ni le roi, ni les évêques, ni les avocats ne respectèrent aucune bienséance. Henri dévoilait les mystères du premier lit nuptial de sa femme pour la chasser du second. Il s'obstinait à s'en délivrer à tout prix.
Il importait au roi que le divorce fût prononcé en Angleterre par le tribunal des légats et confirmé par le pape, selon sa pollicitation et sa bulle décrétale. Rien n'aurait désolé Henri comme un appel de Catherine au souverain pontife, puisque cet appel aurait aidé les fourberies de Clément VII en lui suggérant d'évoquer la cause à Rome.
Dans de telles conjonctures, il était urgent de déterminer Catherine à se confier de tout au roi. Henri ordonna impérieusement par Thomas Boleyn à Wolsey d'incliner la reine à cette résolution.
Wolsey obéit. Il se rendit par la Tamise avec Campeggio à Bridewell, résidence de Catherine. La pauvre reine était entourée de ses filles d'honneur. Elles brodaient, faisaient de la tapisserie et causaient tout ensemble. La reine filait, selon sa coutume. On lui annonça les cardinaux. «Que voulez-vous, milords,» leur dit-elle, en les rejoignant dans le salon d'attente. «Entretenir un instant Votre Altesse dans son oratoire,» répondirent les légats. Catherine avait passé la quenouille et le fuseau à l'une de ses filles. Elle avait les mains libres. Elle présenta la droite à Campeggio, la gauche à Wolsey et elle les introduisit, suivant leur vœu, dans son oratoire.
Quand ils sortirent tous trois, les filles de la reine remarquèrent sur leurs visages des traces profondes d'émotion. La reine avait beaucoup pleuré. Campeggio était triomphant et Wolsey soucieux, abattu. La reine leur avait appris, au milieu des larmes, des soupirs et des sanglots, qu'elle avait envoyé déjà au Vatican sous un pli fermé de son sceau et par un de ses gentilshommes son appel au pape.
Assuré de cet appel, certain par Campana, l'un des secrétaires de Clément VII, que le saint-père venait de conclure un traité avec Charles-Quint, Campeggio escamota le jugement des légats en ajournant dérisoirement le procès au 1er octobre. C'était le 23 juillet. Les avocats réclamèrent en vain, malgré leur véhémence, l'arrêt des légats. Wolsey était accablé, Campeggio inébranlable. Le roi, caché dans une pièce voisine, entrevoyait tout et entendait tout. Il s'efforçait de se contenir, mais sa figure bouleversée et ses brusques mouvements trahissaient sa fureur. Ceux qui le connaissaient comprirent que Wolsey était perdu, que Campeggio serait outragé et le pape vomi. La physionomie de Henri VIII fut pendant toute une semaine farouche et tragique. Il dissimulait pourtant de son mieux.
Sa rage intérieure excitée par l'appel de Catherine, par la perfidie de Wolsey, par l'audace de Campeggio, redoubla aux nouvelles de Rome.
Le pape avait conclu son traité avec Charles-Quint. L'empereur avait signé ce traité à Barcelone, le 29 juin 1529. Il y avait une clause secrète par laquelle Charles renonçait à poursuivre devant un concile la déposition de Clément VII pour raison de bâtardise. L'empereur restituait au saint-père Ravenne, Cervia, Modène et Reggio. D'autres avantages étaient encore stipulés. Le plus grand de tous aux yeux du pontife était la réintégration de la maison de Médicis dans le gouvernement de Ferrare.
Le bâtard de cette maison la relèverait de l'abaissement. Clément VII ne pouvait payer assez cher un tel honneur. Il risqua le schisme d'Angleterre sans balancer. Il lança dans le monde catholique sa bulle d'évocation qui, en déracinant le tribunal des légats, violait, par le pape, la pollicitation et la bulle décrétale émanées du pape. Henri VIII était bafoué. Il s'en souviendra.
Si Clément VII eût sauvegardé l'inviolabilité du mariage, au nom du principe évangélique et de la morale de l'Église, cette noble inflexibilité eût racheté même le dommage d'un schisme en pleine éclosion. Mais il n'en fut pas ainsi. Tels furent les démentis que se donna le pontife, ses circuits, ses embûches, ses lâchetés, qu'il n'eut guère sur le roi, en cette circonstance, que la supériorité d'un fourbe sur une dupe. Les légats aussi eurent bien des astuces, Henri bien des duplicités, de sorte qu'il serait difficile de dire quel vêtement, dans cette longue négociation, recouvrit plus de trahisons et de vices, de la tunique blanche du pape, de la robe rouge des cardinaux, ou du manteau d'hermine du roi!
Henri VIII ne fit pas d'abord explosion. Mais il était ulcéré contre Catherine qui s'opiniâtrait à demeurer reine d'Angleterre, et contre Wolsey qui avait misérablement louvoyé entre Rome et Greenwich. Le roi était exaspéré aussi contre Campeggio et contre le pape. Il ne se gênait pas dans l'expression de son mépris. Les ducs de Norfolk et de Suffolk, le vicomte de Rochefort fomentaient les colères du roi. Lady Anne exaltait l'ambition pontificale de Henri. Elle lui montrait une tiare anglaise en perspective. «Le pape n'est qu'un évêque, l'évêque de Rome,» disait-elle. «Oui, répondait Henri, Clément n'est qu'un évêque et un évêque ignorant. Il est de plus un bâtard, un charlatan et un parjure.»
Wolsey cependant vivait dans une tempête. Ses ennemis avaient hâte d'en finir avec lui. Anne «l'oiseau de nuit» chantait à l'oreille du roi contre le cardinal une chanson de mort. Elle était bien dangereuse: car elle était toute-puissante. Les courtisans s'inclinaient devant lady Anne comme devant une reine et un premier ministre. Wolsey qui l'avait combattue dans l'ombre, qui l'enviait en favori, qui la haïssait comme son mauvais génie, elle allait le précipiter. Elle lui rendait guerre pour guerre. Les grands seigneurs de la cour, Norfolk et Suffolk en tête, poussaient lady Anne. Wolsey était un obstacle à leurs rapines. Ils s'adjugeaient, après sa chute, les propriétés des monastères. «La fantaisie de ces milords, écrit du Bellay, est, que le cardinal mort ou ruiné, ils déferont incontinent l'Estat de l'Église, et prendront tous ses biens. Ils le crient en pleine table.»
Les rancunes du roi contre Wolsey qui n'avait pas été net avec Rome, correspondaient à l'animosité des lords contre le cardinal.
Henri, qui avait besoin de se distraire, fit un petit voyage avec une partie de sa cour et avec sa maîtresse dans le Northampton-shire. Il s'y installa à sa résidence de Grafton. Cette résidence plaisait au roi, qui avait là ses plus beaux haras et ses plus riches forêts. Mlle de Boleyn était très-friande des cerises de ce comté, les meilleures d'Angleterre. Quand elle ne pouvait plus les manger sur l'arbre, elle les mangeait en conserves. Aujourd'hui encore le pays est planté de cerisiers, mais il a moins de bois. Ces bois sont en grande partie remplacés par des pâturages. Je connais un de ces pacages, le plus grand de tous, appelé Peterboroughfen où plus de trente communes nourrissent leurs troupeaux de moutons et leurs vaches grasses.
Le comté de Northampton est encore féodal. Il l'était beaucoup plus, lorsqu'au mois de septembre 1529, Henri VIII s'y établit avec sa maîtresse, dans sa maison de chasse de Grafton.
Il paraît que le roi avait dès lors en sa possession une lettre de Wolsey soit au pape, soit à un prélat italien, par laquelle le cardinal légat conseillait la bulle d'évocation. Cette lettre que Henri ne pouvait pardonner à son ancien favori, il l'avait serrée précieusement dans son pourpoint et ne l'avait pas même confiée à lady Anne. Il attendait l'occasion d'en écraser le cardinal. Elle se présenta naturellement à Grafton où Wolsey avait suivi la cour. Le soir de son arrivée, comme le cardinal saluait le roi dans la chambre de parade, Henri l'attira à l'écart, sous la tenture d'une fenêtre. Un dialogue s'engagea entre eux. Wolsey baissait les yeux et répondait timidement aux questions amères du roi. Soudain le roi s'animant, tira de son sein un papier qu'il déplia et qu'il secoua convulsivement devant la face pâle du chancelier. «Lisez, lisez, disait Henri, est-ce bien votre écriture?» Le cardinal balbutiant et tremblant, le roi se calma un peu, et déroba Wolsey aux regards avides des courtisans. Il l'emmena dans son cabinet où la conversation continua. Le cardinal essaya-t-il de nier? Henri, soit doute, soit commisération, remit la justification au lendemain. Le chancelier rentra dans la chambre de parade où, par la dignité de son maintien et par la sérénité de sa physionomie, il dérouta les curiosités. Toutefois ses ennemis ne furent pas longtemps dans l'anxiété. Le duc de Suffolk, aïeul de Jane Grey, beau-frère du roi et grand maître du palais, fit dire au cardinal, qu'il n'y avait pas d'appartement pour lui au château. Wolsey fut atterré. La nuit était noire et orageuse. Il fut obligé de remonter sur sa mule et d'aller s'abriter à plus d'une lieue de Grafton dans la maison d'un ami.
Le lendemain, lorsqu'il vint au château, le roi partait pour la chasse. De la selle de son cheval, Henri dit au cardinal, s'il avait à lui parler, de s'entendre avec ses ministres. Il l'invita cruellement à ne pas l'attendre et à ne pas quitter le légat Campeggio, qui avait pris congé. Le roi s'enfonça ensuite dans les hautes futaies, accompagné de lady Anne et d'une troupe de joyeux chasseurs. Il dîna à Harewell-Park, et ne revint que fort tard au château pour être certain de n'y plus trouver Wolsey. Le chancelier s'était éloigné, en effet, le cœur brisé, en compagnie de son collègue le cardinal Campeggio.
C'est à ce moment précurseur du schisme que je découvre pour la première fois sous les voûtes de Waltham-Abbey un homme encore obscur, mais qui exercera une influence prodigieuse. Cet homme est le docteur Cranmer.
Il était né dans le comté de Nottingham à Aslacton. Son nom était ancien, sa famille illustre. Son père, retiré dans un manoir modeste, était aimé du peuple et fort considéré de la noblesse. Il avait soigné l'éducation de son fils.
Le jeune Cranmer se distingua bientôt à Cambridge. Un mariage d'amour, que la mort trancha vite, ne fut pas un long obstacle à sa carrière ecclésiastique. Oxford et Cambridge se le disputèrent. Il opta pour Cambridge, où il reçut le grade de docteur.
Cranmer avait une âme élevée, un esprit lumineux, le goût de la vérité et le talent de la controverse. Il était très-savant. Il haïssait le moyen âge. Il était révolutionnaire, sans le vouloir, par une pente naturelle de son intelligence. Il croyait que son devoir envers Dieu était de substituer le bon sens et l'Écriture sainte à la scolastique et aux traditions. En 1529, il avait quarante ans. Réfugié, loin de la peste qui dévastait Cambridge, à Waltham-Abbey, chez sir Cressy, ami de son père, il instruisait les enfants de son hôte, et payait ainsi une hospitalité passagère.
Gardiner et Fox, qui visitèrent sir Cressy après que Wolsey eut quitté Grafton, rencontrèrent le docteur Cranmer au château. Il y était traité en égal, presque en supérieur. Ses belles manières, son attitude fière et modeste, son tact exquis annonçaient sa condition. L'insinuation et la justesse de sa parole révélaient un initiateur. C'était un gentilhomme sacerdotal. Il avait lu les novateurs allemands et suisses. Il admirait Luther, et il devait le dépasser en hardiesse sur la grande question de la présence réelle; mais il s'enveloppait de prudence, et il voilait l'audace du fond sous les convenances de la forme. Le moine de Wittemberg, au contraire, rachetait parfois ses timidités de doctrine par les éclats et les fougues d'une téméraire éloquence.
Fox et Gardiner prirent un singulier plaisir à causer de toutes choses, à Waltham-Abbey, avec Cranmer. Un jour, à dîner, ils déroulèrent toutes les difficultés que suscitait au roi le divorce qu'il poursuivait à Rome contre Catherine d'Aragon.
Cranmer, d'abord silencieux, se laissa entraîner à la logique de ses idées. Il dit sans effort le mot de la situation. Gardiner et Fox furent éblouis.
«Comment pouvez-vous être embarrassés? D'un côté, le Lévitique, la loi divine qui condamne le mariage du roi; d'un autre côté, Jules II qui l'a permis, Clément VII qui le maintient. Ici la Bible, là le pape! N'est-ce pas la Bible qui doit l'emporter?
—Et qui, reprit Fox, prononcera entre la Bible, le livre sacré, et le pape, le chef de l'Église visible?
—Qui? s'écria Cranmer, plein déjà du principe vital de la Réforme; qui? le premier chrétien venu, armé du texte souverain. Dans cette grande cause du roi et du pontife, si la conviction individuelle ne suffit pas, pourquoi ne pas consulter toutes les universités de l'Europe? Leur science biblique ferait bientôt fléchir l'autorité très-faillible du pape.»
Gardiner et Fox, le lendemain, rejoignirent la cour. Ils racontèrent au roi leur bonne fortune à Waltham-Abbey. Gardiner avait tenté de donner l'expédient comme de lui et de s'en attribuer l'honneur, mais Fox ne le souffrit pas; il ne consentit pas à omettre Cranmer. Henri VIII fut pénétré de joie.
«Ah! docteur Cranmer, docteur Cranmer, dit-il, de quel labyrinthe vous avez le fil? Oui, nous interrogerons les universités. Je vaincrai par là. Cette fois, je tiens Rome! je tiens la truie par l'oreille.»
Le roi manda aussitôt Cranmer, qui répéta ses arguments et qui réitéra son conseil. «C'est bien, c'est bien, dit Henri; mais il faut écrire ces bonnes preuves.» Et s'adressant au vicomte de Rochefort, qui était là: «Emmenez le docteur Cranmer, ayez soin de lui et qu'il ne manque de rien. Installez-le dans votre hôtel à Durham-House, sous le toit de lady Anne, et qu'il compose là un traité sur la nécessité de mon divorce, sur sa légitimité, autant que sur l'opportunité de consulter à cet égard les universités, soit anglaises, soit étrangères.» Cranmer ne recula point; il était d'un siècle qui avait une séve vigoureuse, d'un siècle héroïque et inventeur, d'un siècle antiromain, du siècle des penseurs et des novateurs.
Machiavel avait écrit (1516) ces lignes froidement implacables et mathématiquement prophétiques, à la veille de la Réforme de Luther:
«On ne peut donner une plus forte démonstration de la décadence de Rome et de sa chute prochaine, que de voir les peuples les plus voisins de la capitale de l'Église d'autant moins religieux qu'ils en sont plus près.
«Puisque certaines personnes estiment que la prospérité de l'Italie dépend de l'Église de Rome, qu'il me soit permis d'apporter contre cette opinion quelques raisons, dont deux, entre autres, me paraissent sans réplique. Je soutiens d'abord que le mauvais exemple de cette cour a détruit en Italie tout sentiment de piété. C'est le premier service qu'elle nous a rendu; mais elle nous en a rendu un plus grand qui entraînera la ruine de l'Italie: elle nous a toujours maintenus divisés.
«Un pays ne peut véritablement prospérer que lorsqu'il n'obéit en entier qu'à un seul gouvernement, soit monarchie, soit république. Telle est la France, telle est l'Espagne. Si le gouvernement de toute l'Italie n'est pas ainsi organisé, c'est à l'Église seule que nous en sommes redevables.... N'ayant jamais été assez puissante pour s'emparer de toute l'Italie et n'ayant pas souffert qu'un autre l'occupât, l'Église a été cause que ce pays n'a pu se réunir sous un chef de gouvernement; il a été divisé entre plusieurs petits princes et seigneurs. De là son fractionnement et sa faiblesse, qui l'ont livré en proie non-seulement à des étrangers puissants, mais à quiconque l'a attaqué.
«Or, tout cela, c'est à la cour de Rome que nous le devons.» (Discours sur Tite-Live, t. II, p. 445-446.)
Voilà ce que démêlait Machiavel avec l'infaillibilité de son coup d'œil d'aigle italien, et voici ce que criait Luther du fond de son tourbillon germanique.
Il appelle le pape «monstre papalin.» «Le pape, dit-il, est une tête d'âne qui ne saurait être la tête de l'Église; car l'Église est un corps spirituel qui ne peut ni ne doit avoir de tête officielle. Christ seul est le seigneur et le chef de l'Église.»
Il écrit au pape Adrien (1523): «Je suis fâché de donner de si bon allemand contre ce pitoyable latin de cuisine dont vous faites usage.»
Il répond au pape Clément, qui annonçait dans deux bulles un jubilé pour 1525: «Cher pape Clément, toute ta clémence ne te sera comptée. Nous n'achèterons plus d'indulgences. Chères bulles, retournez à Rome d'où vous venez; faites-vous payer par les Italiens. Qui vous connaît ne vous achète plus. Nous savons, Dieu merci, que ceux qui croient le saint Évangile ont à toute heure un jubilé. Bon pape, qu'avons-nous affaire de tes bulles? Épargne le plomb et le parchemin; cela est désormais d'un mauvais rapport.» (Luth., Werke IX, p. 204.)
Le réformateur disait du pape Jules II: «C'était un diable incarné,» et du pape Clément VII: «Il n'y a jamais eu de plus rusé trompeur sur la terre que ce pape-là.»
Érasme disait à son tour de Luther: «Il est insatiable d'injures et de violences; c'est un Oreste furieux.» A quoi Luther répliquait: «La colère m'est bonne; je ne sais si de sang-froid je pourrais aussi bien dire. Dans la colère, mon tempérament se retrempe, et toutes les tentations, tous les ennuis se dissipent. Je n'écris et ne parle jamais mieux qu'en colère.»
La papauté chancelait donc sous les assauts redoublés de l'intelligence moderne, lorsque le docteur Cranmer (1529) attira Henri VIII dans le courant électrique des temps. Henri ne doit pas être confondu néanmoins avec les philosophes et les protestants qui résistaient au nom de leurs lumières ou de leur conscience, car lui ne résista qu'au nom de ses voluptueux caprices aiguisés de scrupules. C'est ce qui justifie les réformés de ne le pas reconnaître pour un des leurs. Il n'est guère à leurs yeux qu'un «catholique révolté.»
Il a été le tyran de l'Église anglicane; c'est Cranmer qui en fut le père, le fondateur.
Moins indifférent que Machiavel, moins impétueux que Luther, le docteur Cranmer condamnait comme l'un la papauté temporelle, et comme l'autre la papauté spirituelle, mais il n'insultait pas. L'ardeur du théologien s'alliait chez lui avec la courtoisie du gentilhomme. Il sera un réformateur de cour. Aussi s'empressa-t-il d'obéir aux ordres du roi, qui correspondaient en lui à une conviction. Il accepta un appartement à Durham-House, chez le vicomte de Rochefort, père d'Anne Boleyn. Il devint l'hôte, l'ami, le chapelain de cette maison. Il faisait de petits séjours à Waltham-Abbey, dans la demeure de sir Cressy. C'est sous ces deux toits qu'inspiré tour à tour par les conversations de lady Anne et par le recueillement de la solitude, il préparait savamment le schisme de l'Angleterre et le divorce de Henri VIII. Pendant qu'il travaillait ainsi à la ville et à la campagne, il entendit de ses retraites l'écroulement de Wolsey.