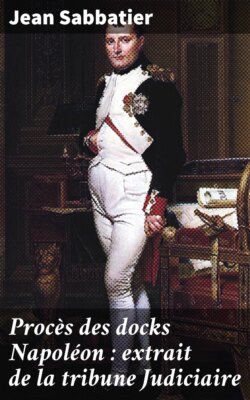Читать книгу Procès des docks Napoléon : extrait de la tribune Judiciaire - Jean Sabbatier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTERROGATOIRE DES PRÉVENUS.
ОглавлениеTable des matières
CUSIN, 49 ans, ancien banquier, détenu.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous étiez banquier à Paris lorsque, le 17 septembre 1852, parut le décret qui vous accordait, à vous et à vos associés, la concession des Docks; vous étiez antérieurement à la tête, en qualité de banquier, de la Compagnie financière qui avait pour titre l’Union commerciale ?
CUSIN. — Oui, M. le président.
D. A quelle époque a été formée la Compagnie de l’Union commerciale?
R. En 1846.
D. Quel était son capital?
R. 3 millions réduits ensuite à 2 millions.
D. Dans quelle position pécuniaire était l’Union commerciale en 1852, au moment où la Société des Docks a été organisée?
R. Dans une situation très convenable, très satisfaisante.
D. Il résulte de l’examen auquel on s’est livré dans l’instruction que cette Compagnie devait être fondée par vous et par Legendre au capital de 12 millions, sur lesquels 3 millions étaient exigés pour la constitution de la Société, et que 2 millions seulement auraient été réalisés; que ces 2 millions formaient tout l’actif de la Société qui a fonctionné depuis 1845 jusqu’en 1849 avec un capital fictif?
R. La situation était extrêmement difficile à cette époque. Dès le mois de janvier 1846, la Banque avait haussé son escompte, qui avait été jusque-là de 4 pour 100, et c’était la première fois qu’un pareil fait se produisait.
Notre Société n’a pas été créée par un appel au public, elle a été en quelque sorte fondée en famille. Nos relations avaient amené non pas des promesses de souscriptions, comme cela se pratique dans toutes les Sociétés, mais des engagements verbaux en grand nombre. Quand est arrivé le mois d’août, la récolte ayant été peu abondante, tel qui devait prendre 15,000 francs d’actions n’en a pris que pour 10,000 francs. La situation des affaires a empiré de plus en plus, l’hiver de 1847 a été plus mauvais que celui de 1846, et enfin la révolution de février est arrivée. Cependant nous étions soutenus par l’espoir que ceux qui avaient pris des engagements verbaux les tiendraient; nous avons pu réunir une somme assez importante, et nous nous sommes empressés de la mettre à la disposition du commerce.
D. Nous vous parlons de ce fait parce qu’il a une certaine importance. En 1846, vous fondez une maison de banque qui devait avoir 3 millions de capital, et vous vous déclarez constitués avec 2 millions. C’est là une irrégularité qui ne doit pas tarder à se reproduire dans une autre Société d’une manière bien autrement grave. Veuillez préciser quelle était, au mois de septembre 1852, la situation de l’Union commerciale. Le capital de 2 millions avec lequel elle fonctionnait était-il disponible, pouvait-il s’appliquer à de grandes entreprises? N’était-il pas, au contraire, considérablement diminué par des dépenses préalables?
R. Il était liquide.
D. Il résulte du rapport de l’expert que votre gestion avait été imprudente, que vous aviez immobilisé la plus grande partie du capital qui vous avait été confié, et qu’au moment où les Docks ont commencé, votre fonds de roulement n’était que de 320,000 francs, ce qui réduisait l’importance de votre maison à de très faibles proportions?
R. Je dois faire observer que les maisons de banque ne peuvent pas conserver leur capital liquide. Une opération s’engage, elle peut durer deux ou trois mois, et on ne trouve pas toujours des fonds de roulement disponibles. Cela arrive dans toutes les grandes entreprises, où les premiers capitaux engagés en entraînent d’autres, si l’on ne veut pas s’exposer à les perdre. En 1849 et 1850, c’est-à-dire à une époque rapprochée de septembre 1852, nous nous étions engagés dans des opérations considérables en Espagne.
D. Et dans plusieurs autres, à Paris, qui absorbaient 15 ou 16,000,000 francs de votre capital. — Un autre fait au point de vue de l’Union commerciale : Vous étiez astreint à verser 250,000 francs, ainsi que votre coassocié Legendre, pour le montant d’actions qui devaient rester comme garantie de votre gestion. Vous n’aviez pas ces 250,000 francs, vous les avez empruntés et versés comme vos propres capitaux, puis vous les avez remboursés avec l’argent provenant de la caisse. Vous amoindrissiez de cette manière le capital social dans la proportion de 500,000 francs?
R. J’ai trouvé à emprunter 250,000 francs qui me manquaient. Évidemment, quand je me suis associé avec M. Legendre, je ne prévoyais pas que la révolution de février viendrait entraver les précautions que j’avais prises pour mon remboursement, qui était échelonné de six mois en six mois. La maison que nous prenions gagnait de 100 à 120,000 francs par an, je pouvais donc rembourser facilement. La révolution arrive, les époques de mes remboursements sont reculées, mais ils s’opèrent.
D. Je sais bien que les 250,000 francs ont été remboursés, mais avec l’argent des actionnaires; et la preuve que ce n’est pas avec vos propres ressources, c’est que vous avez fait chaque année des prélèvements considérables sur la caisse. Ces prélèvements se sont élevés, pour vous et pour vos quatre coaccusés, à une somme de plus de onze cent mille francs, dont vous êtes tous débiteurs envers la Compagnie des Docks. Au surplus, ce ne sont là que des observations préliminaires, et le débat éclaircira tous ces points, que je ne fais qu’indiquer en passant.
C’est donc le 17 septembre 1852 que vous avez obtenu le décret de concession des Docks. Pour la mise à exécution de ce décret, vous avez formé une Société en commandite qui devait être plus tard convertie en Société anonyme. L’acte de cette Société est à la date du 12 octobre 1852, le capital social était fixé à 50 millions, divisés en 200,000 actions de 250 fr. J’appelle votre attention sur les articles 6 et 7 des statuts:
«Le fonds social est fixé à la somme de 50 millions de francs, divisés en
» 200,000 actions de 250 francs chacune. La Société ne sera constituée que par la
» souscription de la totalité des actions. Le montant des actions sera payable
» moitié en souscrivant, l’autre moitié au fur et à mesure des besoins.»
C’étaient là les dispositions fondamentales des statuts, et vous y avez contrevenu. Vous avez ouvert, à partir du 12 octobre, la souscription dans vos bureaux; il vous est arrivé un grand nombre de demandes d’actions. Il résulte du rapport de l’expert, et des recherches très longues et très consciencieuses auxquelles il s’est livré, que vous auriez reçu des lettres de demande pour 225,000 actions. Vous rappelez-vous cela? R. Parfaitement.
D. Ce chiffre ne vous a pas paru suffisant; lorsque vous vous êtes présenté devant votre Conseil de surveillance, vous lui avez déclaré que le nombre des demandes n’était pas de 225,000, mais de 318,000. Vous avez même produit un état constatant ce chiffre de 318,000. Vous êtes allé plus loin encore: vous avez déclaré que le chiffre des demandes s’était élevé à 870,366, représentant une somme de plus de 200 millions. Vous appelez-vous ce fait?
R. Pas du tout.
D. Nous vous en donnerons la preuve dans le cours des débats; nous vous représenterons la pièce dans laquelle se trouve cette énonciation. Ceci est grave, parce que cela prouve qu’au début de l’affaire vous n’étiez déjà plus dans le vrai. Vous avez reçu des lettres par lesquelles on vous demande 225,000 actions, et vous produisez les états portant qu’on vous en demande 318,000; et puis, dans une déclaration verbale, vous enflez considérablement ce chiffre, vous le portez à 870,366?
R. Les états dont l’expert a parlé ont été faits dans les bureaux. Ce n’est pas sur ces états que les attributions des actions ont été faites, c’est sur les lettres. L’expert a pu se tromper; il s’est trompé. Il est évident que, dans les états qu’ils ont dressés, les employés n’ont voulu faire qu’une évaluation du chiffre des actions demandées, et je n’ai jamais fait valoir ceci que comme considération morale. Quand j’ai dit qu’il y avait eu plus de demandes que d’actions émises, je n’ai dit qu’une chose parfaitement vraie.
D. Vous précisiez des chiffres, vous disiez: J’ai 870,000 demandes, il ne m’en faut que 200,000.
R. Où ai-je dit cela?
D. Dans votre rapport au Conseil de surveillance, à la date du 27 novembre 1852, c’est-à-dire à une époque très rapprochée de la constitution de la Société, et voici ce que j’y lis:
«Cependant sans avoir fait un seul appel aux capitaux, le public avait accueilli
» ce projet avec un empressement qu’on aurait difficilement compris si le nom du
» Prince qui patronnait notre entreprise n’en justifiait et n’en expliquait pas la
» vivacité. Plus de deux cents millions de demandes nous ont été adressées et ont
» répondu victorieusement aux détracteurs de cette opération.»
Voilà un rapport fait par vous, qui concorde avec ce qu’a dit l’expert lorsqu’il a déclaré que vous aviez porté le chiffre des demandes à plus de 870,000; il est évident qu’il a trouvé ce chiffre quelque part. Au surplus, nous entendrons, l’expert. Ainsi, dès le début, vous trompez le Conseil de surveillance, vous trompez le public, vous entrez dans une. voie mauvaise, dans celle du mensonge, même dans celle du faux, car dans un état destiné à constater le nombre des demandes d’actions, des chiffres ont été grattés ou ajoutés. Quelqu’un vous demandait-il 100 actions, vous ajoutiez un zéro, ce qui faisait 1,000 au lieu de 100.
R. Ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées... L’assemblée du Conseil dont vous parlez eut lieu le 28 novembre 1852, et l’attribution des actions avait été faite le 9 ou le 10 octobre, pendant que M. Legendre était à Londres.
D. Ne confondons pas: ce n’est pas sur la réunion du Conseil ni sur l’attribution des actions que je provoque votre attention en ce moment; c’est sur le grattage des chiffres de l’état, grattage fait dans le but de tromper le Conseil et le public, et de prouver que les nombres que vous accusiez étaient réels. Si alors vous aviez produit des lettres de demandes d’actions dont le nombre était bien suffisant, puisqu’il s’appliquait à 225,000 actions, il n’y aurait pas eu fraude; mais vous vouliez donner à l’affaire une importance plus considérable. Vous disiez près de 800,000 quand le chiffre réel n’était que 220,005, et pour en justifier aux yeux du Conseil de surveillance, vous n’hésitiez pas à recourir au moyen du grattage.
R. J’affirme que je n’ai jamais produit au Conseil ni lettres ni état, que l’état dont vous parlez n’a jamais été un titre quelconque pour établir le chiffre des demandes.
D. Les lettres ont été retrouvées, elles sont parmi les pièces de conviction; elles pourront vous être représentées dans le cours des débats. Ce qui résulte de ceci, c’est que des erreurs très volontaires ont été commises par vous; c’est que des chiffres mensongers ont été mis à la place des chiffres vrais, et que par conséquent vous étiez, dès le début, sorti de la vérité.
Maintenant nous allons rencontrer le même système d’erreurs et de mensonges en ce qui touche l’attribution des actions. Pour la souscription, vous aviez un délai extrêmement court. La souscription avait été ouverte dans les bureaux le 12 octobre et fermée le 20: quel chiffre de demandes avez-vous admis dans cet intervalle?
R. Je ne me rappelle pas au juste, de 100 à 120,000.
D. Vous en avez délivré 85,000.
R. Il n’a été versé effectivement dans la caisse que le montant de 85,000 actions; mais il est établi dans le rapport qu’un certain nombre de lettres avaient été rachetées, ce qui porte le chiffre des actions attribuées à 100,000 environ.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — A 101,867.
M, LE PRÉSIDENT (à Cusin). — Toujours est-il que, dans les mois d’octobre et de novembre, vous aviez encaissé une somme qui s’élevait à 10 ou 11,000,000 francs. Vous vous rappelez ce fait. Vous aviez 10 ou 11,000,000 francs dans votre caisse. Aviez-vous pris soin de créer une caisse particulière pour recevoir ces valeurs si considérables?
R. Non, M. le président, la sortie des espèces ne devait pas tarder, puisque les terrains achetés devaient se payer comptant,
D. C’étaient là des sommes très considérables. Il s’agissait d’une Société qui se fondait, et dont la durée devait être longue. Il semble que vous auriez dû pourvoir à la création d’une caisse particulière, au lieu de déposer de telles sommes dans la caisse de l’Union commerciale; vous ne l’avez pas fait. Enfin, vous aviez en caisse de 10 à 11 millions. Le 28 novembre, dans cette assemblée du Conseil dont nous parlions tout à l’heure, un membre vous demande quelle est la somme encaissée, et vous répondez de la manière la plus affirmative: 17 millions! Vous rappelez-vous ce fait?
R. Il y avait d’une part les lettres qui avaient été rachetées, de l’autre les démarches que faisait à Londres M. Legendre pour obtenir une souscription dont il n’a été rien dit, celle de la maison Ricardo, qui a manqué par le fait de notre volonté. Quand M. Legendre est revenu de Londres et que j’ai vu l’impossibilité d’accepter les conditions des capitalistes anglais, je me suis tourné, d’accord avec ces messieurs, vers M. Riant, qui, nous ayant vendu des terrains pour des sommes considérables, me paraissait dans des conditions tout à fait bonnes pour prendre un certain nombre d’actions. Les pourparlers ont duré quelque temps; M. Riant n’a dit non que quelque temps après: M. Legendre était retourné à Londres. C’est ainsi que, d’accord avec mes collègues, j’ai pu accuser le chiffre que vous relevez, en pensant que M. Riant, qui nous avait vendu des terrains pour 9 millions, prendrait des actions pour le tiers de cette somme.
D. Le point sur lequel j’appelle votre attention est celui-ci: Comment se fait-il que, n’ayant placé à cette époque que 86,000 actions, ce qui faisait de 10 à 11 millions, vous ayez déclaré au Conseil que vous aviez 17 millions en caisse?
R. J’ai déjà répondu. Nous étions dans des termes tels avec M. Riant, que nous ne doutions pas qu’il ne nous consolât, en prenant des actions pour une somme importante, des chagrins que nous avions éprouvés en rejetant l’inacceptable proposition des Anglais.
D. Vous n’aviez pas pu, à cette époque, recevoir l’assurance que la Compagnie de Londres à laquelle vous vous étiez adressé vous prêterait l’appui de ses capitaux?
R. Ce n’est pas la Compagnie de Londres qui a refusé l’opération, c’est nous.
D. Ainsi vous ne deviez pas considérer sa souscription, très éventuelle, comme devant se réaliser. Comment parliez-vous donc de 17 millions?
R. J’ai eu l’honneur de vous répondre que nous comptions sur M. Riant pour 5 ou 6 millions d’actions.
D. Nous entendrons M. Riant. En attendant, c’est de la sorte que vous expliquez que, n’ayant que 10 millions, vous en annonciez 17?
R. Oui, M. le Président.
D. C’est un tort grave; il était plus simple de dire au Conseil de surveillance : Nous avons 10 milllions en caisse, nous espérons, au moyen de souscriptions que nous avons en vue, porter ce chiffre à 17 millions. C’eût été beaucoup mieux, vous auriez été dans le vrai, et vous ne vous seriez pas exposé au reproche d’avoir trompé le Conseil. Ce n’est pas tout. Vous avez écrit le 14 janvier au Ministre du commerce que vous aviez, non pas 10, non pas 17, mais 25 millions en caisse. Voici les termes de votre lettre:
«Nous avons fondé une Société anonyme au capital de cinquante millions, et
» dès le 20 octobre dernier, la souscription était close, la moitié du capital social
» exigible était versée. Dès lors commençait pour nous une responsabilité dont
» nous avons mesuré l’étendue et que nous n’avons pas un instant déclinée.»
R. Ma réponse sera bien simple, et j’espère qu’elle jettera la lumière sur ce point du débat. Nous étions allé voir M. le comte de Persigny, alors ministre du commerce (c’était, je crois, le 20 ou le 22 novembre), et nous lui avions exactement exposé la situation. M. de Persigny nous avait conseillé de nous adresser à M. Pereire. Nous l’avions fait immédiatement. Des pourparlers s’étaient engagés; la négociation se suivait; M. de Mecklembourg était avec nous pour la mener à bonne fin; nous avions acheté des terrains, nous nous occupions des terrassements, et enfin l’acte qui a été plus tard signé le 18 mars était projeté. Cet acte avait été délibéré et arrêté bien avant l’époque de sa date, puisqu’il avait été préparé par M. de Mecklembourg, qui malheureusement était mort lorsqu’il a été passé. Il n’échappera certainement pas à M. le Président qu’au moment où nous avons acheté des terrains et fait des terrassements, nous étions d’accord avec le ministre, et que nous avons dû lui écrire la lettre dont parle M. le Président, car il était décidé que les actions seraient mises en syndicat et que M. Pereire serait le chef absolu de l’affaire, par l’intermédiaire de M. de Mecklembourg.
D. C’est une simple allégation, et la preuve qu’elle n’a aucun fondement, c’est qu’après avoir écrit au ministre: «La souscription est close, la moitié du capital est versée,» le lendemain même le Ministre vous demandait la justification de ce capital de 25 millions, ou vous la faisait demander par le directeur général du commerce, ce qui est la même chose?
R. C’est bien différent!
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Voici les termes de la lettre de M. Heurtier, directeur général:
» J’ai lu attentivement la lettre que vous m’avez adressé le 15 de ce mois pour
» me faire connaître les opérations de la Compagnie des Docks Napoléon, depuis le
» 17 septembre dernier, date du décret qui vous a autorisés à établir ces Docks.
» Je ne trouve pas les énonciations de votre exposé assez précises en ce qui concerne
» l’emploi de la somme de vingt-cinq millions, que vous avez encaissée.
» Je vous prie de m’envoyer sans retard le décompte exact détaillé de cette
» somme.»
CUSIN. — J’ai eu l’honneur de dire que la négociation avec M. Pereire, ouverte d’accord avec M. de Persigny, mettait toutes choses à leur place, et que lorsque M. Heurtier nous a écrit, nous lui avons répondu que ce n’était pas à lui, mais au Ministre que la justification devait être faite.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous mettez ici en avant le nom du Ministre: comment voulez-vous qu’une pareille assertion soit acceptée du tribunal, lorsque vous allez de mensonge en mensonge, lorsque vous avez produit ce système de mensonge, non-seulement quant au nombre des actions, mais quant au chiffre des sommes encaissées? Ainsi, vous recevez 225,000 demandes, et vous dites 318,000, et puis 800,000; ainsi, vous avez 10 millions, en caisse, et vous dites tantôt 17, tantôt 25. Il y a dès le début un système de mensonge qui semble avoir été organisé pour induire tout le monde en erreur, le public d’abord, le Conseil de surveillance ensuite, et enfin le Ministre du commerce.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — A quelle époque ces prétendues conférences avec M. le Ministre du commerce?
CUSIN. — Le 22 ou le 23 novembre 1852, c’est-à-dire deux ou trois jours après la déclaration que les souscriptions étaient faites.
M. LE PRÉSIDENT. — Comment se fait-il qu’en janvier vous persévériez à alléguer le chiffre de 25 millions?
LE TÉMOIN. — Nous étions d’accord avec M. Pereire.
D. M. Pereire n’est intervenu qu’au mois de mars 1853.
R. Si le traité porte la date du 18 mars, c’a été uniquement pour répondre à un scrupule de M. Pereire, qui ne voulait pas signer avant d’avoir fait un rapport au Ministre. Ce rapport est daté du 17 mars.
D. Voici ma question. Vous dites que dès le mois de novembre vous aviez signalé au Ministre l’état exact des choses, à savoir que vous n’aviez encaissé que 10 millions au lieu de 25. En ce cas vous auriez dit la vérité au mois de novembre: pourquoi alors alléguer 25 millions en janvier? Le directeur général, M. Heurtier, auquel vous écriviez cette lettre du 15 janvier, ne savait donc rien de la réalité des choses?
R. Je ne pouvais pas aller au-devant de confidences que le ministre pouvait ne lui avoir pas faites.
D. Vous fixez au 21 ou au 22 novembre votre entrevue avec le Ministre : comment donc expliquez-vous la déclaration que vous lui faisiez, en présence de la déclaration contraire que vous faisiez, le 20 novembre 1852, par-devant le notaire Dufour, et dans laquelle vous affirmiez que la totalité du capital social était souscrite? Vous mentiez donc à l’un ou à l’autre?
R. Nous avions, nous, souscrit les actions manquantes; nous nous étions engagés à fournir l’intégralité du capital.
D. Vous cherchez à décliner en partie la responsabilité qui pèse sur vous, en disant: «85,000 actions seulement ont été souscrites; le reste, c’est la maison Cusin, Legendre et Comp. qui s’en est chargée.» Vous comprenez qu’une pareille raison est fort peu admissible. Comment! vous aviez un capital de 2 millions, dont 15 ou 1,600,000 francs étaient immobilisés, et vous alliez souscrire pour 30 et quelques millions d’actions?
R. D’abord, ce n’était pas 30, c’était 14 ou 15, puisque 11 étaient déjà versés.
D. 25 millions, c’était la moitié du capital engagé, et la nécessité pouvait faire appeler l’autre moitié, c’est-à-dire encore 25 millions, ou 125 fr. par action. Et c’est dans cette situation que vous vous chargiez du placement de 115 mille actions?
R. Nous les prenions pour les placer.
D. Vous ne les avez pas placées. Mais revenons au traité Pereire, car plus on marche dans cette affaire, et plus on est environné de mensonges. Vous avez déclaré qu’au début de la Société vous aviez placé 101,867 actions. Or, dans le traité Pereire, qui est du 18 mars, vous déclarez que 87,800 actions seulement sont placées: comment donc pouvez-vous concilier cette allégation avec la précédente?
R. Les lettres que nous attendions n’étaient pas toutes arrivées.
D. Vous n’avez pas plus délivré de lettres pour les 101 mille que pour les 80 et quelques mille.
R. Je vous demande pardon.
D. Ceci sera vérifié, et nous allons vous dire pourquoi vous avez pro cédé ainsi, et pourquoi vous n’avez pas délivré le nombre d’actions qui vous étaient demandées: Parce que, au début, les actions avaient assez de faveur, elles étaient négociées à primes, et plus vous en auriez gardé, plus vous auriez gagné. Voilà pourquoi, au lieu d’en délivrer 200,000 qui vous étaient demandées, vous n’en délivriez qu’un nombre très restreint.
R. C’était à cause de l’opération alors poursuivie à Londres par MM. Legendre et Riant.
D. Ici encore vous n’êtes pas dans le vrai. Legendre, votre coinculpé, et M. Riant sont allés à Londres; mais le 9 octobre ils étaient de retour et vous rapportaient le traité de la maison Ricardo, qui prenait 60 à 70 mille actions à des conditions qui ne nous sont pas connues, mais qui paraissent assez avantageuses. Vous avez déclaré, vous personnellement, que les propositions n’étaient pas acceptables, et Legendre a été renvoyé à Londres pour signifier à la maison Ricardo la rupture du traité. C’est alors que vous vous êtes chargé de placer toutes les actions, parce que vous vouliez réaliser à votre profit le bénéfice des primes.
R. Je vous répondrai très catégoriquement, sur ce sujet, qu’à l’arrivée de MM. Riant et Legendre, une rupture entre M. Riant et moi a été la conséquence de l’avortement de la négociation. La réconciliation entre M. Riant et moi n’a été faite que le 20 novembre, dans le cabinet de M. Dufour.
D. L’état de votre caisse et de vos écritures a été arrêté à la date du 7 mai 1853, deux mois après le traité Pereire. A cette époque, vous débitiez votre maison de banque de la somme totale de 87,800 actions, qui avaient produit une somme de 10 millions 975 mille francs. Il n’y avait donc alors de placé par vos soins que 87,800 actions, et il en restait encore à votre disposition, c’est-à-dire attachées à la souche, 112,000. Le nombre de 112,000 figure dans votre traité avec M. Pereire. Par ce traité vous vous étiez imposé plusieurs conditions. M. Pereire avait remarqué un vice dans la confusion de la caisse des Docks avec celle de l’Union commerciale, et il avait demandé qu’une caisse spéciale fùt créée pour les Docks. Il avait remarqué aussi que les fonds qui étaient dans vos mains n’auraient pas dû y être, et il avait demandé que tous les fonds disponibles fussent portés en compte courant au Crédit mobilier; et puis que les 112,000 actions qui restaient encore à délivrer, qui se trouvaient par conséquent dans la caisse des Docks, fussent mises en syndicat. Il était interdit à toutes les parties, à M. Pereire comme à vous, d’en vendre jusqu’à ce que certaines formalités eussent été accomplies. Vous en avez vendu; pourquoi? Parce que l’affaire, qui s’était un instant discréditée par la rupture avec la maison Ricardo, s’était relevée dans les premiers jours de janvier, lorsque le bruit avait circulé que M. Pereire allait se mettre à la tête de l’entreprise. Il y avait eu une hausse qui a atteint jus qu’à 55 francs, et vous avez profité de cette circonstance pour agir contrairement au traité du 18 mars; vous avez vendu un certain nombre d’actions pour réaliser la prime à votre bénéfice.
R. Non, M. le Président. Je n’aurais pas mieux demandé que de déposer les fonds au Crédit mobilier; mais c’eût été exécuter le traité du 18 mars, ce que M. Pereire ne voulait pas avant que les demandes du 17 mars lui eussent été accordées.
D. Je ne vous fais pas une inculpation de ce fait, je dis que c’était là une des conditions du traité ; mais je vous rappelle qu’une autre condition du même traité, et de celle-là je vous fais une inculpation, c’est que les 112,000 actions restant dans la caisse ne pouvaient être négociées par personne, qu’elles devaient être mises en syndicat, 83,000 pour M. Pereire, 29,000 pour vous, qu’il était interdit jusque-là d’en vendre et que vous en avez vendu.
R. Je réponds formellement non.
D. Le contraire résulte encore du rapport de l’expert.
R. Le rapport n’est, du commencement à la fin, qu’une masse de confusions.
D. C’est ce que nous verrons. Je vous préviens, en attendant, que l’expert a trouvé non-seulement que vous aviez vendu des actions, mais il a même trouvé le chiffre des actions vendues: ce chiffre est de 2,732.
Maintenant vous ne vendiez pas ces actions sous votre nom, mais sous le nom de tiers; vous avez emprunté même celui de votre valet de chambre, qui figure pour une vente de 1,003 actions.
R. J’ai fort heureusement trouvé l’explication de ce fait, qui, en apparence, a de la gravité. Dans le traité Pereire une réserve de 1,978 actions était faite pour satisfaire aux demandes d’un certain nombre de souscripteurs auxquels il avait été accordé des délais pour payer. Il est arrivé que M. Picard, l’un de nos principaux employés, au lieu de délivrer les actions, que les souscripteurs auraient pu vendre à la Bourse avec une prime de 9 francs, leur a simplement remis cette prime; et le nom de Bernard a été pris pour éviter de mettre plusieurs noms sur les livres. Maintenant je dois supposer que les 2,300 dont vous venez de parler sont les mêmes que les 1,978 qui avaient été exceptées du syndicat, et dont plusieurs sont restées disponibles par suite des opérations que je viens de signaler. Ainsi les ventes ont été faites du consentement et avec l’autorisation de M. Pereire. Quant au surplus, je répète ce que j’ai déjà eu l’honneur de dire: Non, il n’a pas été vendu d’actions sur celles mises en syndicat.
D. Bernard, votre valet de chambre, n’est pas le seul sous le nom duquel vous ayez fait des opérations, pour prélever les bénéfices illicites qui résultaient de ces négociations d’actions. Vous aviez ouvert sur votre livre un compte Docks négociations, et c’était à ce compte que vous aviez porté ces opérations illicites. J’en trouve deux notamment qui ont donné l’une 56,000 francs, l’autre 79,307 francs de bénéfice. Je le répète, à raison de la faveur qui s’attachait au nom de M. Pereire, les actions s’étaient élevées à 280 francs, et même 300 francs, et vous profitiez de cette circonstance pour faire vendre, sous le nom de Bernard, ces actions qui ne valaient que 250 fr., prix d’émission. Vous profitiez donc d’une prime illicite de 50 fr. qui ne vous appartenait pas; c’est ainsi qu’on a trouvé sur vos livres ces deux opérations, l’une de 56,000 francs, l’autre de 79,307 francs. J’ajoute que vous ne faisiez pas cela dans l’intérêt de la Compagnie dont vous étiez gérant, mais au profit de votre maison de banque: c’étaient Cusin et Legendre qui spéculaient sur des actions dont ils n’étaient que les détenteurs. Voilà ce qui résulte du rapport de l’expert. Que répondez-vous?
R. Que je n’ai aucune espèce de connaissance de ce fait. J’affirme positivement que, pas plus dans la maison de banque que dans la Société des Docks, nous n’avons fait d’attribution de bénéfices. J’affirme encore que les écritures, depuis le début de l’affaire jusqu’au 2 août 1853, ont été tenues par M. Picard; par conséquent M. Picard a conservé ainsi par devers lui toutes les notes qui pourraient me mettre à même de répondre aux demandes qui me sont faites et qui établissent la parfaite vérité des faits que j’affirme.
D. Lorsque M. Picard sera entendu, il répondra à ce fait; mais puisque son nom est prononcé, nous devons dire ceci: qu’il s’est déterminé à donner sa démission le 5 août 1853, précisément parce qu’il avait vu qu’on se livrait à des tripotages d’actions auxquels il ne lui convenait pas de prendre part. Vous les niez ces tripotages, vous niez les bénéfices illicites que vous vous procuriez ainsi; nous allons en trouver des preuves.
Le 30 juin 1853 on a relevé votre situation active et passive. La totalité des recettes montait à 11,843,546 fr., ainsi qu’il résulte des livres de votre maison. Vos dépenses s’étaient élevées à 8,617,233 fr.: il y avait donc un excédant de recette sur les dépenses de 3,216,313 fr. Vous deviez à cette époque des sommes assez importantes, notamment 11 à 1,200,000 fr. pour travaux de terrassements. Cependant de votre passif, mis en regard de votre actif, il résultait un déficit de 538,000 fr., et on l’explique, parce que vous aviez fait à deux Sociétés industrielles des avances très considérables : nous voulons parler des Sociétés de Javel et de Pont-Remy. Vous étiez créditeur de ces deux Sociétés; vous aviez pris chez elles des intérêts au fur et à mesure que l’argent des Docks vous était venu.
R. Nous nous étions chargés, comme banquiers, du placement des actions de Javel et de Pont-Remy.
D. Comment se fait-il qu’on vous voie figurer pour 3 millions dans la compagnie de Javel?
R. C’est un emploi que nous avions fait du capital des Docks.
D. Mais qui vous avait autorisé à affecter 3 millions du capital des Docks aux actions de Javel et de Pont-Remy?
R. Personne.
D. Aviez-vous consulté le Conseil d’administration? Vous étiez-vous fait autoriser par une réunion d’actionnaires?
R. C’était inutile, l’emploi n’était pas à demeure, c’était un fait passager qui ne devait durer que le temps de trouver, pour les actions de Javel, d’autres preneurs dont l’argent aurait remplacé celui que nous avions employé.
D. Vous dites que c’était un emploi passager, et trois ans se sont écoulés depuis que vous l’avez fait!
R. Nous avions voulu religieusement laisser les choses dans l’état où elles se trouvaient lors du bilan de 1854, mais les circonstances sont devenues plus difficiles que nous n’avions pu le prévoir.
D. Tout le temps de votre gestion, vous vous êtes trouvé avoir appartenant aux Docks des sommes considérables qui se chiffraient par millions. Votre devoir, comme gérant des Docks, était de faire de ces sommes l’usage le plus utile et le meilleur, c’est-à-dire de réaliser le plus promptement possible vos capitaux, et d’en faire le placement qui vous présentait le plus de garantie? Vous ne l’avez pas fait?
R. Nous pensions le faire.
D. Et vous immobilisiez ces capitaux dans les entreprises industrielles, et l’on vous voit augmenter de jour en jour l’importance de vos intérêts dans la compagnie de Javel! Dans les six mois qui suivent la création des Docks, vous disposez d’abord de 400,000 fr., puis de 1 million 400,000 fr. sur leur capital.
R. Cet argent n’est pas perdu.
D. Vous contreveniez ainsi à vos statuts et aux ordres de l’Administration, car le Ministre vous avait prescrit de déposer les fonds à la Caisse des consignations ou de prendre des bons du Trésor. Vous n’en faites rien: au lieu de tout cela, vous versez 405,000 fr. dans la Société de Pont-Remy, puis vous arrivez au chiffre de 3 à 4 millions pour la Société de Javel; et tout cela avec l’argent des Docks, sans demander conseil à personne, sans consulter ni le Conseil d’administration, ni les actionnaires. Est-ce que par hasard les actionnaires avaient versé leur argent pour qu’on le plaçât dans une Société de produits chimiques?
R. Non, mais la réalisation de ces valeurs était présente à notre esprit, et serait infailliblement arrivée, si Les circonstances l’eussent permis. Nous croyions avoir le droit de faire ce que nous avons fait, et nous croyions bien faire. Si nos prévisions ne se sont pas réalisées, c’est la difficulté des temps qu’il faut en accuser. Et puis le projet du bilan de 1854 nous autorisait à maintenir le statu quo; dans l’attente de l’homologation, nous ne pensions pas que notre situation provisoire se prolongerait aussi longtemps.
D. — L’homologation que vous attendiez était une raison de plus de ne pas disperser les fonds que vous aviez en dépôt. D’un jour à l’autre l’entreprise pouvait prendre une grande activité, et vous aviez besoin alors de capitaux considérables. Il fallait faire ce que vous disait le Ministre: déposer ces fonds à la Banque, à la Caisse des consignations, ou les convertir en bons du Trésor. Vous ne l’avez pas fait.
En 1853, votre situation s’est encore assombrie. Vous avez cherché, par tous les moyens possibles, à réaliser les ressources qui vous manquaient précisément parce que vous augmentiez vos dépenses et que l’argent des Docks ne suffisait plus aux charges que vous vous étiez imposées. C’est alors qu’on vous voit faire des opérations sur les actions et en vendre des quantités très-considérables. Nous trouvons que vous en avait fait vendre 13,500 par l’intermédiaire d’un M. Jules Lecomte.
R. Oui, M. le Président.
D. Est-ce que ce M. Jules Lecomte serait par hasard l’ancien rédacteur de l’Indépendance belge?
R. Oui, M. le Président.
D. Ah! nous ne savions pas qu’il eût cette qualité de courtier. Eh bien, il a vendu 13,500 actions?
R. Il ne les a pas vendues pour son compte.
D. Je comprends, Jules Lecomte était pour vous une couverture; vous opériez sous son nom, comme sous celui de Bernard, votre valet de chambre.
R. Mais non, M. le Président.
D. Cette négociation a amené une perte de 300,000 francs?
R. Je n’ai pas connaissance de cela.
D. Nous l’établirons en temps et lieu. Vous avez encore fait négocier par un sieur Schlesinger 6,985 actions, qui ont donné une perte de 183,000 francs. — Nous rappelons ce que nous disions tout à l’heure: au moment où les actions se négociaient à prime, vous vendiez, vous mettiez dans votre caisse personnelle les bénéfices qui en résultaient, et lorsque vous faites vendre des actions à perte, vous portez la perte au compte des Docks. Votre opération est toute simple: Y a-t-il bénéfice, vous le prenez; y a-t-il perte, vous la faites supporter aux Docks.
R. Il n’a été fait aucune attribution, aucun partage, personne n’a rien mis dans sa poche. Je tiens essentiellement à établir ce fait. L’expert a dit que telle et telle opération avait produit tels bénéfices. Si les bénéfices ont été produits, ils existent encore. Ni M. Legendre, ni moi, ni personne, n’a mis un sou dans sa poche. Les explications qui pourront être données en temps et lieu détruiront ce précédent fâcheux que l’accusation veut faire peser sur nous.
D. Pourquoi faisiez-vous vendre 13,500 actions par Lecomte, rédacteur de l’Indépendance belge? Vous aviez un encaisse plus considérable qu’il ne vous le fallait pour les Docks, vous aviez 4 millions tout prêts.
R. Nous ne les avions pas sans comprendre les avances faites à Javel et à Pont-Remy.
D. Sans doute, et c’est pour cela que vous faisiez vendre à perte les actions des Docks.
R. Si nous avions agi autrement, nous aurions compromis d’une manière bien plus grave les intérêts des actionnaires. Toute opération commerciale bien ou mal engagée doit être soutenue. Mais je prétends que les nôtres étaient bonnes; les abandonner, les laisser en souffrance, s’arrêter tout d’un coup, c’eût été les jeter dans une perturbation épouvantable; c’eût été, je le répète, faire éprouver aux actionnaires une perte bien autrement forte que celle qu’ils ont éprouvée.
Je dois faire une autre remarque. Le traité intervenu entre nous et M. Pereire, au mois de mars, l’attribution de 88,000 actions, la mise en syndicat de 112,000 autres, tout cela devait nous amener des bénéfices.
D. Nous verrons tout à l’heure que les avantages que vous vous attribuez par le bilan de 1854, 1 million comme commission de banque et 300 mille francs pour trois mois de gérance, vous faisaient d’assez beaux bénéfices, sans que vous en vinssiez demander d’autres à la vente des actions.
R. L’attribution d’actions dont je parle était une attribution purement morale sur laquelle je m’appuie pour détruire la mauvaise impression produite sur le tribunal par les opérations auxquelles nous nous livrions. La position où nous sommes est déjà bien assez malheureuse (elle ne peut être pire), pour qu’on ne nous refuse pas le droit de dire ce qui peut atténuer les griefs qui nous sont reprochés. Ainsi, M. Pereire, au début de l’affaire, nous avait fait attribuer 29,000 actions sur celles qui devaient être mises en syndicat, et toutes les opérations qui ont été faites depuis l’ont été avec une entière bonne foi de notre part. Je le dis bien sincèrement, si nous avions su, quand nous avons entamé l’affaire de Javel avec M. de Sussex, que nous lui donnerions 3 millions, nous ne l’aurions pas conclue. L’affaire des Docks prenait notre temps à un point qui ne peut s’imaginer, ce qui faisait que nous ne pouvions pas donner les mêmes soins aux autres opérations. Mais nous avions l’espoir de voir cesser cet état de choses si Le traité avec M. Pereire fût devenu définitif; la liberté qu’il nous aurait donnée nous aurait permis de nous occuper immédiatement de l’affaire de Javel, de celle de Pont-Remy et de toutes les autres, et nous y aurions trouvé des ressources qui auraient rétabli la caisse des Docks.
D. Vous dites que, si vous aviez prévu que l’affaire de Javel vous entraînerait à un versement de 3 millions, vous n’y seriez pas entré ; mais vous y êtes entré dans l’intérêt de votre banque, l’Union commerciale, et si vous avez été entraînés à y mettre plus de fonds que vous ne pensiez, c’est que cette affaire se présentait à vous comme un Eldorado. Vous faisiez l’affaire avec l’argent des Docks; mais si elle eût donné tous les bénéfices que vous en attendiez, ce n’eussent pas été les Docks qui en auraient profité.
Lorsque vous avez négocié cette affaire, M. de Sussex s’est réservé 20 p. 100 comme gérant, 40 p. 100 comme fondateur industriel et auteur de découvertes, c’est-à-dire qu’il commençait par prélever 60 p. 100 sur les actionnaires, avant tout bénéfice. Mais dans cette part du lion, il y avait bien quelque chose pour la maison de banque Cusin et Legendre. Vous, Cusin, vous vous étiez fait remettre 800 actions, qui faisaient un capital de 400 mille francs. Vous vous étiez fait faire cette remise dans votre intérêt personnel, et non dans l’intérêt des Docks. Cependant c’était avec l’argent des Docks que vous opériez, c’était avec l’argent des Docks que vous espériez des bénéfices considérables.
R. Il y a confusion dans ce que vous venez de dire, M. le Président; il n’a été fait aucune espèce d’attribution, les choses restaient libres.
D. Quel devait être le sort de ces 400 mille francs?
R. Le jour où le règlement définitif avec les Docks serait arrivé, ce traité aurait eu toutes ses conséquences, et on aurait vu notre volonté se manifester là ; mais dans la situation où nous étions, les choses sont restées libres, comme je vous le disais.
D. C’est-à-dire que personne n’en a rien su jusqu’au moment où la Société des Docks, enfin avertie, a fait saisir les actions. Il est bien entendu que vous aviez fait l’affaire de Javel avec l’argent des Docks, et que vous vous étiez fait faire des remises considérables, puisqu’elles se chiffraient par 400 mille francs. Il est bien entendu encore que ce bénéfice était pour l’Union commerciale, et que les Docks n’en auraient rien eu.
R. C’est une induction.
D. Vous avez restitué ces actions à l’Union commerciale, mais vous n’avez jamais parlé de restitution quand il s’est agi des Docks.
Il est évident, il est encore bien établi qu’à la date du 19 février 1854 vous vous chargez en recette de 120,000 actions, c’est-à-dire d’une somme représentant 15 millions; à cette somme doivent se joindre les produits des entrepôts des Marais et de Putod que vous aviez achetés. Nous voyons dans les écritures que ces entrepôts avaient donné à cette époque un bénéfice de plus de 500 mille francs; ce qui porte l’actif des Docks à plus de 15 millions 500 mille francs. C’est ici le cas de vous demander comment il se fait qu’ayant en caisse non-seulement des capitaux considérables restés sans emploi, que vous auriez dû placer suivant l’avis du Ministre, soit à la Caisse des consignations, soit en bons du Trésor, ce qui aurait rapporté des intérêts aux actionnaires, mais encore deux entrepôts qui fonctionnent et dont les bénéfices sont représentés par un chiffre de 500 mille francs, comment il se fait, dis-je, que depuis trois ans que la Société des Docks avait été constituée, que les actionnaires avaient versé leur argent, il n’y ait eu, malgré les nombreuses demandes qui vous sont parvenues, ni assemblée générale, ni distribution du dividende? Aux termes des statuts, les actions devaient recevoir un intérêt de 4 p. 100; comment se fait-il qu’il n’ait pas été donné même un sou d’intérêt?
R. Ceci est très facile à expliquer. Nous étions continuellement en négociations, tantôt avec M. Pereire, tantôt avec M. de Rothschild, tantôt avec d’autres; si nous avions assemblé les actionnaires, et que nous leur eussions dit ce qui se faisait, nous aurions compromis les négociations pendantes. Ces négociations n’ont jamais cessé. Il y en avait encore au mois de novembre 1855, six semaines avant notre arrestation; nous étions alors en pourparlers avec M. de Rothschild.
D. Mais les difficultés dont vous parlez, en supposant qu’elles vous eussent empêché de réunir vos actionnaires pendant deux ou trois ans, ne devaient pas vous empêcher de leur distribuer au moins l’intérêt de 4 pour 100, qui devait être pris même sur le capital?
(Le prévenu ne répond pas.)
En 1853, vous vous trouviez dans une situation qui s’empirait tous les jours. Vous aviez auprès de vous un commissaire du gouvernement, M. Berryer. M. Berryer était là plutôt à titre officieux qu’à titre officiel, puisqu’il ne pouvait être commissaire du gouvernement qu’autant que la Société serait homologuée et convertie en Société anonyme: voulez-vous nous dire comment il se fait que vous ayez été amené à donner à M. Berryer une allocation très considérable en dehors de son traitement?
C’est en 1853, au mois de mars, que M. Berryer a été nommé, par arrêté du Ministre du commerce. Le Ministre vous disait: Le traitement est de 5,000 francs, c’est vous qui devez en faire les fonds; mais vous ne devez pas avoir de rapports directs avec le commissaire impérial; vous devez faire verser au trésor le traitement de M. Berryer, et M. Berryer le fera ordonnancer par le Ministre. Le traitement de M. Berryer était de 425 francs par mois environ; comment se fait-il que vous, gérant des Docks, vous ayez triplé ce traitement par un traitement supplémentaire et secret de 1,250 francs par mois, ce qui le portait, à l’insu du Ministre à près de 1,750 fr.? Quel a été votre motif?
R. M. Berryer devrait éclairer le Ministre sur le système des Docks, soit à Londres, soit ailleurs, c’était par conséquent un travail continuel qui absorbait une partie de son temps. Maintenant nous n’ignorions pas que la situation de M. Berryer était exceptionnelle, c’est-à-dire que, n’étant pas constitués en Société anonyme, il ne pouvait pas être commissaire impérial. Mais le Ministre voulait avoir auprès de nous quelqu’un qui lui dît comment les choses se passaient. Le lendemain du jour où nous avons obtenu la concession, nous avions demandé un règlement d’administration publique. Nous nous livrions à l’étude des questions que nous avions à résoudre, et il nous avait paru que le Ministre aimait mieux avoir auprès de nous une personne de son choix, pour discuter les points qui nous embarrassaient, que de les discuter directement avec nous. Voilà le motif pour lequel nous avons fait à M. Berryer quelques avances comme banquiers.
D. Comment, quelques avances? Elles se sont élevées à 110,000 francs!
R. Je reprends mon expression; j’ai voulu dire traitement, et ce traitement n’a pas porté sur une grosse somme.
D. Ne perdons pas de vue qu’indépendamment de ce traitement vous lui avez donné 110,000 francs. Quel est le motif qui a pu vous déterminer à donner clandestinement, à l’insu de tout le monde, à un homme qui avait été placé auprès de vous par le gouvernement pour contrôler votre entreprise, pour éclairer le Ministre sur ce qui se passait dans la Compagnie, pour lui dire si les intérêts de la Compagnie et ceux du public étaient dans des mains honnêtes; comment se fait-il qu’outre ce que vous appelez une avance de 110,000 francs, vous ayez donné à M. Berryer une somme mensuelle de 1,250 francs par mois, indépendamment de son traitement? Quel est le motif qui vous y a déterminé ?
R. Les frais de voyage que nécessitaient les études qu’il avait à faire.
D. Si vous aviez à étudier l’affaire des Docks, vous pouviez envoyer des agents en Angleterre, en Hollande; mais vous preniez pour cela l’agent même du gouvernement, cela paraît singulier.
R. J’ai trouvé dans le rapport de l’expert copie d’une lettre que M. Berryer écrivait au Ministre, en novembre ou en décembre 1853, dans laquelle il lui disait qu’il allait étudier la question des Docks et des warrants.
D. Oui, mais en même temps M. Berryer disait au ministre qu’il subviendrait aux frais de voyage au moyen de ses ressources personnelles. Il se gardait bien de parler du traitement clandestin de 1,250 francs, qu’il recevait par mois, et le Ministre comprenait si bien que les choses devaient être comme l’écrivait M. Berryer que, dans une lettre qu’il adressait au ministre des affaires étrangères, qui le consultait précisément à l’occasion d’une lettre de M. Berryer, nous trouvons l’expression la plus énergique, la plus formelle, que les frais de voyage devaient être supportés par M. Berryer sur ses propres ressources; M. Berryer le comprenait tellement ainsi, qu’il disait: Je ne demande rien, cette affaire m’intéresse; je ferai le voyage à mes frais, et plus tard, si le gouvernement trouve que les travaux auxquels je vais me livrer ont une certaine utilité, il me donnera sans doute une indemnité. Ainsi dans cette affaire, vous, banquier, vous trompiez encore la religion du Ministre. Ce supplément de traitement n’avait-il pas pour objet de décider M. Berryer à fermer les yeux? N’avait-il pas pour but de l’empêcher de voir ce que l’expert a vu très clairement dans l’affaire des Docks, ce que M. Pereire y avait entrevu? Quel motif enfin avez-vous eu d’ouvrir un crédit de 110,000 francs à M. Berryer?
R. Je le répète, c’était pour payer son temps. Je vais vous dire quelque chose de plus. Les questions d’entrepôt, de warrants, d’aménagement de marchandises, nous connaissions tout cela sur le bout du doigt; mais nous avons pensé que le gouvernement voulait savoir si ce que nous disions était exact. Pour cela, nous avions besoin d’envoyer quelqu’un en Angleterre; M. Berryer s’adresse à nous pour obtenir les fonds nécessaires à son voyage. Maintenant il va sans dire que, si au lieu d’être banquiers nous eussions été autre chose, sa demande aurait pu nous paraître singulière. Que font les banquiers? Ils donnent de l’argent à qui il leur plaît d’en donner. S’ils se trompent, c’est leur affaire; mais je ne pense pas qu’on puisse les condamner pour cela. Nous avons voulu indemniser M. Berryer du travail qu’il faisait. Je dois ajouter qu’étant allé moi-même à Londres en janvier 1854, M. Berryer y était installé de telle sorte, qu’il m’a procuré l’entrée dans tous les Docks, et qu’il a fait mettre à ma disposition des modèles, des registres, une foule de documents dans lesquels nous avons trouvé des avantages très grands pour poursuivre dans la voie où nous étions entrés, quant à l’aménagement intérieur des Docks.
D. Ceci n’est malheureusement pas vrai; ce n’est pas pour cela que vous avez ouvert un crédit de 110,000 francs à M. Berryer. Vous ne pouviez pas ignorer sa situation gênée, embarrassée; elle était notoire. Elle résulte du reste de ses lettres, dans lesquelles il vous demande constamment de l’argent, et vous lui avez donné des sommes considérables. Je comprendrais jusqu’à un certain point que vous lui eussiez, comme vous le dites, ouvert un crédit; mais quel motif a pu vous décider à faire l’abandon de ces sommes? Vous savez ce que je veux dire: je parle de ce traité secret, qui n’est nié ni par vous ni par Berryer, qui porte la date de septembre 1854, et dans lequel vous dites à Berryer:
«Votre compte s’élève à 59,000 francs; sur cette somme il faut déduire 15,000 francs de traitement que nous vous avons donné. Reste 44,000 francs. Nous vous parferons 100,000 francs, lorsque l’homologation de la Société des Docks aura été obtenue du Conseil d’État et que l’affaire aura été constituée en Société anonyme; nous nous engageons à vous donner quittance de ces 44,000 francs, et à vous remettre 56,000 francs en actions libérées, ce qui fera un total de 100,000 francs.»
Encore une fois quel motif aviez-vous de donner ainsi 100,000 francs à M. Berryer?
R. Il fallait constituer l’entreprise; nous agissions en vue des résultats probables qu’elle devait avoir, et il me semble que, sur les attributions qui nous étaient faites, nous pouvions bien en faire à notre tour. Nous en avons fait à bien d’autres, à M. Wilmar, par exemple.
D. M. Wilmar est un Anglais qui vous avait mis en rapport avec les actionnaires: c’était un intermédiaire, et il n’était pas commissaire du gouvernement. Que vous donniez une prime à un intermédiaire, cela peu se comprendre; mais au commissaire du gouvernement chargé spécialement de vous surveiller, d’éclairer le Ministre sur votre gestion, de protéger les intérêts énormes qui vous étaient confiés, que vous lui donniez un traitement clandestin de 15,000 francs par an, et que vous lui disiez; Notre Société va être constituée en Société anonyme, et quand elle le sera, nous vous donnerons encore 100,000 francs; nous sommes en droit de vous demander pourquoi?
R. Il me semble, M. le Président, que j’ai répondu. J’ai eu l’honneur de dire que les voyages de M. Berryer, sa coopération pour arriver à éclairer la division du Ministère du commerce, qui entend peu de chose à ces questions, les dépenses auxquelles cela l’entraînait, justifient parfaitement les indemnités que nous lui avons allouées. Il nous a paru d’ailleurs tout à la fois plus convenable et plus simple de déterminer une somme que de nous livrer à un examen de détail pour savoir ce qu’il avait dépensé, par sous et centimes, à l’hôtel ou sur le paquebot. Remarquez d’ailleurs qu’il n’y a eu en cela rien de clandestin; tout s’est fait d’accord avec nos collègues, MM. Stockes et Orsi (M. Duchêne de Vère n’était pas à la réunion); c’est par conséquent une affaire réglée au grand jour et non dans l’ombre.
D. Comment! vous n’avez pas voulu faire un compte par sous et deniers, vous avez donné à M. Berryer un traitement mensuel de 1,250 francs, et il est inscrit sur vos registres pour une somme de 110,000 francs! Au surplus, Berryer répondra lui-même quand nous l’interrogerons.
J’ai à vous interroger sur un autre point, sur le traité avec la maison Fox et Henderson: vous aviez acheté des terrains, mais vous n’étiez pas converti en Société anonyme; par conséquent il n’y avait pas encore possibilité de faire aucuns travaux. Comment se fait-il que vous passiez avec la maison Fox et Henderson, qui d’ailleurs est maintenant en faillite, un traité de construction pour les Docks, dont le chiffre s’élève à 24 millions, à la moitié de votre capital social? Comment se fait-il que vous lui imposiez l’obligation de prendre 32,000 actions, et que vous déclariez qu’elle a versé la somme représentant ces 32,000 actions, c’est-à-dire 4 millions? Et puis, comment se fait-il que, par un traité secret, vous, concessionnaire chargé de protéger, de défendre les intérêts des actionnaires qui vous les ont confiés, vous receviez un pot-de-vin de 1,800,000 francs?
R. Le pot-de-vin n’a été ni demandé ni reçu, ou, pour mieux dire, il n’a jamais été question de pot-de-vin. Les 1 million 800,000 francs devaient être une atténuation aux sacrifices déjà faits. La vente des actions ayant amené un déficit, et la maison Cusin et Legendre s’étant chargée de ce sacrifice, après avoir traité avec MM. Fox et Henderson, opération pour laquelle nous avions consulté le Ministre, après avoir pris les devis tels qu’ils étaient établis pour les travaux du Louvre, il a été marchandé sur les bénéfices que ces messieurs feraient, afin qu’une partie de ces bénéfices arrivât comme atténuation à couvrir les sacrifices qui avaient été faits. Cette combinaison était si peu secrète, que tout le monde la connaissait, que tous les membres du Conseil d’administration la connaissent, et jamais personne n’a manifesté aucune inquiétude, élevé aucune réclamation, aucune prétention sur cette somme qui, au su de tous, de l’aveu de tous, devait servir d’atténuation aux pertes que nous avions faites.
D. Ceci est une pure allégation de votre part. Rien dans votre situation ne justifie le traité si considérable que vous avez fait avec Fox et Henderson, car vous stipuliez pour 24 millions de travaux, c’est-à-dire l’emploi de la moitié de votre capital, alors que ces travaux n’avaient aucune urgence. En faisant, dis-je, avec MM. Fox et Henderson un traité si considérable, vous leur imposiez l’obligation de prendre 32,000 actions. Cela peut se comprendre par le désir d’atténuer votre situation dans une certaine mesure, mais alors pourquoi un traité secret? Pourquoi, si ces 1,800,000 francs n’étaient pas un pot-de-vin, faire trois actes au lieu d’un seul? Vous dites que cette remise était faite non pas à vous personnellement, mais à tous les concessionnaires, pour atténuer une perte qui s’élevait à des millions? Il est permis de n’en rien croire.
R. Si les choses eussent été ainsi faites, quelle trace serait restée du sacrifice que ces messieurs s’imposaient pour ces constructions, qui devaient avoir toujours une grande importance comme travaux? Si au lieu de 24 millions on avait dit seulement 22 millions 200,000 francs, il n’y aurait pas eu possibilité de faire l’atténuation des 1 million 800,000 francs.
D. C’est-à-dire que, pour appeler les choses par leur nom, il n’y aurait pas eu possibilité de tromper tout le monde. Aujourd’hui on vient vous dire: Le traité avec MM. Fox et Henderson portait à 24 millions le chiffre des travaux, et puis il y avait un traité secret en vertu duquel ces messieurs faisaient une remise de 1 million 800,000 francs. Ceci a été envisagé à ce point de vue par tout le monde. Vous avez plaidé devant le Tribunal de commerce, et le Tribunal de commerce a qualifié l’acte de la manière la plus sévère. Il a dit que les constructeurs anglais, comme Cusin et Legendre, s’étaient entendus pour tromper les actionnaires.
R. J’ai le malheur d’être en prison, je ne sais que ce qu’on me dit.
D. Dans l’intérêt des actionnaires, il n’était nullement nécessaire de faire un traité secret; il fallait fixer l’importance des travaux, non pas à 24 millions, mais à 22 millions 200,000 francs, et par conséquent ne pas faire un traité secret de 1 million 800,000 francs, qui fait supposer une attribution toute personnelle, aussi bien que les 400,000 francs qui vous ont été donnés dans l’affaire de Javel.
R. Il n’y a pas plus d’attribution personnelle dans un cas que dans l’autre; cela sera établi, je l’espère. Une petite observation. La remise de 1 million 800,000 francs coïncide avec la nécessité où nous étions de payer 900,000 francs d’hypothèques sur l’entrepôt de Putod, sinon il fallait vendre des actions pour près d’un million pour purger cette hypothèque, ce que nous avons été obligé de faire, et c’est là l’origine du compte de M. Orsi. Ainsi, vers la fin de juin 1854, c’est-à-dire un mois avant la présentation du bilan, ce besoin d’argent nous a mis dans le cas de faire à M. Orsi la proposition de négocier les actions que nous avions sous la main.
D. Ce point sera expliqué ; mais on vous inculpé aujourd’hui d’avoir voulu mettre ces 1 million 800,000 francs dans votre poche. Au mois d’août 1854, le Ministre était préoccupé singulièrement de la situation des Docks. On vous a demandé un bilan de votre situation active et passive. Vous l’avez présenté, et pour atténuer le déficit énorme qui existait dans la caisse, vous y avez fait figurer pour la première fois les actions de Javel et de Pont-Remy. Ce bilan a été l’objet d’un examen très attentif; il a été constaté qu’il était complétement mensonger; vous l’avez dit vous-même, il avait été dressé pour égarer la religion du Ministre.
Il est quelques points sur lesquels vos efforts pour arriver à une balance qui était impossible, n’auraient pas même pu être tentés, si le commissaire du gouvernement avait fait son devoir. Vous y avez fait figurer 1 million pour commission de banque, et 300,000 francs pour frais de gérance. Ainsi voilà une entreprise qui se constitue en novembre 1852, et le 12 août 1854, vingt-deux mois après, on produit un bilan où les gérants, qui avaient 10 pour 100 sur les bénéfices de l’entreprise, demandent 1 million pour commission de banque, 300,000 francs pour frais de gérance: comment pouvez- vous justifier cela?
R. Les statuts disent que les administrateurs pourront avoir tout à la fois un traitement et une part dans les bénéfices. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que la présentation de ce bilan avait été faite sur la demande du Ministre, c’est un fait qu’il faut ne pas oublier. Le bilan était dressé purement et simplement à l’appui de la demande en homologation de la Société anonyme.
D. Je le veux bien; mais ce n’était pas une raison pour faire un bilan mensonger.
R. Le bilan n’est pas mensonger.
D. Les chiffres qui y sont portés figurent pour la première fois. Ce sont des chiffres arrangés, par conséquent mensongers en ce qu’il y a 1 million pour frais de commission, et 300,000 francs pour frais de gérance. Il y avait là une exagération incroyable. Comment, pour 15 ou 18 mois d’exercice 300,000 francs pour frais de gérance, indépendamment de votre commission de banquier! Il me semble que c’était entendre singulièrement les intérêts des actionnaires.
R. Ceci n’était qu’un projet.
D. Il y a bien autre chose. Vous et vos coinculpés, vous êtes portés sur les livres pour des sommes assez considérables, et qui se sont augmentées au fur et à mesure que les capitaux affluaient. Ainsi vous, Cusin, vous êtes débiteur personnellement de 265,000 francs, Legendre de 444,000, Duchêne de 123,000, Berryer de 110,000.
R. C’est à la maison Cusin et Legendre que cette somme est due.
D. Voilà qui est de plus en plus merveilleux. Vous êtes portés tous les trois à titre de débiteurs sur les livres de la maison de banque pour des sommes qui s’élèvent à près d’un million, mais qui proviennent de l’argent des Docks, et si vous veniez à payer un jour, ce serait à la maison Cusin et Legendre que vous payeriez!
R. Je soutiens que le rapport de l’expert est fait contrairement à tous les principes. Legendre et moi nous vivions très économiquement; nous prenions par an 8, 10, 12,000 francs pour vivre, nous et nos familles, d’une manière conforme à notre position; nous ne prenions rien de plus.
D. Il est un fait sur ce point qui résulte non de l’instruction, mais de votre situation comme gérant de l’Union commerciale. Vous preniez votre part aussi dans cette Société, et, suivant M. Dépinoy, cette part était de 1,000 francs par mois.
R. C’est une erreur des plus grandes... Je voudrais cependant bien ne rien laisser passer... Voici comment nous procédions. Nous avions un compte courant dans la maison de banque, et quand nous avions besoin de 2 ou 300 francs, nous en payions l’intérêt. Nous avons alors imaginé de prélever une somme de 1,000 francs par mois, qui était portée à notre débit, mais sans intérêt. Tout notre avantage était de ne pas payer d’intérêt dans le courant de l’année. Mais à l’époque de l’inventaire, les 12,000 francs que nous avions pris dans le courant de l’année étaient diminués de notre compte. Je tiens à bien établir cela.
D. Vous vous expliquerez là-dessus. Revenons à l’affaire des Docks.
R. Vous avez dit que nous avions, M. Legendre, M. Duchêne, M. Berryer et moi, prélevé près de 1 million 100,000 francs. Vous ne faites pas état des intérêts que nous avions dans l’Union commerciale.
D. Dans cette maison, dont le capital était de 2 millions?
R. La somme de 1,100,000 francs se réduit par le fait à 600,000 francs, parce que nous sommes, Legendre et moi, intéressés dans l’Union pour 500,000 francs. L’expert n’a pas pu dire qu’il n’y eût pas à la souche des actions nous appartenant. Or, nous n’avons pris, depuis l’origine des Docks, que 9, 10, 12, 13,000 francs au plus pour nos dépenses journalières. Admettons que l’Union ne marchât qu’avec les Docks, ce qui n’est pas, Legendre et moi nous aurions pris 30,000 francs sur ce même argent, ce ne serait pas 1,100,000 francs, mais 30,000 francs; et encore j’exagère. Legendre n’a pas pris plus de 12 à 13,000 francs par an, moi autant, cela fait 26,000 francs au plus. Vous voyez que cette observation a une énorme portée. On nous a imputé tant de choses, que je ne dois laisser aucune occasion de me justifier.
D. L’expert répondra à vos observations sur ce point. Nous voulons seulement vous faire remarquer ceci, que le chiffre des remises qui vous ont été faites s’est augmenté. Il était de 225,000 francs au 31 décembre 1853, il a été depuis de 253,000; et celui de Legendre dépasse beaucoup les 250,000 francs qu’il devait rapporter, puisque son compte s’élève à 444,000 francs.
LEGENDRE. — C’est une erreur des plus complètes.
CUSIN. — Les prélèvements ont été faits en raison des besoins de la famille et de la position que nous occupions. Nous vivions avec la plus grande économie. Je me charge d’établir que nous n’avons pas dépensé 15,000 fr. par an, que nous n’avons pas même atteint ce chiffre.
M. LE PRÉSIDENT. — Pouvez-vous vous expliquer sur le bilan de 1855, préparé, arrangé pour l’assemblée des actionnaires que vous deviez enfin convoquer et duquel résulte un déficit de 6,866,000 francs?
R. J’y ai été complètement étranger; ma préoccupation n’était pas de dresser le bilan, mais de savoir ce qu’il y avait à faire. Nous étions en pourparlers avec M. Lehon. M. Lehon nous conseille de convoquer les actionnaires; nous les convoquons. Le 9 janvier, les actionnaires ont le droit de venir déposer leurs actions; il en est déposé un très grand nombre. Il y avait nécessité de se trouver là et de s’expliquer. Je déclare qu’il n’y a eu ni arrangements d’écritures, ni arrangement d’un tableau, ni projet d’explications à donner à cette assemblée, qui devait se tenir 15 jours après. M. Malpas, le seul témoin que j’aie fait assigner, vous dira comment a été dressé ce bilan et quelles communications lui ont été faites. Quant à nous, nous n’avons pas à le justifier, nous n’y avons en rien contribué.
D. Lorsque nous interrogerons l’expert, nous lui demanderons des explications sur ce bilan, et nous devons dire qu’il se trouve à peu près d’accord avec vous, car entre vos appréciations et les siennes il n’y a qu’une différence extrêmement légère.
C’est ainsi que vous arrivez à la fin de 1855, époque à laquelle est intervenu le décret qui a révoqué la concession qui vous avait été faite. Les termes de ce décret sont graves, ils vous chargent, nous devons les remettre sous vos yeux.... Vous savez que le Ministre du commerce avait délégué un inspecteur général des finances pour vérifier toute votre comptabilité. Un rapport qui a dû vous être communiqué a été fait, et c’est par suite de ce rapport qu’est intervenu le décret dont voici le texte:
«Vu notre décret du 17 septembre 1852, etc.; — Vu l’avis de la section du
» Conseil d’État, etc.; – Vu les rapports de l’inspecteur général des finances, qui a
» été chargé de vérifier la situation de l’entreprise:
» Considérant que, de ces documents et de l’ensemble des documents recueillis, il
» résulte que les concessionnaires, par les irrégularités et les abus graves de leur
» gestion, se sont mis dans l’impossibilité absolue de réaliser les intentions de notre
» décret précité et de procurer au commerce, etc.
» Avons décrété : — L’autorisation accordée aux sieurs Cusin, Legendre et
» Duchêne de Vère est révoquée sans préjudice des droits des tiers, etc.»
Et à cette occasion nous devons vous rappeler ce passage d’une lettre d’un de vos coaccusés, d’Orsi. Orsi appelait votre attention sur votre gestion et vous écrivait de Londres, le 23 août 1853, dans les termes que voici:
«Je ne puis, mon cher monsieur Cusin, m’empêcher de vous faire observer
» qu’à Londres comme à Paris les Docks se meurent, si par un coup hardi et
» renonçant à toute remorque, vous ne vous attachez pas à marcher tout seul. On
» a parlé d’influences au Ministère de l’intérieur. Illusion! L’influence, c’est la
» boune gestion de l’affaire; l’influence, c’est le résultat positif, tangible, progressif
» des opérations de la Division des marais; l’influence enfin, c’est la diminution du
» capital, la souscription et le versement de ce qui reste, et l’homologation des
» statuts. Voilà mon opinion carrément formulée. Ainsi que j’ai eu le plaisir de
» vous l’annoncer, vous êtes sûr de trouver ici 5 millions placés. Si vous en désirez
» davantage, vous n’avez qu’à le dire. Mais conformément à vos instructions,
» je me suis borné au chiffre de 5 millions.»
Vous l’entendez: il vous disait que ce que vous aviez de mieux à faire, c’était de bien gérer l’entreprise, et vous n’avez pas tenu compte de ses conseils, puisque vous êtes devant le tribunal de police correctionnelle, et qu’un décret a déclaré votre gestion entachée de graves abus.
R. Il me semble que M. Orsi, en me disant de me garantir de toute espèce de remorque, rendait au contraire un certain hommage à la possibilité que nous aurions de faire marcher l’affaire, et que, quand il écrivait cela, il n’avait pas du tout l’intention de jeter un blâme sur nous.
D. Je n’ai pas dit un blâme, j’ai dit un conseil. J’ai ajouté que ce conseil était celui de la bonne gestion de l’affaire, et que le décret de révocation déclare énergiquement que votre gestion n’a pas été bonne.
R. La gestion ne laissait rien à désirer, elle marchait comme elle devait marcher; je parle du matériel et du personnel. Encore une fois, quand M. Orsi nous disait de ne pas céder à des influences, il faisait allusion aux personnes avec lesquelles nous étions en rapport. Jusqu’alors toutes les influences privées disparaissaient; nous étions tous dans le cas d’aller de l’un à l’autre, et encore une fois je ne pense pas que M. Orsi ait voulu jeter un blâme sur la manière dont les intérêts sociaux étaient conduits. Telle n’était pas son intention.
D. Maintenant que nous avons jeté un coup d’œil sur l’ensemble de l’opération, nous devons vous rappeler que vous êtes traduit en police correctionnelle sous la double inculpation d’abus de confiance, pour avoir détourné les capitaux des Docks de leur destination, pour les avoir appliqués à un usage autre que celui auquel ils étaient destinés; et puis vous êtes accusé d’escroquerie comme ayant employé des manœuvres frauduleuses, en ce sens que vous auriez présenté, comme constituée, une Société qui ne l’était pas, et appelé les actionnaires à entrer dans une affaire qui n’offrait aucune espèce de garantie, puisqu’elle n’était pas même légalement constituée. Cette double inculpation vous est commune avec Legendre et Duchêne de Vère, qui ont fait ce que vous avez fait vous-même.
R. Il est évident que tout a été fait en commun.
D. Il est des actes qui vous sont reprochés personnellement, d’autres collectivement, comme ayant été accomplis par vous, concurremment avec Legendre. Et tout d’abord nous vous dirons que Legendre a prétendu dans l’instruction que, s’il était resté nominalement attaché à l’affaire, en fait c’était vous qui aviez fait tout. Expliquez-vous là-dessus.
R. Le tribunal peut être parfaitement convaincu que, s’il y a eu un malentendu dans cette affaire, ça été d’y avoir employé trop de personnes. Il serait bien singulier que toute la responsabilité pesât sur nous, et que nos collaborateurs n’en eussent encouru aucune. Bien des personnes ont travaillé avec nous: M. le baron Heeckreen, M. Guibert, M. Carteret....
D. Ces personnes n’étaient pas concessionnaires. Je parle en ce moment de vous et de Legendre. Or, Legendre a déclaré dans l’instruction qu’il avait été intéressé dans la maison de banque, mais qu’il était resté étranger à l’émission des actions, que vous faisiez tout dans l’affaire des Docks, qu’il avait donné de temps en temps sa signature, mais qu’au fond il avait ignoré ce qui s’était passé. Telle est sa déclaration.
R. Je suis surpris... Mais je dirai que tout s’est absolument passé dans le cabinet de Cusin et Legendre. Bien des personnes qui ne faisaient pas partie de la maison, mais qui, à un titre quelconque, savaient ce qui s’y passait, pourraient en déposer.
D. Ainsi l’énonciation fausse d’un capital, tantôt de 17 millions, tantôt de 25, vous serait exclusivement imputable. Il en serait de même de la négociation des actions et de toutes les mesures importantes qui ont été prises.
R. Je regrette d’avoir à m’expliquer sur ce point, mais enfin je pourrais faire appel aux souvenirs de M. Plé. Un débat s’était engagé entre nous à l’occasion du chiffre de 200,000 actions.
D. Par conséquent Legendre savait comme vous que les 200,000 actions n’étaient pas placées?
R. Sans doute, et une circonstance me revient à l’esprit. Les questions avaient été si bien débattues, qu’à la suite de cette conférence, qui avait été très longue, M. Riant, avec lequel j’étais en froid, mit sa main dans la mienne, et nous nous embrassâmes dans le cabinet de M. Dufour. M. Legendre savait parfaitement bien que les actions n’étaient pas souscrites; j’ajoute que la maison de banque savait bien aussi que l’encaissement n’en était pas fait. Je crois, M. le Président, que j’ai répondu.
D. Ainsi vous n’assumez pas seul la responsabilité des mesures qui avaient une certaine importance; vous déclarez qu’elles étaient prises de concert avec les autres concessionnaires?
R. Oui, M. le Président.
D. Voilà votre réponse en ce qui touche Legendre. En ce qui touche Berryer, vous avez déjà répondu. Berryer et Orsi paraissent devant le tribunal comme vos complices. Ils ne sont pas considérés comme les auteurs de l’escroquerie et de l’abus de confiance, mais seulement comme s’en étant rendus complices. Orsi avait été chargé par vous de négocier un très grand nombre d’actions. Il a remis par votre ordre, à la Compagnie de Graissessac à Béziers, 12,000 actions des Docks pour un prêt de 360,000 francs. Est-ce dans l’intérêt des Docks que ce prêt était fait?
R. Évidemment, puisqu’il figure dans le bilan de 1854.
D. Mais à cette époque vous aviez un encaisse considérable: 3 à 4 millions; vous avez dû appliquer les 300,000 fr. à autre chose?
R. C’est toujours la même réponse à vous faire. Dans les questions que vous me faites, M. le Président, comme dans le rapport de l’expert, il n’est jamais tenu compte de la situation où se trouvaient les affaires de Javel et de Pont-Remy. On établit ainsi un encaisse qui n’existe pas. Dès l’instant qu’on sait que nous avions appliqué le capital des Docks aux affaires de Pont-Remy et de Javel, il est bien évident que, chaque fois qu’on établit notre position, il faut tenir compte de cette application, et on ne le fait jamais.
D. Orsi a déclaré qu’il n’avait été qu’un intermédiaire officieux dans la négociation de ce prêt; que, si vous aviez voulu le faire vous-même, vous auriez discrédité la Société des Docks, et qu’il l’avait fait en son nom, uniquement pour vous rendre service.
R. Pour rendre service à l’affaire des Docks.
D. L’encaisse des Docks était plus considérable que les dépenses; les Docks n’avaient donc pas besoin d’emprunter 300,000 fr.?
R. C’est toujours la même chose. Si l’expert avait tenu compte des sommes versées dans les caisses de Javel et de Pont-Remy, il ne serait pas arrivé à trouver un disponible aussi considérable que celui qu’il a trouvé. Si vous voulez du chiffre que vous m’indiquez, j’y consens; mais retranchez-en Javel et Pont-Remy.
D. Dans cette hypothèse même nous n’arriverions encore pas au résultat que vous indiquez, puisque l’encaisse serait supérieur de près dé 400,000 francs, car vos avances vis-à-vis de Pont-Remy et de Javel n’avaient pas, à cette époque, dépassé 2 millions. En sorte qu’il y aurait un solde créditeur de plus de 2 millions, au commencement de 1854, c’est-à-dire au moment où vous avez fait le report où figurent les 12,000 actions. Par conséquent, de quelque manière qu’on envisage la question, vous n’aviez pas besoin d’emprunter 360,000 francs.
R. Je vous demande pardon.
D. Ceci s’expliquera. Ce n’est pas la seule question que j’aie à vous adresser: Orsi a encore déposé, entre les mains du duc de Galliera, 8,000 actions pour un prêt de 240,000 francs; est-ce comme administrateur des Docks ou comme intermédiaire qu’il faisait ce nouvel emprunt pour sauvegarder votre situation?
R. Pour cela, je suis embarrassé ; ma mémoire me fait complétement défaut.
D. Orsi, quand nous l’interrogerons, éclaircira ce point. — Duchêne de Vère a donné sa démission en 1853. Ce n’était qu’une fiction, car en 1854 nous le voyons encore s’occuper des affaires tout comme auparavant. En 1853, il donne sa démission sous signature privée; en 1854, nous le voyons faire des actes publics, notamment un traité par lequel il partage avec vous les 10 pour 100 de bénéfice?
R, Il avait donné sa démission sous la réserve de tous ses droits.
D. Il était donc devenu étranger à la gestion des affaires à cette époque?
R. La date de la rupture de nos rapports avec M. Duchêne de Vère s’établira par son compte courant dans la maison Cusin et Legendre.
D. Il s’élève à 123,000 fr., n’est-ce pas?
R. Nous avons cessé nos rapports de gestion avec M. Duchêne de Vère, à l’époque où nous avons cessé de lui donner de l’argent, vers le commencement de juillet 1854. Depuis le 12 août 1854, il ne s’est rien fait dans l’affaire des Docks. Ils existaient: ils sont restés comme ils étaient. Depuis cette époque, il ne s’est fait aucune opération de vente ou d’achat à la Bourse ou ailleurs. La démission a été donnée le 20 juin, la cession des rapports a eu lieu le 15 juillet.
D. Lorsque, en 1853, vous aviez mis en circulation des actions vierges de toute opération, est-ce qu’il n’avait pas circulé des bruits fâcheux à la Bourse sur rémission de ces actions, dont le papier attestait qu’elles n’avaient pas encore été mises en circulation; n’avez-vous pas entendu exprimer des soupçons à cet égard?
R. Il m’en est revenu quelque chose.
D. Est-ce qu’à cette époque-là vous n’auriez pas fait déposer dans une chambre quinze à dix-huit mille actions, et employé un moyen assez singulier pour leur donner l’apparence d’actions qui auraient beaucoup circulé ?
R. Je ne me rappelle pas cela.
D. Mais on dit que, pour leur donner l’apparence d’actions vieillies, elles auraient été jetées dans une chambre, et que là deux ou trois personnes armées de balais les auraient bouleversées de toutes les façons?
R. Je ne me rappelle pas cette circonstance-là.
D. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre déclaration?
R. Si vous voulez bien le permettre, M. le Président, je réserverai pour la suite des débats ce que je pourrais avoir encore à dire.
LEGENDRE, 62 ans, l’un des associés de la maison Cusin, Legendre et Cie, l’un des concessionnaires des Docks.
M. LE PRÉSIDENT. Vous avez été l’associé de Cusin pour l’Union commerciale; tous les faits qui lui sont imputés relativement à cette Société vous sont communs avec lui. Vous avez été comme lui concessionnaire des Docks; tous les reproches qui lui sont adressés s’appliquent également à vous: qu’avez-vous à dire?
LEGENDRE. J’ai à dire que, lors de la concession des Docks, j’ai été envoyé en Angleterre pour traiter l’affaire Ricardo; que, pendant mon absence, les demandes d’actions ont afflué en si grande abondance, que j’ai pensé qu’on pourrait se passer des Anglais. Cependant, mes négociations avec eux avaient réussi; j’avais envoyé à M. Cusin un projet de Société signé par eux; ce n’est que plus tard que leurs exigences ont paru si exagérées, qu’on les a repoussées.
D. Vous avez dit dans l’instruction que tout se faisait sous votre nom, plutôt qu’avec votre participation; est-ce que vous vous contentiez de ce qu’on vous disait?
R. Lorsque je suis revenu à Paris, une grande quantité d’actions demandées avaient été distribuées aux différents demandeurs; maison en avait réservé pour une somme considérable aux Anglais.
D. Lorsque vous êtes revenu d’Angleterre, vous avez rapporté, dites-vous, un traité signé avec les Anglais?
R. C’était un projet de traité. Je n’étais dans cette négociation qu’un simple mandataire comme M. Riant.
D. La maison anglaise était-elle engagée par ce projet de traité ?
R. Elle l’était, sauf les conditions particulières qui restaient à discuter. On les discuta, et elles parurent si exorbitantes, que le Conseil d’administration décida que, vu les souscriptions en France, qui étaient considérables, il n’y avait pas lieu d’accéder aux propositions de la maison anglaise. C’est alors que je retournai en Angleterre.
D. Vous dites que le Conseil d’administration fut d’avis de renoncer à l’association anglaise: le contraire résulte de l’instruction. Il en résulte que, lorsque vous êtes revenu à Paris porteur de l’engagement conditionnel de la maison anglaise, ce ne serait pas le Conseil de surveillance, mais vous et Cusin qui vous seriez arrogé le droit de le repousser?
R. Tout ce que je me rappelle, c’est que, M. Cusin m’ayant dit qu’il fallait renoncer à ce traité, je retournai en Angleterre pour tâcher d’obtenir des conditions plus favorables. Je n’y parvins pas; et, comme les souscriptions en France étaient considérables, je le répète, on pensa pouvoir se passer des Anglais. Maintenant, quant à ce qui concerne la déclaration de constitution de la Société, j’ai agi de bonne foi, en toute conscience. Voyant des souscriptions aussi nombreuses que celles qui arrivaient de tous les points de la France, je crus franchement, de bonne foi, que le fonds social était souscrit.
D. Non; vous avez fait sciemment une fausse déclaration. Quelle nécessité de faire cette déclaration du 20 novembre, où vous dites que la Société est constituée, c’est-à-dire que toutes les actions sont souscrites et payées. Pourquoi ne pas attendre?
R. Pour moi, la souscription était complète. Il y a eu dans tout ceci un grand tort, selon moi: ça été de ne pas demander la moitié ou le quart du versement des actions souscrites. Si cette fraction eût été versée immédiatement, nous ne serions pas ici aujourd’hui, parce que le capital eût été complété.
D. On devait verser 125 fr. par action; c’était bien la moitié ?
R. Cela n’a pas été fait.
D. Par une raison bien simple: vous gardiez les actions par-devers vous afin de profiter de la prime?
R. Je n’en sais rien. Comme il y avait 200,000 actions souscrites, naturellement on ne pouvait pas accorder à chaque souscripteur la quantité d’actions qu’il avait demandées.
D. Vous étiez l’un des chefs de la maison de banque: votre devoir n’était pas de vous en rapporter à ce qu’on disait, mais de vérifier.
R. Quand on a confiance en son associé, comme j’avais confiance en M. Cusin, on ne songe pas à passer en revue une masse de lettres aussi considérable que celle que nous avions reçue. Je m’occupais plus spécialement du travail des bureaux. Je le répète, je croyais la souscription entière et complète lorsque j’ai signé la déclaration.
D. Est-ce que vous n’avez pas vérifié par vous-même quelle était la situation de l’affaire; de quelle manière la comptabilité était tenue?
R. M. de Mecklembourg, en qui j’avais toute confiance, faisait partie du Conseil d’administration, et il avait été décidé qu’il n’y aurait qu’une personne qui s’occuperait de l’affaire des Docks. C’est alors qu’on transporta les bureaux des Docks dans une partie de l’hôtel Laffitte, n° 27, entièrement distincte de celle qu’occupait la maison de banque. Vous pouvez demander à M. Picard, qui était à cette époque chargé de l’affaire des Docks, de quelle manière se faisait cette administration.
D. Ainsi, dès ce moment, vous ne vous êtes plus occupé de ce qui se faisait?
R. J’étais dans le cabinet; je donnais ma signature quand on me la demandait, mais toutes les opérations des Docks se faisaient dans d’autres bureaux. Quand on avait décidé une chose, M. Cusin, ou plus particulièrement la personne qui travaillait avec lui, venait me dire: «Telle chose est décidée, telle signature doit être donnée;» et la confiance que j’avais faisait que je la donnais. A chaque instant les choses étaient sur le point de se terminer, et désirant de toute mon âme que cette affaire se terminât, je donnais mon concours dans tout ce qui était possible pour la faire réussir.
D. Comment avez-vous consenti à ce que les capitaux des Docks fussent appliqués à Javel et à Pont-Remy?
R. M. Cusin vous a répondu pour moi: Javel et Pont-Remy étaient un placement pour l’argent des Docks. Je considérais ces deux affaires comme excellentes. C’est pour retirer un intérêt de l’argent des Docks, qui restait endormi, que nous avons fait ce placement-là. Je le considère encore aujourd’hui comme bon, si on veut n’y pas apporter d’entraves.
D. Vous savez bien aussi qu’à l’égard de Javel il a été fait une remise de 100 actions?
R. Il faut distinguer deux choses: Javel, affaire montée par une maison de banque, et les Docks, grande affaire qui promettait un avenir considérable. Javel pouvait nous servir puissamment à monter les Docks, c’est pour cela que nous nous y sommes livrés tout entiers comme banquiers. D’ailleurs, les placements que nous faisions à Javel avaient un caractère essentiellement provisoire.
D. Et vous faisiez ces placements avec des capitaux qui n’étaient pas vôtres?
R. J’ai eu l’honneur de vous dire, M. le Président, que l’affaire de Javel nous paraissait bonne, excellente; nous la croyions certaine. C’est pour cela que j’ai consenti à ce que des fonds inactifs y fussent placés provisoirement. Ces fonds devaient être retirés plus tard, lorsque les besoins du service l’exigeraient.
D. Votre expérience des affaires devait vous indiquer que le placement que vous faisiez ainsi, à titre purement provisoire, pouvait se prolonger au delà du terme prévu. La prudence vous interdisait donc de le faire. D’ailleurs, vous ne deviez pas affecter à Pont-Remy et à Javel l’argent des Docks, et vous ne l’avez fait, évidemment, que pour obtenir une prime de plus?
R. Vous pourriez me dire que je me suis trompé, mais non m’en faire un crime.
D. Pour vous, l’erreur était difficile. Vous aviez la lettre du Ministre qui vous disait de placer cet argent soit à la Banque, soit à la Caisse des consignations, ou de le convertir en rentes sur l’État.
R. Je n’avais pas de rapports avec le Ministre.
D. Les fonds employés à Javel sont représentés par plusieurs valeurs: il y a des actions et des obligations; avez-vous porté les obligations comme les actions à l’actif des Docks?
R. Le principe des obligations avait été établi par nous, mais la délivrance de ces titres a été postérieure.
D. Répondez à la question précise que je vous fais: Dans l’actif des Docks faites-vous figurer les obligations Javel?
R. Oui, M. le Président.
D. Depuis quelle époque?
R. Je ne saurais préciser. La délivrance des obligations n’a été faite que depuis notre arrestation.
D. Nous vous précisons à tous deux cette question, et en voici l’importance. Il y a débat entre la liquidation de l’Union, dont vous étiez les gérants, et les administrateurs provisoires des Docks. Les liquidateurs de l’Union élèvent la prétention que les obligations doivent entrer dans la caisse de l’Union. C’est comme banquiers que vous avez fait cette affaire; or vous auriez fait figurer à l’actif des Docks des actions, et à l’actif de l’Union des obligations. Et comme les obligations ont été créées postérieurement aux actions, et qu’aux termes de leur création elles priment les actions, l’Union viendrait prendre la meilleure partie de l’actif, les actions n’auraient aucune espèce de valeur. Je vous demande donc si vous avez fait figurer à l’actif des Docks les obligations comme les actions de Javel?
CUSIN. — Nous avions, par délibération du mois de juillet 1855, décidé qu’une émission d’obligations serait faite. Il fallut nécessairement un certain temps pour que ces obligations arrivassent à être confectionnées, imprimées, et tout ce qui s’ensuit. Eh bien! on ne veut attribuer à l’actif des Docks qu’une seule chose: les actions. J’ai des réserves sérieuses à faire sur ce qu’ont fait depuis les liquidateurs de l’Union commerciale, qui ont pris mon lieu et place. Je suis à même de donner des détails qui éclaireront complétement la religion du tribunal. Les liquidateurs n’ont pas le droit de faire l’attribution des obligations.
D. Cette partie des débats devant revenir, nous pouvons la négliger en ce moment.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Je soutiens, les livres à la main, qu’au moment où vous avez placé l’argent des Docks à Pont-Remy et à Javel, c’est-à-dire en 1853, je ne parle pas des obligations qui ont été prises en 1854. je soutiens qu’en 1853, lorsque vous jetiez 2 millions à Javel et 405,000 fr. à Pont-Remy, vous ne remettiez pas aux Docks les titres de ces actions, vous les gardiez dans l’Union commerciale. Ce n’est que le 12 août 1854 que, pour masquer le déficit, lorsqu’il s’est agi d’envoyer un bilan qui pût permettre l’homologation, vous avez voulu combler le déficit apparent par les titres de Javel et de Pont-Remy, que vous possédiez depuis dix-huit mois.
R. Je fais remarquer qu’un procès-verbal établit qu’une de nos premières opérations a été de tenir compte des actions de Javel. Dès ce moment donc, la maison Cusin et Legendre était dessaisie de fait de ces actions.
D. La preuve de l’inculpation, je la trouve dans votre bilan de 1853. Ce n’est qu’en août 1854 que vous avez crédité les Docks des sommes prêtées à Sèvres et à Pont-Remy. Avant cette époque, les écritures étaient passées au profit de l’Union.
R. L’Union ne pouvait passer d’écritures qu’au moment où l’acceptation était faite par les Docks. Ainsi MM. Torchet et Picard n’ont pris livraison qu’au mois de mars; c’est seulement ce jour-là que les écritures ont été passées dans l’Union commerciale.
LEGENDRE. — Quant à moi, je déclare formellement que tout ce qui a pu appartenir à Javel ou à Pont-Remy, était la propriété des Docks. Je ne me suis jamais mêlé de la comptabilité, de la tenue des livres, mais j’affirme que tout appartenait aux Docks.
M. LE PRÉSIDENT. — Avez-vous eu connaissance qu’en 1852 et 1853 des actions avaient été vendues au-dessous du cours?
R. J’en ai eu connaissance.
D. Est-ce que ce n’est pas votre fils qui s’occupait de ces négociations?
R. Mon fils était employé dans la maison, il faisait ces négociations comme d’autres.
D. Avez-vous entendu dire aussi que 12,000 actions avaient été données en nantissement à la Compagnie du chemin de fer de Béziers?
R. Dans ce moment-là, je ne m’occupais nullement des Docks, dont l’administration était tout à fait séparée de celle de la maison de banque; ce n’est que plus tard que j’ai appris qu’un dépôt d’actions avait été fait dans la Compagnie de Graissessac à Béziers.
D. Vous ne vous occupiez que de la maison de banque?
R. Pas d’autre chose; et lorsque M. Chappuis, l’inspecteur général des finances est venu, il m’a toujours trouvé confiné dans la maison de banque, où je me tenais. Chaque fois que je lui ai offert d’aller travailler avec lui, il m’a renvoyé. Un jour M. Monginot, qui a été désigné par le juge d’instruction pour faire l’expertise, est venu à Mazas, où je suis détenu, et m’a dit: Mon travail sera peut-être un peu long, mais je n’aurai jamais rien à vous demander. Et en effet, je n’ai pas revu M. Monginot.
D. Voulez-vous nous donner quelques explications sur ce fait, que vous êtes porté débiteur de 444,000 francs?
R. Je tiens à faire comprendre au tribunal qu’il y a une erreur matérielle. J’ai 250,000 francs d’actions à la souche, qu’il faut déduire. Ensuite il faut remonter un peu haut. J’étais autrefois dans le commerce des toiles, je l’avais quitté, je n’avais plus d’occupation, lorsque MM. Fréville et Comp., maison fort honorable dont M. Cusin était l’associé, manifesta l’intention de quitter les affaires et de céder ses opérations à M. Cusin. On me proposa d’entrer dans cette affaire; je fis cette observation à MM. Fréville et Comp., que je n’avais pas de fonds. Ils me répondirent que cela ne faisait rien, que je trouverais facilement ma mise de fonds, et qu’en calculant seulement les bénéfices qu’ils faisaient, dans l’espace de deux à trois ans je pourrais rembourser ce que j’aurais emprunté. En effet, ils avaient fait une belle fortune Je consentis. Je fus obligé d’emprunter. J’avais pris trois ans pour rembourser; mais la révolution de 1848 arriva et nous mit dans l’impossibilité de réaliser personnellement les bénéfices que nous devions espérer. Malgré l’extension qu’avait prise notre maison et le crédit dont elle jouissait, nous n’avions pas de bénéfices. L’époque de mes remboursements est arrivée en 1849, 1850, 1851; j’ai été obligé de les opérer. C’est alors que j’ai fait des prélèvements, mais je les ai faits sur la maison de banque, et nullement sur l’argent des Docks, puisque c’eût été au préjudice de l’établissement des Docks. Comme vous l’a dit M. Cusin, nous ne prenions que ce qui était nécessaire pour notre subsistance, 10, 12,000 francs par an. Et, remarquez que depuis l’existence de la maison de banque Cusin et Legendre nous n’y avions rien prélevé. Aujourd’hui on nous fait un crime de ce qui devrait tourner à notre avantage. 1848 avait laissé un déficit dans la maison, nous étions parvenus à le combler, et, je le répète, nous n’avions prélevé ni intérêt ni dividende, rien de ce qui avait été distribué à nos actionnaires. Nous aurions donc aujourd’hui un compte à réclamer d’eux, à leur demander ce qui devait nous revenir. Enfin, pour répondre à l’inculpation, depuis l’affaire des Docks, nous n’avons prélevé que ce qui était absolument nécessaire à notre subsistance, et ces prélèvements nous les avons faits non pas à la compagnie des Docks, mais à la maison de banque.
D. Vous dites que l’administration des Docks était dans une partie séparée de l’hôtel où était la maison de banque, que vous ne vous en occupiez pas, que vous vous occupiez seulement de la maison de banque; mais quand il s’est agi de Berryer, vous vous en êtes bien occupé ?
R. Je vous répondrai que pour moi, mettant à part sa qualité de commissaire du gouvernement, qui était officieuse, M. Berryer était la personne qui s’occupait plus que qui que ce soit de faire réussir l’affaire. M. Berryer y donnait tout son temps, il faisait des voyages à Londres, il travaillait à faire réussir l’entreprise, non-seulement avec nous, mais encore près du ministère, où je ne suis jamais allé. Il montrait à cette époque la meilleure volonté du monde, et c’est dans la conviction où j’étais que cette entreprise réussirait, que je ne balançais pas à donner à M. Berryer la rémunération de ses services.
D. Puisque vous vous occupiez de la maison de banque, vous avez dû avoir connaissance du crédit ouvert à M. Berryer, qui s’est élevé à 110,000 francs?
R. Sans doute. Pourquoi la maison de banque n’aurait-elle pas consenti à ouvrir un crédit à M. Berryer comme à d’autres personnes! Nous avons été trompés souvent, mais on ne peut pas faire un crime à un homme d’avoir ouvert un crédit à un autre homme, comme je vous l’aurais ouvert à vous, M. le Président, si vous aviez eu besoin d’argent. On rit.)
D. Mais vous avez dû savoir que ce compte ouvert s’était converti, à une certaine époque, en don?
R. Il n’y a pas eu de don du tout. M. Berryer était constamment débité sur les livres des sommes qu’on lui versait. Nous admettions que l’affaire arriverait à bonne fin par ses soins, par son travail quotidien. Supposons que cette affaire, qui a malheureusement mal tourné, eût bien tourné, il eût été dû à M. Berryer, comme à tous les autres qui s’en seraient occupés, une rémunération. Je n’aurais pas balancé à la lui donner, et, en conscience, je n’aurais pas cru faire une mauvaise action.
D. Vous aviez connaissance de l’acte qui lui accordait 100,000 francs?
R. Certainement; mais cet acte ne devait avoir d’exécution qu’autant que l’affaire serait arrivée à bonne fin.
D. Enfin vous en avez eu connaissance, c’est tout ce que j’ai à vous demander: avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vous venez de dire?
R. Rien, monsieur le Président, si ce n’est les observations que les dépositions des témoins pourront rendre nécessaires.
DUCHÊNE, DE VÈRE, 45 ans, l’un des concessionnaires des Docks.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous êtes prévenu des mêmes faits que vos deux coprévenus, Cusin et Legendre.
DUCHÊNE DE VÈRE. — Mon intervention dans cette affaire est très claire. Je suis l’auteur du plan des Docks; c’est moi qui l’ai élaboré en grande partie, je n’ai connu aucun fait de comptabilité... J’attendrai que vous vouliez bien m’interroger pour répondre. Je ne connais la plupart des faits introduits dans les débats que par l’instruction. J’ai donné ma démission assez promptement; ma participation dans l’affaire est assez légère.
D. Vous êtes sorti de l’affaire en 1853, par suite de circonstances que je ne veux pas rappeler, mais vous n’en êtes sorti qu’ostensiblement, en réalité vous y êtes resté.
R. M. le Président, l’observation n’est pas très exacte. J’en suis réellement sorti le 16 avril 1853. J’en suis sorti de telle façon que je n’y ai plus eu aucune espèce d’action. Ma démission a été connue du commissaire du gouvernement, du gouvernement lui-même, elle a été publiée, rien n’a été caché. J’avais donc perdu toute espèce d’influence sur la conduite de l’affaire. Ni mes observations, si j’avais eu à en faire, ni mon intervention n’eussent servi à rien. Je ne suis intervenu dans aucune opération subséquente. On ne m’a jamais consulté que sur la question pratique des Docks. A celle-là j’ai continué de travailler et j’aurais continué dix ans pour que l’affaire réussit; j’avais voué ma vie à son succès. J’étais donc, non dans l’affaire, mais à côté ; je n’avais ni le droit, ni le pouvoir de rien savoir de ce qui se passait dans la comptabilité.
D. Vous prétendez qu’à partir de votre démission, vous êtes resté complétement étranger aux opérations: la correspondance prouverait le contraire. Il y a entre autres une lettre de Berryer, du mois de février 1854, par laquelle il réclame que vous fassiez le voyage de Londres, de la manière la plus accélérée possible, que votre présence y est nécessaire.
R. Oui, mais il serait étrange d’induire de cette lettre de M. Berryer, qui m’appelait à Londres, que je fisse encore partie de l’administration de la Société. Cette lettre est du reste la seule qui existe, il n’y en a pas d’autre.
D. Il y en d’autres. Vous avez signé un traité avec M. Paxton, un Anglais avec lequel les Docks étaient en relation.
R. Lorsque cette lettre est arrivée, on m’a demandé d’aller à Londres pour expliquer la position des Docks aux personnes anglaises qui pouvaient être disposées à entrer dans l’affaire. J’ai longtemps habité l’Angleterre, j’y ai des relations personnelles, je parle l’anglais, et j’ai fait tous mes efforts pour attirer dans l’entreprise des capitalistes anglais. J’avais foi en cette entreprise, après ma démission comme avant; j’y ai foi encore; je la crois bonne, excellente comme affaire, je la crois surtout appelée à rendre les plus grands services au public. Sir John Paxton y entrait à ma recommandation, et c’était une très bonne acquisition, car M. Paxton s’est longtemps occupé de l’intérieur des Docks, personne ne pouvait veiller mieux que lui à la construction des Docks français, sous le rapport de l’hygiène comme sous celui de l’aménagement des marchandises.
D. Vous avez signé un traité pour partager les bénéfices, et le 20 novembre 1852 vous vous êtes associé à Cusin et à Legendre pour déclarer devant le notaire Dufour que les fonds étaient versés et que la Société était constituée.
R. C’est vrai, cette déclaration a été faite dans le cabinet de M. Dufour. Comme on vous l’a dit, j’avais la profonde conviction que les actions étaient souscrites: la maison Cusin et Legendre avait les meilleures relations possibles. Je ne doutais pas le moins du monde, je ne pouvais pas douter qu’elle fût capable d’effectuer le payement des actions prises en son nom. Je ne me suis aucunement mêlé, pour mon compte, du placement des actions, ni d’aucune opération de Bourse, et je n’ai jamais possédé une seule action.
D. On dit cependant qu’à une certaine époque vous auriez été détenteur de 200 actions.
R. Jamais.
D. Ce fait a été énoncé par Cusin. (A Cusin.) Un de vos employés vous a demandé des renseignements à cet égard, à l’occasion d’un titre de 200 actions qui avait été remis à Duchêne de Vère?
CUSIN. — Effectivement, M. Duchêne de Vère doit se rappeler qu’il m’a fait remettre un jour un paquet de souches jaunes s’appliquant à 200 actions que lui avait donné M. Carteret.
DUCHÊNE DE VÈRE. — Je ne m’en souviens pas.
M. LE PRÉSIDENT. — Enfin vous n’avez jamais eu d’actions?
R. Jamais.
D. Mais la maison de banque vous avait ouvert un crédit de 123,000 fr.
R. C’est une erreur. C’est la première fois que j’entends parler de cette somme. J’ai pris, je crois, 116,000 francs, dont j’ai payé les intérêts, n’ayant aucune espèce d’appointements, n’ayant rien prélevé sur les Docks.. Je n’ai pris que le strict nécessaire pour mes voyages multipliés à Londres, et pour les dépenses très considérables que nécessitait l’état de vie que je devais tenir à Londres, dans l’intérêt dés Docks. Si l’affaire eût réussi, il est évident que j’aurais reçu une indemnité, soit à titre d’appointements, soit a tout autre; rien ne m’eût été plus aisé que de justifier de mes dépenses à la liquidation ou à n’importe qui, et cette indemnité m’aurait servi à rembourser MM. Cusin et Legendre.
Arthur BERRYER, 45 ans, commissaire du gouvernement près la Compagnie des Docks
M. LE PRÉSIDENT. — C’est au mois de février 1853 que vous avez été nommé Commissaire du gouvernement près de la Compagnie des Docks?
BERRYER. — Oui, M. le Président.
D. Dans la lettre par laquelle le Ministre vous faisait part de votre nomination, il vous annonçait qu’un traitement de 5,000 francs était attaché aux fonctions que vous alliez remplir?
R. Oui, M. le Président.
D. Quelque temps après, vous avez consenti à recevoir un supplément de traitement de 1,250 francs par mois?
R. M. le Président, il serait nécessaire de dire quelle était ma position aux Docks; quelques explications sont pour cela indispensables.
J’ai été nommé par M. de Persigny qui attachait, comme vous le savez, une très grande importance à l’entreprise. M. de Persigny désirait avoir une connaissance exacte des choses telles qu’elles étaient, et non telles qu’elles étaient annoncées. M. de Persigny me chargea, par un intermédiaire des plus honorables, le 10 mars 1853, c’est-à-dire quelques jours après ma nomination, de lui faire un rapport sur les Docks. Je fis ce rapport. Je signalais au Ministre qu’au lieu de 200,000 actions placées, il n’y en avait que 85,000, et que les livres ne me semblaient pas avoir le caractère commercial exigé en pareil cas; qu’ils étaient bien tenus d’après un brouillard, mais qu’ils n’étaient pas revêtus d’un véritable caractère commercial. Le Ministre ne me fit aucune espèce d’observation.
A quelque temps de-là, il me demanda un état de situation des Docks; je lui envoyai un nouveau rapport très détaillé dans lequel je l’avertissais que le capital des Docks n’était pas fait et que la Société était dans l’impossibilité de marcher. Il ne me fut fait aucune espèce d’observation.
. Un peu plus tard, j’ai fait un troisième rapport au Ministre, où j’expliquais la difficulté de ma situation. Les Docks étaient une Société en commandite qui n’était pas soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement, les concessionnaires m’avaient accepté officieusement, ils pouvaient me refuser les communications que je leur demandais. Enfin, je ne laissais rien ignorer de la situation administrative des Docks.
Dès mon entrée, j’avais demandé aux concessionnaires tous les documents qui pouvaient établir la situation de la Société. Il y avait en caisse une somme considérable qui n’était pas représentée en valeurs. Je fis des observations. MM. Cusin et Legendre m’écrivirent une lettre par laquelle ils m’annonçaient que cette somme était dans leur maison de banque. Je communiquai cette lettre au Ministère de l’agriculture et du commerce. En réponse, le Ministre, qui était alors M. Magne, chargea le directeur général, M. Heurtier, d’inviter ces Messieurs à déposer les fonds disponibles à la Caisse des Consignations, ou de les convertir en bons du Trésor. Le Ministre savait donc parfaitement quelle était la situation des Docks.
Pendant que je suivais cette affaire avec un caractère officiel en apparence et sans être soutenu officiellement, une chose me frappa, qui me frappe encore aujourd’hui, c’est que la question des Docks, qui est cependant une question vitale, n’était connue de personne au ministère, on n’en savait absolument rien. Pendant quinze ou dix-huit mois, j’eus de fréquents entretiens, soit avec le Ministre, soit avec M. Heurtier. Je ne cessais de leur expliquer que, si les Docks rencontraient des difficultés financières, il y en avait une plus grave encore: c’était que la question technique n’était connue de personne, ni de ceux qui devaient les faire fonctionner, ni de ceux qui devaient les surveiller.
Le Ministre fut frappé de cette situation. La question financière pour les Docks se compliquait à ce moment par la retraite de M. Pereire, par les échéances des achats de terrains qu’avait vendus le chemin de fer de Saint-Germain, et enfin par les travaux de-déblais à la place de l’Europe qui absorbaient aussi une somme très considérable. Je n’ai jamais pu, et cela vous le comprendrez très facilement après l’instruction qui a eu lieu, je n’ai jamais pu avoir une connaissance exacte de l’état financier des Docks. Du reste, je l’ai dit souvent au Ministre, je ne suis pas comptable, j’ai très peu d’aptitude à surveiller une maison de banque, ou une administration financière. Ce qui me préoccupait, c’était la question des Docks en elle-même, c’est pour celle-là que j’ai déployé, autant que je l’ai pu, mon intelligence et mon activité.
J’ai expliqué au Ministre que la situation financière était très critique, que M. Pereire se retirait au moment où il n’y avait plus de ressources et où sa retraite pouvait tuer même une société considérable. La Société allait crouler, et je regardais sa chute comme un malheur public, et à cause du nom qu’elle portait, celui du chef de l’État, et à cause de l’institution qui pouvait rendre de si grands services au pays.
C’est à ce moment que je demandai à aller en Angleterre. Tout à l’heure M. le Président disait que le Ministre n’était pas instruit de la manière dont je recevais de l’argent, je lui en demande pardon. J’avais expliqué à M. le directeur général que les concessionnaires, dans la situation où ils se trouvaient comme question d’argent, voulant faire étudier la question technique, désiraient que les frais de mon voyage en Angleterre fussent supportés par eux. Je vais préciser le fait, et on pourra citer les témoins. J’en causai à plusieurs reprises avec M. Heurtier, et dans une dernière entrevue à ce sujet, je lui rappelai l’offre des concessionnaires. M. Heurtier me répondit: C’est tout simple. Je vais chez MM. Cusin et Legendre et je dis: Le Ministre m’autorise à prendre chez vous l’argent nécessaire à ma mission. Je reçus ma mission, mes passe-ports et des introductions près diverses personnes de Londres. On produira les lettres de recommandation. Je sais parfaitement que le gouvernement français appuie ses envoyés; pour les employés de deuxième ordre, comme je l’étais alors, les appuis sont en général extrêmement réservés: aussi, ce qui va vous frapper, c’est qu’au lieu de simples lettres de recommandation, j’avais des lettres officielles; j’étais recommandé à M. le comte Walewski, ambassadeur, à M. Herbert, consul général, dans des termes très chauds. On savait parfaitement que mon nom, le nom très-honorable que je porte et qui reçoit aujourd’hui une si profonde humiliation en moi, pouvait servir à la solution de la question des Docks. En apparence, je n’allais en Angleterre que pour étudier la question pratique.
J’y suis arrivé... Mais auparavant je dois, pour bien préciser les faits, parler d’une scène qui s’était passée chez M. Fleury, chef de la division du commerce extérieur. C’était vers le 7 décembre 1853, je lui annonçai que je partais. Il me demanda quels fonds subviendraient à mes dépenses; je lui répondis que les concessionnaires y pourvoiraient. Il s’emporta, il me dit que M. Heurtier ne savait pas ce qu’il faisait; que je ne pouvais pas, étant l’agent du gouvernement, recevoir de l’argent des concessionnaires. Il ajouta qu’il ne me remettrait pas des documents si je partais dans ces conditions.
Cependant, trois jours après je reçus un passe port et des lettres de recommandation. Auparavant j’avais reçu, le 5 décembre, une lettre de M. Heurtier, dans laquelle il me disait: «Puisque vous vous êtes pourvu ailleurs de la question d’argent, vous pouvez partir.»
Je suis arrivé en Angleterre, comme je vous le disais, aussi appuyé que possible. Quand j’ai cherché à traiter la question des Docks Napoléon, je dois vous le dire franchement, en Angleterre tout le monde m’a ri au nez. On se demandait ce que pouvait être un dock à Paris; le nom tout d’abord présentait un non-sens. On se demandait, d’un autre côté, quelles pouvaient en être les alimentations. J’expliquai la situation dans laquelle se trouvait le commerce parisien. Je dis que presque toutes nos denrées sont soumises aux lois de douane, aux droits d’octroi, que ces dépenses sont toujours lourdes. pour le commerce, et qu’il était nécessaire d’avoir des entrepôts qui facilitassent la transmission des marchandises sans frais d’avances pour les divers négociants.
Soit que je fusse dans le vrai, soit qu’on m’accordât quelque bienveillance, après quinze jours passés en Angleterre, je revins en France parfaitement renseigné. J’avais écrit étant en Angleterre une lettre à l’ambassadeur, M. Walewski. Dans cette lettre, je lui expliquais très au long la situation que j’avais prise et qu’on m’avait laissé prendre très facilement.
Le 31 décembre 1853, j’étais revenu en France; je dis au Ministre que j’entrevoyais la conclusion de l’affaire des Docks. Pendant mon séjour à Londres, je m’étais abouché avec les personnages les plus importants, avec des hommes dont les noms sont illustres, qu’on avait fait nobles à cause de leurs travaux, auxquels on avait prodigué les plus hautes distinctions publiques.
Dès cette époque, le gouvernement avait entre ses mains les plans, je les ai vus; ils doivent exister encore. Dans cette situation, on pouvait faire pour 20 ou 25 millions de constructions. J’allai trouver sir Charles Fox et M. Henderson, son associé. Je leur expliquai l’état des choses, non pas seulement au point de vue des constructions, mais de l’administration. MM. Fox et Henderson furent tellement frappés de ce que j’avais pu leur dire, que non-seulement ils ouvrirent l’oreille à nos propositions, mais qu’ils s’engagèrent à souscrire pour 50,000 actions, soit 12 millions de capital.
Le gouvernement connut donc l’effet de ma première démarche en Angleterre, il le connut si bien, qu’il m’autorisa à repartir pour suivre mes démarches au point de vue du capital et de mes études spéciales sur la question des Docks... Je vous demande pardon d’être un peu long, mais ces explications sont nécessaires pour me laver de l’accusation. Je retournai en Angleterre.
Comme j’avais l’honneur de vous le dire tout à l’heure, j’avais reçu de M. le comte Walewski un accueil plein d’une excessive bienveillance. Je reçus alors de toutes les personnes qui étaient haut placées à Londres, soit dans l’industrie, soit dans le commerce, soit dans la finance, soit dans la diplomatie, les mêmes témoignages de bienveillance. Je prie M. le Président de vouloir bien remarquer que je n’ai eu de relations à Londres qu’avec les hommes les plus éminents, que je ne suis jamais descendu aux relations de bas étage, ni à celles de l’agio, quoique je me sois abouché, pour ainsi dire, avec de bien nombreuses personnes. Je puis vous prononcer les noms des personnes qui, après les honorables relations qui m’ont rapproché d’elles, seront profondément étonnées de me voir dans cette enceinte. Ce sont en effet: sir John Bowring, aujourd’hui gouverneur de Hong-Kong; de Mac’Culloch, le plus éminent économiste anglais; lord Palmerston; Ed. Cardwell, l’élève le plus distingué de sir Robert Peel; sir Thomas Freemantle, le directeur des douanes; M. Humel, solicitor général des douanes, qui est l’un des savants les plus éminents parmi les jurisconsultes de ce pays. Voilà les hommes avec lesquels j’avais des relations, avec lesquels je cherchais à sauver l’institution créée par le décret du 17 septembre 1852.
Je suis entré dans ces relations, et avec le bienveillant appui de ces hautes intelligences j’ai commencé à soulever le voile de cette puissance anglaise, dont nous voyons les effets, dont nous ne connaissons pas la cause. J’ai vu que l’Angleterre n’était forte et n’inondait le monde de ses produits que parce qu’elle accordait au négociant la plus grande facilité pour monnayer sa marchandise; ce spectacle m’a frappé d’admiration.
Tout me souriait alors, l’alliance faisait qu’on m’ouvrait les bras, j’en ai profité. J’ai fait tout ce qu’il était possible au monde pendant trois ans, pour importer dans mon pays cette institution. Je l’ai fait avec entraînement; j’y ai dépensé mon activité, mon temps, mon argent.
L’accusation m’oppose un compte de 140,000 francs avec la maison de banque Cusin et Legendre; je puis en faire un autre. Quand je me suis marié, j’avais 350,000 francs en réunissant ma fortune à celle de ma femme, j’ai eu en trois ans le maniement de 250,000 francs. J’ai reçu de la Société des Docks 110,000 francs, 140,000 francs, si vous voulez, le chiffre sera plus élevé. J’avais reçu de ma femme 50,000 francs de capitaux par contrat de mariage; j’avais, avec mes appointements de 5,000 fr., 20,000 francs de revenus. J’en dépensais 30,000 pour les dépenses de ma maison, de ma vie, soit, pour trois ans, environ 100,000 francs. J’ai mis tout le reste dans l’affaire des Docks; j’étais amené à cette dépense pour me tenir au niveau des relations honorables que j’avais liées. J’ai travaillé avec courage, et je persévérerai malgré la honte que je subis aujourd’ hui, parce que la pensée que je suis est une noble pensée. Vous savez quelle était ma situation politique et le nom que je porte; mais vous ne savez pas la douleur que j’ai causée à mon père en acceptant les fonctions que j’ai remplies: en suivant la voie que je m’étais tracée, ma persévérance ne peut être justifiée que par le but honorable que je me suis proposé...
Je suis retourné en Angleterre. Il s’agissait de lier une combinaison française et anglaise; les personnes avec lesquelles j’étais en rapport ont immédiatement accepté mes idées. A la suite de conférences préliminaires, on a discuté un traité, pas avec moi, pas en ma présence.
Une question préliminaire avait été posée par moi, je veux parler de la remise. Ce n’était pas une remise d’argent, une remise à titre de cadeau; jamais, à ma connaissance, il n’en a été fait, jamais il n’a dû en être fait. Il en avait été question dans le but que voici (je n’accepte pas pour moi ce qui a été expliqué par les concessionnaires, je m’explique, moi, vis-à-vis du tribunal). M. Fox, en entreprenant les travaux, s’engageait à faire Souscrire des actions pour une somme considérable; mais M. Fox, pour apporter un concours d’argent, devait se trouver vis-à-vis d’une Société parfaitement liquide en ce qui regarde les capitaux.
Je discutais avec M. Fox cette question d’une remise; M. Fox me dit: Je ne fais pas de remise. Je lui explique alors que cette remise n’est pas un cadeau à faire, mais une manière de couvrir une perte qu’on m’avait dit exister sur le capital des Docks au détriment des actionnaires. Je disais à M. Fox: Vous comprenez très bien que ce déficit, comblé par l’abandon d’une partie de vos bénéfices, remettra immédiatement l’affaire tellement en bonne situation, que toutes les personnes auxquelles vous proposerez d’y entrer s’empresseront de le faire, tandis que si vous la présentez avec un déficit, il est évident que personne ne voudra y entrer. Voilà la considération vraie, exacte, qui m’a amené à parler d’une remise. Je n’ai Jamais eu aux Docks le maniement, la direction d’aucuns fonds. J’affirme, malgré l’accusation qu’on fait peser sur moi, que je n’ai jamais reçu une action. Si j’avais voulu me faire faire des cadeaux, vendre mon silence, il m’était très facile de recevoir de la main à la main. Loin de là, j’ai donné récépissé de toutes les sommes que j’ai reçues de la maison Cusin et Legendre. On a pris ma correspondance particulière, on y a cherché des accusations; on n’y a vu qu’une gêne d’argent. Quand on est lancé dans une entreprise comme celle où je m’étais engagé, quand on poursuit un but comme celui que je poursuivais, il peut vous survenir des gênes d’argent. Qu’a-t-on vu dans la gêne que j’éprouvais? J’empruntais, mais je devais rendre ou par des travaux, des dépenses ou de l’argent; et la preuve que je n’avais qu’un compte courant, c’est que je donnais un reçu de toutes les sommes que je recevais. Je n’ai jamais eu dans l’affaire des Docks qu’un compte parfaitement clair, considérable peut-être, mais qui s’expliquait par les dépenses que j’étais forcé de faire. Outre les 110,000 francs que j’ai reçus des Docks, et mes revenus, il s’est trouvé dans ma fortune une disparition de 60,000 francs, constatée par la séparation de biens que je viens de faire avec madame Berryer.
Pour revenir à l’affaire des Docks, dès que MM. Fox et Henderson ont été abouchés avec les concessionnaires, je n’ai plus eu de relations avec eux. Je me suis si peu occupé du traité, que j’étais en Angleterre lorsqu’il se passait à Paris.
J’ai poursuivi l’affaire des Docks avec une ardeur incroyable. M. le Président disait tout à l’heure ou donnait à entendre qu’on m’abandonnait une somme d’argent pour que je me fisse aveugle ou muet. Je n’ai été ni l’un ni l’autre. Tous mes rapports, jusqu’au mois de septembre 1855, font connaître absolument la situation au Ministre. Le Ministre ne pourrait pas me démentir. J’ai eu avec lui (tantôt M. Magne, tantôt M. Rouher) vingt conversations particulières, dans lesquelles je lui ai dit qu’il fallait sauver à tout prix les Docks dans l’intérêt public aussi bien que dans l’intérêt des actionnaires. On ne l’a pas voulu. J’ai proposé les moyens les plus honorables, les plus pratiques, les seuls possibles encore aujourd’hui,, si on ne veut pas étrangler dans une question personnelle une question d’intérêt public.
J’ai fait trois, quatre, six rapports, je n’ai rien caché, je n’avais aucun intérêt à rien cacher. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à pallier les mauvaises actions. Je crois qu’il est beaucoup plus facile de n’en pas faire. Je n’en ai pas fait, je n’en ai pas voulu faire; je suis resté persévéramment dans l’affaire des Docks dans le principe, et j’y ai consacré tout ce que j’avais de force et d’intelligence.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez prétendu, il y a un instant, qu’on n’avait en aucune façon ignoré au ministère du commerce à quelle source vous puisiez l’argent de vos voyages. Vous avez été jusqu’à dire que vous aviez annoncé qu’il vous était fourni par les concessionnaires. Le contraire résulte de la correspondance. Il y a une lettre au dossier dans laquelle le Ministre ou le directeur général vous faisait sentir précisément que ce n’étaient pas les concessionnaires qui devaient fournir de pareils fonds, et vous répondiez à ce scrupule en disant: «Je me suis pourvu, et c’est
» avec mes ressources personnelles que je fais les frais de voyage.» Dans cette même lettre, vous allez au-devant, des explications qui pourraient vous être demandées, vous faites connaître vos ressources; vous allez plus loin: vous parlez du département de la Drôme et du banquier sur lequel vous pouviez tirer des traites.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Voici la lettre que vous écriviez:
«Monsieur le Directeur général,
» Vous désirez savoir avec quels fonds je pourvoirai aux dépenses de voyage
» que je vous ai demandé de faire en Angleterre pour y étudier des Docks.
» J’ai l’honneur de vous faire savoir que c’est sur mon avoir personnel que je
» prélèverai la somme qui me sera nécessaire. Pour que vous connaissiez plus certainement
» ma position, je fournis à mon banquier des traites sur Valence
» (Drôme) auxquelles les loyers que j’ai à toucher au premier janvier prochain
» feront face.
» Si le résultat de mes recherches en Angleterre est utile aux vues du gouvernenement,
» j’ai toujours pensé que je serais par lui indemnisé de mes déboursés.»
R. Cette lettre a été écrite dans le cabinet de M. Heurtier, à la suite d’une conversation que nous avions eue. Il m’avait dit: Il n’est pas dans l’ordre de vous donner une réponse catégorique pour vous autoriser à demander l’argent de vos voyages aux concessionnaires; écrivez-moi un mot pour me dire que vous ferez vous-même les fonds. Je répondis à M. Heurtier : Voici ce que je peux faire: je peux prendre les dépenses à mon compte personnel, et puis je réglerai avec le banquier qui m’avancera sur des prêts apparents. C’était en effet la première combinaison, c’était ainsi que devaient se faire les choses. Mais, en y réfléchissant, M. Heurtier me dit: Écrivez-moi une lettre (lettre à laquelle il n’a pas répondu), où vous me direz que vous prenez les fonds sur vos ressources personnelles. C’est la discussion que j’avais eue avec M. Fleury, et dont je vous ai parlé tout à l’heure, qui avait amené cet échange de lettres. C’est uniquement pour la régularisation administrative qu’on m’a fait écrire cette dernière lettre. Il ne faut pas qu’il y ait ici la moindre amphibologie; si quelque doute restait dans l’esprit du tribunal, je demanderais qu’on citât M. Fleury; il ne pourra pas nier la scène qu’il a eue avec moi.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous prétendez que M. Fleury était instruit que vous deviez faire le voyage de Londres sur les fonds des concessionnaires. Eh bien! voici une lettre où vous dites que M. Fleury veut ajourner le voyage parce qu’il n’y a pas de fonds au budget de l’année. On préparait alors le budget de l’année suivante.
R. C’est encore un billet écrit dans le cabinet de M. Heurtier.
D. Il est signé de vous.
R. Oui; mais la signature ne dit pas la date du billet. Ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que pendant trois ans il y a eu pour cette affaire des Docks un labeur qui surpasse les forces humaines. On ne se rend pas compte de la position d’une Société qui porte le nom du chef de l’État et qui se trouvait dans cette situation, autour de laquelle, si j’osais ainsi parler, rôdaient comme des loups dévorants des hommes qui voulaient l’absorber. Eh 1 messieurs, je ne puis pas avoir la tête assez puissamment organisée pour dire après trois ans la date précise d’un billet que M. Heurtier m’obligeait à lui écrire inopinément.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez fait connaître au tribunal que lorsque vous aviez été nommé commissaire du gouvernement, votre premier soin avait été de faire un rapport sur la situation où se trouvait l’affaire, vous avez signalé notamment que les livres n’étaient pas tenus dans la forme commerciale. Ceci est parfaitement vrai.
Vous avez ajouté que le Ministre avait été trompé par les déclarations qui lui avaient été faites sur le capital qui n’était pas encore souscrit. Vous avez dit, dans votre rapport du 22 mars 1853, un mois après votre entrée en fonctions, qquel était alors le chiffre exact des actions souscrites, environ 85,000; tout ceci est parfaitement exact, et le Ministre a dû, à partir de ce moment, connaître la situation de l’affaire.
Dans le cours de la même année, vous avez fait un second rapport, et, dans ce second rapport, en date du 11 septembre 1853, vous avez signalé 4 millions 191,549 francs (je prends vos chiffres) en caisse. Jusque-là vous paraissez avoir parfaitement compris et rempli votre devoir et sauvegardé les intérêts qui vous étaient confiés. Mais à ce rapport du mois de septembre, le Ministre a répondu; il s’est préoccupé de l’emploi de la somme considérable que possédait la Société des Docks et dans sa lettre du 1er octobre 1853, il vous a dit: «La Société des Docks ayant plus de 4 millions en caisse, je vous invite à veiller à ce que cette somme reçoive l’emploi que j’ai indiqué ;» et en même temps, il vous annonçait qu’il avait écrit à Cusin et à Legendre de ne pas conserver en caisse la somme de 4 millions 191,549 francs, mais de la convertir en bons du Trésor. Vous étiez donc parfaitement renseigné sur les prescriptions faites par le Ministre à Cusin et à Legendre.
Plus tard vous avez été invité à donner de nouveaux renseignements au Ministre, par suite de plaintes formées par un grand nombre d’actionnaires, qui trouvaient que l’affaire ne produisait pas les résultats auxquels on devait s’attendre; qui s’étonnaient que dix-huit mois se fussent écoulés sans que les statuts eussent été observés, sans que l’assemblée générale eût été convoquée, sans qu’ils eussent reçu un sou d’intérêt, et qui allaient jusqu’à suspecter la bonne foi des gérants. On vous demande, à vous commissaire du gouvernement, des renseignements. Vous écrivez au Ministre, et dans votre lettre du 24 mai 1854 vous lui déclarez que vous vous êtes livré aux investigations les plus nombreuses et les plus minutieuses; que vos impressions, d’abord favorables aux actionnaires, se sont modifiées par suite d’un examen plus attentif, et que leurs plaintes sont sans fondement. Vous ajoutez, pour calmer les inquiétudes du Ministre:
«Je viens d’examiner la position financière des Docks. La maison Cusin et Le
» gendre est débitrice de 4 millions 976,000 francs. Je me suis assuré que ce solde
» de près de 5 millions a reçu l’emploi le meilleur, dans les. conditions les plus
» désirables, celles qui présentent la plus entière sécurité...»
Ce n’est pas tout: sachant qu’une partie de cette somme avait été versée dans la caisse des Sociétés de Pont-Remy et de Sèvres, vous ajoutez ceci:
«Ce sont des placements sur hypothèque de premier ordre, sur des immeubles
» présentant les plus entières sûretés.»
Comment pouvez-vous expliquer un pareil langage?
R. J’avais demandé des renseignements à MM. Legendre et Cusin, qui m’avaient fait connaître leur situation vis-à-vis des Sociétés de Javel et de Pont-Remy. Ceci doit se rapporter à la fin de décembre 1853. Ces Sociétés avaient, à cette époque là, une valeur réelle et certaine, et un avenir qui devait inspirer toute confiance. En présence de la demande du Ministre, je priai ces messieurs de m’éclairer sur la situation vraie de ces entreprises, que je ne connaissais même pas de nom. Ils me répondirent que la valeur de Javel et de Pont-Remy était beaucoup plus considérable que le placement qu’ils avaient fait des fonds des Docks sur ces établissements; que non-seulement la valeur intrinsèque de ces immeubles était là pour garantie, mais que les titres qu’ils avaient primaient tous les autres titres.
Vous me parlez d’une lettre du mois de mai, il y en a une postérieure. Lorsque je suis entré un peu plus avant dans l’affaire, j’ai reconnu qu’il n’y avait pas de placement hypothécaire, mais bien des valeurs qui comprenaient dans leur avoir des immeubles. C’était à cela que s’appliquait le mot hypothécaire. Peu de temps après, dans une lettre au Ministre, j’ai rectifié cette expression.
D. Il y a une nouvelle lettre du Ministre du 17 juin 1854, qui vous demande comment il se fait que dans un de vos rapports vous ayez fixé l’encaisse à 4 millions 191,540 fr., et dans l’autre à 4 millions 937,965 fr, Il vous demande une explication sur cette différence. Il vous demande ensuite en quoi consiste le placement hypothécaire dont vous avez parlé, et il ajoute que dans des affaires de cette nature il y a obligation pour le département du Commerce d’exercer un contrôle sévère.
R. Je comprends que le Ministre demande un contrôle sévère: mais lorsqu’on vient lui dire qu’une Société qui se prétend constituée avec 200,000 actions n’en a que 85,000, que les livres ne sont pas réguliers; quand un commissaire du gouvernement dit cela au Ministre, et que le Ministre ne répond rien, que voulez-vous que fasse le commissaire? Pouvais-je lui donner des renseignements plus propres à éveiller son attention? Cent fois je me suis plaint à lui de cette situation, et jamais mes plaintes n’ont amené aucun résultat. On ne prenait aucune mesure ni dans l’intérêt de l’institution, ni dans l’intérêt des actionnaires. Vous ayez des lettres de moi où j’indiquais les mesures qu’il y avait à prendre. On me répondait qu’il s’agissait d’une Compagnie non autorisée, que le gouvernement n’avait pas à en connaître; véritablement, il fallait pour persévérer toute l’ardeur de ma conviction, de ma foi dans les succès de l’affaire. Oui, cent fois j’ai averti le Ministre; vous avez une lettre, vous pouvez la lire; cent fois j’ai dit à M. Magne et à M. Rouher, qui lui a succédé, qu’il fallait sauver la Compagnie dans l’intérêt de l’institution et dans l’intérêt non moins sacré des actionnaires qui perdaient leur argent. J’ai eu un jour avec M. Magne une scène des plus vives, une scène telle que je suis sorti de son cabinet; il m’a rappelé, mais il n’a pris aucune mesure, et M. Rouher n’en a pas pris davantage. Après tout, je ne veux pas aller au fond des choses... Mon Dieu! messieurs, vous avez fait une instruction, vous l’avez faite très longue, et aujourd’hui que nous sommes en accusation, vous voyez que nous sommes en présence du chaos.
D. Il me sera facile de vous prouver que ce que vous appelez le chaos c’est la lumière.
Me MARIE. — Ce serait, dans tous les cas, la lumière après dix-huit mois de travail.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Au lieu de parler de chaos, il serait plus simple de donner cette lettre rectificative, par laquelle vous prétendez avoir averti le Ministre qu’il n’y avait pas de placement hypothécaire.
Me MARIE. — Nous la chercherons.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous demandiez quelle était la situation d’un commissaire impérial et ce qui lui restait à faire après avoir fait connaître la situation de la Compagnie près de laquelle il était placé. Eh bien! je vous dirai que le devoir du commissaire impérial était de ne pas dire que l’encaisse des Docks était placée sur des valeurs hypothécaires offrant toute sécurité ; que vous vous étiez livré à un contrôle très sérieux, et que vous aviez acquis la certitude que les intérêts des actionnaires n’étaient pas en péril. — Ce qu’il fallait dire, c’était précisément le contraire de ce que vous avez dit. Au lieu d’écrire que l’encaisse des Docks était placée de la manière la plus sûre sur hypothèque, il fallait dire que 5 millions appartenant aux actionnaires avaient été imprudemment, frauduleusement jetés dans les Sociétés de Javel et de Pont Remy, et voilà ce que nous ne trouvons nulle part dans vos rapports. Avez-vous jamais parlé de cette transformation qu’avait subie l’encaisse des Docks?
R. Parfaitement. Les faits étaient entièrement connus du Ministre. Ils l’étaient tellement que le bilan du 12 août 1854, qui suit cette lettre de quelques jours, parle des valeurs de Javel et de Pont-Remy. Si ces valeurs n’avaient pas été connues du Ministre, il y avait une chose toute simple à faire: c’était, en recevant le bilan, de me dire: Donnez-moi des explications. (M. l’Avocat impérial me demandait tout à l’heure une lettre qu’on cherche et qu’on va trouver.) Le Ministre, en recevant ce bilan, aurait dû demander au commissaire du gouvernement quelles étaient ces valeurs. Il ne l’a pas demandé.
Vous me citiez tout à l’heure les plaintes des actionnaires: il y avait des choses très-graves qui pouvaient être très-fondées; aussi la réponse que je fais est toute spéciale. En effet, un grand nombre de gens ne cherchaient qu’à devenir maîtres des Docks. Je ne veux suspecter l’intention de personne, mais la lettre qui est sous vos yeux ne se rapporte qu’à un fait de cette nature. Il s’agit d’un actionnaire très-considérable qui avait voulu entrer dans l’affaire, qui avait fait des propositions à MM. Cusin et Legendre, qui était venu chez moi me demander s’il n’était pas possible d’évincer le personnel et de se mettre en son lieu et place. C’est à l’occasion de ce fait que j’ai écrit au Ministre que les plaintes des actionnaires n’étaient pas aussi fondées qu’elles paraissaient l’être.
D. Vous avez dit tout à l’heure que vos voyages en Angleterre étaient parfaitement connus du Ministre, et que tout le temps que vous aviez passé en Angleterre était, pour ainsi dire, la conséquence d’une mission que vous aviez reçue. Il paraît qu’il n’en serait pas ainsi, car nous avons une lettre adressée par le Ministre du commerce à son collègue des affaires étrangères, à la date du 17 juin 1854, et dans cette lettre nous lisons ce paragraphe:
«M. Berryer n’avait d’ailleurs aucun caractère pour traiter cette affaire, l’intervention
» du commissaire du gouvernement près l’entreprise des Docks, dans
» une transaction ayant pour objet de reconstituer cette entreprise, eût présenté,
» à l’étranger surtout, des inconvénients réels.»
Enfin, le Ministre des affaires étrangères avait consulté le Ministre du commerce, et ce dernier lui répondait que vous n’étiez pas autorisé à agir en Angleterre dans votre qualité de commissaire du gouvernement.
R. Le ministre a pu écrire cela, mais le fait n’en était pas moins connu du ministère. Quelqu’un s’est-il avisé de dire au commissaire du gouvernement : «Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas?» Bien loin de là : lorsque, après le traité avec la maison Fox et Henderson, je suis revenu à Paris (c’était vers la fin de février), j’ai été chez M. Magne: il m’a vivement complimenté sur les résultats que j’avais obtenus.
D. Tout cela n’explique pas la lettre du ministre de l’agriculture et du commerce à son collègue des affaires étrangères.
R. Le ministre de l’agriculture et du commerce pouvait écrire ce que bon lui semblait: il était mon supérieur... Du reste, les journaux ont fait grand bruit de ma présence à Londres. On m’a présenté à la reine; j’ai été reçu dans les maisons de la plus haute société ; j’étais, pour ainsi dire, avoué du gouvernement, on m’écrivait officiellement du ministère en Angleterre; il ne s’est pas passé un jour où ma situation à Londres n’ait été connue au ministère. Il y a même ceci de remarquable que, dans une circonstance, le Ministre avait refusé de m’y laisser aller. Du reste M. Magne et M. Rouher, qui lui a succédé, ont eu en maintes occasions l’explication de mes voyages en Angleterre; ils ont su que j’y étais pour étudier la question des Docks. Ils ont su les personnages que j’y voyais, les gens dont j’étais entouré. Voyez de quelle manière j’agissais: je n’agissais pas comme quelqu’un qui faisait une mauvaise action; je ne stipulais rien.
Vous me parlez d’un traité dont j’ai retrouvé une copie dans le rapport de l’expert. Ce traité n’a jamais eu le sens qu’on lui prête. Ce traité a été fait sans que la personne pour laquelle on le faisait ait su de quoi il s’agissait. C’est, je crois, un M. Tenain qui l’a écrit; il pensait qu’il s’agissait d’un marché, probablement. Il a été fait en d’autres termes une copie de ce traité, qui a été complétement modifié. Il a été déposé chez M. Dufour, notaire. Comme l’affaire des Docks prenait une tournure qui me décidait à me retirer, je demandai l’anéantissement de ce traité ; il a été anéanti. Voilà quelle est ma situation vis-à-vis de la pièce que l’on m’oppose.
Ce traité anéanti établissait ce qu’on a appelé des marchés. Je me trouvais dans une situation telle, que depuis les trois ou six mois qui s’étaient écoulés depuis mon immixtion active dans l’affaire, je n’avais aucun nantissement, aucune garantie de mes dépenses de la part de ces messieurs; je me trouvais à découvert des sommes qu’ils m’avaient avancées, à moins que je ne pusse justifier de mes dépenses. Je ne puis pas accepter le traité qui est reproduit.
D. Dans une lettre que vous écriviez au Ministre, et dans laquelle vous vous disiez chargé, de concert avec les sieurs Stockes et Carteret, d’établir la situation financière de la Compagnie, dans cette lettre, du 12 septembre 1854, nous trouvons une phrase sur laquelle nous avons une explication à vous demander:
«Quant à la présence de mon nom parmi les actionnaires de la Compagnie des
» Docks et des administrateurs futurs de cette Société, je ne puis que vous dire
» que c’est à mon insu que mon nom a été porté sur la liste qui vous a été
» remise; à mon grand étonnement j’ai appris ce fait et je récuse toute participation
» intéressée dans cette Société.»
Eh bien! au moment où vous écriviez cela, vous receviez mensuellement un traitement occulte de la Compagnie, ou plutôt des concessionnaires.
R. Du tout! C’était une somme qu’on me remettait tous les mois, et voici à quoi elle était destinée: j’habite Versailles, il me fallait venir tous les jours à Paris; je prenais des voitures; j’étais obligé d’aller aux entrepôts, au ministère, chez Cusin; j’y suis allé autant de fois qu’il y a de jours dans l’année.
D’un autre côté, j’ai fait faire en Angleterre des travaux que le tribunal ne soupçonne pas, mais qui sont gigantesques. Les Docks se sont établis en Angleterre et fonctionnent aujourd’hui, après soixante ans de tâtonnements. Chaque Dock a sa manière particulière d’être administré. Il est excessivement difficile de se rendre compte dans un Dock de ce que la marchandise peut y devenir, de ce qu’elle peut y perdre. Il y a eu en Angleterre des documents considérables, effrayants, rassemblés sur la question des Docks. Il m’a fallu voir tous ces documents ou les faire traduire, ou en faire faire des extraits. J’avais en Angleterre des jeunes gens attachés aux Docks, et qui, moyennant une subvention que je devais leur faire, m’envoyaient tous les documents dont j’avais besoin, et que mes relations avec les directeurs des Docks me permettaient de puiser aux sources les plus sûres.
Ces relations m’ont mis à même d’avoir la connaissance la plus exacte, la plus complète de tous les règlements qui servent au fonctionnement des Docks; mais j’avais besoin tous les jours de faire des recherches sur les progrès ou les accidents qui se produisaient dans ces établissements. C’étaient là des choses utiles, indispensables pour l’établissement des Docks en France.
J’ai fait entendre souvent à Cusin et à Legendre quelles étaient les études techniques auxquelles je me livrais; et je dois ajouter, à leur honneur, que lorsque je leur ai fait connaître les dépenses que j’avais faites, jamais ils n’ont élevé la moindre objection, et se sont empressés de les payer, de me fournir tous les fonds qui m’étaient nécessaires.
Je disais, messieurs, que j’avais fait des dépenses considérables; elles n’ont pas été perdues: elles avaient amené les Anglais à entrer dans l’affaire, et un homme dont le nom est au-dessus de toute atteinte, ayant bien voulu gratuitement se rendre en Angleterre, a été patroné par moi auprès de tous les directeurs; il a pu recueillir ainsi des documents du plus grand prix pour notre institution. En France, j’avais deux employés qui ne faisaient pas autre chose que copier et analyser les documents qui m’arrivaient chaque jour, et qui étaient volumineux. Ces travaux devaient être rémunérés par des payements réguliers, c’est pour cela qu’il m’était alloué une somme fixe par mois. j’ai fait ainsi des dépenses considérables, et il s’en faut de beaucoup que les 1,250 fr. que je recevais par mois m’aient couvert de ces dépenses. J’ai fait huit grands séjours en Angleterre; j’y suis allé à peu près comme on va de Paris à Saint-Cloud.
D. Mais enfin vous auriez dû comprendre qu’en votre qualité de commissaire du gouvernement, ce traitement qui vous était alloué à l’insu du Ministre (car il ne résulte pas de vos explications que le ministère l’ait jamais connu), était incompatible avec vos fonctions.
R. Si le ministre ne connaissait pas les détails de ma situation, il en connaissait l’ensemble. Il savait très bien que je ne pouvais pas passer dix ou douze mois en Angleterre sans y dépenser de l’argent. M’accuser d’avoir voulu voler l’argent des actionnaires est une monstruosité !
D. Vous êtes accusé, non pas de l’avoir volé, mais de l’avoir reçu.
R. L’accusation est inqualifiable!
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Défendez-vous avec plus de calme et de modération, dans votre intérêt.
R. Monsieur l’avocat impérial, je suis fâché de me laisser emporter; mais lorsque l’on est si cruellement blessé dans son honneur, il est difficile de se contenir. En raison des dépenses que je faisais, 100,000 fr. devaient m’être alloués lorsque l’affaire serait homologuée. J’avais reçu 110,000 fr.; je serais donc resté débiteur de 10,000 fr. vis-à-vis la maison Cusin et Legendre.
D. Le traité a-t-il été déposé chez un notaire?
R. Oui, monsieur l’avocat impérial.
D. A quel moment devait-il être ouvert?
R. Après l’homologation; mais il a été déchiré quelques mois après le dépôt.
D. A quelle époque a-t-il été déposé ?
R. Le 14 septembre 1854.
ORSI, 49 ans, l’un des concessionnaires des Docks.
M. LE PRÉSIDENT. — A quelle époque êtes-vous entré dans la Société des Docks?
ORSI. — Vers la fin de 1852, à une époque très voisine de la constitution de la Société.
D. En quelle qualité ?
R. Le voici: M. Duchêne de Vère vient un matin à la maison (la Société était déjà constituée); il me dit qu’il allait me présenter à MM. Cusin et Legendre... Il me présente à ces messieurs.
D. Après la retraite de Duchêne de Vère, avez-vous été appelé à partager les avantages des concessionnaires?
R. Non, monsieur le Président.
D. Vous avez succédé comme concessionnaire à Duchêne de Vère?
R. Oui; mais il y a eu une raison à cette substitution. L’affaire était dans les mains de M. de Rothschild, qui devait la réorganiser. Il l’étudiait depuis longtemps; après bien des hésitations il avait accepté de la reconstituer; cependant il hésita encore: au moment designer, il exprima quelques inquiétudes pour des motifs particuliers à un des concessionnaires. On me fit sentir que M. de Rothschild n’hésiterait plus à terminer l’affaire des Docks, si une autre personne prenait la place de M. Duchêne de Vère. Comme je tenais beaucoup à ce que cette affaire se conclût dans l’intérêt des actionnaires et du nom qu’elle portait, je m’offris pour prendre la place de M. Duchêne de Vère. La substitution fut acceptée; je me rendis chez M. Dufour pour signer: je croyais l’affaire terminée; je croyais M. de Rothschild décidé à y entrer. Sept à huit jours se passèrent, et M. de Rothschild ne signa pas. On en demanda la raison, et M. de Rothschild répondit: «Je désire savoir si le gouvernement m’autorise à fractionner les Docks en plusieurs établissements, au lieu d’un établissement unique.» Le gouvernement y consentit, et un traité fut rédigé et signé dans le cabinet de M. de Rothschild par MM. Cusin, Legendre et moi. Au bout de quelques jours, M. de Rothschild refusa de réaliser l’engagement formel quoique verbal qu’il avait pris. J’avais la certitude que M. de Rothschild était disposé à se charger de l’opération, et c’est justement pour l’y déterminer que je consentis à entrer, sans avantage aucun, à la place de M. Duchêne de Vère.
D. A partir du moment où vous y êtes entré, on vous voit déployer une grande activité, emprunter, sur dépôt d’actions, des sommes considérables : 360,000 fr. à la Compagnie de Graissessac à Béziers; 240,000 fr. à M. le duc de Galliera. Cette remise de tant d’actions devait vous révéler la situation de la Société ?
R. C’est vrai; je me doutais bien que ses besoins étaient considérables; mais tout le monde partait d’un principe: sauver l’affaire. Elle était belle, il fallait la soutenir par tous les moyens possibles; c’est la raison qui m’a déterminé à contracter les deux emprunts auxquels vous faites allusion.
D. Vous avez joué ce rôle non-seulement en France, mais en Angleterre. On vous voit vendre 2,000 actions à Londres.
R. Ce n’est pas de la vente, c’est de l’achat de 2,000 actions qu’il s’agit. Cette opération a été faite à la suite de la baisse qu’avaient subie les actions. Nous voulions, M. Cusin et moi, tâcher de relever le marché pour le placement d’une partie de ces actions qui étaient encore dans nos mains. Pour cela, nous songeâmes à ouvrir un marché, une bourse à Londres, afin de pouvoir faire ce qu’on appelait des arbitrages entre Londres et Paris, et c’est pour cela qu’une quantité d’actions fut achetée par moi, Orsi, et par M. Armani mon associé. Elles ont été payées par des remises faites à la maison de Londres par M. Cusin, et elles ont été livrées à M. Cusin. Ce ne sont donc pas des actions vendues, ce sont des actions achetées.
D. Ainsi, c’était une opération pour faire monter les actions, afin d’écouler celles qui étaient en réserve?
R. Oui, monsieur le Président.
D. Avez-vous participé à quelques-uns des traités faits par les concessionnaires, notamment à celui de la maison Fox et Henderson?
R. Il faut toujours remonter à l’origine de cette affaire. On voulait la sauver à tout prix. Quel était l’obstacle qui s’opposait à ce qu’elle fût sauvée? C’était le déficit de 5 millions qui nous empêchait d’aller au Conseil d’État. Lorsque MM. Fox et Henderson ont fait un contrat avec les concessionnaires des Docks, nous leur avons dit: «Il y a là une somme de 1 million 800,000 fr. que vous avez consenti à donner; il faut que vous la versiez dans la caisse des Docks, il faut combler ce déficit.» Il fallait bien employer cette forme pour trouver là 1 million 800,000 francs dont les actionnaires n’auraient pas profité si on avait diminué le contrat d autant. Le traité était nul si les statuts ne venaient pas à être homologués par le Conseil d’État, et jamais le Conseil d’État ne les aurait homologués sans que le déficit fût comblé. Voilà le motif de cette opération, à laquelle je n’ai en rien participé.
D. On vous reproche encore quelques termes de la correspondance qui s’est échangée entre vous et les concessionnaires, alors que vous étiez à Londres et que vous cherchiez à remonter l’affaire. On vous reproche, notamment, ce passage d’une lettre que vous auriez écrite à Cusin
«Lorsqu’une affaire est sûre et d’un bénéfice énorme, c’est tout bonnement une
» folie de donner à des actionnaires ce qu’on peut mettre dans sa poche.»
Je vous demanderai quelques explications sur cette phrase.
R. L’explication de cette phrase est parfaitement facile: les expressions qu’on y blâme ne se rapportent nullement à l’affaire des Docks; elles se rapportent à une affaire d’aluminium dont s’occupait M. Sussex. M. Sussex avait trouvé moyen de produire, de faire cet aluminium; il voulait en tirer un grand parti, et nous discutâmes longtemps avec M. Cusin la question de savoir s’il valait mieux former une compagnie par actions, ou trouver deux ou trois capitalistes qui consentiraient à émettre la somme d’argent nécessaire à la fabrication du nouveau produit. M. Cusin était d’avis de former une société. C’est inutile, disais-je, un ou deux capitalistes suffisent pour faire marcher cette fabrication, pourquoi donner à des actionnaires un bénéfice qu’on peut réaliser sans recourir à eux? Voilà l’explication de la lettre.
D. On donnait à cette phrase un caractère plus général: on la considérait comme pouvant se rattacher à l’affaire des Docks?
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — N’avez-vous pas vendu des actions sur le marché de Paris?
R. Oui, Monsieur, le même motif qui faisait faire des reports a fait faire cette vente.
D. C’étaient des actions détachées de la souche, et vous savez parfaitement bien qu’il ne pouvait pas en être détaché, si elles n’avaient pas été souscrites?
R. Je savais parfaitement bien que ces actions allaient constituer une perte; mais je savais aussi que ces Messieurs, qui les avaient déclarées souscrites, auraient fait la différence.
D. Si MM. Cusin et Legendre les avaient souscrites, ils n’auraient pas eu besoin d’un prête-nom. Dès qu’ils avaient recours à un prête-nom pour cette vente, qu’ils n’osaient pas faire eux-mêmes, il y avait quelque chose de suspect qui devait appeler votre attention. Vous dites, dans votre mémoire écrit qui est aux pièces que Gusin, Legendre et Duchêne de Vère ne pouvaient, sans déprécier ces valeurs, les faire vendre sous leur nom; c’est donc pour cela qu’ils les faisaient vendre sous le nom d’un intermédiaire?
R. Je ne le nie pas.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous étiez possesseur d’un grand nombre de ces actions?
R. Non pas comme propriétaire.
D. Comment se fait-il que, dans un traité fait entre vous et un Anglais, le sieur Wilmar, vous disiez que vous en aviez pour 500,000 francs, et que vous les remettiez entre les mains de cet Anglais, pour faire je ne sais quelle opération de bourse?
R. Le traité n’a jamais été exécuté.
D. Mais cette énonciation du traité était-elle véritable ou mensongère?
R. C’était un projet qui n’a jamais été réalisé.
D. Possédiez-vous, oui ou non, ces actions?
R. Non.
D. Par conséquent elles vous avaient été prêtées?
R. C’était une opération qui devait être faite dans le même but que celle de Londres, pour obtenir la hausse.
D. Ce sont des manœuvres assez singulières, et aujourd’hui vous nous dites que cette énonciation est mensongère?
R. Il y a une erreur. Lorsqu’il s’agissait de relever le cours des actions, M. Wilmar vint proposer à M. Cusin de faire un report de 500,000 francs sur un nombre déterminé d’actions. Il fut fait un traité à cet égard. Les actions devaient être déposées entre les mains de M. Mallet, qui devait faire une avance de 500,000 francs. Le traité fut passé et signé ; et puis sur les observations que je fis à M. Cusin, relativement au danger de cette opération, M. Cusin dit: Il faut l’annuler. Le traité fut annulé, et les actions ne sortirent pas de la caisse. Voilà l’explication de l’affaire.
D. Ce que vous déclarez, c’est que votre énonciation était fausse et que les actions dont vous parlez étaient empruntées à Cusin?
R. Parfaitement.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Vous faisiez des opérations de bourse avec les actions des Docks pour le compte de Cusin et Legendre, et pour reconnaître le service que vous leur rendiez, Cusin et Legendre partageaient avec vous le bénéfice. Ils vous donnaient 10 pour 100 sur le résultat des opérations?
R. Nous ne pouvions pas retirer à M. Wilmar la part qui lui revenait.
D. Il y avait là 10 pour 100 de prélèvement, à qui les remettiez-vous?
R. A M. Wilmar.
D. Non, la part de Wilmar était faite, et, indépendamment de sa part, il y avait encore 10 pour 100 de bénéfice.
Me GRÉVY. — Il est évident qu’Orsi n’était là qu’un prête-nom, et que l’opération se faisait pour ces Messieurs?
ORSI — Tous les bénéfices devaient entrer dans la caisse des Docks
M. LE PRÉSIDENT. — Il est fâcheux que vous ayez consenti à prêter votre. nom aux concessionnaires, qui n’auraient pas pu faire de telles opérations sans votre concours.