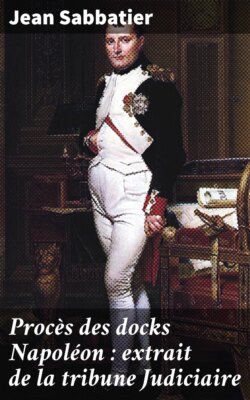Читать книгу Procès des docks Napoléon : extrait de la tribune Judiciaire - Jean Sabbatier - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DÉPOSITIONS DES TÉMOINS.
ОглавлениеTable des matières
M. DUFOUR, 32 ans, notaire à Paris.
M. LE PRÉSIDENT. — Lorsque les inculpés ont été faire, le 20 novembre 1852, une déclaration dans votre étude, portant que la Société des Docks était constituée par la souscription intégrale de 200,000 actions, a-t-il été échangé entre eux des explications?
R. Aucune.
D. Il vous a été dit que toutes les actions, au nombre de 200,000, avaient été souscrites: Avez-vous pu croire que le fait était vrai?
R. Parfaitement vrai, d’autant plus qu’il était de notoriété à Paris que les souscriptions avaient dépassé de beaucoup le nombre des actions créées. On parlait dans le public d’une souscription de 200 millions, au lieu de 50 millions.
D. Est-ce que Cusin ne vous aurait pas dit quelque chose de nature à vous faire comprendre que la totalité des actions n’était pas souscrite?
R. On ne m’a donné aucun renseignement, si ce n’est que les souscriptions étaient couvertes.
D. N’êtes-vous pas le notaire de M. Riant?
R. Non-seulement son notaire, mais son successeur médiat.
D. C’est chez vous que s’est passé l’acte par lequel M. Riant a vendu des terrains à la Compagnie des Docks?
R. Oui, pour une somme de plus de 9 millions.
D. N’avez-vous pas été dépositaire de certains plis cachetés qui vous auraient été remis par les concessionnaires?
R. J’ai été dépositaire de deux plis; j’en avais oublié un lorsque j’ai été entendu par M. le Juge d’Instruction. Le premier a été retiré par ces Messieurs; le second a été ouvert en ma présence.
D. Lorsqu’on a déposé ces plis entre vos mains, vous a-t-on donné connaissance des papiers qu’ils contenaient?
R. Nullement. Les personnes qui me les avaient remis sont revenues, elles ont retiré les papiers, et j’ai conservé l’enveloppe d’un de ces plis.
D. Comment se fait-il que cette enveloppe soit restée dans vos mains?
R. Elleyest restée comme décharge, la décharge a été mise sur l’enveloppe.
D. Est-ce que vous demandez décharge de tous les plis qui sont déposés dans vos mains?
R. Non, c’est par hasard que j’ai pris décharge cette fois. Il n’est pas dans mes habitudes de le faire; je ne sais sous quelle impression j’ai agi dans cette circonstance.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Vous a-t-on donné connaissance du traité qui se trouvait sous l’un de ces plis?
R. Nullement. Ce pli m’a été remis cacheté et signé. Les déposants sont venus le reprendre plus tard et l’ont déchiré.
M. LE PRÉSIDENT. — N’est-il pas à votre connaissance qu’il contenait la promesse d’une rémunération?
R. J’ai entendu dire qu’il avait pour objet des rémunérations à des personnes dénommées, pour le cas où la vente des terrains de M. Riant se réaliserait.
D. Savez-vous le chiffre de ces rémunérations?
R. C’était 80,000 francs, je crois, destinés à M. Duchêne de Vère et à l’architecte.
D. Est-ce qu’il n’est pas venu chez vous des actionnaires, à la date de 1852?
R. Il en est venu à plusieurs époques. Aux uns j’ai donné communication des statuts, aux autres j’en ai délivré expédition.
CUSIN. — Lorsque la constitution a été faite, ne vous rappelez-vous pas que M. Riant m’a donné une poignée de main pour rétablir des relations rompues, et que M. Plé nous a servi d’intermédiaire?
LE TÉMOIN. — Je crois en effet me rappeler que MM. Cusin et Riant se sont donné une poignée de main.
CUSIN. — Vous voyez que M. Plé était présent. Eh bien, toutes explications lui ont été données. Je comprends que M. Dufour déclare qu’on ne lui a pa& dit que les souscriptions n’étaient pas déposées dans la caisse; mais cela a été dit à M. Riant.
LE TÉMOIN. — J’affirme que devant moi il n’a été rien dit qui pût me donner à croire que le capital n’était pas versé.
M. RIANT, 67 ans, ancien notaire et ancien membre du conseil municipal de Paris.
M. LE PRÉSIDENT. — Quelles relations avez-vous eues avec les inculpés?
R. Comme membre du conseil municipal, j’ai eu occasion d’entrer plusieurs fois en relation avec M. Cusin, banquier, à raison des emprunts contractés par la Ville, et je dois dire que je n’ai jamais eu qu’à me louer de mes rapports avec lui. Ses souscriptions étaient régulières, les sommes qu’il annonçait reconnues exactes, son cautionnement toujours versé à la caisse de la Ville. En 1852, M. Cusin n’obtint pas les emprunts de la Ville, et on le considérait comme plus sage que ses concurrents qui les avaient obtenus. Tout cela nous donnait beaucoup de confiance en lui.
A quelque distance de là, M. Horeau, l’architecte qui avait fait le fameux projet pour les Halles centrales, me présenta M. Duchêne de Vère qui avait concouru à l’Exposition de Londres. M. Duchêne de Vère sollicitait, conjointement avec M. Cusin, l’obtention de la concession des Docks. Le décret obtenu, je fis tous mes efforts pour engager les concessionnaires des Docks à s’appuyer sur l’exemple et sur le crédit des Anglais. En effet, les Anglais pratiquent depuis de nombreuses années ce que le décret de 1852 a voulu établir en autorisant les Docks, c’est-à-dire l’emmagasinage et la manutention de la marchandise dans les conditions de la meilleure conservation, et la représentation de la marchandise par des certificats ou warrants qui servent à la négocier sans déplacement et à la mobiliser ainsi indéfiniment. Il était, selon moi, très utile que l’industrie anglaise concourût à établir les Docks à Paris. Mais nous sommes dans d’autres conditions que l’Angleterre, les Docks doivent fonctionner autrement chez nous. Ils doivent fonctionner non-seulement pour les marchandises importées, mais encore pour celles qui sont destinées à l’exportation. Dans un intérêt tout à fait parisien, dans l’intérêt de cette grande cité qui devient aujourd’hui essentiellement manufacturière, nous désirions que les marchandises fabriquées à Paris avec des matières importées en France, et qui s’élèvent à 3 ou 400 millions par an, pussent être déposées dans les Docks et poinçonnées (comme c’était, du reste, l’idée de Colbert), pour mettre un terme à la fraude qui les discrédite à l’étranger. Nous pensions donc qu’il était nécessaire que les Anglais vinssent nous apporter non-seulement leur argent, mais leur concours et leur expérience. Établir des Docks à Paris est matériellement facile, mais les rendre florissants, mais les faire servir à l’écoulement de 3 ou 400 millions de marchandises fabriquées à Paris, c’est ce que le temps et l’expérience seuls peuvent faire. Or les Anglais sont nos aînés en cette matière, comme en bien d’autres.
Mes observations étaient justes, elles furent prises en considération. Je me décidai à aller en Angleterre, pour appuyer M. Legendre. Nous entrâmes en négociation avec la maison Ricardo. Nous lui demandions son concours, elle nous l’accordait. Nous ne signâmes pas avec elle un traité ; mais nous arrêtâmes des conditions.
De retour à Paris, nous trouvâmes M. Cusin disposé à porter seul le fardeau de cette immense affaire. Je ne partageai pas sa confiance, et je me retirai incontinent.
Je n’avais plus aucune relation avec M. Cusin, quant à cette affaire, lorsque, trois ou quatre mois après, on vient me dire: Il dépend de vous, si vous voulez consentir quelque concession, de faire marcher les Docks. — De quoi s’agit-il? — M. Pereire vient prendre les Docks. L’intermédiaire qui me disait cela était M. Plé, mon conseil, homme très respectable. Je répondis aussitôt: Tout ce que M. Pereire voudra, je le ferai; je suis hautement convaincu de la capacité hors ligne de M. Pereire; je suis sûr qu’il fera marcher l’affaire. Qu’est-ce qu’il demande? — Que vous réduisiez votre contrat de moitié, — Je n’y mets pas d’obstacle» Il n’y avait pas là de sacrifice pour moi: cette moitié, dans trois ans, avec la réalisation des Docks, devait naturellement doubler de valeur. — Mais l’autre moitié, au lieu de vous être payée comptant, ne le sera qu’à terme, et pour les 2,250,000 francs qu’on vous devra, vous voudrez bien ne pas prendre d’intérêts, parce qu’il nous faut trois ans pour constituer les Docks. J’y consentis tout de suite, je ne fis aucune objection; seulement, je demandais que M. Pereire nous donnât sa parole qu’il resterait à la tête des Docks. C’est ce qui explique que sa signature figure sur la rétrocession de mes terrains.
J’étais préoccupé des Docks dans l’intérêt de la ville de Paris: je regarde cette institution comme essentiellement parisienne et gouvernementale; je la considère comme devant un jour assurer la tranquillité de Paris, car ce n’est pas sans inquiétude que j’ai vu que la population de Paris s’était augmentée dans ces dernières années de 400,000 habitants. Jamais l’État ni la Ville de Paris n’auraient assez d’argent pour venir au recours d’une pareille population aux jours du chômage. Je crois donc qu’il faut à tout prix éviter le chômage. Comme nous n’aurions pas assez d’argent pour payer les ouvriers, comme on ne pourrait pas satisfaire à leurs besoins avec les utopies de Louis Blanc et autres (On rit), je suis d’avis qu’il faut prévenir le chômage par de bonnes institutions commerciales. J’accédai donc avec empressement aux conditions de M. Pereire, qui favorisaient l’établissement des Docks.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — Vous êtes venu de Londres avec le traité Ricardo?
R. Oui, Monsieur.
D. Et la rupture n’est pas venue de Ricardo, mais de Cusin?
R. Je crois qu’on a demandé des conditions nouvelles à M. Ricardo et que M. Ricardo les a refusées. Je dois dire, à l’honneur des Anglais, que la rupture des conventions arrêtées ne serait jamais venue d’eux.
D. Vous avez dit dans votre déposition écrite que, lorsque vous étiez arrivé d’Angleterre, Cusin se montrait très mécontent du traité, qu’il annonçait l’intention de rompre, et trouvait que les Anglais demandaient un trop grand nombre d’actions?
R. C’est parfaitement exact. Je crois qu’en voyant les demandes de souscriptions affluer de tous côtés, il s’était fait illusion sur la puissance de sa maison et l’influence de son nom.
M. LE PRÉSIDENT. — Ainsi la rupture a suivi immédiatement votre arrivée?
R. Immédiatement.
D. Et vous aviez tout lieu de croire que, si les propositions avaient été acceptées, la maison anglaise n’aurait pas reculé ?
R. Certainement. De pareils retours ne sont pas dans les habitudes anglaises.
D. Est-ce qu’il y avait des conditions exorbitantes, contraires à l’honneur national?
R. Il n’y avait rien de semblable. Ils figuraient dans la Compagnie aux mêmes conditions que les actionnaires français. Bien des pourparlers eurent lieu, et il n’y eut pas la moindre contestation sur le fonctionnement du comité français et du comité anglais.
D. Aujourd’hui, selon vous, la responsabilité morale de cette rupture doit peser sur Cusin. Mais on dit, dans son intérêt, que s’il avait manifesté l’intention de refuser les conditions de la maison anglaise, dont vous et Legendre étiez porteurs, c’est qu’il y avait des clauses incompatibles avec l’honneur national, que lui personnellement ne pouvait pas accepter. Il n’aurait jamais souffert, dit-il, qu’en ce qui concernait un établissement placé sous le patronage de l’Empereur, l’administration principale fût à Londres, et qu’il n’y eût à Paris qu’un bureau secondaire?
R. Je ne me rappelle pas qu’il ait été question de pareilles conditions. Il est possible que les Anglais aient dit qu’il fallait qu’ils eussent la majorité dans le comité de Londres. Je suppose qu’ils l’eussent demandé, il fallait bien leur laisser les moyens de se mouvoir, pour apporter chez nous, soit leur longue expérience, soit leurs capitaux. Lorsque nous allions leur demander 15 ou 20 millions, il fallait bien leur laisser une certaine faculté d’agir. Les choses ne pouvaient pas se faire autrement.
D. Ainsi ce qui vous décidait personnellement, c’étaient les capitaux des Anglais que vous vouliez voir arriver, et surtout leur expérience?
R. Oui, M. le Président. Les Docks ont été inventés lorsqu’on cherchait à perfectionner l’emmagasinage. Et il est arrivé ce qui arrive souvent lorsque l’on cherche, comme le dit la Bruyère: on a trouvé mieux que ce qu’on cherchait, on a trouvé la mobilisation de la marchandise. Eh bien! il faut, en France, trouver encore autre chose. Les Docks, dans ce pays, auront surtout le très grand avantage de permettre l’institution du poinçonnage; l’ouvrier répondra alors de son œuvre, et notre marchandise, qui est exportée sur tous les points du globe, y sera accueillie avec une confiance qui en assurera l’écoulement.
D. Vous avez dit que vous étiez resté complétement étranger à ce qui s’était fait dans les Docks; est-ce que ce n’est pas postérieurement à ce voyage, le 10 ou 12 octobre 1852, que vos terrains ont été vendus?
R. Non, M. le Président; les terrains étaient vendus auparavant, immédiatement après le décret de concession, autant que je puis me rappeler. Quant à la rétrocession de moitié, elle a été faite après, en mars 1853.
Me NIBELLE, avocat de Cusin. — Lorsque le témoin a vendu cette quantité de terrains, avait-il été stipulé, entre les concessionnaires et lui, qu’il prendrait une somme plus ou moins considérable d’actions dans l’entreprise?
R. Jamais rien de semblable n’a été stipulé indirectement, ni indirectement. Je n’ai jamais, quant à moi, pris aucune action dans aucune affaire industrielle quelconque, pas même dans le chemin de fer de Rouen, à l’établissement duquel j’ai activement concouru.
CUSIN. — Dans une affaire si grave pour moi, il est tout naturel que mes souvenirs soient plus précis que ceux de M. Riant. M. Riant nous est arrivé de Londres sous le coup de la préoccupation désagréable que la négociation anglaise n’avait pas réussi. Nous avions acheté les terrains de M. Riant sur papier libre au mois de juin. C’est le lendemain ou le surlendemain du décret de septembre que nous avons régularisé le contrat des terrains qui n’avait été jusque-là qu’à l’état de projet. J’étais au débarcadère quand ces messieurs sont arrivés. Le lendemain, je suis allé chez M. Riant, il était au lit; il s’est habillé devant moi. Je crois que nous sommes allés ensemble chez M. de Persigny. M. Riant vint à la maison; j’examinai, chemin faisant, les conditions que les Anglais nous faisaient. La subordination du comité français au comité anglais me parut impossible. M. Riant nous dit bien ce qu’il attendait des Docks, mais il ne dit pas tout ce que nous en attendions. Il ne s’agissait pas seulement de transporter les Docks anglais à Paris; il fallait le faire dignement. Je dis à M. Riant: «Les propositions dont vous êtes porteurs ne sont pas admissibles. Non-seulement nous avons le nom de l’Empereur à la tête de l’affaire, mais nous avons le prince Murat à la tête du Conseil d’administration. Voulez-vous que nous subordonnions le comité français au comité anglais? Il y a un moyen: prenez des actions, et en les prenant vous calmerez le chagrin que nous avons de la non-réussite de notre tentative en Angleterre.» M. Riant nous dit, en effet, qu’il n’en prendrait pas; qu’il ne voulait pas se mêler dans des opérations industrielles; mais quand la bonne harmonie a été rétablie entre M. Riant et moi, j’ai pu croire que cette résolution n’était pas irrévocable. Je tiens à constater ce fait, monsieur le Président. Je dois ajouter ce que M. Riant a oublié, c’est qu’il m’a embrassé et m’a dit: «Les choses sont rétablies maintenant. »
R. Je n’ai aucun souvenir de tout cela. Je ferai remarquer seulement que, quand je suis arrivé de Londres, vous étiez accablé de demandes de souscriptions, et que vous n’aviez nul besoin de me demander la mienne, à moi qui n’ai jamais souscrit à rien.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous avez dit que ce qui avait principalement déterminé Cusin à refuser le concours de la maison Ricardo, c’est qu’i avait trouvé que cette maison demandait trop d’actions.
R. Je crois me rappeler que c’était là en effet la cause principale, et cela s’explique par la demande excessive d’actions qui existait sur la place de Paris. Il y en avait non pas pour 50, mais pour 60 et 80 millions, à ce que disait Cusin. Il y en avait tant à cette époque, qu’il ne pouvait, disait-il, en proposer à personne. Il se trompait sur ce point.
D. Il résulte de la déposition du témoin que les actions avaient une telle faveur à cette époque, que Cusin désirait les conserver toutes. C’était un moyen de réaliser un bénéfice par la prime?
CUSIN. — Le rapport de l’expert établit le contraire, puisque nous avons été obligés de racheter des promesses.
D. Vous rachetiez des promesses précisément en vue des primes. La promesse, qui était la représentation d’une action non délivrée, se vendait à la Bourse 8 à 9 fr., et l’action pouvait se vendre un jour avec 50, 60 fr. de prime.
R. Nous ne nous sommes servis d’aucune. Je demande la permission d’insister sur un point: M. de Persigny nous demanda un jour, pour nous en faire un grief, ce que M. Riant avait pris d’actions, et sur notre réponse qu’il n’en avait pas pris, il s’emporta.
Me NIBELLE. — Il y a mieux à dire: M. Cusin a acheté à M. Riant pour 9 millions de terrains; s’il était aussi cupide qu’on le dit, c’était bien le cas de demander une prime. S’est-il réservé quelque chose par traité secret ou autrement?
LE TÉMOIN. — Non; il n’a rien demandé, rien exigé.
M. LE PRÉSIDENT. — Rien ne l’établit ni n’est de nature à le faire soupçonner. Le prix réel auquel M. Riant vendait son terrain était stipulé dans le contrai.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. N’est-il pas à votre connaissance que Legendre était parti pour Londres afin de rompre le traité Ricardo?
R. Il est en effet parti pour Londres; mais on m’a dit que c’était pour obtenir de meilleures conditions de la maison Ricardo.
D. A quelle époque êtes-vous revenu de Londres, et à quelle époque Cusin vous a-t-il manifesté l’intention de porter seul le fardeau de l’affaire?
R. Le 10 ou le 12 octobre.
M. LE PRÉSIDENT. — A l’occasion de la vente de vos terrains, vous êtes entré en relations avec Duchêne de Vère; ne lui avez-vous pas donné une rémunération, un pot-de-vin?
R. J’ai donné une rémunération à divers intermédiaires. J’en avais oublié deux dans cette répartition. Ils vinrent me réclamer une indemnité pour la peine qu’ils avaient prise en s’occupant, en 1848, de la création des Docks. Je leur proposai 12,000 fr., j’allai jusqu’à 20,000 fr.; ils en demandaient 60,000; le tribunal de première instance leur en accorda 30,000. C’est un usage. Tous ces gens qui s’agitent autour des grandes entreprises, aussitôt que ces grandes entreprises sont réalisées, s’empressent de réclamer des salaires qui leur sont plus ou moins dus. J’ai fait des remises comme tout le monde, et je les ai faites de la manière la plus honorable.
D. Combien avez-vous donné à peu près à Duchène?
R. 60,000 fr. environ; depuis j’ai ajouté 20,000 fr. M. Duchêne avait été en Angleterre; il avait fait des dépenses; il me demanda un supplément motivé sur ces dépenses, et il me parut juste de le lui accorder.
D. A part le traité avec M. Pereire, et ce qui concerne la rétrocession de vos terrains, vous êtes resté étranger à l’affaire?
R. Absolument.
D. Des droits considérables d’enregistrement ont dû être payés?
R. Environ 500,000 fr.
D. La vente de vos terrains s’élevait primitivement à 9 millions 200,000 fr.; quel en était le chiffre après la rétrocession?
R. 4 millions 200,000 fr.
D. Quel est le motif qui vous a déterminé à revenir sur un acte accompli de cette importance?
R. Une raison de la plus grande simplicité. Dans cette opération, la vente de mes terrains n’était pas ma seule préoccupation. Je portais un intérêt encore plus vif à la fondation des Docks, qui importait essentiellement à la prospérité présente et future de la ville de Paris. D’ailleurs, mes terrains devaient acquérir une augmentation considérable. La rétrocession devait devenir avantageuse, Il le faut bien pour compenser l’abandon d’intérêt pendant trois ans à laquelle j’ai consenti, ce qui équivaut à une remise de 15 pour 100. Mes terrains ne me causent aucune préoccupation, malgré leur importance. Je règle ma dépense sur mes revenus, et ces terrains, qui sont la propriété de ma famille, sont placés dans un quartier où chaque année ajoute à leur valeur un chiffre supérieur au produit que pourrait donner l’emploi du prix s’ils étaient vendus. Mes terrains ne m’inquiètent donc pas. Je ne tiens pas à les réaliser. Ce sera l’affaire de mes enfants. C’est connu de tout Paris. (Sourires).
M. SUSSEX, 37 ans, chimiste, gérant de la Société de Javel.
M. LE PRÉSIDENT. — Vous fabriquez des produits pour l’agriculture, des engrais?
R. Oui, monsieur le Président,
D. A quel capital votre Société a-t-elle été constituée?
R. Au capital de 3 millions d’abord, porté ensuite à 5 millions.
D. Veuillez nous faire connaître vos rapports avec la maison Cusin et Legendre. Leur maison de banque était, dans le principe, celle où vous aviez un compte courant. Expliquez-nous comment ce compte, faible au commencement, est devenu par la suite si considérable?
R. Vers le commencement de 1852, je proposai à MM. Cusin et Legendre de m’ouvrir un crédit qui me mît à même de fabriquer des engrais par un nouveau procédé dont je suis l’auteur. Ce crédit devait être employé à essayer mon procédé, à faire des engrais, et si le résultat de ces essais était favorable, je devais proposer à MM. Cusin et Legendre de constituer une société considérable pour l’exploitation de mon brevet. MM. Cusin et Legendre consentirent à m’ouvrir un crédit; les essais prirent quelques mois. M. Cusin, M. Legendre, moi et quelques autres personnes qui figurent dans l’affaire, nous dressâmes des statuts qui furent signés ne varietur. Il fut fait de plus entre nous un acte sous condition suspensive, par lequel MM Cusin et Legendre se chargeaient du placement des actions de la société future, les essais réussissant. Le 20 avril 1852, l’acte définitif fut passé dans l’étude de Me Dufour, et alors MM. Cusin et Legendre émirent le capital. Ils versèrent certaines sommes à valoir sur les actions dont le placement leur appartenait. Voilà l’origine de mes rapports avec MM. Cusin et Legendre.
D. Lorsque la Société fut constituée, quelles furent les premières attributions, et notamment la part qui vous fut faite comme gérant?
R. Il m’était attribué 40 pour 100 nets dans les bénéfices de la Société, en raison de mon apport, et 20 pour 100 comme gérant.
D. De sorte qu’à ce double titre vous preniez 60 pour 100!... Est-ce que Cusin et Legendre ne s’étaient pas obligés à souscrire la moitié du capital, quoi qu’il arrivât?
R. Ils s’étaient réservé exclusivement le droit de placer toutes les actions; il m’était interdit d’en placer. Je devais donc considérer ces messieurs comme devant fournir tout le capital.
D. Quelle est la date précise de la constitution définitive de votre Société ?
R. Le 15 septembre 1852.
M. LE PRÉSIDENT (à Cusin). — Ainsi, au mois de septembre 1852, l’Union commerciale, dont vous étiez les gérants, se chargeait de la totalité du capital de 3 millions de la Société de Javel: avec quoi deviez-vous y faire face?
R. Avec le public. Toutes les fois qu’un banquier figure quelque part pour placer des actions, il fait appel au public.
D. Combien en avez-vous placé de ces actions?
R. 5 à 600 seulement.
D. Vous en avez conservé par conséquent 5,500, et vous avez fourni au témoin l’intégralité du capital?
R. Évidemment.
D. Avec quels fonds, avec l’argent des Docks?
R. Sans doute.
D. Voilà qui est constaté : vous avez fondé la Société de Javel, au capital de 3 millions, avec l’argent des Docks?
R. J’ai l’honneur de vous faire observer, monsieur le Président, que toutes les fois qu’une souscription est ouverte chez un banquier, ce banquier appelle le public à venir prendre chez lui les actions qu’il a à vendre. Les préoccupations qui nous étaient suscitées par les Docks ne nous ont pas permis de nous occuper de l’affaire de Javel. C’est ce qui nous a forcé à lui attribuer provisoirement des fonds étrangers; mais nous n’avions pas l’intention de monopoliser ces actions: nous voulions parfaitement bien les vendre.
D. (Au témoin). Les 60 pour 100 que vous vous êtes attribués sur les bénéfices, à titre d’inventeur et de gérant, les avez-vous conservés pour vous seul?
R. Non, monsieur le Président. J’ai eu l’honneur de vous dire que j’avais fait des attributions aux personnes qui m’avaient prêté leur concours pendant les expériences dont je parlais il y a un instant, et que je considérais comme les fondateurs de la Société.
D. Quelles sont ces personnes, quelle est cette part?
R. Je crois avoir attribué 10 pour 100 à MM. Cusin et Legendre.
D Dans votre déclaration au juge d’instruction, vous avez dit 20 pour 100.
R. Je crois me rappeler que c’est 10 pour 100 à chacun de ces messieurs. Je leur ai fait cet abandon par lettres, à chacun d’eux personnellement.
D. (A Cusin et à Legendre). — Ainsi, c’était avec l’argent des Docks que vous faisiez l’affaire, et c’était personnellement que vous receviez 20 pour 100?
CUSIN. — Puisque l’accusation arrive à se servir de ce fait, je déclare que nous n’avons pas partagé de bénéfices avec M. Sussex; je l’établirai clairement quand MM. Monginot et Depinois viendront.
D. (Au témoin). — Est-ce qu’à certaine époque il n’y a pas eu un dividende qui s’est élevé à quelques francs pour 100. — R. Oui, en 1853, les actions ont rapporté 26 francs, c’était quelque chose comme 5 1/4 pour 100.
D. MM. Cusin et Legendre ont-ils reçu leur part dans cet intérêt? —
R. Nécessairement.
CUSIN. — Non, monsieur, Legendre et moi nous n’avons pas participé à cette répartition. Rien n’était terminé alors, tout était provisoire; le règlement de l’affaire était subordonné à l’attribution des actions aux Docks.
D. Comment! vous aviez dans les mains un grand nombre d’actions, et vous n’avez pas reçu l’intérêt afférent à chacune de ces actions?
LE TÉMOIN. — Effectivement, ils ont reçu le dividende afférent aux actions dont ils étaient propriétaires.
D. Eh bien, ce dividende, qui est plus considérable que les souvenirs du témoin ne semblent l’indiquer, ce dividende ne figure nulle part dans la comptabilité des Docks. C’est avec l’argent des Docks que Cusin et Legendre ont fait les opérations, et c’est dans leur poche qu’ils mettent le dividende?
CUSIN. — Je viens de faire remarquer que le règlement de l’affaire était subordonné à l’attribution des actions aux Docks, et cette attribution n’a été consommée que dans le mois de mars de l’année 1856; jusque-là MM. Torchet et Picard n’avaient pas pris livraison des actions. Voilà pour le premier point. Dans le bilan de 1854, nous avions bien porté l’attribution aux Docks des actions dont nous étions détenteurs, mais en réservant de faire compte après l’acceptation de ce payement.
D. (Au témoin). — Votre capital de 3 millions a été insuffisant; vous avez été obligé de l’augmenter. Par quel moyen l’avez-vous augmenté ? —
R. Au moyen d’une émission d’obligations.
D. Et elle a été faite par la maison Cusin et Legendre?
R. Non, pas précisément. L’émission a été décidée en Conseil, et MM. Cusin et Legendre n’ont pas pris, comme banquiers, l’engagement de faire souscrire; ils ont souscrit eux-mêmes les 2 millions d’obligations. Il est intervenu un traité où personnellement ces messieurs souscrivaient les obligations, mais ce n’était pas la maison de banque.
D. Toutes les obligations ont-elles été placées?
R. Une partie a été mise en dépôt pour faire face aux dépenses déjà faites, ou nous les avons données en garantie à des créanciers. Il en a été déposé chez M. Dufour, notaire, 400 sur la totalité des obligations, représentant 400,000 francs.
D. Par qui ce dépôt a-t-il été fait?
R. Par moi, comme gérant. 949 ont été gardées par Cusin et Legendre.
D. Ainsi, sur ces 2000 obligations, Cusin et Legendre en auraient pris pour près de 1 million, et ils seraient propriétaires de la moitié environ?
R. Oui, de 949.
D. (A Cusin). — Ces 400,000 francs déposés chez M. Dufour, c’est encore de l’argent des Docks?
R. Oui, monsieur le Président.
D. Comment se fait-il que vous ayez continué à marcher dans cette voie, à disposer de ce qui ne vous appartenait pas? Puisque l’affaire de Javel ne produisait pas les résultats que vous en attendiez, il semble que vous n’auriez pas dû y mettre de nouveaux capitaux?
R. Quand on est banquier et qu’on est engagé dans une affaire, il faut aller jusqu’au bout.
D. Je comprends cela quand on agit avec son argent, mais quand c’est avec l’argent d’actionnaires qui n’ont pas entendu le placer dans l’opération de M. Sussex, quelque bonne qu’elle soit, il me semble qu’on devrait y mettre plus de circonspection. Or, il est évident que les personnes qui avaient pris des actions dans les Docks, n’entendaient pas que leurs fonds vinssent alimenter les entreprises de M. Sussex?
R. J’ai eu l’honneur de répondre que, si l’affaire des Docks eût été terminée, nous aurions trouvé, dans la liberté de l’emploi de notre temps, la possibilité de faire un placement avantageux des actions immobilisées dans l’affaire Sussex.
D. (Au témoin). — A quelle époque cette création d’obligations a-t-elle été faite?
R. Le 14 juillet 1854.
D. (A Cusin). — Vous dites qu’à cette époque vous étiez engagé à soutenir l’affaire Javel, et pour la soutenir vous vous serviez de l’argent des Docks?
R. Nous avions toujours l’espoir de placer les actions. Nous voulions sauver l’affaire, comme nous le dirons plus tard, et la sauver par tous les moyens possibles. Nous n’avons jamais eu en vue qu’une chose: donner corps et vie aux Docks; et le moyen d’y parvenir n’était pas de laisser discréditer les affaires dans lesquelles nous étions engagés. Du reste, je prierai M. Sussex de vouloir bien dire au Tribunal si les conditions nouvelles dans lesquelles il était placé n’étaient pas de nature à donner à son entreprise une certaine solidité.
D. Ceci est en dehors du débat; nous n’avons pas à examiner si l’affaire de Javel, pas plus que celle de Pont-Remy, est une bonne ou une mauvaise opération.
(Au témoin). — Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez donné à Cusin et à Legendre, en leur nom personnel, 20 pour 100 de vos bénéfices : cette part de bénéfices n’a-t-elle pas été convertie plus tard en 800 actions Javel?
R. Oui, M. le Président.
M. LOMBARD, 49 ans, ex-directeur de la division des Marais aux Docks, détenu.
D. Vous étiez l’un des principaux employés des Docks?
R. J’étais directeur de la division des Marais, chargé des entrepôts.
D, Avez-vous participé à l’émission des actions?
R. En aucune manière.
D. Vous êtes détenu en ce moment et mis en accusation au sujet d’un détournement de fonds qui vous est imputé ?
R. Je n’étais chargé d’aucun maniement de fonds comme directeur, seulement j’ai fait des prélèvements pour me payer des appointements qui m’avaient été promis. Du reste, ce sont des faits qui s’expliqueront devant la Cour d’assises, quand j’y passerai.
D. Quels rapports avez-vous eus avec Cusin et Legendre?
R. Mes rapports avec eux étaient tout naturels: MM. Cusin et Legendre étaient les administrateurs de la Société, j’étais leur subordonné, je recevais les ordres qu’ils me donnaient.
D. Vous vous occupiez des écritures?
R. En aucune manière.
D. Ne vous a-t-on pas chargé de faire le bilan de la situation des Docks à une époque où vous aviez cessé d’appartenir à cette administration?
R, Oui, on m’en a chargé en 1854, mais j’appartenais aux Docks.
D. Est-ce que ce travail était dans vos attributions?
R. Non; mais je venais fort souvent à l’administration, où l’on m’appelait pour me consulter sur certaines spécialités que j’étais plus à même d’apprécier. Un jour, en réunion du Conseil, on porta sur la table des documents qui émanaient de la maison de banque Cusin et Legendre; et là il fut question, M. le Commissaire impérial présent, d’établir des comptes. Ma présence à cette réunion n’était pas chose extraordinaire, puisqu’il ne se passait pas de jour que je n’allasse à l’administration centrale. Ces messieurs me dirent: Vous vous entendez très bien à faire des chiffres, voilà des documents qui arrivent de la comptabilité, nous voudrions établir une situation d’après ces documents. J’examinai les chiffres de l’actif et du passif, j’établis la situation sur-le-champ. Pour me rendre compte si cette opération était bien exacte, je pris une feuille volante en forme de journal, j’y raisonnai chaque article, je le déduisis, je fis, en un mot, une espèce de grand-livre de cette feuille et j’établis une balance que je remis à ces messieurs.
D. Vous dites que vous avez fait ceci d’après des éléments qui vous étaient donnés; mais cela a-t-il été relevé par vous sur les livres?
R. Non, on m’a apporté des feuilles volantes émanant de la main des employés de la maison... Voilà quatorze mois que je suis en prison, ma mémoire est fatiguée; je ne pourrais pas vous dire au juste le nombre de ces feuilles, mais il y en avait plusieurs.
D. Est-ce qu’elles n’étaient pas de la main de Cusin?
R. Aucunement.
D. Vous n’êtes pas d’accord avec un témoin qui a déclaré que cette situation avait été dressée par vous sur une feuille volante d’après des documents écrits et signés de Cusin?
R. Les documents qui m’ont été remis en plein Conseil n’étaient aucunement de la main de M. Cusin; ils étaient de la main d’un employé, je ne sais lequel. L’écriture de M. Cusin m’est bien connue.
D. Est-ce que vous n’avez pas été étonné qu’on vous fît faire un travail qui était dans les attributions d’un autre employé, d’un employé de la comptabilité centrale? Comment se fait-il qu’on soit allé chercher à l’entrepôt des Marais un employé supérieur dont ce n’est pas la fonction, pour le faire travailler à une situation qui devait être faite par les employés chargés habituellement de ces travaux? Est-ce que cela ne vous a pas paru extraordinaire?
R. Si on me l’avait fait faire avec mystère, je l’aurais trouvé extraordinaire, mais on me le demandait en plein Conseil.
D. Pourriez-vous indiquer les personnes qui étaient là ?
R. Il y avait M. le Commissaire impérial, M. Cusin, M. Legendre, M. Orsi, M. Carteret, M. Stockes, d’autres peut-être; je puis avoir oublié des noms depuis trois ans.
M. L’AVOCAT IMPÉRIAL. — A quelle époque avez-vous été chargé de ce travail?
R. Au mois d’août 1854. Cela a été fait séance tenante. Tous les documents étaient sur la table. C’étaient, je le répète, des pièces émanées de la comptabilité de l’administration centrale; elles se composaient de plusieurs feuilles de la main d’un employé ; il n’y avait pas de trace de la main des administrateurs.
M. LE PRÉSIDENT. — Puisque la chose était si simple, puisqu’il suffisait de mettre à l’actif ce qui était à l’actif, et au passif ce qui était au passif, par quel motif allait-on vous chercher, vous qui habituellement ne travailliez pas aux bilans?
R. En effet, je ne faisais que le bilan de ma comptabilité, ou plutôt je le faisais faire la plupart du temps par mon teneur de livres; mais je n’ai pas été étonné, parce que vingt fois j’avais été appelé à l’administration centrale pour assister aux Conseils. Je n’étais pas seulement un directeur pour recevoir le public, j’avais quelque habitude des affaires, je pouvais donner des renseignements très utiles en matière de douane et de statistique. A l’époque surtout où ces messieurs voulaient créer des Docks près de chaque chemin de fer, il était très naturel qu’ils vinssent me consulter sur les renseignements que je pouvais leur donner. C’est pour cela que je n’ai rien trouvé d’étonnant à cette demande de situation en plein Conseil. S’ils me l’eussent faite hors du cabinet, je n’aurais pas accédé.
D. Duchêne de Vère faisait-il partie du Conseil?
R. Il n’appartenait plus à l’administration.
D. Ainsi, il résulte de votre déposition qu’on vous a appelé dans cette circonstance pour vous faire faire un bilan?
R. Oui, monsieur.
CUSIN. — M. Levitre était à la tète de la comptabilité de l’administration centrale; mais M. Lombard ayant plus que lui encore l’habitude de ces sortes de travaux, c’est pour cela que nous l’avons chargé de vérifier si les chiffres étaient exacts. Voilà ma seule observation.