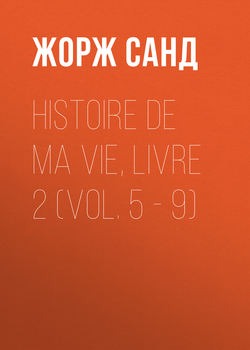Читать книгу Histoire de ma Vie, Livre 2 (Vol. 5 - 9) - Жорж Санд - Страница 2
TOME CINQUIÈME CHAPITRE QUATRIEME
ОглавлениеIdée d'une loi morale réglementaire des affections. — Retour à Nohant. — Année de bonheur. — Apologie de la puissance impériale. — Commencemens de trahison. — Propos et calomnies des salons. — Première communion de mon frère. — Notre vieux curé; sa gouvernante. — Ses sermons. — Son voleur, sa jument. — Sa mort. — Les méfaits de l'enfance. — Le faux Deschartres. — La dévotion de ma mère. — J'apprends le français et le latin.
Je m'ennuyais beaucoup, et pourtant je n'étais pas encore malheureuse. J'étais fort aimée, et ce n'est pas là ce qui m'a manqué dans ma vie. Je ne me plains donc pas de cette vie, malgré toutes ses douleurs, car la plus grande doit être de ne point inspirer les affections qu'on éprouve. Mon malheur et ma destinée furent d'être blessée et déchirée précisément par l'excès de ces affections qui manquaient tantôt de clairvoyance ou de délicatesse, tantôt de justice ou de modération. Un de mes amis, homme d'une grande intelligence faisait souvent une réflexion qui m'a toujours paru très frappante, et il la développait ainsi:
«On a fait des règles et des lois morales pour corriger ou développer les instincts, disait-il; mais on n'en a point fait pour diriger et éclairer les sentimens. Nous avons des religions et des philosophies pour régler nos appétits et réprimer nos passions; les devoirs de l'âme nous sont bien enseignés d'une manière élémentaire, mais l'âme a toutes sortes d'élans qui donnent toutes sortes de nuances et d'aspects particuliers à ses affections. Elle a des puissances qui dégénèrent en excès, des défaillances qui deviennent des maladies. Si vous consultez les amis, si vous cherchez un remède dans les livres, vous aurez différens avis et des jugemens contradictoires; preuve qu'il n'y a pas de règle fixe pour la morale des affections même les plus légitimes, et que chacun, livré à lui-même, juge à son point de vue l'état moral de celui qui lui demande conseil; conseil qui ne sert à rien, d'ailleurs, qui ne guérit aucune souffrance et ne corrige aucun travers. Par exemple, je ne vois pas où est le catéchisme de l'amour. Et pourtant l'amour, sous toutes les formes, domine notre vie entière: Amour filial, amour fraternel, amour conjugal, amour paternel ou maternel, amitié, bienfaisance, charité ou philanthropie. L'amour est partout, il est notre vie même. Eh bien! l'amour échappe à toutes les directions, à tous les exemples, à tous les préceptes. Il n'obéit qu'à lui-même, et il devient tyrannie, jalousie, soupçon, exigence, obsession, inconstance, caprice, volupté ou brutalité, chasteté ou ascétisme, dévoûment sublime ou égoïsme farouche, le plus grand des biens, le plus grand des maux, suivant la nature de l'âme qu'il remplit et possède. N'y aurait-il pas un catéchisme à faire pour rectifier les excès de l'amour, car l'amour est excessif de sa nature, et il l'est souvent d'autant plus qu'il est plus chaste et plus sacré. Souvent les mères rendent leurs enfans malheureux à force de les aimer, impies à force de les vouloir religieux, téméraires à force de les vouloir prudens, ingrats à force de les vouloir tendres et reconnaissans. Et la jalousie conjugale! où sont ses limites permises d'atteindre, défendues de dépasser? Les uns prétendent qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie, d'autres que le véritable amour ne connaît pas le soupçon et la méfiance. Où est, sous ce rapport, la règle de conscience qui devrait nous enseigner à nous observer, à nous guérir nous-mêmes, à nous ranimer quand notre enthousiasme s'éteint, à le réprimer quand il s'emporte au delà du possible? Cette règle, l'homme ne l'a pas encore trouvée; voilà pourquoi je dis que nous vivons comme des aveugles, et que si les poètes ont mis un bandeau sur les yeux de l'amour, les philosophes n'ont pas su le lui ôter.»
Ainsi parlait mon ami, et il mettait le doigt sur mes plaies; car, toute ma vie, j'ai été le jouet des passions d'autrui, par conséquent leur victime. Pour ne parler que du commencement de ma vie, ma mère et ma grand'mère, avides de mon affection, s'arrachaient les lambeaux de mon cœur. Ma bonne, elle-même, ne m'opprima et ne me maltraita que parce qu'elle m'aimait avec excès, et me voulait parfaite selon ses idées.
Dès les premiers jours du printemps, nous fîmes les paquets pour retourner à la campagne. J'en avais grand besoin. Soit trop de bien-être, soit l'air de Paris, qui ne m'a jamais convenu, je redevenais languissante et je maigrissais à vue d'œil. Il n'aurait pas fallu songer à me séparer de ma mère: je crois qu'à cette époque, ne pouvant avoir le sentiment de la résignation et la volonté de l'obéissance, j'en serais morte. Ma bonne maman invita donc ma mère à revenir avec nous à Nohant, et comme je montrais à cet égard une inquiétude qui inquiétait les autres, il fut convenu que ma mère me conduirait avec elle, et que Rose nous accompagnerait, tandis que la grand'mère irait de son côté avec Julie. On avait vendu la grande berline, et on ne l'avait encore remplacée, vu un peu de gêne dans nos finances, que par une voiture à deux places.
Je n'ai point parlé dans ce qui précède de mon oncle Maréchal, ni de sa femme ma bonne tante Lucie, ni de leur fille ma chère Clotilde. Je ne me rappelle rien de particulier sur eux dans cette période de temps. Je les voyais assez souvent, mais je ne sais plus où ils demeuraient. Ma mère m'y conduisait, et même quelquefois ma grand'mère, qui recevait d'eux et qui leur rendait de rares visites. Les manières franches et ouvertes de ma tante ne lui plaisaient pas beaucoup; mais elle était trop juste pour ne pas reconnaître le devoûment vrai qu'elle avait eu pour mon père, et les excellentes et solides qualités du mari et de la femme.
J'eus donc le plaisir de demeurer deux ou trois jours avec ma mère et Caroline, dans une intimité de tous les momens. Puis ma pauvre sœur retourna en pleurant à sa pension, où l'on mit, je crois, Clotilde avec elle pendant quelque temps pour la consoler; et nous partîmes.
Cette portion de l'année 1811 passée à Nohant fut, je crois, une des rares époques de ma vie où je connus le bonheur complet. J'avais été heureuse comme cela rue Grange-Batelière, quoique je n'eusse ni grands appartemens ni grands jardins. Madrid avait été pour moi une campagne émouvante et pénible; l'état maladif que j'en avais rapporté, la catastrophe survenue dans ma famille par la mort de mon père, puis cette lutte entre mes deux mères, qui avait commencé à me révéler l'effroi et la tristesse, c'était déjà un apprentissage du malheur et de la souffrance. Mais le printemps et l'été de 1811 furent sans nuages, et la preuve, c'est que cette année-là ne m'a laissé aucun souvenir particulier. Je sais qu'Ursule la passa avec moi, que ma mère eut moins de migraines que précédemment, et que s'il y eut de la mésintelligence entre elle et ma bonne maman, cela fut si bien caché, que j'oubliais qu'il pouvait y en avoir et qu'il y en avait eu. Il est probable que ce fut aussi le moment de leur vie où elles s'entendirent le mieux, car ma mère n'était pas femme à cacher ses impressions: cela était au-dessus de ses forces, et quand elle était irritée, la présence même de ses enfans ne pouvait l'engager à se contenir.
Il y eut aussi dans la maison un peu plus de gaîté qu'auparavant. Le temps n'endort pas les grandes douleurs, mais il les assoupit. Presque tous les jours, pourtant, je voyais l'une ou l'autre de mes deux mères pleurer à la dérobée, mais leurs larmes même prouvaient qu'elles ne pensaient plus à toute heure, à tout instant, à l'objet de leurs regrets. Les douleurs dans leur plus grande intensité n'ont pas de crises; elles agissent dans une crise permanente pour ainsi dire.
Mme de la Marlière vint passer un mois ou deux chez nous. Elle était fort amusante avec Deschartres, qu'elle appelait petit père et qu'elle taquinait du matin au soir. Elle n'avait pas, à coup sûr, autant d'esprit que ma mère, mais il n'y avait jamais de bile dans ses plaisanteries. Elle avait de l'amitié pour Deschartres sans être hostile à ma mère, à qui elle donnait même toujours raison. Cette vieille femme légère était bonne, facile à vivre, impatientante seulement par son caquet, son bruit, son mouvement, ses éclats de rire retentissans, ses bons mots un peu répétés et le peu de suite de ses propos comme de ses idées. Elle était d'une ignorance fabuleuse malgré le brillant de son caquet. C'était elle qui disait une épître à l'âme au lieu d'un épithalame, et Mistoufiè pour Méphistophélès. Mais on pouvait se moquer d'elle sans la fâcher. Elle riait aux éclats de ses bévues, et c'était d'aussi bon cœur que quand elle riait de celles des autres.
Les petits jardins, les grottes, les bancs de gazon, les cascades allaient leur train pendant toute la belle saison. Le parterre du vieux poirier, qui marquait à notre insu la sépulture de mon petit frère, reçut de notables améliorations. Un tonneau plein d'eau fut placé à côté, afin que nous puissions nous livrer aux travaux de l'arrosage. Un jour, je tombai la tête la première dans ce tonneau et je m'y serais noyée si Ursule ne fût venue à mon secours.
Nous avions chacune notre petit jardin dans ce jardin de ma mère, qui était lui-même si petit qu'il aurait bien dû nous suffire; mais un certain esprit de propriété est tellement inné dans l'être humain, qu'il faut à l'enfant quatre pieds carrés de terre pour qu'il aime réellement cette terre cultivée par lui, et dont l'étendue est proportionnée à ses forces. Cela m'a toujours fait penser que, quelque communiste qu'on pût être, on devait toujours reconnaître une propriété individuelle. Qu'on la restreigne ou qu'on l'étende dans une certaine mesure, qu'on la définisse d'une manière ou d'une autre selon le génie ou les nécessités des temps, il n'en est pas moins certain que la terre que l'homme cultive lui-même lui est aussi personnelle que son vêtement. Sa chambre ou sa maison est encore un vêtement, son jardin ou son champ est le vêtement de sa maison, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette observation des instincts naturels, qui constate le besoin de la propriété dans l'homme, semble exclure le besoin d'une grande étendue de propriété. Plus la propriété est petite, plus il s'y attache, mieux il la soigne, plus elle lui devient chère. Un noble Vénitien ne tient certainement pas à son palais autant qu'un paysan du Berry à sa chaumière, et le capitaliste qui possède plusieurs lieues carrées en retire moins de jouissances que l'artisan qui cultive une giroflée dans sa mansarde. Un avocat de mes amis disait un jour en riant, à un riche client qui lui parlait à satiété de ses domaines: «Des terres? vous croyez qu'il n'y a que vous pour avoir des terres? J'en ai aussi, moi, sur ma fenêtre, dans des pots à fleurs, et elles me donnent plus de plaisir et moins de soucis que les vôtres.» Depuis, cet ami a fait un gros héritage; il a eu des terres, des bois, des fermes, et de soucis par conséquent.
En abordant l'idée communiste, qui a beaucoup de grandeur parce qu'elle a beaucoup de vérité, il faudrait donc commencer par distinguer ce qui est essentiel à l'existence complète de l'individu de ce qui est essentiellement collectif dans sa liberté, dans son intelligence, dans sa jouissance, dans son travail. Voilà pourquoi le communisme absolu, qui est la notion élémentaire, par conséquent grossière et trop forcée de l'égalité vraie, est une chimère ou une injustice.
Mais je ne pensais guère à tout cela, il y a trente-sept ans4! Trente-sept ans! Quelles transformations s'opèrent dans les idées humaines pendant ce court espace, et combien les changemens sont plus frappans et plus rapides à proportion dans les masses que chez les individus! Je ne sais pas s'il existait un communiste il y a trente-sept ans; cette idée aussi vieille que le monde n'avait pas pris un nom particulier, et c'est peut-être un tort qu'elle en ait pris un de nos jours, car ce nom n'exprime pas complétement ce que devrait être l'idée.
On n'en était pas alors à discuter sur de semblables matières. C'était la dernière, la plus brillante phase du règne de l'individualité. Napoléon était dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute la plénitude de son influence sur le monde. Le flambeau du génie allait décroître; il jetait sa plus vive lueur, sa clarté la plus éblouissante sur la France ivre et prosternée. Des exploits grandioses avaient conquis une paix opulente, glorieuse, mais fictive, car le volcan grondait sourdement dans toute l'Europe, et les traités de l'empereur ne servaient qu'à donner le temps aux anciennes monarchies de rassembler des hommes et des canons. Sa grandeur cachait un vice originel, cette profonde vanité aristocratique du parvenu qui lui fit commettre toutes ses fautes, et rendit de plus en plus inutiles, au salut de la France, la beauté du génie et du caractère de l'homme en qui la France se personnifiait. Oui, c'était un admirable caractère d'homme, puisque la vanité même, le plus mesquin, le plus pleutre des travers, n'avait pu altérer en lui la loyauté, la confiance, la magnanimité naturelles. Hypocrite dans les petites choses, il était naïf dans les grandes. Orgueilleux dans les détails, exigeant sur des misères d'étiquette, et follement fier du chemin que la fortune lui avait fait faire, il ne connaissait pas son propre mérite, sa vraie grandeur. Il était modeste à l'égard de son vrai génie.
Toutes les fautes qui ont précipité sa chute comme homme de guerre et comme homme d'État, sont venues d'une trop grande confiance dans le talent ou dans la probité des autres. Il ne méprisait pas l'espèce humaine, comme on l'a dit, pour n'estimer que lui-même: c'est là un propos de courtisan dépité ou d'ambitieux secondaire jaloux de sa supériorité. Il s'est confié toute sa vie à des traîtres. Toute sa vie il a compté sur la foi des traités, sur la reconnaissance de ses obligés, sur le patriotisme de ses créatures. Toute sa vie il a été joué ou trahi.
Son mariage avec Marie-Louise était une mauvaise action et devait lui porter malheur. Les gens les plus simples et les plus tolérans sur la loi du divorce, ceux mêmes qui aimaient le plus l'empereur, disaient tout bas, je m'en souviens bien: «C'est un mariage d'intérêt. On ne répudie pas une femme qu'on aime et dont on est aimé.» Il n'y aura, en effet, jamais de loi qui sanctionne moralement une séparation pleurée de part et d'autre, et qui s'accomplit seulement en vue d'un intérêt matériel. Mais, tout en blâmant l'empereur, on l'aimait encore parmi le peuple. Les grands commençaient à le trahir, et jamais ils ne l'avaient tant adulé. Le beau monde était en fêtes. La naissance d'un enfant roi (car ce n'eût pas été assez pour l'orgueil du soldat de fortune que de lui donner le titre de Dauphin de France) avait jeté la petite bourgeoisie, les soldats, les ouvriers et les paysans dans l'ivresse. Il n'y avait pas une maison riche ou pauvre, palais ou cabane, où le portrait du marmot impérial ne fût inauguré avec une vénération feinte ou sincère. Mais les masses étaient sincères: elles le sont toujours. L'empereur se promenait à pied, sans escorte, au milieu de la foule. La garnison de Paris était de 12,000 hommes!
Pourtant la Russie armait. Bernadotte donnait le signal d'une immense et mystérieuse trahison. Les esprits un peu clairvoyans voyaient venir l'orage. La cherté des denrées frappées par le blocus continental effrayait et contrariait les petites gens. On payait le sucre 6 francs la livre, et, au milieu de l'opulence apparente de la nation, on manquait de choses fort nécessaires à la vie. Nos fabriques n'avaient pas encore atteint le degré de perfectionnement nécessaire à cet isolement de notre commerce. On souffrait d'un certain malaise matériel, et quand on était las de s'en prendre à l'Angleterre, on s'en prenait au chef de la nation, sans amertume il est vrai, mais avec tristesse.
Ma grand'mère n'avait point d'enthousiasme pour l'empereur. Mon père n'en avait pas eu beaucoup non plus, comme on l'a vu dans ses lettres. Pourtant, dans les dernières années de sa vie il avait pris de l'affection pour lui. Il disait souvent à ma mère: «J'ai beaucoup à me plaindre de lui, non pas parce qu'il ne m'a pas placé d'emblée aux premiers rangs; il avait bien autre chose en tête, et il n'a pas manqué de gens plus heureux, plus habiles et plus hardis à demander que moi: mais je me plains de lui, parce qu'il aime les courtisans, et que ce n'est pas digne d'un homme de sa taille. Pourtant, malgré ses torts envers la révolution et envers lui-même, je l'aime. Il y a en lui quelque chose, je ne sais quoi, son génie à part, qui me force à être ému quand mon regard rencontre le sien. Il ne me fait pas peur du tout, et c'est à cela que je sens qu'il vaut mieux que les airs qu'il se donne.»
Ma grand'mère ne partageait pas cette sympathie secrète qui avait gagné mon père, et qui, jointe à la loyauté de son âme, à la chaleur de son patriotisme, l'eussent certainement empêché, je ne dis pas seulement de trahir l'empereur, mais même de se rallier après coup au service des Bourbons. Il fallait que cela fût bien certain, d'après son caractère, puisque après la campagne de France, ma grand'mère, toute royaliste qu'elle était devenue, disait en soupirant: «Ah! si mon pauvre Maurice avait vécu, il ne m'en faudrait pas moins le pleurer à présent! Il se serait fait tuer à Waterloo ou sous les murs de Paris, ou bien il se serait brûlé la cervelle en voyant entrer les Cosaques.» Et ma mère m'en disait la même chose de son côté.
Pourtant ma grand'mère redoutait l'Empereur plus qu'elle ne l'aimait. A ses yeux c'était un ambitieux sans repos, un tueur d'hommes, un despote par caractère encore plus que par nécessité. Les plaintes, les critiques, les calomnies, les révélations fausses ou vraies, ne remplissaient pas alors les colonnes des journaux. La presse était muette: mais cette absence de polémique donnait aux conversations et aux préoccupations des particuliers un caractère de partialité et de commérage extraordinaire. La louange officielle a fait plus de mal à Napoléon que ne lui en eussent fait vingt journaux hostiles. On était las de ces dithyrambes ampoulés, de ces bulletins emphatiques, de la servilité des fonctionnaires et de la morgue mystérieuse des courtisans. On s'en vengeait en rabaissant l'idole dans l'impunité des causeries intimes, et les salons récalcitrans étaient des officines de délations, de propos d'antichambre, de petites calomnies, de plates anecdotes qui devaient plus tard rendre la vie à la presse sous la Restauration. Quelle vie! Mieux eût valu rester morte que de ressusciter ainsi, en s'acharnant sur le cadavre de l'empire vaincu et profané.
La chambre à coucher de ma grand'mère (car, je l'ai dit, elle ne tenait pas salon, et sa société avait un caractère d'intimité solennelle) fût devenue une de ces officines si, par son bon esprit et son grand sens, la maîtresse du logis n'eût fait, de temps en temps, ouvertement la part du vrai et du faux dans les nouvelles que chacun ou plutôt chacune y apportait: car c'était une société de femmes plutôt que d'hommes, et, au reste, il y avait peu de différence morale entre les deux sexes: les hommes y faisant l'office de vieilles bavardes. Chaque jour on nous apportait quelque méchant bon mot de M. de Talleyrand contre son maître, ou quelque cancan de coulisses. Tantôt l'empereur avait battu l'impératrice, tantôt il avait arraché la barbe du Saint-Père. Et puis, il avait peur; il était toujours plastronné. Il fallait bien dire cela pour se venger de ce que personne ne songeait plus à l'assassiner, si ce n'est quelque intrépide et fanatique enfant de la Germanie, comme Staps ou La Sahla. Un autre jour, il était fou; il avait craché au visage de M. Cambacérès. Et puis son fils, arraché par le forceps au sein maternel, était mort en voyant la lumière, et le petit roi de Rome était l'enfant d'un boulanger de Paris. Ou bien, le forceps ayant déprimé son cerveau, il était infailliblement crétin, et l'on se frottait les mains, comme si, en rétablissant l'hérédité au profit d'un soldat de fortune, la France devait être punie par la Providence de n'avoir pas su conserver ses crétins légitimes.
Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au milieu de tous ces déchaînemens sournois contre l'empereur, il n'y avait pas un regret, pas un souvenir, pas un vœu pour les Bourbons exilés. J'écoutais avec stupeur tous ces propos; jamais je n'entendis prononcer le nom des prétendans inconnus qui trônaient à huis-clos on ne savait où, et quand ces noms frappèrent mes oreilles en 1814, ce fut pour la première fois de ma vie.
Ces commérages ne nous suivaient pas à Nohant, si ce n'est dans quelques lettres que ma grand'mère recevait de ses nobles amies. Elle les lisait tout haut à ma mère, qui haussait les épaules, et à Deschartres, qui les prenait pour paroles d'Évangile, car l'empereur était sa bête noire, et il le tenait fort sérieusement pour un cuistre.
Ma mère était comme le peuple: elle admirait et adorait l'empereur à cette époque. Moi, j'étais comme ma mère et comme le peuple. Ce qu'il ne faut jamais oublier ni méconnaître, c'est que les cœurs naïvement attachés à cet homme furent ceux qu'aucune reconnaissance personnelle et aucun intérêt matériel ne lièrent à ses désastres ou à sa fortune. Sauf de bien rares exceptions, tous ceux qu'il avait comblés furent ingrats. Tous ceux qui ne songèrent jamais à lui rien demander lui tinrent compte de la grandeur de la France.
Je crois que ce fut cette année-là ou la suivante qu'Hippolyte fit sa première communion. Notre paroisse étant supprimée, c'est à Saint-Chartier que se faisaient les dévotions de Nohant. Mon frère fut habillé de neuf ce jour-là. Il eut des culottes courtes, des bas blancs et un habit veste en drap vert-billard. Il était si enfant que cette toilette lui tournait la tête, et que s'il réussit à se tenir tranquille pendant quelques jours, ce fut dans la crainte, en manquant sa première communion, de ne pas endosser ce costume splendide qu'on lui préparait.
C'était un excellent homme que le vieux curé de Saint-Chartier mais dépourvu de tout idéal évangélique. Quoiqu'il eût un de devant son nom, je crois qu'il était paysan de naissance, ou bien, à force de vivre avec les paysans, il avait pris leurs façons et leur langage, à tel point qu'il pouvait les prêcher sans qu'ils perdissent un mot de son sermon; ce qui eût été un bien si ses sermons eussent été un peu plus évangéliques. Mais il n'entretenait ses fidèles que d'affaires de ménage, et c'était avec un abandon plein de bonhomie qu'il leur disait en chaire: «Mes chers amis, voilà que je reçois un mandement de l'archevêque qui nous prescrit encore une procession. Monseigneur en parle bien à son aise. Il a un beau carrosse pour porter sa grandeur, et un tas de personnage pour se donner du mal à sa place. Mais moi, me voilà vieux, et ce n'est pas une petite besogne que de vous ranger en ordre de procession. La plupart de vous n'entendent ni à hue ni à dia. Vous vous poussez, vous vous marchez sur les pieds, vous vous bousculez pour entrer ou sortir de l'église, et j'ai beau me mettre en colère, jurer après vous, vous ne m'écoutez point et vous vous comportez comme des veaux qui entrent dans une étable. Il faut que je sois à tout, dans ma paroisse et dans mon église; c'est moi qui suis obligé de faire toute la police, de gronder les enfans et de chasser les chiens. Or, je suis las de toutes ces processions qui ne servent à rien du tout pour votre salut et pour le mien. Le temps est mauvais, les chemins sont gâtés, et si monseigneur était obligé de patauger, comme nous, deux heures dans la boue avec la pluie sur le dos, il ne serait pas si friand de cérémonies. — Ma foi, je n'ai pas envie de me déranger pour celle-là, et si vous m'en croyez, vous resterez chacun chez vous... Oui dà, j'entends le père un tel qui me blâme, et voilà ma servante qui ne m'approuve point... Ecoutez: que ceux qui ne sont pas contens, aillent... se promener. Vous en ferez ce que vous voudrez: mais quant à moi, je ne compte pas sortir dans les champs: je vous ferai votre procession autour de l'église. C'est bien suffisant. Allons, allons, c'est entendu. Finissons cette messe qui n'a duré que trop longtemps.» J'ai entendu de mes deux oreilles plus de deux cents sermons, dont celui-là est un specimen très atténué, et dont les formes sont restées proverbiales dans nos paroisses, particulièrement la formule de la fin qui était comme l'amen de toutes ses prédications et admonestations paternelles.
Il y avait à Saint-Chartier une vieille dame d'un embonpoint prodigieux, dont l'époux était maire ou adjoint de la commune. Elle avait eu une vie orageuse: novice, avant la révolution, elle avait sauté par dessus les murs du monastère pour suivre à l'armée un garde français ou un suisse; je ne sais par quelle suite d'aventures étranges elle était venue asseoir ses derniers beaux jours dans le banc des marguilliers de notre paroisse où elle avait apporté beaucoup plus des manières du régiment que de celles du cloître. Aussi la messe était-elle interrompue à chaque instant par ses bâillemens affectés et par ses apostrophes énergiques à M. le curé: «Quelle diable de messe, disait-elle tout haut. Ce gredin-là n'en finira pas! — Allez au diable! disait le curé à demi-voix, en se retournant pour bénir l'auditoire: Dominus vobiscum.»
Ces dialogues, jetés à travers la messe et dans un style si accentué que je ne puis en donner qu'une très faible traduction, troublaient à peine la gravité de l'auditoire rustique, et comme ce furent les premières messes auxquelles j'assistai, il me fallut quelque temps pour comprendre que c'étaient des cérémonies religieuses. La première fois que j'en revins, ma grand'mère me demandant ce que j'avais vu: J'ai vu, lui dis-je, le curé qui déjeûnait tout debout devant une grande table, et qui, de temps en temps, se retournait pour nous dire des sottises.
Le jour où Hippolyte fit sa première communion, le curé l'avait invité à déjeûner après la messe. Comme ce gros garçon n'était pas trop ferré sur son catéchisme, ma grand'mère, qui désirait que la première communion fût, comme elle le disait, une affaire baclée, avait prié le curé d'user d'un peu d'indulgence, alléguant le peu de mémoire de l'enfant. M. le curé avait été indulgent, en effet, et Hippolyte fut chargé de lui porter un petit cadeau: c'était douze bouteilles de vin muscat. On se mit à table et on déboucha la première bouteille. — Ma foi, fit le bon curé, voilà un petit vin blanc qui se laisse boire et qui ne doit pas porter à la tête comme le vin du crû. C'est doux, c'est gentil, ça ne peut pas faire de mal. Buvez, mon garçon, mettez-vous là: Manette, appelez le sacristain, et nous goûterons la seconde bouteille quand la première sera finie.
La servante et le sacristain prirent place et trouvèrent le vin fort gentil. En effet, Hippolyte ne se méfiait de rien, n'en ayant jamais eu à sa discrétion. Les convives le trouvèrent un peu chaud à la seconde bouteille, mais après essai, ils déclarèrent qu'il ne portait pas l'eau. On passa au troisième et au quatrième feuillet du bréviaire, comme disait le curé, c'est à dire aux autres bouteilles du panier, et insensiblement le communiant, le curé, la servante et le sacristain se trouvèrent si gais, puis si graves, puis si préoccupés, qu'on se sépara sans trop savoir comment. Hippolyte revint seul par les prés, car depuis longtemps tous les paroissiens venus à la messe étaient rentrés chez eux. Chemin faisant, il se sentit la tête si lourde qu'il croyait voir danser les buissons. Il prit le parti de se coucher sous un arbre et d'y faire un bon somme. Après quoi, ses idées s'étant un peu éclaircies, il put revenir à la maison, où il nous édifia tous par sa gravité et sa sobriété le reste de la journée.
La servante du curé était une toute petite femme, propre, active, dévouée, tracassière et acariâtre: ce dernier défaut étant souvent comme un complément inévitable des qualités dont il est peut-être l'excès. Elle avait sauvé la vie et la bourse de son maître pendant la révolution. Elle l'avait caché, elle avait nié sa présence avec beaucoup de hardiesse et de sang-froid au temps de la persécution. Cela ne s'était point passé dans notre vallée noire, où les prêtres ni les seigneurs n'ont jamais été menacés sérieusement ni maltraités en aucune façon. Depuis ce temps, Manette gouvernait despotiquement son maître, et le faisait marcher comme un petit garçon. Ils sont morts à peu d'intervalle l'un de l'autre, dans un âge très avancé, et malgré leurs querelles et le peu d'idéal de leur vie, le temps qui ennoblit tout avait donné à leur affection mutuelle un caractère touchant. Manette voulait toujours que son maître fût exclusivement soigné et servi par elle; mais elle n'en avait plus la force, et lorsqu'il était malade, quand elle l'avait bien veillé et médicamenté, elle tombait malade à son tour. Alors, le curé prenait une autre servante pour que la vieille pût se reposer et se soigner. Mais à peine était-elle debout qu'elle était furieuse de voir une étrangère dans la maison. Elle n'avait pas de repos qu'elle ne l'eût fait renvoyer.
Mais plus elle allait, plus elle perdait ses forces. Elle se plaignait alors d'avoir trop d'ouvrage et de n'être point secondée. Et vite le curé de reprendre une aide qu'il fallait renvoyer de même au bout de huit jours. C'était une criaillerie perpétuelle, et le curé s'en plaignait à moi, car j'avais trente et quelques années qu'il vivait encore.. «Hélas! disait-il, elle me rend très malheureux, mais que voulez-vous? Il y a soixante et sept ans que nous sommes ensemble, elle m'a sauvé la vie, elle m'aime comme son fils, il faut bien que celui qui survivra ferme les yeux de celui qui partira le premier. Elle me gronde sans cesse, elle se plaint de moi comme si j'étais un ingrat: je tâche de lui prouver qu'elle est injuste, mais elle est si sourde qu'elle n'entend pas la grosse cloche!» Et, en disant cela, le vieux curé ne se doutait pas qu'il était sourd lui-même à ne pas entendre le canon.
Il n'était pas très aimé de ses paroissiens, et je pense qu'il y avait bien au moins autant de leur faute que de la sienne: car, quoi qu'on dise des touchantes relations qui existent dans les campagnes entre curés et paysans, rien n'est si rare, du moins depuis la révolution, que de voir les uns et les autres se rendre justice et se témoigner de l'indulgence. Le paysan exige du curé trop de perfection chrétienne: le curé ne pardonne pas assez au paysan son existence et les défauts de son éducation morale, qui sont un peu l'œuvre du catholicisme, venu en aide au despotisme pour le tenir dans l'ignorance et la crainte. Quoi qu'il en soit, notre curé avait de bonnes qualités. Il était d'une franchise et d'une indépendance de caractère qui ne se rencontrent plus guère dans la hiérarchie ecclésiastique. Il ne se mêlait pas de politique, il ne cherchait pas à exercer de l'influence pour plaire à tel personnage ou pour se préserver des rancunes de tel autre, car il était courageux, audacieux même par nature. Il aimait la guerre de passion, et se plaisait au récit des campagnes de nos soldats, disant que, s'il n'était pas prêtre, il voudrait être militaire. Certes, il tenait bien un peu de l'un et de l'autre, car il jurait comme un dragon et buvait comme un templier. «Je ne suis point un cagot, moi, disait-il, sous la Restauration. Je ne suis pas un de ces hypocrites qui ont changé de manières depuis que le gouvernement nous protége. Je suis le même qu'auparavant et n'exige point que mes paroissiens me saluent plus bas, ni qu'ils se privent du cabaret et de la danse, comme si ce qui était permis hier ne devait plus l'être aujourd'hui. Je suis mauvaise tête, et je n'ai pas besoin de nouvelles lois pour me défendre. Si quelqu'un me cherche noise, je suis bon pour lui répondre, et j'aime mieux lui montrer mon poing que de le menacer des gendarmes et du procureur du roi. Je suis un vieux de la vieille roche, et je ne crois pas qu'avec leur loi contre le sacrilége ils aient réussi à faire aimer la religion. Je ne tracasse personne et ne me laisse guère tracasser non plus. Je n'aime pas l'eau dans le vin et ne force personne à en mettre. Si l'archevêque n'est pas content, qu'il le dise, je lui répondrai, moi! Je lui montrerai qu'on ne fait pas marcher un homme de mon âge comme un petit séminariste; et s'il m'ôte ma paroisse, je n'irai pas dans une autre. Je me retirerai chez moi. J'ai huit ou dix mille francs de placés. C'est assez pour ce qui me reste de temps à vivre, et je me moquerai bien de tous les archevêques du monde.»
En effet, l'archevêque étant venu donner la confirmation à Saint-Chartier, et déjeûnant chez le curé avec tout son état-major, monseigneur voulut plaisanter son hôte, qui ne se laissa point faire. «Vous avez quatre-vingt-deux ans, monsieur le curé, lui dit il, c'est un bel âge! — Oui-dà, monseigneur, répliqua le curé, qui ne se faisait pas faute de quelques liaisons hasardées dans le discours: vous avez beau z-être archevêque, vous n'y viendrez peut-être point.» L'observation du prélat voulait dire au fond: Vous voilà si vieux que vous devez radoter, et il serait temps de laisser la place à un plus jeune. — Et la réplique signifiait: Je ne la céderai point que vous ne m'en chassiez, et nous verrons si vous oserez faire cette injure à mes cheveux blancs.
A ce même déjeuner, vers le dessert, comme l'archevêque devait venir dîner chez moi, le curé, apostrophant mon frère qui était à côté de lui et croyait lui parler tout bas, lui cria en vrai sourd qu'il était: «Ah çà, emmenez-le donc et débarrassez-moi de tous ces grands messieurs-là, qui me font une dépense de tous les diables et qui mettent ma maison sens dessus dessous. J'en ai prou, et grandement plus qu'il ne faut pour savoir qu'ils mangent mes perdrix et mes poulets tout en se gaussant de moi.» Ce discours tenu à haute voix au milieu d'un silence dont le bon curé ne se doutait pas, mit Hippolyte dans un grand embarras; mais voyant que l'archevêque et le grand-vicaire en riaient aux éclats, il prit le parti de rire aussi, et on quitta la table, à la grande satisfaction de l'Amphytrion et de Manette qui, croyant cacher leurs pensées, les disaient tout haut, à la barbe de leurs illustres hôtes.
Vers la fin de sa vie, notre curé eut une émotion qui dut la hâter. Il avait la manie de cacher son argent comme beaucoup de vieillards qui n'osent le placer, et qui se créent un tourment avec les économies destinées à faire la sécurité de leurs vieux jours. Il avait mis les siennes dans son grenier. Un voisin, qu'il avait pourtant, dit-on, comblé de bienfaits, se laissa tenter, grimpa la nuit par les toits, pénétra par une lucarne, et s'empara du trésor de M. l'abbé. Quand celui-ci vit ses écus dénichés, il eut tant de colère et de chagrin qu'il faillit devenir fou. Il était au lit, il avait presque le délire quand le procureur du roi vint, sur sa requête, prendre des informations et recevoir sa plainte. Ce qui ajoutait à la douleur et à l'indignation du vieillard, c'est qu'il avait deviné l'auteur du délit; mais, au moment de le désigner aux poursuites de la justice, il fut pris de compassion pour cet homme qu'il avait aimé, et peut-être aussi d'un remords de chrétien pour cet amour de l'argent qui l'avait trop dominé. «Faites votre besogne, dit-il au magistrat qui l'interrogeait; j'ai été volé, c'est vrai, mais si j'ai des soupçons, je n'en dois compte qu'au bon Dieu, et il ne m'appartient pas de punir le coupable.» On le pressa vainement. «Je n'ai rien à vous dire, fit-il en tournant le dos avec humeur. Je pourrais me tromper. C'est vous autres, magistrats, de prendre cela sur votre conscience. C'est votre état et non le mien.»
La nuit suivante, l'argent fut reporté dans le grenier, et Manette, en furetant avec désespoir, le retrouva dans la cachette d'où on l'avait soustrait. Le voleur, pris de repentir et touché de la générosité du curé, s'était exécuté à l'instant même. Le curé, pour faire cesser les investigations de la justice et les commentaires de la paroisse, donna à entendre qu'il avait rêvé la perte de son argent, ou que sa servante, pour le mieux cacher, l'avait changé de place et ne s'en était pas souvenue le lendemain, à cause de son grand âge, qui lui avait fait perdre la mémoire. On raconta donc de diverses manières l'aventure du curé, et plusieurs versions courent encore à cet égard. Mais il m'a raconté lui-même ce que je raconte ici à son honneur, et même à l'honneur de son voleur, car le sentiment chrétien qui estime le repentir plus agréable à Dieu que la persévérance, est un beau sentiment dont la justice humaine ne tient guère de compte.
Ce vieux curé avait beaucoup d'amitié pour moi. J'avais quelque chose comme trente-cinq ans qu'il disait encore de moi: «L'Aurore est un enfant que j'ai toujours aimé.» Et il écrivait à mon mari, supposant apparemment qu'il pouvait lui donner de l'ombrage: «Ma foi, monsieur, prenez-le comme vous voudrez, mais j'aime tendrement votre femme.»
Le fait est qu'il agissait tout paternellement avec moi. Pendant vingt ans, il n'a pas manqué un dimanche de venir dîner avec moi après vêpres. Quelquefois j'allais le chercher en me promenant. Un jour, je me fis mal au pied en marchant, et je n'aurais su comment revenir, car, dans ce temps-là, il ne fallait pas parler de voitures dans les chemins de Saint-Chartier, si le curé ne m'eût offert de me prendre en croupe sur sa jument; mais j'aurais mieux fait de prendre en croupe le curé, car il était si vieux alors qu'il s'endormait au mouvement du cheval. Je rêvassais en regardant la campagne, lorsque je m'aperçus que la bête, après avoir progressivement ralenti son allure, s'était arrêtée pour brouter, et que le curé ronflait de tout son cœur. Heureusement l'habitude l'avait rendu solide cavalier, même dans son sommeil; je jouai du talon, et la jument, qui savait son chemin, nous conduisit à bon port, malgré qu'elle eût la bride sur le cou.
Après le dîner, où il mangeait et buvait copieusement, il se rendormait au coin du feu, et, de ses ronflemens, faisait trembler les vitres. Puis il s'éveillait et me demandait un petit air de clavecin ou d'épinette: il ne pouvait pas dire piano, l'expression lui semblant trop nouvelle. A mesure qu'il vieillissait, il n'entendait plus les basses; les notes aiguës de l'instrument lui chatouillaient encore un peu le tympan. Un jour il me dit: «Je n'entends plus rien du tout. Allons, me voilà vieux!» Pauvre homme! il y avait longtemps qu'il l'était. Et pourtant, il montait encore à cheval à dix heures du soir, et s'en retournait, en plein hiver à son presbytère, sans vouloir être accompagné. Quelques heures avant de mourir, il dit au domestique, que j'avais envoyé savoir de ses nouvelles: «Dites à Aurore qu'elle ne m'envoie plus rien; je n'ai plus besoin de rien; et dites-lui aussi que je l'aime bien, ainsi que ses enfans.»
Il me semble que la plus grande preuve d'attachement qu'on puisse revendiquer, c'est d'avoir occupé les dernières pensées d'un mourant. Peut-être aussi y a-t-il là quelque chose de prophétique qui doit inspirer de la confiance ou de l'effroi. Lorsque la supérieure de mon couvent mourut, de soixante pensionnaires qui l'intéressaient toutes à peu près également, elle ne songea qu'à moi, à qui pourtant elle n'avait jamais témoigné une sollicitude particulière. «Pauvre Dupin, dit-elle à plusieurs reprises dans son agonie, je la plains bien de perdre sa grand'mère.» Elle rêvait que c'était ma grand'mère qui était malade et mourante à sa place. Cela me laissa une grande inquiétude et une sorte d'appréhension superstitieuse de quelque malheur imminent.
Ce fut vers l'âge de sept ans que je commençai à subir le préceptorat de Deschartres. Je fus assez longtemps sans avoir à m'en plaindre, car, autant il était rude et brutal avec Hippolyte, autant il fut calme et patient avec moi dans les premières années. C'est pour cela que je fis de rapides progrès avec lui, car il démontrait fort clairement et brièvement quand il était de sang-froid; mais dès qu'il s'animait, il devenait diffus, embarrassé dans ses démonstrations, et la colère le faisant bégayer, le rendait tout à fait inintelligible. Il maltraitait et rudoyait horriblement le pauvre Hippolyte, qui pourtant avait de la facilité et une mémoire excellente. Il ne voulait pas tenir compte du besoin d'activité d'une robuste nature que de trop longues leçons exaspéraient. J'avoue bien, malgré mon amitié pour mon frère, que c'était un enfant insupportable. Il ne songeait qu'à briser, à détruire, à taquiner, à jouer de mauvais tours à tout le monde. Un jour, il lançait des tisons enflammés dans la cheminée, sous prétexte de sacrifier aux dieux infernaux et il mettait le feu à la maison. Un autre jour, il mettait de la poudre dans une grosse bûche pour qu'elle fît explosion dans le foyer et lançât le pot-au-feu au milieu de la cuisine. Il appelait cela étudier la théorie des volcans. Et puis il attachait une casserole à la queue des chiens et se plaisait à leur fuite désordonnée et à leurs cris d'épouvante à travers le jardin. Il mettait des sabots aux chats, c'est à dire qu'il leur engluait les quatre pieds dans des coquilles de noix et qu'il les lançait ainsi sur la glace ou sur les parquets, pour les voir glisser, tomber, et retomber cent fois avec des juremens épouvantables. D'autres fois il disait être Calchas, le grand-prêtre des Grecs, et, sous prétexte de sacrifier Iphigénie sur la table de la cuisine, il prenait le couteau destiné à de moins illustres victimes: et, s'évertuant à droite et à gauche, il blessait les autres ou lui-même.
Je prenais bien quelquefois un peu de part à ses méfaits dans la mesure de mon tempérament qui était moins fougueux. Un jour que nous avions vu tuer un cochon gras dans la basse-cour, Hippolyte s'imagina de traiter comme tels les concombres du jardin. Il leur introduisait une petite brochette de bois dans l'extrémité qui, selon lui, représentait le cou de l'animal: puis, pressant du pied ces malheureux légumes, il en faisait sortir tout le jus. Ursule le recueillait dans un vieux pot à fleurs pour faire le boudin, et j'allumais gravement un feu fictif à côté pour faire griller le porc, c'est à dire le concombre, ainsi que nous l'avions vu pratiquer au boucher. Ce jeu nous plut tellement que, passant d'un concombre à l'autre, choisissant d'abord les plus gras, et finissant par les moins rebondis, nous dévastâmes lestement une couche, objet des sollicitudes du jardinier. Je laisse à penser quelle fut sa douleur quand il vit cette scène de carnage. Hippolyte, au milieu des cadavres, ressemblait à Ajax immolant dans son délire les troupeaux de l'armée des Grecs. Le jardinier porta plainte, et nous fûmes punis: mais cela ne fit pas revivre les concombres, et on n'en mangea pas cette année-là.
Un autre de nos méchans plaisirs était de faire ce que les enfans de notre village appellent des trompe-chien. C'est un trou que l'on remplit de terre légère délayée dans de l'eau. On le recouvre avec de petits bâtons; sur lesquels on place des ardoises et une légère couche de terre ou de feuilles sèches, et quand ce piége est établi au milieu d'un chemin ou d'une allée de jardin, on guette les passans et on se cache dans les buissons pour les voir s'embourber, en vociférant contre les gamins abominables qui s'inventent de pareils tours5. Pour peu que le trou soit profond, il y a de quoi se casser les jambes; mais les nôtres n'offraient pas ce danger-là, ayant une assez grande surface. L'amusant, c'était de voir la terreur du jardinier qui sentait la terre manquer sous ses pieds dans les plus beaux endroits de ses allées ratissées, et qui en avait pour une heure à réparer le dommage. Un beau jour, Deschartres y fut pris. Il avait toujours de beaux bas à côtes, bien blancs, des culottes courtes et de jolies guêtres de nankin, car il était vaniteux de son pied et de sa jambe; il était d'une propreté extrême et recherché dans sa chaussure; avec cela, comme tous les pédans c'est un signe caractéristique à quoi on peut les reconnaître à coup sûr, même quand ils ne font pas métier de pédagogues, il marchait toujours le jarret tendu et les pieds en dehors. Nous marchions derrière lui pour mieux jouir du coup d'œil. Tout d'un coup le sol s'affaisse, et le voilà jusqu'à mi-jambe dans une glaise jaune, admirablement préparée pour teindre ses bas. Hippolyte fit l'étonné, et toute la fureur de Deschartres dut retomber sur Ursule et sur moi. Mais nous ne le craignions guère; nous étions bien loin avant qu'il eût repêché ses souliers.
Comme Deschartres battait cruellement mon pauvre frère, et qu'il se contentait de dire des sottises aux petites filles, il était convenu, entre Hippolyte, Ursule et moi, que nous prendrions beaucoup de ces sortes de choses sur notre compte, et même nous avions, pour mieux donner le change, une petite comédie tout arrangée et qui eut du succès pendant quelque temps. Hippolyte prenait l'initiative: «Voyez ces petites sottes! criait-il aussitôt qu'il avait cassé une assiette ou fait crier un chien trop près de l'oreille de Deschartres, elles ne font que du mal! voulez-vous bien finir, mesdemoiselles!» Et il se sauvait, tandis que Deschartres, mettant le nez à la fenêtre, s'étonnait de ne pas voir les petites filles.
Un jour que Deschartres était allé vendre des bêtes à la foire, car l'agriculture et la régie de nos fermes l'occupaient en première ligne, Hippolyte, étant sensé étudier sa leçon dans la chambre du grand homme, s'imagina de faire le grand homme tout de bon. Il endosse la grande veste de chasse, qui lui tombait sur les talons, il coiffe la casquette à soufflet, et le voilà qui se promène dans la chambre en long et en large, les pieds en dehors, les mains derrière le dos, à la manière du pédagogue. Puis il s'étudie à imiter son langage. Il s'approche du tableau noir, fait des figures avec de la craie, entame une démonstration, se fâche, bégaie, traite son élève d'ignorant crasse et de butor; puis, satisfait de son talent d'imitation, il se met à la fenêtre et apostrophe le jardinier sur la manière dont il taille les arbres, et le critique, le réprimande, l'injurie, le menace.. le tout dans le style de Deschartres, et avec ses éclats de voix accoutumés. Soit que ce fut assez bien imité, soit la distance, le jardinier qui, dans tous les cas, était un garçon simple et crédule, y fut pris, et commença à répondre et à murmurer. Mais quelle fut sa stupeur quand il vit à quelques pas de lui le véritable Deschartres, qui assistait à cette scène et ne perdait pas un des gestes ni une des paroles de son sosie. Deschartres aurait dû en rire, mais il ne supportait pas qu'on s'attaquât à sa personnalité, et, par malheur, Hippolyte ne le vit pas, caché qu'il était par les arbres. Deschartres, qui était rentré de la foire plus tôt qu'on ne l'attendait, monta sans bruit à sa chambre et en ouvrit brusquement la porte, au moment où l'espiègle disait d'une grosse voix à un Hippolyte supposé: «Vous ne travaillez pas, voilà une écriture de chat et une orthographe de crocheteur; pim! pan! voilà pour vos oreilles, animal que vous êtes!»
En ce moment la scène fut double, et pendant que le faux Deschartres souffletait un Hippolyte imaginaire, le vrai Deschartres souffletait le véritable Hippolyte.
J'apprenais la grammaire avec Deschartres et la musique avec ma grand'mère. Ma mère me faisait lire et écrire. On ne me parlait d'aucune religion, bien qu'on me fît lire l'Histoire sainte. On me laissait libre de croire et de rejeter à ma guise les miracles de l'antiquité. Ma mère me faisait dire ma prière à genoux, à côté d'elle qui n'y manquait pas, qui n'y a jamais manqué. Et même c'étaient d'assez longues prières; car, après que j'avais fini les miennes et que j'étais couchée, je la voyais encore à genoux, la figure dans ses mains et profondément absorbée. Elle n'allait pourtant jamais à confesse et faisait gras le vendredi; mais elle ne manquait pas la messe le dimanche, ou, quand elle était forcée de la manquer, elle faisait double prière; et quand ma grand'mère lui demandait pourquoi elle pratiquait ainsi à moitié, elle répondait: «J'ai ma religion, de celle qui est prescrite, j'en prends et j'en laisse. Je ne peux pas souffrir les prêtres; ce sont des caffards, et je n'irai jamais leur confier mes pensées qu'ils comprendraient tout de travers. Je crois que je ne fais point de mal, parce que, si j'en fais, c'est malgré moi. Je ne me corrigerai pas de mes défauts, je n'y peux rien; mais j'aime Dieu d'un cœur sincère, je le crois trop bon pour nous punir dans l'autre vie. Nous sommes bien assez châtiés de nos sottises dans celle-ci. J'ai pourtant grand'peur de la mort, mais c'est parce que j'aime la vie, et non parce que je crains de comparaître devant Dieu, en qui j'ai confiance, et que je suis sûre de n'avoir jamais offensé avec intention. — Mais que lui dites-vous dans vos longues prières? — Je lui dis que je l'aime; je me console avec lui de mes chagrins et je lui demande de me faire retrouver mon mari dans l'autre monde. — Mais qu'allez-vous faire à la messe? vous n'y entendez goutte? — J'aime à prier dans une église; je sais bien que Dieu est partout; mais, dans l'église, je le vois mieux, et cette prière en commun me paraît meilleure. J'y ai beaucoup de distractions, cela dure trop longtemps; mais enfin il y a un bon moment où je prie Dieu de tout mon cœur, et cela me soulage. — Pourtant, lui disait encore ma grand'mère, vous fuyez les dévots? — Oui, répondait-elle, parce qu'ils sont intolérans et hypocrites, et je crois que si Dieu pouvait haïr ses créatures, les dévots et les dévotes surtout seraient celles qu'il haïrait le plus. — Vous condamnez par là votre religion même, puisque les personnes qui la pratiquent le mieux sont les plus haïssables et les plus méchantes qui existent. Cette religion est donc mauvaise, et, plus on s'en éloigne, meilleur on est; n'est-ce pas la conséquence de votre opinion? — Vous m'en demandez trop long, disait ma mère. Je n'ai pas été habituée à raisonner mes sentimens, je vais comme je me sens poussée, et tout ce que mon cœur me conseille, je le fais sans en demander la raison à mon esprit.»
On voit par là, et par l'éducation qui m'était donnée, ou plutôt par l'absence d'éducation religieuse raisonnée, que ma grand'mère n'était pas du tout catholique. Ce n'était pas seulement les dévots qu'elle haïssait, comme faisait ma mère, c'était la dévotion, c'était le catholicisme qu'elle jugeait froidement et sans pitié. Elle n'était pas athée, il s'en faut beaucoup. Elle croyait à cette sorte de religion naturelle enseignée et peu définie par les philosophes du dix-huitième siècle. Elle se disait déiste, et repoussait avec un égal dédain tous les dogmes, toutes les formes de religion. Elle tenait, disait-elle, Jésus-Christ en grande estime, et, admirant l'Évangile comme une philosophie parfaite, elle plaignait la vérité d'avoir toujours été entourée d'une fabulation plus ou moins ridicule.
Je dirai plus tard ce que j'ai gardé ou perdu, adopté ou rejeté de ses jugemens. Mais, suivant pas à pas le développement de mon être, je dois dire que, dans mon enfance, mon instinct me poussait beaucoup plus vers la foi naïve et confiante de ma mère que vers l'examen critique et un peu glacé de ma bonne maman. Sans qu'elle s'en doutât, ma mère portait de la poésie dans son sentiment religieux, et il me fallait de la poésie; non pas de cette poésie arrangée et faite après mûre réflexion, comme on essayait d'en faire alors pour réagir contre le positivisme du dix-huitième siècle, mais de celle qui est dans le fait même et qu'on sent dans l'enfance sans savoir ce que c'est et quel nom on lui donne. En un mot, j'avais besoin de poésie, comme le peuple, comme ma mère, comme le paysan qui se prosterne un peu devant le bon Dieu, un peu devant le diable, prenant quelquefois l'un pour l'autre et cherchant à se rendre favorables toutes les mystérieuses puissances de la nature.
J'aimais le merveilleux passionnément, et mon imagination ne trouvait pas son compte aux explications que m'en donnait ma grand'mère. Je lisais avec un égal plaisir les prodiges de l'antiquité juive et païenne. Je n'aurais pas mieux demandé que d'y croire. Ma grand'mère, faisant de temps en temps un court et sec appel à ma raison, je ne pouvais pas arriver à la foi. Mais je me vengeais du petit chagrin que cela me causait en ne voulant rien nier intérieurement. C'était absolument comme pour mes contes de fées, auxquels je ne croyais plus qu'à demi, en de certains momens et comme par accès.
Les nuances que revêt le sentiment religieux suivant les individus, est une affaire d'organisation, et je ne fais pas le procès à la dévotion comme ma grand'mère, à cause des vices de la plupart des dévots. La dévotion est une exaltation de nos facultés mentales, comme l'ivresse est une exaltation de nos facultés physiques. Tout vin enivre quand on boit trop, et ce n'est pas la faute du vin. Il y a des gens qui en supportent beaucoup et qui n'en sont que plus lucides; il en est d'autres qu'une petite dose rend idiots ou furieux, mais, en somme, je crois que le vin ne nous fait révéler que ce que nous avons en nous de bon ou de mauvais, et le meilleur vin du monde fait mal à ceux qui ont la tête faible ou le caractère irritable.
L'exaltation religieuse, sur quelque dogme qu'elle s'appuie, est donc un état de l'âme sublime, odieux ou misérable, selon que le vase où fermente cette brûlante liqueur est solide ou fragile. Cette surexcitation de notre être fait de nous des saints ou des persécuteurs, des martyrs ou des bourreaux, et ce n'est certainement pas la faute du christianisme si les catholiques ont inventé l'inquisition et les tortures.
Ce qui me choque dans les dévots en général, ce ne sont pas les défauts qui tiennent invinciblement à leur organisation, c'est l'absence de logique de leur vie et de leurs opinions. Ils ont beau dire, ils font comme faisait ma mère: ils en prennent et ils en laissent, et ils n'ont pas ce droit que ma mère s'arrogeait, avec raison, elle qui ne se piquait point d'orthodoxie. Quand j'ai été dévote, je ne me passais rien, et je ne faisais pas un mouvement sans m'en rendre compte et sans demander à ma conscience timorée s'il m'était permis de marcher du pied droit ou du pied gauche. Si j'étais dévote aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas l'énergie d'être intolérante avec les autres, parce que le caractère ne s'abjure jamais; mais je serais intolérante vis-à-vis de moi-même, et l'âge mûr conduisant à une sorte de logique positive, je ne trouverais rien d'assez austère pour moi. Je n'ai donc jamais compris les dames du monde qui vont au bal, qui montrent leurs épaules, qui songent à se faire belles, et qui pourtant reçoivent tous leurs sacremens, ne négligent aucune prescription du culte, et se croient parfaitement d'accord avec elles-mêmes. Je ne parle pas ici des hypocrites, ce ne sont point des dévotes; je parle de femmes très naïves et à qui j'ai souvent demandé leur secret pour pécher ainsi sans scrupule contre leur propre conviction, et chacune me l'a expliqué à sa manière, ce qui fait que je ne suis pas plus avancée qu'auparavant.
Je ne comprends pas non plus certains hommes qui croient de bonne foi à l'excellence de toutes les prescriptions catholiques, qui en défendent le principe avec chaleur, et qui n'en suivent aucune. Il me semble que si je croyais tel acte meilleur que tel autre, je n'hésiterais pas à l'accomplir. Il y a plus, je ne me pardonnerais pas d'y manquer. Cette absence de logique chez des personnes que je sais intelligentes et sincères est quelque chose que je n'ai jamais pu m'expliquer. Cela s'expliquera peut-être pour moi quand je repasserai mes souvenirs avec ordre, ce qui m'arrivera, certes, pour la première fois de ma vie, en les écrivant, et je pourrai analyser la situation de l'âme aux prises avec la foi et le doute, en me rappelant comment je devins dévote et comment je cessai de l'être.
A sept ou huit ans, je sus à peu près ma langue. C'était trop tôt, car on me fit passer tout de suite à d'autres études, et on négligea de me faire repasser la grammaire. On me fit beaucoup griffonner; on s'occupa de mon style, et on ne m'avertit qu'incidemment des incorrections qui se glissaient peu à peu dans mon langage, à mesure que j'étais entraînée par la facilité de m'exprimer par écrit. Au couvent, il fut entendu que je savais assez de français pour qu'on ne me fît point suivre les leçons des classes; et, en effet, je me tirai fort bien à l'épreuve des faciles devoirs distribués aux élèves de mon âge; mais, plus tard, quand je me livrai à mon propre style, je fus souvent embarrassée. Je dirai comment, au sortir du couvent, je rappris moi-même le français, et comment, douze ans plus tard, lorsque je voulus écrire pour le public, je m'aperçus que je ne savais encore rien; comment je fis une nouvelle étude, qui, trop tardive, ne me servit guère, ce qui est cause que j'apprends encore ma langue en la pratiquant, et que je crains de ne la savoir jamais: la pureté, la correction seraient pourtant un besoin de mon esprit, aujourd'hui surtout, et ce n'est jamais par négligence ni par distraction que je pèche, c'est par ignorance réelle.
Le malheur vint de ce que Deschartres, partageant le préjugé qui préside à l'éducation des hommes, s'imagina que, pour me perfectionner dans la connaissance de ma langue, il lui fallait m'enseigner le latin. J'apprenais très volontiers tout ce qu'on voulait, et j'avalai le rudiment avec résignation. Mais le français, le latin et le grec qu'on apprend aux enfans prennent trop de temps: soit qu'on les enseigne par de mauvais procédés, ou que ce soient les langues les plus difficiles du monde, ou encore que l'étude d'une langue quelconque soit ce qu'il y a de plus long et de plus difficile pour les enfans: toujours est-il qu'à moins de facultés toutes spéciales, on sort du collége sans savoir ni le latin, ni le français, et le grec encore moins. Quant à moi, le temps que je perdis à ne pas apprendre le latin fit beaucoup de tort à celui que j'aurais pu employer à apprendre le français, dans cet âge où l'on apprend mieux que dans tout autre.
Heureusement je cessai le latin d'assez bonne heure, ce qui fait que, sachant mal le français, je le sais encore mieux que la plupart des hommes de mon temps. Je ne parle pas ici des littérateurs, que je soupçonne fort de n'avoir pas pris leur forme et leur style au collége, mais du grand nombre des hommes qui ont parfait leurs études classiques sans songer depuis à faire de la langue une étude spéciale. Si on veut bien le remarquer, on s'apercevra qu'ils ne peuvent écrire une lettre de trois pages sans qu'il s'y rencontre une faute de langage ou d'orthographe. On remarquera aussi que les femmes de vingt à trente ans, qui ont reçu un peu d'éducation, écrivent le français généralement mieux que les hommes, ce qui tient, selon moi, à ce qu'elles n'ont pas perdu huit ou dix ans de leur vie à essayer d'apprendre les langues mortes.
Tout cela est pour dire que j'ai toujours trouvé déplorable le système adopté pour l'instruction des garçons, et je ne suis pas seule de cet avis. J'entends dire à tous les hommes qu'ils ont perdu leur temps et l'amour de l'étude au collége. Ceux qui y ont profité sont des exceptions. N'est-il donc pas possible d'établir un système où les intelligences ordinaires ne seraient pas sacrifiées aux besoins des intelligences d'élite?
4
1848.
5
Le Berrichon a le goût des verbes réfléchis. Il dit: Cet homme ne sait pas ce qu'il se veut, il ne sait quoi se faire ni s'inventer.