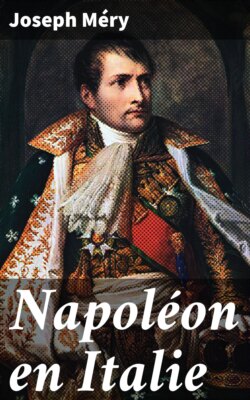Читать книгу Napoléon en Italie - Joseph Méry - Страница 5
II
BAPTÊME ET DÉNOMBREMENT
ОглавлениеQuand le hasard agit avec intelligence,
Il perd son nom: il faut l’appeler Providence;
Au début de la guerre, une invisible main
A conduit nos soldats sur le noble chemin
Où retentit un nom d’illustre renommée,
Lannes Montebello, l’Achille de l’armée!
La grande ombre était là, debout, comme autrefois,
Et l’air retentissait d’une héroïque voix
Qui disait: «Mes enfants, le premier canon tonne,
Je suis Montebello; c’est ma main qui vous donne,
Dans ce jour où vos coups vont semer la terreur,
Le baptême de sang, au nom de l’Empereur!
Après trente combats, que notre histoire nomme,
Je mourus, honoré des larmes du grand homme;
Marchez dans les éclairs, sur les foudres d’airain,
Dignes de vos aïeux et de votre parrain!
Quand la France combat, l’univers la regarde!»
Ils étaient, ce jour-là, cinq mille en avant-garde,
France et Piémont, afin que l’un et l’autre sang
S’unissent, pour sceller le pacte, en commençant;
Afin que le prologue, écrit avec l’épée,
Fût signé des deux noms, avant leur épopée;
Un contre trois, toujours selon l’usage admis;
Donc, égaux par le nombre avec les ennemis.
Au César du Danube, arrivé de la veille,
On voulait faire voir enfin une merveille,
Son aigle épouvantant le nôtre, et, disait-on,
Le noyant dans le fleuve où périt Phaëton!
Et l’Éridan riait dans ses massifs de saules,
Car l’aigle de la France et l’ancien coq des gaules
Lui sont connus; ce roi des beaux fleuves latins,
Arbitre de la guerre, arbitre des destins,
A vu, sur son théâtre, ennobli par la gloire,
Passer tous les enfants du Rhône et de la Loire;
Et ce juge éternel du monde belliqueux,
Jamais ne partagea ses lauriers qu’avec eux.
L’aigle n’est pas noyé; son vol perce la nue;
La France est toujours France, elle se continue:
Des hauts sommets alpins à peine nous tombons,
Et nous sommes vainqueurs! Les augures sont bons;
L’ouverture est superbe, et dans la Lombardie
Les chœurs italiens déjà l’ont applaudie,
Et de Napoléon en voyant l’héritier,
Prédisent même chance au drame tout entier!
Arrivez maintenant, faites votre œuvre immense,
Soldats libérateurs, le poëte commence,
Car il sait bien comment vous devez la finir:
Déjà votre passé lui montre l’avenir,
Et déjà s’il prélude à votre hymne de fête,
C’est qu’avec vous il est aisé d’être prophète.
Il vous a vu partir, dans un avril joyeux,
Il vous a vu marcher du pas de vos aïeux,
Et puis vous envoler, créateurs de l’histoire,
Sur le chemin de fer qui mène à la victoire.
C’étaient nos fantassins, légers sous leurs fardeaux,
Le fusil sur l’épaule, et le sac sur le dos,
Par un de ces beaux soirs que jamais on n’oublie,
Comme à la promenade allant en Italie.
On voyait, en avant, passer les colonels,
Avec leurs yeux de flamme et leurs airs paternels,
Calmes sur leurs chevaux, dans la foule animée,
Brunis par le soleil d’Afrique ou de Crimée,
Adressant à Paris, sous les ombres du soir,
Ces tranquilles adieux qui disent au revoir;
Et, sur le boulevard, devant le café Riche,
Saluant leurs amis, sans songer à l’Autriche.
C’étaient des escadrons de toute arme, étalant
Les splendides rayons d’un luxe étincelant,
Souriant aux clairons qui sonnaient à leur tête,
Courant à la bataille en costume de fête.
C’étaient les artilleurs dont l’arrêt souverain,
Prononcé dans la plaine avec des voix d’airain,
Des fils de Metternich fait taire la parole,
Licencie un congrès, déchire un protocole,
Et, par son éloquence, éclairant l’horizon,
Aux diplomates sourds fait entendre raison.
Puis, ceux qui de la mort vont égayer les scènes,
Le zouave, cousin du chasseur de Vincennes,
Le zouave, soldat par l’Europe vanté!
Notre siècle, pourtant, ne l’a pas inventé:
Cet Africain, ce fils d’une zone enflammée,
Ce lion en turban qui veut suivre une armée,
Annibal le créa de ses puissantes mains,
Et comme épouvantail le fit voir aux Romains.
Il arriva, bronzé par le soleil numide,
La flamme au front, vêtu d’une simple chlamyde,
Des plaines aux sommets bondissant dans les airs
Selon la gymnastique enseignée aux déserts,
Et, rouge météore, ou tempête vivante,
Semant partout, au vol, la mort et l’épouvante.
C’est le même zouave, et s’il n’a plus aux mains
Le glaive droit qui tue et creuse des chemins,
Foudroyant quatre fois la légion romaine
Au Tessin, à Trébie, à Canne, à Trasimène,
Il a la baïonnette, une arme de l’enfer,
Un poignard à deux mains, un ouragan de fer.
Son cousin, le chasseur, assez humble de taille,
Se diminue encor dans un jour de bataille,
Et même disparaît; c’est un soldat serpent,
Qui dédaigne la marche, et qui vole en rampant;
Son fusil ne ment pas; quand l’amorce étincelle,
Quand son œil a marqué le but, le but chancelle
Et tombe; il tient caché le coup qui va partir,
Et s’amuse au combat, comme il s’amuse au tir.
Voici la garde, avec son drapeau de Crimée!
Fille de l’Empereur et de sa grande armée,
Elle sait son devoir, et connaît son blason:
Quand on voyait surgir son aigle à l’horizon,
Jadis, le sol tremblait; une voix, dans l’espace,
Disait: Inclinez-vous, c’est la France qui passe!
Et cette voix souvent nous donnait au réveil
La victoire endormie au coucher du soleil.
Nous ne regrettons rien; sa fille est digne d’elle:
Terrible dans les chocs, vivante citadelle,
La garde impériale est une armée à part
Et peut offrir à l’autre un solide rempart,
Si, par distraction, une fois, la victoire
Donnait une lacune à notre jeune histoire.
Ils sont partis; hier encore ils étaient là
Défilant devant nous, en masse; on attela
L’hippogriffe aux wagons; la trombe de fumée
Qui guidait les Hébreux, vers l’heureuse Idumée,
S’éleva dans les airs, comme un signal de Dieu,
Et cinq cent mille voix leur firent un adieu...
Le lendemain, rasant les flots de Ligurie,
Ils voyaient l’horizon de la terre chérie,
Et Gênes, la première avant toutes ses sœurs,
Pour eux mettait à nu ses montagnes de fleurs.
Là, partout, on signait le pacte qui nous lie
Au glorieux destin promis à l’Italie:
Les nobles jeunes gens, par la gloire excités,
Pour courir aux drapeaux désertent les cités;
Guelfes et Gibelins, oubliant leur querelle,
Veulent une Italie, et se battront pour elle.
Plus d’Autriche sur nous! ont-ils dit en brisant
Le traité qui les lie à ce joug écrasant.
L’étincelle française allume l’incendie;
Tous, vêtus en soldats, viennent en Lombardie;
Ils quittent, dédaigneux du luxe et du repos,
L’ombre de leurs villas pour l’ombre des drapeaux;
Ils quittent leurs palais où la jeunesse hérite
Des roses de Pœstum, des lits du Sybarite;
La nymphée, où la gerbe au murmure léger
Fit inventer la sieste au pied de l’oranger;
Les amours commencés aux douces promenades,
Sous le dôme des pins et sous les colonnades;
Le théâtre superbe, où le chant de Verdi
Par un public artiste est toujours applaudi;
Les concerts sur le fleuve et les bals sous les arbres;
Les Louvres, rayonnant de toiles et de marbres;
Les Cashines, Longchamps du monde florentin;
Le Cours, où Rome encor semble parler latin;
Les maisons de plaisance, au bord du lac tranquille,
Ou sur les flots d’azur, franges de la presqu’île;
Tout ce qui donne enfin de suaves instants
Au sourire premier des fleurs et du printemps;
Et tous ces déserteurs du Latium moderne,
Inhument leurs blasons au fond d’une giberne;
Pour prendre le fusil mettent à nu les mains,
Fabriquent la cartouche avec leurs parchemins,
Se font au dur métier des marches et des veilles,
Au sifflement du plomb préparent leurs oreilles,
Et, dans leurs courts festins, mêleront en courant,
Le pain noir du soldat avec l’eau du torrent.
Ces élégants seigneurs n’auront plus qu’une fête,
La bataille! Un héros marche et brille à leur tête,
Garibaldi; cet homme est un drapeau vivant;
Nul ne reste en arrière à son cri d’en avant!
Il est, malgré l’Autriche, et Vienne, et son conclave,
Le Spartacus chrétien de la noblesse esclave;
Son nom donne à Gessler déjà l’effroi mortel,
Sur le lac et les monts, chers à Guillaume Tell!
Oh! tant de souvenirs, tant d’histoires passées,
De généreux instincts, d’héroïques pensées,
Ne seront pas perdus! nous touchons à l’instant
Où le bruyant Paris se tait, car il attend
Avec un cœur rempli d’espérances avides
Une voix de canon, tonnant aux Invalides,
Le Te Deum d’Arcole, impérial refrain
Qu’un cri de peuple mêle à l’orchestre d’airain!)