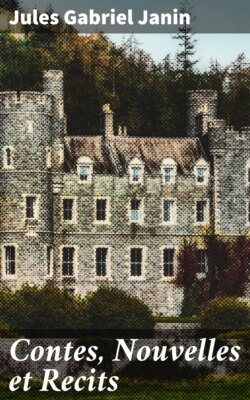Читать книгу Contes, Nouvelles et Recits - Jules Gabriel Janin - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеLa ville d'Évreux, en Normandie, est une des grandes et antiques cités de la province. Elle compte, au nombre de ses évêques, des hommes illustres à tous les titres du talent, de la naissance et de la vertu. Grâce à leur exemple, à leurs enseignements, la foi de l'Évangile est restée en toute sa pureté à l'ombre austère de ses cloîtres, de ses chapelles, de cette église cathédrale qui soutiendrait fièrement la comparaison avec la cathédrale même de la ville de Rouen, la capitale. Au temps où va se passer notre histoire, une des abbayes de la ville d'Évreux, l'abbaye de Saint-Sauveur, avait pour abbesse une dame illustre, Mme de La Rochefoucauld, la propre nièce de ce rare et grand esprit, M. le duc de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, et de cet autre duc de La Rochefoucauld, l'ami du roi, qui, pendant quarante ans de sa vie, avait assisté au botté et au débotté de Sa Majesté, qu'elle allât à la chasse, ou qu'elle en revînt, et toujours Sa Majesté avait rencontré ses regards attristés si le roi était triste, et joyeux s'il daignait sourire. En ce moment, le grand siècle est achevé; le roi et son digne ami, accablés de la même vieillesse et sous le poids du même ennui, assistent silencieux aux derniers jours du grand règne; ils en ont contemplé toutes les merveilles, ils en subissent maintenant toutes les douleurs: une ruine immense, une gloire évanouie, un deuil sans cesse et sans fin de ces jeunes princes et de ces belles princesses, doux enfants dont les voix fraîches avaient peine à réveiller ces échos endormis. Et maintenant tout se tait dans ce Versailles des repentirs, des remords et des tombeaux.
Un soir d'hiver, quand le jour tout à coup tombe, au seuil de la sainte abbaye où Mme de La Rochefoucauld était un exemple austère des plus grandes vertus, une pauvre femme, à pied et venant de loin, s'était assise sur un banc de pierre et se reposait d'une grande course. Elle était jeune encore, et l'on voyait qu'elle avait été fort belle; mais la peine et l'abandon, la pauvreté, dont le joug est si dur, avaient laissé sur ce beau visage une empreinte ineffaçable. Évidemment cette humble femme était au bout de ses forces et ne pouvait aller plus loin. Elle tenait de ses mains nues et pressait sur son coeur résigné une enfant pâle et frêle, une petite fille affamée et dont les grands yeux, brillant du triste éclat de la fièvre, imploraient à travers la porte fermée une protection invisible. Après un instant d'attente, et sans que la mère, ici présente, eût osé faire un appel à cette charitable maison, la porte s'ouvrit comme par miracle, et deux soeurs du Saint-Sauveur vinrent à la femme abandonnée, et, l'encourageant de la voix et du geste, celle-ci prit l'enfant dans ses bras, celle-là conduisit la mère au réfectoire, où se réunissaient toutes les soeurs pour le repas du soir. La salle était tiède et bien close; au coin du feu pétillant dans l'âtre était le fauteuil de Mme l'abbesse. On y fit asseoir la pauvre voyageuse; empressées autour de cette misère touchante, les bonnes soeurs lui prodiguèrent tous les services; elles lavèrent ses pieds ensanglantés sur les pavés du chemin; elles présentèrent à cette abandonnée la coupe où buvait Mme de La Rochefoucauld elle-même, et pendant que la douce couleur revenait à cette joue où tant de larmes avaient coulé, la petite fille, débarrassée enfin de ses haillons, se réjouissait dans des linges blancs et chauds. Prenez et mangez! Puis la mère et l'enfant furent conduites à l'infirmerie, et s'endormirent paisibles dans un lit, dont elles étaient privées depuis huit jours.
Le lendemain, à leur réveil, leur premier regard rencontra les yeux tendres et sérieux tout ensemble de cette illustre dame de La Rochefoucauld. De sa voix, faite aussi bien pour la prière que pour le commandement, elle encouragea la mère à lui raconter par quelle suite de misères elle était arrivée à ce dénuement si triste et si complet. La mère alors répondit qu'elle avait épousé naguère un gentilhomme, un pauvre Irlandais de la catholique Irlande, qui l'avait emmenée avec lui dans une cabane où, pendant quatre années, ils avaient eu grand'peine à vivre. Il y avait deux ans déjà que la petite fille était au monde, et Dieu sait qu'ils avaient grand espoir de l'élever; mais la famine avait envahi toute la contrée, et la peste avait emporté le mari; les hommes du fisc étaient venus qui avaient vendu la cabane et le champ de blé; puis la charité publique, disons mieux, la prudence irlandaise, habile à se défaire des pauvres gens sans soutien, les avait embarquées sur une barque de pêcheur qui les avait jetées à la côte, et voilà comment elle était venue en tendant la main jusqu'à ce lieu d'asile, où elle espérait trouver quelque emploi dans la domesticité de l'abbaye, et chaque jour un verre de lait chaud pour son enfant.
A ce récit, tout rempli de courage et de résignation, les dames de Saint-Sauveur répondirent qu'elles emploieraient la mère à la lingerie et qu'elles adopteraient la jeune enfant. Mais la mère était morte après une lutte désespérée de quinze mois contre le mal qui l'envahissait, elle mourut en bénissant ses bienfaitrices et leur recommandant son enfant. La jeune fille avait grandi dans l'intervalle, et le bien-être et l'amitié de tant de bonnes mères adoptives avaient affermi sa santé chancelante. Elle était devenue assez jolie et toute mignonne; elle était un véritable jouet pour les jeunes novices, dont elle remplaçait la poupée. Elle était tout le long du jour admirée et choyée; on obéissait à ses moindres fantaisies, et sa plus légère parole était comptée. «Ah! disaient les bonnes dames, qu'elle a de grâce et qu'elle a d'esprit! Elle est charmante;» et c'est à qui redoublerait de tendresse.
Seule, Mme l'abbesse était réservée avec cette enfant. Elle disait que toutes ces louanges auraient bientôt gâté le meilleur naturel; que mieux eût valu munir cette orpheline contre les embûches et les pièges du dehors; qu'elle aurait bientôt sa vie à conduire et son pain de chaque jour à gagner… Mais c'étaient là de vaines paroles; le couvent n'avait pas d'autre enjouement et s'en donnait à coeur joie. Et plus l'enfant grandissait, plus grandes étaient les tendresses; ces dames se disputaient le bonheur de lui apprendre à lire, à écrire, et les belles histoires qu'elle lisait dans Royaumont, tout rempli des plus belles images. Quelques-unes de ces dames, plus savantes, enseignaient à ce jeune esprit, celle-ci la géographie, et celle-là les premières notions des mathématiques. Des veuves retirées du monde, et qui n'acceptaient du cloître que le silence et la solitude, attendant l'heure où leur deuil se changerait en grande parure, avaient soin de chanter à ta jeune recluse une suite d'élégies et de chansonnettes galantes, avec accompagnement de théorbe ou de clavecin. Pensez donc si elle en était toute joyeuse, et si ces belles chansons se gravaient facilement dans ce jeune cerveau.
Les deux vraies mères de la jeune Élisa (c'était son nom) s'appelaient Mmes de Gien. Elles s'étaient chargées tout particulièrement de cette enfant devenue une grande fille, et comme elles seraient mortes de chagrin à la seule idée de s'en séparer, elles se firent nommer au prieuré de Saint-Louis, situé dans un faubourg de la ville de Rouen, sur les hauteurs. Mme de Gien l'aînée, étant abbesse, eut sa soeur pour coadjutrice, et l'une et l'autre, ayant pris congé de Mme de La Rochefoucauld, elles emmenèrent avec elles la jeune Élisa, qui devint une espèce de souveraine en ce prieuré, qui était pauvre et menaçait ruine de toute part. Mais ces dames avaient obtenu de leur famille une pension qui leur permettait de garder avec elles leur fille adoptive. Elles l'aimaient, en effet, comme une mère aime son enfant; elle, de son côté, les entourait de mille tendresses. Elle était leur lectrice et leur secrétaire; elle devint leur conseil.
Les livres étant chers et rares, ces dames ouvrirent une école, et la jeune Élisa tint leur école, où venaient plusieurs fillettes assez grandes, qui se lièrent d'amitié avec leur institutrice. Une entre autres, Mlle de Silly, agréable et bien faite, un bon esprit, un bon coeur, une vraie et sincère Normande, éblouie et charmée à son tour par la jeune Élisa, en fit comme sa soeur aînée. Elles s'éprirent l'une pour l'autre d'une amitié très grande, et se firent le serment de ne plus se quitter: «Non, jamais de séparation. Nous vivrons ensemble.»
Et justement Mlle de Silly fut prise d'un mal affreux en ce temps-là. Une jeune fille y laissait très souvent la vie et presque toujours sa beauté. Ce mal, qui répandait la terreur, était presque sans remède, et Mlle de Silly, lorsqu'au bout de quarante jours elle sentit disparaître enfin cette contagion qui avait éloigné de sa jeunesse toutes ses compagnes, trouvant la petite Élisa qui se tenait à son chevet comme un ange gardien: «Tu vois bien, lui dit-elle, que j'avais raison de t'aimer: tu m'as sauvé la vie! Et comme Élisa lui voulait apporter un miroir:—Non, non, pas encore, attendons; je dois être affreuse!» et quelques larmes vinrent mouiller ses beaux yeux couverts encore du nuage… Elle ne fut pas défigurée; elle revint à la beauté comme elle était revenue à la vie, et sa reconnaissance en redoubla pour cette amie qui l'avait sauvée.
Mme de Silly la mère accourut aussitôt que sa fille fut hors de danger, et ne put guère se refuser à inviter la jeune Élisa d'accompagner sa fille au château de Silly. C'était une vieille maison bâtie en S, l'usage étant alors de donner aux châteaux normands la forme de la première lettre du nom de la terre: ainsi la Meilleraie représentait une M dans la disposition de ses bâtiments; mais la véritable distinction du château de Silly, c'est qu'il était placé au beau milieu de la vallée d'Auge, où tout fleurit, jusqu'aux épines. Au printemps, en été, aux derniers jours de l'automne, on n'entend que ruisseaux murmurant, oiseaux chantant, légers bruissements sous le souffle invisible.
Une fillette hors de son couvent, toute rayonnante de jeunesse et d'espérance, est naturellement heureuse en ce vaste jardin, et volontiers elle oublie, ô l'ingrate! le couvent et ses mères adoptives. Tel était l'enivrement de la jeune Élisa, lorsqu'au bras de son amie elle entrait dans cette maison, triste au dedans, c'est vrai, mais au dehors toute charmante. M. de Silly le père était un vieillard morose; on ne l'entendait guère, on le voyait fort peu, il comprenait que sa mort était proche, et, résigné comme un vieux soldat, il se préparait à mourir en chrétien.
Beaucoup plus jeune, et très agissante encore, Mme de Silly s'inquiétait avec modération des tristesses de son mari, non plus que des dangers récents de sa fille, en proie à la petite vérole. Elle était, comme toutes les mères de ces temps antiques, passionnée pour la gloire et pour le nom de leur maison; toute leur tendresse et toute leur ambition se reportaient sans cesse et sans fin sur leur fils, héritier et continuateur du nom, de la fortune et de l'autorité des aïeux. C'était l'habitude et la loi du monde féodal: tout revenait au fils aîné; il était tout, le cadet n'était rien, il s'appelait M. le chevalier, et passait une vie obscure en un coin du château de son père, heureux de promener dans les jardins paternels le neveu qui devait le déshériter tout à fait. Quant aux filles, elles étaient encore moins comptées que les cadets; on les mettait au couvent, moyennant une petite dot, et les voilà disparues à jamais.
Ainsi Mlle de Silly, dans la maison de ses pères, était une étrangère autant que la jeune Élisa; mais l'habitude et la résignation, ajoutez la jeunesse, ont de grands privilèges! Elles se contentent à si peu de frais! l'horizon le plus prochain, elles ne vont pas au delà. Le lendemain, voilà le rêve des jeunes filles; aujourd'hui, demain, rien de plus, pourvu qu'aujourd'hui et demain le jardin soit en fleur.
Donc ces deux jeunesses, livrées à elles-mêmes, lisaient les chers poètes de la jeunesse, à commencer par La Fontaine; elles s'enivraient des tragédies de Racine; elles savaient par coeur l'Athalie et l'Esther. Parfois le vieux Corneille et parfois Molière étaient invoqués de ces deux ingénues; le plus souvent elles se racontaient de belles histoires qu'elles avaient inventées. Mais leur curiosité la plus vive et la causerie intarissable, c'était le retour du comte de Silly, le fils unique et l'unique héritier, dans le château de ses pères, disons mieux, dans son château.
Le comte de Silly remplissait de son souvenir jusqu'au dernier recoin de ces demeures; ses chiens hurlaient dans le chenil; ses bois étaient remplis de gibier; ses paysans regardaient chaque matin de quel côté le maître et seigneur allait venir; son banc restait vide à l'église. Il était partout; le plus petit enfant du village eût raconté au passant la gloire et le nom du jeune seigneur. Il était capitaine à seize ans, colonel quatre ans plus tard. Il avait fait toutes les guerres malheureuses des dernières années de Louis XIV, toujours vaincu et se relevant toujours. A la bataille d'Hochstedt, où il s'était battu comme un héros, le comte de Silly avait été fait prisonnier par les Anglais, qui l'avaient emmené dans leur île, où ses blessures et surtout le regret de la patrie absente eurent bientôt réduit le jeune homme à désespérer de la vie. Une dame, une amie qu'il avait à la cour, s'était inquiétée enfin de ses destinées, et, grâce à son intervention, le jeune homme allait revenir, prisonnier sur sa parole. On l'attendait de jour en jour, les deux jeunes filles non moins impatientes que la marquise de Silly, sa mère.
Il revint enfin au milieu de la joie universelle, et la jeune Élisa, avertie à l'avance, reconnut du premier coup d'oeil le parfait cavalier dont elle avait entendu parler si souvent. C'était un jeune homme aux yeux noirs et pleins de feu, de bonne mine et de taille haute, à la tournure militaire, à la démarche un peu grave et le front pensif. Il avait beaucoup vieilli en peu de temps; rien ne vieillit un militaire comme une guerre malheureuse. Celui-là, nous l'avons dit, était venu à la mauvaise heure, après M. de Turenne, après les grandes victoires, les villes conquises, les batailles gagnées, les Te Deum et les drapeaux que le victorieux va suspendre aux voûtes sacrées de l'hôtel royal des Invalides. «Monsieur le maréchal, on n'est plus heureux à notre âge,» disait Louis XIV à l'un de ses généraux vaincus… Louis XIV et le maréchal de Villeroi en parlaient bien à leur aise; ils avaient la gloire ancienne en consolation de la défaite présente; mais les jeunes gens, les nouveaux-nés, appelés les derniers à la gloire, où donc était leur consolation de n'arriver qu'à la défaite?
En ces tristes pensées vivait depuis longtemps le comte de Silly. Il avait beau payer de sa personne, être au premier rang des combattants, pousser le soldat aux ennemis, appeler de toute sa voix la victoire à son aide… il y avait toujours un moment où il fallait céder, reculer, repasser le fossé, incendier la ville assiégée et sortir la nuit aux pétillements de ces clartés funèbres. Que disons-nous? et ce moment funeste où le plus vaillant rend son épée, et ces longs sentiers par lesquels il faut passer, conduit par la cohorte ennemie; et ces femmes, ces enfants, ces vieillards, parmi les victorieux, qui disent, vous désignant d'un doigt méprisant: Voilà des vaincus, des prisonniers! C'étaient là des angoisses insupportables, et M. de Silly, porteur d'une épée qui ne lui appartenait plus, rentra chez lui triste, abattu, la tête courbée, imposant silence aux cris de joie. Il baisa la main de sa mère sans mot dire, et dans les bras de son père il pleura. Le père aussi pleurait la gloire passée; il avait, par pitié pour son fils, détacha de sa poitrine sa croix de Saint-Louis.
Ce retour, qu'elles s'étaient figuré superbe et triomphant, avait frappé de stupeur les deux jeunes filles, et, chose encore plus étrange (elles étaient à peu près du même âge, de la même taille, et les traits de Mlle de Silly avaient un peu grossi), le jeune colonel prit Élisa pour sa soeur, et sa soeur pour l'étrangère. Il embrassa tendrement la première, il salua poliment la seconde, et ne voyant pas que celle-ci rougissait, que celle-là restait interdite, il s'enferma dans un cabinet plein de livres, où il se tenait chaque jour, triste et silencieux, lisant les guerres de Thucydide, les Commentaires de César ou les livres de Polybe. Il étudiait aussi les grands capitaines; à chaque bataille gagnée il poussait un profond soupir.
C'est ainsi qu'il menait une vie austère et sérieuse au milieu de ses livres, cherchant la solitude, le visage couvert d'une sombre tristesse. Étonnées et bientôt fâchées de son indifférence, les deux jeunes filles en murmurèrent chacune de son côté; bientôt celle-ci fit à celle-là la confidence que si son frère ne l'avait pas reconnue, elle, de son côté, avait grand'peine à reconnaître son frère dans ce beau ténébreux. «Quand il a quitté, disait-elle avec un gros soupir, la maison paternelle, il était tout ce qu'il y a de plus alerte et de plus joyeux; il ne parlait que de batailles et de victoires; il écrivait des sonnets et des chansons; il aimait la chasse, et, le dimanche, il dansait sous l'orme avec les villageoises. Si parfois le violoneux du pays manquait à la fête, eh bien, M. mon frère envoyait chercher son violon et nous faisait danser. En ce temps-là, il portait de beaux habits brodés, les cheveux bouclés; il n'avait pas de moustache; en revanche, une plume à son chapeau rappelait le blanc panache de la bataille d'Ivry. On n'entendait que sa voix dans la maison, que ses appels dans les bois… On m'a changé mon frère! Il ressemble à quelque Anglais puritain du temps de Cromwell. On viendrait me dire qu'il s'est fait huguenot, je ne m'en étonnerais point.»
Tels étaient les discours de Mlle de Silly à sa jeune camarade, et celle-ci, opinant du bonnet, ne songeait guère à prendre en main la défense de ce beau cavalier, dont la conduite lui semblait véritablement plutôt d'un rustre et d'un mal élevé que d'un porteur d'épée et d'un gentilhomme. Or ces deux jeunes personnes, qui se croyaient bien seules, se faisaient leurs confidences, assises sur les marches d'un pont rustique à l'extrémité du parc, au murmure de l'eau transparente, et celle-ci, non plus que celle-là, était loin de se douter que le jeune homme écoutait malgré lui leur conversation sous l'arche du pont où il s'était arrêté pour voir l'eau couler, ce qui est le signe d'un vrai penchant à la rêverie. A la fin, quand elles eurent bien débité toutes leurs censures, elles s'en revinrent au logis en se tenant par la taille, et l'on voyait à leur attitude que la conversation interrompue avait repris de plus belle.
—Ah! se disait M. de Silly, quand on est battu quelque part, on l'est partout, et le jour que voici m'apporte une défaite de plus.
Cependant, à l'heure du souper, il entra d'un visage plus riant que d'habitude, et quand il eut salué son père et sa mère, il fit une belle révérence aux jeunes dames. Le repas fut gai; le vieux seigneur était dans ses bons moments, et comme il était grand amateur de proverbes, il en lâcha deux ou trois coup sur coup au grand contentement des convives.
—Vous riez, disait-il, vous feriez mieux d'être un peu sérieux. Le proverbe est l'écho de la sagesse des nations.
—Monseigneur, repartit le comte de Silly, cette sagesse des nations se trompe assez souvent, j'en suis fâché pour elle. Encore aujourd'hui, elle en fait de belles avec moi, la sagesse des nations! Il est écrit: A bon entendeur salut… J'ai entendu d'étranges choses sur mon compte, et qui sortaient cependant de charmantes bouches. Oui-da, je suis un rustre, un manant, un aveugle, un mal élevé, que dis-je? un huguenot! Et puis si mal vêtu, si mal poli et triste à l'avenant.
A chaque mot qu'il disait, pensez donc si la confusion des jeunes filles était grande, et la vive rougeur qui leur montait à la joue! Elles eussent encore été sur le pont, qu'elles se seraient jetées à l'eau la tête la première.
—Eh bien, là, reprenait le marquis, vous n'avez pas la chance heureuse, mon cher fils; à votre âge, et tourné comme vous l'êtes, le moindre écho vous devrait être indulgent et facile. Il disait de si belles choses à l'heure où le roi mon maître et moi nous n'avions que vingt ans. Telles furent les confidences de Mlle de La Vallière au moment où passait Sa Majesté non loin du bosquet des demoiselles d'honneur. Qu'il entendit de belles choses!
—Soyez sûr, Monsieur, reprit le colonel de Silly, qu'elles avaient vu tout au moins la silhouette du roi, ou qu'une branche indiscrète avait craqué sous ses pas. Si Sa Majesté eût été bien cachée dans le bosquet de Latone, elle eût peut-être entendu des vérités aussi cruelles… Mais quoi! la vérité est si belle, elle a tant de charmes, s'il en faut croire la sagesse des nations.
Naturellement, Mlle de Silly fut la première à revenir de son trouble, et reprenant bientôt l'offensive:
—Il n'y a que la vérité qui offense, reprit-elle avec un beau rire, et qui se sent morveux se mouche, a dit la sagesse des nations.
Elle était fine et piquante, Mlle de Silly, et quoiqu'il en soit, à dater de ce moment, la glace fut rompue entre le jeune homme et les deux jeunes filles, et la bonne harmonie une fois établie, ils se promenèrent et causèrent comme de vieux amis, la jeune Élisa prenant sa part de ces douces et honnêtes gaietés.
Ainsi se fût passée en ces innocents loisirs toute la belle saison; mais un jour, comme on venait de seller les chevaux pour une longue promenade, une chaise de poste, couverte de poussière, entrait dans la cour du château. Les gens de la maison, déjà réunis sur le perron, virent descendre un homme entre deux âges et tout semblable à quelque abbé de cour qui eût été capitaine d'infanterie avant d'entrer dans les ordres. Il avait la taille haute et la tête belle; il portait le rabat, et ses bottes étaient éperonnées.
Sa démarche aisée annonçait un homme de cabinet. C'était l'abbé de Vertot lui-même, un historien plein d'esprit, d'éloquence, intelligent, avec toutes les qualités de l'historien, moins cette qualité suprême dont nous parlions tout à l'heure, la vérité. Il s'inquiétait beaucoup moins d'être vrai que d'être intéressant, rare et curieux; pour peu que les matériaux de son histoire fussent à sa portée, il s'en servait très volontiers; mais s'il fallait consulter les chartes anciennes, chercher dans la poussière des bibliothèques un document précieux, notre historien s'en passait plus volontiers encore. Un jour qu'on lui avait promis un récit authentique du siège de Malte:
—Ah! dit-il, vous venez trop tard, mon siège est fait.
La sagesse des nations a pieusement recueilli cette belle parole de l'abbé de Vertot, et elle en a fait un proverbe.
Le jour dont nous parlons, il arrivait tout courant de Paris, porteur d'une grande nouvelle:
—Ami, dit-il au jeune homme, on chante aujourd'hui le Te Deum de la paix. Cette fois vous êtes libre, et je vous apporte, avec la croix de Saint-Louis, l'ordre de regagner votre régiment, et, s'il vous plaît, nous partirons ce soir.
A cette nouvelle inattendue on eût vu briller un éclair dans les yeux du jeune homme; il avait en ce moment six coudées, la taille des héros d'Homère, et remettant à son père cette croix militaire qu'il avait si bien gagnée:—Accordez-moi, lui dit-il, l'honneur de la recevoir de vos mains.
Le vieux seigneur, d'une main tremblante d'émotion, posa la croix de Saint-Louis sur la poitrine de son fils, et lui-même il reprit ce cordon rouge dont il s'était dépouillé pour ne pas ajouter à l'humiliation de son enfant. Mais ce fut en vain que le père et la mère priaient le jeune homme de rester encore au château rien que le temps de fêter sa gloire; en vain que les jeunes filles le supplièrent, de leurs regards muets, de ne point partir si vite: il pétillait d'impatience; il ne savait comment contenir sa joie; il baisait les mains de son père et de sa mère en leur disant: «Laissez-moi partir.» Il se voyait déjà à la tête de son régiment; ou bien il allait saluer le roi à Versailles au sortir de la messe, et le roi l'invitait à Marly; si c'était le soir à son grand coucher, le roi lui faisait donner le bougeoir, et il éclairait Sa Majesté jusqu'au seuil de sa chambre; enfin, tous les rêves que peut faire un jeune homme un instant vaincu, prisonnier, désarmé, qui tout d'un coup se voit rappelé sous les drapeaux par la grande voix de la guerre. Il partit donc, accordant à peine un dernier regard à ses deux jeunes camarades, qui le regardaient comme on regarde en songe.
—Il s'en va comme il est venu, disait Élisa à Mlle de Silly.
—Bonsoir à sa compagnie, ajoutait Mlle de Silly. Je ne serai pas longue à me consoler.
Elle songeait qu'en effet son mariage était arrêté avec un jeune seigneur du voisinage, et que son mari l'accompagnerait dans les grands prés, sous les vieux arbres, le long des charmilles auxquelles Élisa disait adieu tout bas pour ne plus les revoir.
Et comme il est écrit qu'un malheur ne vient jamais seul, quelques jours après le départ du jeune colonel, Mlle Élisa de Launay reçut une lettre du couvent dans lequel elle était reine, et qu'elle comptait rejoindre avant peu. Elle ouvrit en tremblant cette lettre dont l'écriture lui était inconnue, et, la malheureuse! les maternelles paroles auxquelles elle était habituée, l'affectueux appel qui lui venait de sa chère abbesse et de sa digne soeur, étaient remplacés par des paroles sévères et par un commandement formel de ne pas rentrer dans l'abbaye.
Hélas! la chère abbesse était morte; elle laissait la maison endettée à tel point, que sa propre soeur était forcée d'en sortir. Les autres religieuses, dont la dot était perdue en grande partie, avaient été recueillies dans les abbayes voisines par les soins de l'archevêque de Rouen, le propre frère de M. de Colbert.
Ainsi désormais, pour la triste Élisa plus d'asile. Hier encore elle allait de pair avec les plus nobles filles du royaume, aujourd'hui la voilà seule, abandonnée et sans autre espoir que la servitude. Hier encore elle avait tant d'amis et comptait tant de protections! aujourd'hui, voici tout ce qui lui reste: un peu d'argent pour se rendre à Paris et une lettre de Mme de Gien, la survivante des deux soeurs, pour Mme l'abbesse des Miramiones, la digne fille de cette aimable et charmante Mme de Miramion, que feu M. le comte de Bussy-Rabutin avait enlevée en plein bois de Boulogne, avec l'aide et l'appui de Mgr le prince de Conti. Mais la vaillante femme, au fond de ce carrosse plein de ténèbres et de menaces, s'était résignée en chrétienne, et quand elle entra dans le château de son ravisseur, comme elle vit sur la muraille un crucifix, elle attesta la sainte image, et prit à témoin Bussy lui-même qu'elle n'aurait plus d'autre époux que Notre-Seigneur Jésus-Christ. Bussy courba la tête et reconduisit Mme de Miramion chez elle, implorant son pardon, qu'elle lui accorda par charité; et ce fut heureux pour le comte de Bussy, le roi l'eût fait jeter à la Bastille pour le reste de ses jours.
Mme de Miramion était morte dans l'exercice austère des plus fortes et des plus généreuses vertus, après avoir fondé un admirable asile où les jeune filles sans fortune et les pauvres veuves déshéritées trouveraient aide et protection. Ce lieu d'asile prit le nom de sa fondatrice, et les dames s'appelaient les Miramiones. C'est en ce lieu que l'orpheline était appelée par le voeu de sa mère adoptive autant que par sa pauvreté.