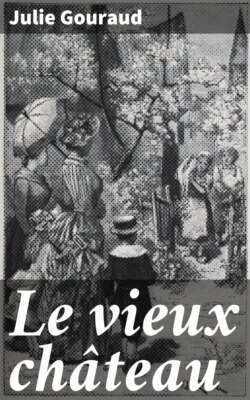Читать книгу Le vieux château - Julie Gouraud - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE I
Table des matières
«Eh bien! madame, les propriétaires du vieux château sont enfin arrivés. Ce n’est pas dommage, depuis six ans qu’ils s’annoncent. Il est vrai que ce n’est pas un joli château comme le nôtre, mais ce n’est pas une raison pour abandonner son bien comme ça.
«Pacaud a déjà porté des lettres et des journaux. On l’a fait déjeuner pendant que Mme Duquesne (c’est le nom des propriétaires) achevait ses lettres. C’est comme chez nous, on a pitié du pauvre homme qui traîne sa jambe par les chemins, et n’en fait pas moins son service. Il y a pourtant des gens qui voient Pacaud en nage et ne lui offrent pas de boire un coup!
«La dame est venue elle-même apporter ses lettres; Pacaud n’a pas attendu d’en être prié pour dire tout ce qu’il sait du pays; puis, il a raconté comment sa femme était morte d’un chaud froid, qu’il restait avec une fille de douze ans, que le malheur d’avoir perdu sa mère avait rendue raisonnable tout d’un coup. Germaine, a-t-il dit, a soin de moi, tout comme ma défunte; quand je rentre de ma tournée, je trouve le souper prêt, la maison propre. Puis ç’a été le tour de son petit André. Par exemple, il a oublié de dire qu’il avait manqué d’être écrasé par un chariot en voulant garer le vieux Thomas, qui s’était embourbé dans un mauvais chemin.
«Lorsque madame lui a demandé des nouvelles de son garçon qu’il avait amené jusqu’à la grille du château, il a redoublé ; ce n’est pas étonnant, car madame avait l’air de l’écouter avec plaisir.
«C’est la vieille Modeste qui m’a conté tout ça.
«Les enfants sont venus rejoindre leur mère, — bien sûr c’était pour voir Pacaud. La petite demoiselle s’appelle Marthe et son frère Paul, il est l’aîné. Enfin, madame, la mère et les enfants ont tout à fait plu à Pacaud, et moi, qui ne les ai pas encore vus, je me réjouis de leur arrivée; ça va faire des amis pour nos enfants. Ah! j’oubliais: il y a aussi la sœur de monsieur, une veuve qui n’est ni jeune ni vieille; elle se nomme Mme Gilbert.»
Il faut croire que tous ces détails n’étaient pas indifférents à Mme Vaslin, dont la propriété était voisine de celle de la famille Duquesne, car elle laissa la bonne Agathe dire tout ce qu’elle venait d’apprendre des étrangers.
Plusieurs semaines s’écoulèrent sans que les voisins témoignassent les uns les autres le désir de faire connaissance.
Les gens du pays ne se contentèrent pas des renseignements de Pacaud, ils s’adressèrent à Antoine, le jardinier et le gardien du vieux château. Le rapport d’Antoine fut aussi favorable que celui de Pacaud: c’étaient des gens bien comme il faut; ils lui donneraient autant d’aides qu’il lui en faudrait pour entretenir les jardins; Madame aimait beaucoup les fleurs: elle en voulait de toutes les saisons.
«Je ne travaillerai plus pour les merles et les moineaux, disait le bonhomme; je n’irai plus à la ville vendre mes légumes et mes fruits à des gens qui osent les marchander, et qui ne sont pas dignes de les manger.»
La joie fut générale lorsqu’on vit ouvrir toutes les fenêtres du château et qu’on entendit rouler une voiture attelée de deux beaux chevaux.
«A la bonne heure! dit une bonne femme du voisinage, je les verrai passer, je les saluerai, et s’il leur prend fantaisie d’entrer chez la vieille Brigitte, ils verront qu’elle n’est pas une sans-soin.»
C’était la première fois que Marthe et Paul se trouvaient en plein champ; les promenades du bois de Boulogne s’effacèrent promptement de leur souvenir; s’ils en parlaient, c’était avec un certain dédain, les petits ingrats.
L’âne mis à leur disposition fut déclaré préférable au landau, dans lequel ils étaient pourtant si heureux de monter par une belle soirée de juillet! Antoine avait préparé un petit jardin dans le grand jardin; des arrosoirs, des bêches et des râteaux attendaient les petits jardiniers; un mouton, au cou duquel Marthe s’empressa d’attacher un grelot, des lapins, des poules, toute une basse-cour enfin. Que de plaisirs nouveaux pour ces petits Parisiens!
C’était encore un plaisir de guetter Pacaud du haut de la terrasse et d’annoncer son arrivée. On en vint bientôt à l’intimité ; Marthe demandait sans cesse d’aller voir Germaine et André. Un jour donc, Mme Duquesne et ses enfants montèrent dans une de ces voitures légères qui passent par tous les chemins; et une demi-heure plus tard, ils arrivaient devant une maison de pauvre apparence, mais dont l’extérieur était soigné ; les murs étaient tapissés d’espaliers de poires, et une haie de rosiers donnait une apparence de coquetterie à la maison. Il n’y avait personne au logis; une voisine appela Germaine, et engagea les visiteurs à entrer chez, elle, en attendant la petite.» Elle est allée laver au ruisseau, la brave enfant; mais ce n’est pas loin d’ici, nous la verrons paraître dans quelques instants, »
Nul doute que la bonne voisine n’eût énuméré toutes les qualités de la fille de Pacaud, si celle-ci lui en eût laissé le temps.
Quelques minutes plus tard, en effet, on aperçut Germaine pliant sous une charge de linge à peine essoré, si bien que son jupon et son tablier étaient mouillés; son frère portait le battoir et le savon. La jeune fille s’empressa de déposer le linge sur la haie d’un petit potager, ouvrit la porte de sa maison et pria Mme Duquesne et les enfants d’entrer et de s’asseoir pendant qu’elle irait changer de jupon.
Dès que Germaine eut disparu, Marthe dit à sa mère:
«Qu’elle est gentille! que je l’aime! mais comment sait-elle déjà laver du linge?
— Ma mignonne, la nécessité et la bonne volonté sont deux grandes maîtresses; et puis, il est probable que cette petite a vu sa mère laver; et peut-être même s’y est-elle exercée sous ses yeux. La propreté de la pièce où nous sommes prouve que Germaine ne craint pas sa peine.
— Oui, elle est propre, dit Marthe en regardant autour d’elle.
— Pourquoi le petit garçon s’en est-il allé ! j’aurais voulu lui parler.
— Le pauvre enfant n’est pas habitué à voir si nombreuse compagnie. Je dirai à Pacaud de nous amener ses enfants un de ces matins, il les prendra à son retour; alors, mes chéris, vous ferez connaissance avec le frère et la sœur.
— Oh! chère maman, que vous êtes bonne!»
Germaine revint après avoir changé de vêtements. Tout en répondant aux questions que lui adressait Mme Duquesne, elle suivait attentivement la marche de l’aiguille du coucou.
«Nous vous gênons peut-être, mon enfant?
— Oh non! madame, je suis bien contente de vous voir, vous, mademoiselle et monsieur; le père nous parle souvent de vous et de Mlle Ursule. Seulement, je vous demande la permission de mettre la marmite au feu, car le père a grand’faim quand il rentre.
— Certainement, ma chère petite; faites vos affaires comme si nous n’étions pas là.»
Germaine profita de la permission qui lui était donnée.
Cette enfant savait tout ce que savent les petites paysannes de son âge; mais Marthe, qui n’avait vu que Sylvie, la cuisinière du vieux château, toucher aux casseroles et aux marmites, était émerveillée du savoir-faire de la villageoise.
On aperçut Germaine portant une charge de linge.
Lorsque Germaine invita ses hôtes à venir prendre une tasse de lait sous la tonnelle, Paul s’écria:
«Quel bonheur! car j’ai joliment soif, mais je n’osais pas le dire.
—Vous avez une vache? demanda Mme Duquesne.
— Oh! non, madame; ces bêtes-là coûtent trop cher; et d’ailleurs, nous n’aurions pas assez d’herbe pour la nourrir; c’est ma tante Julienne qui nous donne du lait de sa vache grise: une fameuse vache, allez!»
Des bols de faïence épaisse, des cuillers d’étain et du pain bis et dur furent mis sur la table; les enfants regardèrent leur mère, et la voyant porter le bol à ses lèvres, ils n’hésitèrent pas à suivre son exemple. Le lait de la Grise fut déclaré exquis.
André demanda la permission à Mme Duquesne d’aller avec M. Paul jusqu’à l’entrée du chemin, pour voir si le père arrivait.
Cette permission fut gracieusement accordée. Pacaud ne tarda pas à paraître; il était couvert de poussière de la tête aux pieds, et quoique chargé de paquets, il marchait aussi vite que peut marcher un pauvre boiteux.
Pacaud était aussi bien commissionnaire que facteur.
«Pacaud, lui disait une voisine, apportez-moi un pain de six livres; vous passez devant le boulanger, ça ne vous retardera pas.»
Une autre le priait de lui prendre un paquet de chanvre chez l’épicier, et jamais le brave homme ne refusait de rendre service à ses voisines indiscrètes. Il faut dire que tant d’obligeance n’était pas tout à fait désintéressée: les voisines étaient bonnes pour ses enfants.
La figure du piéton s’épanouit en voyant M. Paul avec André ; il hâta le pas pour saluer la belle compagnie qui l’honorait de sa visite, et s’étant débarrassé de sa sacoche, il se disposait à s’asseoir lorsque Germaine lui dit:
«Oh! non, père, ne t’assoie pas, tu es en nage; madame permettra bien que tu ailles te changer; pendant ce temps-là, je te servirai ton dîner.
— Certainement, mon enfant; nous allons voir votre petit potager qui me paraît très bien cultivé, et nous reviendrons faire notre visite à votre père.»
Mme Duquesne rentra une demi-heure plus tard; elle loua Germaine et André de la manière dont ils entretenaient leur potager; à l’en croire, Antoine n’avait pas de plus belleslaitues.
Mme Duquesne invita Pacaud à amener ses enfants au vieux château, le dimanche suivant. Le brave homme s’excusa d’abord, puis, comme c’était bien probable, il finit par accepter une si belle invitation.
«Je les connais bien, dit-il à Germaine lorsqu’ils furent seuls, c’est du bon monde, ces gens-là : pas méprisants, généreux. Que Dieu les bénisse!»