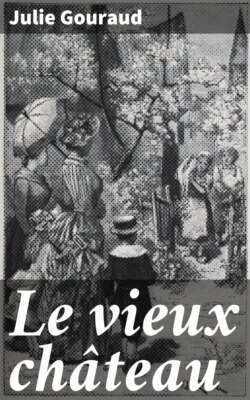Читать книгу Le vieux château - Julie Gouraud - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE II
Table des matières
M. et Mme Duquesne distinguèrent parmi leurs voisins la famille Vaslin. Aux visites de politesse succédèrent bientôt des rapports plus intimes, dont le but était de réunir les enfants. Paul ferait de bonnes parties avec Auguste; et Marthe, qui entrait dans sa douzième année, ne dédaignerait pas Marguerite qui n’avait que dix ans. Effectivement, d’aimables relations s’établirent entre les deux familles; les enfants s’entendaient très bien et les parents s’appréciaient réciproquement; on en vint bientôt à une cordiale intimité.
Après avoir constaté la beauté de Mme Duquesne, on était frappé de la tristesse de son sourire.
«Que peut-il manquer à cette aimable femme? dit Mme Vaslin; son mari paraît un excellent homme, ses enfants sont charmants; Marthe sera jolie comme sa mère; Paul est un garçon plein de vie, et déjà fort avancé pour son âge; d’où peut donc venir la tristesse de cette aimable femme?
— Ah! dit Mlle Lucie, vieille amie qui passait la belle saison avec la famille Vaslin, espèce d’arachné qu’on trouvait toujours à son métier de tapisserie, il n’y a personne en ce monde qui n’ait un petit coin d’amertume dans le cœur; seulement tout le monde n’est pas trahi par des yeux comme ceux de Mme Duquesne.»
De l’antichambre au salon, il n’y a qu’un pas. Pendant que la famille Vaslin cherchait à pénétrer la cause de la tristesse de Mme Duquesne, Ursule s’empressait de dire à Mlle Agathe, la bonne de Marguerite, que Mme Duquesne était venue au vieux château contre son gré, parce que monsieur était fou de chasse, que le voisinage de la forêt allait amener des chasseurs, et que la chasse ne convenait pas à monsieur, très délicat de santé.
«Nous en verrons de belles! ajouta Ursule, tous les amis de monsieur arriveront avec leurs chiens, dès que la chasse sera ouverte; ce sera un train, un sabbat dès le point du jour; et ma chère maîtresse, ajouta tristement Ursule, n’aura plus de repos; elle ne se plaindra pas; alors, c’est impossible que monsieur s’en doute, car madame reçoit les chasseurs de bonne grâce; elle pousse même quelquefois la complaisance jusqu’à suivre la chasse pour faire plaisir à son mari.»
Ainsi prévenus par le rapport d’Ursule, les voisins observèrent combien en effet la délicatesse de M. Duquesne était peu en rapport avec sa passion pour la chasse.
Il ne se passa bientôt plus de semaine sans que les voisins vinssent les uns chez les autres.
Cette première année de séjour au vieux château s’écoula paisiblement: se promener dans les bois, voir moissonner, voir vendanger, tels étaient les plaisirs de Marthe et de Paul.
M. Duquesne tirait de temps en temps un coup de fusil; sa femme se persuada qu’il avait renoncé à la chasse, et elle s’en réjouissait. Il n’en était rien: un étranger étant venu dans le pays, fut présenté par ses amis dans tous les châteaux du voisinage: le comte de M... était un chasseur passionné, qui possédait de magnifiques chasses en Moravie, et chaque année il réunissait chez lui tous les chasseurs de la contrée.
Les récits de l’étranger étaient d’autant plus merveilleux que personne ne pouvait le contredire.
A partir de ce moment, on ne parla que chasse dans le pays.
Des invitations furent adressées à tous les chasseurs connus.
Une grande chasse fut organisée, elle eut un plein succès.
M. Duquesne se crut obligé d’adresser une invitation au comte de M... et d’organiser avec lui une chasse. L’empressement et le bon gré que mit sa femme, à tout disposer dans sa maison ne permirent pas à son mari de se douter combien cette réunion de chasseurs était peu de son goût; loin de là, cette chasse lui causait une sorte d’effroi qu’elle confia à sa vieille Ursule.
Il fut présenté par ses amis dans tous les châteaux du voisinage.
Ursule, tout en partageant les appréhensions de sa maîtresse, s’efforça de la rassurer:
«Monsieur était si bon chasseur! Les chiens si bien dressés, et enfin monsieur avait besoin de distraction.»
Le jour de la chasse est fixé ; quelques jeunes femmes ont accepté d’aller, en voiture découverte, prendre leur part d’un lunch que l’on a décidé d’offrir aux chasseurs au milieu des bois. Paul, qui a un petit cheval, accompagnera ces dames. Mais pourquoi son ami Auguste ne serait-il pas de la partie, puisque lui a aussi un petit cheval, que M. Tisseron, le maître d’équitation, a déclaré capable de figurer sur un champ de bataille? Paul se charge d’obtenir la permission; il prie, il supplie, et il obtient qu’Auguste l’accompagne.
On est aux premiers jours d’octobre; le temps est splendide, les aboiements des chiens annoncent au point du jour le départ des chasseurs. Bourgeois et paysans sont aux fenêtres pour les voir passer.
Paul et Auguste eussent été bien heureux de les suivre, mais ils étaient trop jeunes.
«L’année prochaine, disaient-ils, on nous donnera peut-être un fusil.»
La chasse est commencée: les coups de fusil se succèdent, les victimes sont nombreuses et quelques heures plus tard, on fait halte chez le garde forestier; chacun raconte ses émotions, compte ses trophées; on étale sur l’herbe les lièvres, les perdreaux, les faisans; les dames, qui ont été exactes au rendez-vous, complimentent les chasseurs et caressent les chiens.
On fait honneur aux fruits, aux gâteaux et surtout aux rafraîchissements. Puis le moment de se séparer arrive: les messieurs se remettent en chasse, les dames remontent en voitures et les deux enfants à cheval.
Mme Duquesne et Mme Vaslin se félicitèrent d’avoir procuré à leurs petits cavaliers un plaisir qui n’avait eu aucun inconvénient.
Au sortirde la forêt, un paysan signala au cocher une vache, effarée courant dans un champ peu éloigné de la route que suivaient ces dames.
«Pressez les chevaux, dit Mme Duquesne; nous avons le temps d’arriver au village.»
Le cocher obéit, mais pas assez vite toutefois pour s’éloigner du champ où la vache affolée courait en tous sens. D’autre part, les enfants effrayés dirigeaient mal leurs montures. Un jeune garçon témoin de ce qui se passe accourt, il saisit le cheval de Paul par les naseaux sans pouvoir s’en rendre maître; Paul veut mettre pied à terre, il embarrasse son pied, et tombe en jetant un cri.
«Mon fils est mort!» s’écrie Mme Duquesne, mais le regard de son enfant la dé trompe.
A ce moment, il n’y a que des femmes au village: mais c’est assez; elles s’empressent autour de l’enfant, s’efforcent de rassurer la mère qu’elles distinguent au milieu des autres dames. Paul prend la main de sa mère, il lui sourit, quoique la douleur lui arrache des larmes. Auguste pleure aussi: il ne montera plus à cheval.
Le château de Mme Vaslin étant le plus proche, on y ferait une halte. Mme Duquesne souhaitait d’y arriver promptement, mais la prudence ne le permettait pas.
Dès que les domestiques aperçurent la voiture qui s’avançait au pas, ils soupçonnèrent qu’un malheur était arrivé. Ils connurent bientôt la vérité et l’accueillirent avec une sympathie à laquelle eût été sensible Mme Duquesne, si elle avait pu éprouver un autre sentiment que celui de sa propre douleur.
Le fils du jardinier monte aussitôt à cheval et part au galop pour chercher le médecin. Le messager n’était pas à moitié chemin, lorsqu’il le rencontra; il l’informa de ce qui était arrivé à M. Paul.
M. Thomas était un vieux praticien, ancien major de l’armée; il pratiquait avec un égal succès la médecine et la chirurgie; son cabriolet et son cheval attestaient des habitudes de simplicité qui le faisaient passer pour un original; mais M. Thomas était réellement un homme modeste et de bon sens. Après une absence de quinze années, il était rentré dans sa ville de Chinon, comme il disait, pour se rendre utile à ses concitoyens, mais il ne restait guère à la ville; il avait la confiance des gens de la campagne, il ne se passait pas un jour qu’on ne le rencontrât dans les chemins.
Le docteur arriva promptement près de Paul, quoiqu’il fût loin de prévoir la gravité du mal. Il observa le blessé en silence et finit par dire en souriant:
«Voilà un prisonnier dont je tâcherai d’obtenir promptement la liberté.
— Comment! fit Mme Duquesne, je ne peux pas emmener mon fils chez moi?
— Madame, la prudence s’y oppose; d’ailleurs, il me semble que jamais prison ne fut mieux choisie que celle-ci: une belle chambre, vue sur le parc, gardes-malades dont la présence chassera l’ennui de la réclusion à laquelle M. Paul est condamné. Ah! la prison! je le sais par expérience, elle n’offre jamais de semblables douceurs! Allons, monsieur Paul, du courage! montrez-vous homme!»
En dépit des paroles du docteur, tous les assistants furent consternés. Il était évident que la blessure était grave.
Les petits amis du blessé n’osèrent pas approuver hautement l’ordonnance du docteur Thomas; mais cette ordonnance augmenta beaucoup la considération qu’ils avaient déjà pour lui; néanmoins, lorsqu’il les pria de sortir de la chambre et qu’ils entendirent les cris de Paul, ils accusèrent le médecin de trahison, et ils allèrent se plaindre à Agathe. Leur bonne eut beaucoup de peine à leur faire comprendre l’utilité de l’opération que subissait leur ami; mais lorsqu’un peu plus tard, ils revirent Paul étendu dans son lit, ils se rassurèrent.
Cependant Marthe était inconsolable.
«Si mon frère allait mourir! s’il ne pouvait plus marcher, comme le vieux monsieur qu’on porte à l’église et qu’on vient chercher quand la messe est finie! S’il était seulement comme Pacaud! Mon Dieu, que j’ai de chagrin!»
Quoique plus réservée, Marguerite avait aussi beaucoup de chagrin, elle pleurait.
«Je voudrais bien consoler Marthe, disait-elle à sa bonne, mais je ne trouve rien.
— Tranquillise-toi, ma sœur, lui disait Auguste, Ursule assure qu’à notre âge on se raccommode vite; nous ferons encore de bonnes parties, va!»
Marthe avait disparu.
«Où est-elle? dit Marguerite.
— Elle pleure dans sa chambre; allons la chercher.»
Effectivement, ils trouvèrent Marthe tout en larmes; ils essayèrent, mais en vain, de lui faire partager l’espoir que Paul leur serait bientôt rendu.
Chaque fois que la pauvre petite voyait Pacaud, ses yeux se remplissaient de larmes.
«Oh! pensait-elle, si mon frère était comme ça!»
Cependant le docteur avait constaté que la jambe n’était pas cassée de la façon la plus grave, et que l’enfant serait transportable dans six semaines.
Mme Vaslin avait accueilli ces paroles comme une bonne amie: n’était-il pas tout simple que ses chers voisins trouvassent l’hospitalité chez elle? quelle consolation pour ce petit blessé d’être si bien entouré ! Si une mère pouvait oublier que son fils est victime d’un si grave accident, Mme Duquesne se fût trouvée heureuse sous le toit de ses amis.
La famille Vaslin n’était pas, comme disaient les gens du pays, une famille à la mode. Les maîtres étaient simples dans leurs goûts et leurs habitudes; leurs domestiques subissaient cette heureuse influence. Mlle Agathe et les autres femmes de la maison conservaient le bonnet du pays.
Ursule était accourue pour soigner son garçon; elle s’appropria le titre de garde-malade et prit une autorité dont Mme Duquesne et son amie étaient trop touchées pour chercher à l’amoindrir.