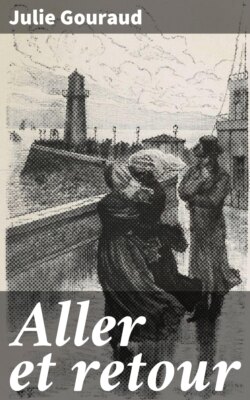Читать книгу Aller et retour - Julie Gouraud - Страница 11
Le départ.
ОглавлениеAntoine, et Pauline s’étaient promis de s’écrire souvent, et ils furent fidèles à leur promesse. Les moindres détails de cette correspondance avaient pour le frère et la sœur un charme qu’eux seuls pouvaient apprécier. Antoine était moins riche en faits divers que Pauline. La vie d’un clerc d’Avoué n’est pas fertile en épisodes; les demoiselles Bouvry tenaient bien une certaine place dans les lettres du jeune homme, mais le présent était vraiment trop pauvre pour s’y arrêter longtemps. L’avenir était un sujet inépuisable de projets tous plus beaux les uns que les autres. Pauline répondait sur le même ton: «Ali! le temps passe vite, disait-elle, et nous serons tout étonnés de nous retrouver bientôt. Que mes amies quittent la Touraine, qu’elles aillent même à l’étranger, si bon leur semble, pour moi je suis Tourangelle, et je resterai Tourangelle.»
La bonne humeur de Pauline était bien précieuse pour distraire sa mère de certaines préoccupations: depuis six mois, M. Olivier gardait un silence qui ne lui était pas habituel; il était distrait, et presque soucieux parfois.
Pauline attribuait ce changement à des affaires sérieuses, et d’ailleurs, ce père bien aimé n’avait-il pas toujours un sourire pour sa fille?
Mme Olivier, plus clairvoyante, s’attristait en constatant que son mari devenait chaque jour moins communicatif. Les visites fréquentes d’un étranger lui causaient de l’ombrage; l’inquiétude n’altérait cependant pas là bonne humeur de l’aimable femme.
Il y avait deux mois que Mme Olivier luttait contre ces tristes préoccupations, lorsqu’elle reçut la visite d’une de ces femmes qui tiennent à honneur d’être informées les premières des affaires d’autrui, et de les faire connaître.
«Eh bien! dit Mme Leclerc, votre mari a donc vendu son Étude? Nous en sommes tous désolés! A qui s’adressera-t-on maintenant pour avoir un bon conseil? Pour placer des fonds?»
Mme Olivier protesta contre cette prétendue nouvelle; la commère insista; mais, voyant enfin le trouble que ses paroles causaient à Mme Olivier, elle ajouta, comme palliatif: «Votre mari a droit au repos, et votre fils, ayant été élevé à Paris, ne doit pas aimer la province.»
Mme Leclerc s’aperçut enfin de l’inopportunité de sa visite; elle se retira brusquement.
Atterrée par la nouvelle qu’une femme indiscrète venait de lui apporter, Mme Olivier se rappela alors certaines paroles de son mari; les visites de l’étranger prirent une importance qui ne lui permit plus le doute: si Mme Leclerc avait été indiscrète, elle n’en était pas moins bien informée. Quelle folie! pensait la pauvre femme. Il n’a pas voulu me consulter, parce qu’il sait bien que, pour la première fois, nous n’eussions pas été d’accord. Elle garda le silence; mais Pauline s’aperçut bien vite du trouble de sa mère; la jeune fille, espérant que ses craintes étaient mal fondées, alla se rassurer auprès de son père; elle n’obtint qu’une réponse évasive, et courant se jeter dans les bras de sa mère, elle pleura, sans connaître le sujet de ses larmes.
Cependant, M. Olivier mit un terme au supplice de sa femme: il lui avoua qu’il songeait à vendre son Étude pour acheter un Cabinet d’Affaires à Paris.
«Ce projet n’est-il pas déjà réalisé ? demanda timidement Mme Olivier. Le bruit en court dans la ville, cher ami.
— Comment peux-tu croire, Louise, que j’aie conclu une si grande affaire sans t’en dire un mot! Rien n’est fini; peu s’en faut, il est vrai. Écoute-moi: je suis dégoûté de la vie de province; il y a vingt-cinq ans que je suis renfermé dans cette petite ville, travaillant du matin au soir, sans être arrivé à un résultat bien fameux. J’ai besoin, ma chère amie, de respirer l’air de la capitale. Je retrouverai les amis de ma jeunesse; ceux-là sont fidèles, tu en as eu la preuve dans Varin. Sois sûre que nous marierons mieux Pauline à Paris que dans ce trou d’Amboise; quant à Antoine, Varin se chargera de son avenir, du moins je l’espère.
— Est-ce bien toi, toujours si prudent, qui parles ainsi?
— Oui, ma chère Louise, la pensée de ton bonheur, crois-le bien, a une grande influence sur le parti que je crois sage de prendre;» — et voyant les larmes que ne pouvait retenir sa femme, il ajouta: «Ce projet te trouble, mais tu arriveras promptement à partager mon opinion. Aie confiance dans un mari qui t’aime et qui aime ses enfants.
— Je me soumettrai, mon ami, mais jamais je n’approuverai qu’à notre âge nous essayions d’une vie nouvelle: les vieux arbres ont des racines profondes.»
Les projets de M. Olivier étaient déjà connus. On regrettait le Notaire et l’homme de bien: «Quelle perte pour notre petite ville! disait-on; c’est un homme si sage, si prudent! Sans lui, disait une veuve, j’aurais fait la folie de vendre ma propriété de Rochecorbon, qui est aujourd’hui d’un excellent rapport.»
Les amies de Mme Olivier la plaignaient de quitter son pays, sa maison, et d’aller faire de nouvelles connaissances. Mais il y a toujours en province des femmes qui rêvent Paris, et considèrent le lieu où les a placées la Providence comme un lieu d’exil, quoiqu’elles y trouvent tous les éléments du bonheur.
M. Olivier laissa passer l’orage. L’Étude était vendue à un Notaire de troisième classe; il habiterait la maison sans en devenir propriétaire. Il fallait donc songer au départ. Le courage manquait à Mme Olivier, naturellement courageuse. Comment s’en étonner, pouvait-elle quitter cette maison sans un brisement de cœur?
Que ferait-elle de tant d’objets dont l’usage allait devenir inutile et qu’elle soignait précieusement en songeant à l’avenir de ses enfants; le portrait de sa mère, œuvre d’un grand artiste, serait-il placé dans un jour aussi favorable? Mais le plus cruel était de perdre le jardin où ses enfants avaient fait leurs premiers pas, et qui offrait un précieux abri contre la chaleur du jour.
Pauline ne regrettait pas moins sa chambre rose et tout ce qui en faisait l’ornement. Ne pas emporter sa volière, ne plus soigner ses fleurs, lui semblait un malheur réel. Ses amies la félicitaient d’aller à Paris: «Que de belles choses vous allez voir!» disaient les étourdies.
Cependant, Agnès, l’amie du cœur, avait d’autres pensées et tenait un autre langage. Les deux jeunes filles augmentaient leurs regrets en énumérant les plaisirs du passé. «Tu ne seras plus à côté de moi à l’église, disait Agnès; nous ne monterons plus ensemble à la Pagode, tu ne seras plus là pour faire les vendanges..... enfin, je soignerai bien tes oiseaux; je leur parlerai de toi, ma petite Pauline. Nous nous reverrons, espérons-le!»
Le jour du départ est fixé, M. Olivier reçoit une lettre de son camarade Varin: «Je ne puis, disait-il, recevoir ton fils dans mon administration.» Il ajoutait à ce refus un blâme absolu du parti que prenait son ami.
Nous ne monterons plus ensemble à la pagode.
Il ne faut pas croire que, si cette réponse défavorable fût venue six mois plus tôt, M. Olivier eût renoncé à ses projets. Il connaissait déjà l’opinion de son ancien camarade, et il ne voulait pas que son plan fût blâmé par un homme dont le jugement lui était connu d’avance.
Après un moment de vive contrariété, l’imprudent se dit: «Bah! Paris est la ville des ressources; mon fils est intelligent; il fera son chemin, et je n’aurai pas à me reprocher d’avoir déprimé son intelligence en le laissant à Amboise, où l’on ne sait faire que de bons dîners.»
Cependant, la mère de famille disposait tout pour le départ; elle n’avait pas cette résignation triste qui accuse à tout instant du jour celui auquel on est forcé d’obéir; sa contenance, quoique triste, était aimable. M. Olivier se persuada que sa femme avait passé de la résignation à la satisfaction de quitter sa province.
L’erreur du brave homme était grande, ce fut avec un déchirement de cœur que Mme Olivier quitta sa chère Touraine.
Heureux de se retrouver en famille, Antoine ne se demanda pas si le parti que prenait son père était sage, et il se livra sans contrainte à la joie de vivre au milieu de ceux qu’il chérissait. Mme Olivier, elle-même, oublia toutes ses appréhensions en embrassant son fils, en constatant sa bonne santé et sa bonne tenue.
Pauline se consola comme on se console à quinze ans. La pensée de voir son frère chaque jour, de prendre les repas ensemble, ne lui permettait plus de regretter ce qu’elle avait eu tant de peine à quitter. Sans doute, Antoine aurait ses occupations, il travaillerait dans sa chambre; mais il n’y aurait qu’une porte à ouvrir pour lui dire bonsoir.
Les premières joies d’une réunion de famille étant apaisées, le jeune homme se demanda si la fortune de son père légitimait sa présence à Paris; et, après beaucoup d’hésitation, il crut, en sa qualité d’aîné, pouvoir lui demander quels motifs l’avaient fait renoncer à son Étude.
«Mon cher enfant, le désir de ne pas te soumettre à la vie de province, comme j’y ai été soumis moi-même, m’a fait saisir l’occasion forfuite de vendre mon Étude à un homme sur lequel j’ai les meilleurs renseignements. Le rêve de M. Nerbonneau était de s’établir à Amboise, comme le mien était d’habiter Paris. Dans quelques mois je serai en possession, d’un excellent Cabinet d’Affaires.
«Quand tu auras achevé ton stage, je partagerai la besogne avec toi, et puis.... Nous songerons à te marier, sois tranquille, mon cher enfant.»
Antoine ne fit aucune réflexion, il demanda seulement si la maison était vendue.
«Non vraiment! pour rien au monde je n’aurais voulu faire ce chagrin à ta mère. D’ailleurs, ne vivant plus avec les Tourangeaux, je ne serai pas fâché de les revoir quelquefois.»
Antoine entrait dans sa vingtième année; l’indépendance, loin de lui nuire, avait développé son jugement: il comprit que son devoir était de respecter l’autorité de son père, de s’abandonner à sa tendresse, et de ne considérer que le bonheur d’être réunis. Il arriva même à se persuader que Paris serait favorable à l’établissement de sa sœur: «Pauline, se disait-il, est charmante, ses manières ne sont pas celles d’une petite fille d’Amboise; ma sœur est faite pour vivre dans la meilleure société.»
Mme Olivier ne s’illusionnait pas; le bonheur d’avoir son fils sous son toit ne pouvait la distraire des préoccupations de l’avenir. Cependant elle s’empressa de chercher un appartement, non pas sans inconvénients, mais où chacun eût à peu près ses aises. Quoique le Cabinet d’Affaires de son mari fût rue Sainte-Anne, elle pensa qu’il serait plus sage de ne pas s’établir dans un quartier aussi central. Après beaucoup de recherches et de fatigues, Mme Olivier trouva rue de Tournon, au quatrième étage d’une maison honorable, un appartement d’un prix modéré ; on s’y établit, sinon grandement, du moins commodément.
S’il était pénible de monter cent marches, on avait l’avantage de voir les ombrages du Luxembourg; on pouvait même, avec un peu de bonne volonté, avoir l’illusion d’être propriétaire de ce magnifique parc dont, en bon prince, M. Olivier accordait la jouissance à ses amis et à ses ennemis, en supposant qu’il eût déjà des uns et des autres.
Antoine quitta sa petite chambre de la rue de Sèvres; il eût regretté cette chambre, si celle qu’il allait habiter n’avait pas eu tous les titres à sa préférence: c’était là qu’il avait travaillé, qu’il avait connu et aimé ce pauvre petit Pierre; et Antoine pensait, avec un certain orgueil, que, grâce à lui, Pierre avait éveillé l’intérêt de son oncle qui, reconnaissant les moyens de l’enfant, s’était décidé à lui faire achever ses études. Pierre était dans un bon collège d’Angleterre, car M. Coudré le destinait à une carrière qui exigeait la connaissance parfaite de la langue anglaise.
Le locataire des demoiselles Bouvry ne les quitta pas sans leur témoigner sa reconnaissance. Il fut convenu qu’on se verrait souvent, qu’on voisinerait. Mlle Zoé déclara qu’elle ne voulait plus louer la chambre qu’avait habitée Antoine: aucun locataire, disait-elle, ne remplacera-celui que nous perdons: c’était bien l’avis de la sœur aînée.
Les meubles qui avaient encore bon air dans la maison d’Amboise semblèrent pitoyables dans l’appartement de Paris. Mme Olivier comprit la nécessité d’y ajouter au moins quelques meubles à la mode, quoique peu convaincue de leur utilité ; mais son mari ayant retrouvé quelques anciens amis, il fallait les recevoir, et dissimuler l’insuffisance d’un établissement qui pouvait produire tout d’abord une impression défavorable.
Quelques relations en amenèrent d’autres, et bientôt Mme Olivier reçut plus de visites qu’elle n’en souhaitait. Habituellement, elle ne quittait sa maison qu’après y avoir établi l’ordre, et bien souvent, étant obligée de travailler, la mère de famille se contentait d’aller respirer l’air dans son jardin, ou d’ouvrir la fenêtre. Mais déjà ses habitudes étaient changées. Quelle que fût l’occupation du moment, elle l’abandonnait, si le temps était beau, pour aller rendre des visites, afin d’épargner les frais d’une voiture.
Lorsqu’à l’obligation de faire des visites s’ajouta celle d’aller en soirée, Mme Olivier prétexta l’âge de sa fille pour refuser toute invitation de ce genre. Son mari fut d’un avis contraire; ces soirées n’étaient que de simples réunions de jeunes filles qui dansaient entre elles; Pauline désirait évidemment faire connaissance avec des jeunes filles de son âge: la mère se rendit, et perdit même tout à coup confiance dans son habileté et dans son goût. Elle se procura aisément l’adresse d’une couturière, car toute Parisienne rend avec empressement ce service à une étrangère!
Dès le lendemain, Mme Olivier et sa fille se rendirent à l’adresse indiquée. Leur surprise fut grande en entendant à quelles conditions la couturière se chargerait de faire une toilette simple et jolie à Mademoiselle. On marchanda, la couturière répondit par un sourire; il fallut se rendre.
La raison n’est pas encore solidement établie dans une tête de quinze ans. Pauline, d’abord surprise des changements survenus dans sa famille, finit par les trouver tout simples.
D’ailleurs, quelle est l’enfant qui doute de la sagesse de ses parents?
La vie parisienne s’insinua au foyer de la famille Olivier; le père était en possession du Cabinet d’Affaires, Antoine gagnait chaque jour davantage la confiance de maître Briant; la prospérité semblait vouloir entrer chez nos Tourangeaux.
Toutes les ressources furent consacrées aux apparences; la mère et la fille avaient une certaine élégance; Mme Olivier ne faisait plus difficulté d’aller en soirée, d’accepter un dîner; et bientôt il y eut échange de politesse. L’insuffisance de Manette comme cuisinière s’accusait chaque jour davantage; il ne fut pas question un seul instant de renvoyer au pays la brave fille, mais de la remplacer par une cuisinière qui fût à la hauteur des circonstances. Manette prit le tablier blanc, et montra dans son nouveau service autant de zèle qu’elle en avait témoigné en toutes choses.
La nouvelle servante causa à Mme Olivier une sorte d’effroi; elle comprit tout de suite qu’il lui serait difficile, sinon impossible, de veiller à l’économie. C’était vrai, Léocadie était une de ces fines commères qui apprécient d’emblée sur quel terrain elles marchent; honnête à sa façon et sans scrupule toutefois, elle avait l’art de gagner un petit douzième sur la dépense. On aurait pu la surprendre, à la fin de chaque journée, travaillant son livre de dépense. Grande, forte, et de bonne humeur, elle prévenait ses maîtres en sa faveur.
Mme Olivier exprima le désir que ariette se formât sous la direction de Léocadie, mais celle-ci n’avait aucun goût pour l’enseignement; sans refuser ses conseils, elle trouvait mille prétextes pour éloigner Manette de la cuisine; la jeune paysanne était en réalité la servante de la cuisinière. Mme Olivier s’en apercçut, et ne chercha plus à obtenir ce qui lui avait semblé si simple; elle s’appliqua alors à former la jeune fille à la couture et lui donna le titre de femme de chambre.
Manette avait bon air avec le tablier blanc; sa main ne manquait pas d’adresse, et le désir de contenter ses maîtres hâta ses progrès.
Le chiffre de la dépense augmenta insensiblement d’un quart, puis d’un tiers. Léocadie criait bien fort contre la cherté des vivres; il lui arrivait cependant de faire de temps à autre un bon marché qu’elle avait grand soin de constater.
Antoine, toujours assidu au travail, considérait froidement le changement qui s’opérait, dans la maison. Il admirait Pauline parée pour le bal, il lui donnait le bras pour entrer dans un salon, mais ne dansait pas, et trouvait un prétexte pour se retirer de bonne heure.
M. Olivier n’approuvait pas la conduite de son fils; toutefois, il prenait patience: cette sagesse prématurée n’était à ses yeux qu’une bizarrerie dont il guérirait comme tant d’autres jeunes gens. Les cinq années de stage n’étaient pas faites pour un garçon comme Antoine, et le père aurait volontiers réclamé une exception à la loi en faveur de son fils.
Antoine, loin de se plaindre de sa carrière, quoiqu’il ne l’eût point choisie, travaillait avec ardeur, il s’intéressait même à un travail que ses camarades déclaraient insipide.
Maître Briant ne tarissait pas en éloges sur le compte d’Antoine; il l’appelait en riant son digne successeur. Ces éloges enchantaient M. Olivier; mais il ne pouvait se dissimuler qu’une charge d’Avoué à Paris n’était pas en rapport avec ses moyens. Puis, ayant besoin d’illusion, il songeait à la possibilité d’un riche mariage. Il fallait simplement pour cela que son fils allât dans le monde, fît des frais, au lieu de se poser en ours, et encore, pensait-il, il y a des ours qui font un beau chemin!
Une fois engagés dans cette voie factice, les provinciaux ne reculèrent pas; les relations s’étendirent, on fit bonne contenance hors de chez soi; mais quelques heures de solitude ramenaient la réflexion et laissaient chaque jour des rides sur le front de la mère de famille.
M. Olivier, en dépit de son assiduité et de son honnête physionomie, n’obtenait pas la confiance de tous les clients que lui avait laissés son prédécesseur. Il feignit d’abord d’attacher peu d’importance à ces infidélités, et ne manquait pas de faire valoir la plus petite affaire. Il y avait cependant une chose que le pauvre homme ne pouvait pas se dissimuler, c’est que les dépenses étaient supérieures aux recettes: l’équilibre du budget était rompu.
Le serviteur qui a vieilli dans la maison pressent, et ne tardé pas à constater le mauvais état de la fortune de ses maîtres; alors, il redouble de zèle; il se dit que son dévouement pourra suppléer beaucoup de choses, adoucir l’épreuve de ceux qu’il honore et qu’il aime; mais ces pensées ne sont pas celles d’un serviteur étranger qui arrive chez des étrangers: Léocadie devina bien vite ce qui se passait dans la famille Olivier. Elle en causa au marché avec les commères de sa connaissance; elle les consulta sur le parti qu’il y avait à prendre, et toutes déclarèrent que Mlle Léocadie n’était pas à sa place.
La chose étant décidée, Mlle Léocadie crut agir loyalement en disant à sa maîtresse qu’elle craignait d’oublier la cuisine dans un si petit ménage, que sa place était ailleurs.
Léocadie avait bien pesé ses paroles; elle pensait avoir donné son congé de la façon la plus polie. Mme Olivier garda le silence, Léocadie prit pour de l’indifférence ce qui était surprise et dignité.
«C’était bien la peine, se dit la cuisinière, de prendre tant de précautions pour lui annoncer mon départ!»
Léocadie se trompait: bien que Mme Olivier pensât, elle aussi, que cette fille n’était pas à sa place dans un intérieur aussi modeste que le sien, elle l’eût encore conservée. M. Olivier s’indigna, il voulut empêcher sa femme de donner un certificat à l’ingrate servante. Pauline parvint à apaiser son père en excusant la conduite de celle qui ignorait les lois de la bonne éducation. «Léocadie nous connaît à peine, mon père, il ne faut pas être surpris de son indifférence pour nous.»