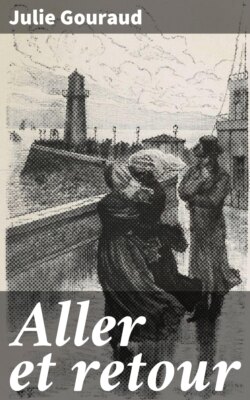Читать книгу Aller et retour - Julie Gouraud - Страница 5
ОглавлениеLes camarades de collège.
Pendant que Mme Olivier donne le dernier coup d’œil à la chambre d’ami, et qu’elle s’assure que rien n’y manque pour l’agrément de l’hôte qu’elle attend, son mari se rend dans la cour de la diligence pour recevoir un ancien camarade de collège, Louis Varin.
Il y avait trente ans que les deux amis s’étaient perdus de vue, et si un petit héritage n’eût amené Varin en Touraine, ils n’auraient jamais eu l’occasion de se revoir.
Cette visite inattendue causait une grande joie à M. Olivier; tous ses souvenirs de jeunesse se ravivèrent. Varin y tenait une si grande place, par ses succès au grand concours, et ses espiègleries à la classe!
Mme Olivier n’ignorait rien de tout cela; elle réservait un aimable accueil à l’ami de son mari. Fille unique d’un architecte, élevée dans la plus grande simplicité, Louise Renaud avait appris de sa mère que le bonheur se trouve dans l’accomplissement du devoir, qu’il faut aimer le chez soi, le faire aimer à son mari et à ses enfants.
C’est dans ces dispositions que Mlle Louise Renaud épousa M. Olivier, notaire à Amboise; elle fut bien accueillie, et bientôt appréciée de toute la société.
M. Olivier avait consenti à ce que sa fille fût élevée à la maison pour consoler sa femme de l’absence de leur fils Antoine, élevé à Rollin, où son père avait fait ses études.
Pauline Olivier avait quinze ans; elle n’était pas précisément jolie, mais charmante; sa taille élégante faisait valoir la simplicité de sa mise; ses manières étaient naturellement d’une distinction qui ne se rencontre pas toujours en province. Illusionnée par l’extérieur charmant de sa fille, Mme Olivier jugeait que Pauline n’était point faite pour être initiée aux soins du ménage, comme elle-même l’avait été par sa mère. Si Pauline témoignait le désir de se rendre utile, Mme Olivier lui disait: «Ma chérie, c’est mon affaire; achève la lecture qui t’intéresse, étudie ton piano.» Pauline, confiante dans les conseils de sa mère, obéissait et se laissait gâter sans scrupule.
C’est dans cet intérieur que M. Varin va passer quelques jours.
La diligence est en retard; M. Olivier ne s’alarme pas, mais il s’impatiente. Enfin le fouet du postillon se fait entendra un nuage de poussière annonce la voiture publique, les voyageurs en descendent. Les deux camarades se reconnaissent, ils se jettent dans les bras l’un de l’autre, et Varin étant en possession de son mince bagage, ils prennent le chemin de la maison du notaire.
Tout en marchant, ils s’entretiennent des principaux événements qui ont rempli ces trente années de séparation. Yarin s’est marié en Belgique, où il a une bonne position dans l’industrie; il passe l’hiver à Bruxelles, non par goût, mais pour se rapprocher de sa fille unique, la baronne de Vandermersh, qui reçoit l’élite de la société ; son château, situé aux environs de Liège, est un séjour délicieux pendant la belle saison. «Tu viendras nous voir,» dit M. Varin; maintenant nous ne pouvons plus laisser passer trente années sans nous visiter.»
Le compte rendu d’Olivier fut beaucoup moins brillant: la société du notaire se composait de quelques paisibles bourgeois, du médecin et du maire.
Les deux amis parlèrent de leur bonheur de famille. Nous regrettons de savoir que le chemin fût désert, quelques passants eussent peut-être fait leur profit des confidences de ces messieurs.
Mme Olivier réservait un gracieux accueil à l’homme qui se détournait de sa route pour venir voir son ancien camarade. «Cette visite, pensait-elle, sera une précieuse distraction pour mon cher François, car, je le sais, il se dégoûte de la vie de province, c’est pourquoi il a voulu qu’Antoine fît ses études à Paris. Nous sommes pourtant heureux dans notre petite maison!»
A ce moment, ses yeux s’arrêtèrent sur le jardin paré des fleurs que le mois de juillet nous donne en abondance.
Ce jardin était le seul luxe de la maison; Mme Olivier et sa fille y passaient une partie de la journée. Le notaire en profitait aussi. Il venait y fumer son cigare après chaque repas; il s’y reposait des visites de ses clients, dont la plupart, honnêtes paysans, s’affranchissaient des lois de la langue française.
La présence de M. Varin fut l’occasion dé réunir quelques amis; l’abondance de la table, la qualité des convives, tout annonçait l’aisance et la considération dont jouissait le notaire. «Olivier, pensait M. Varin, a toujours eu du bon sens, je ne suis pas surpris qu’il apprécie la vie de province.»
Une course à la ferme dont venait d’hériter M. Varin fut l’occasion d’une agréable promenade: fort à l’aise dans un cabriolet qui n’était pas précisément le dernier modèle de l’élégance, les deux amis allaient tranquillement dans les chemins de traverse. Olivier faisait les honneurs du pays, il indiquait, avec le manche de son fouet, les châteaux, il disait aussi un mot plus ou moins favorable des châtelains.
M. Varin était ravi de tout ce qu’il voyait: «Quel bon et beau pays! les arbres portent autant de fruits que de feuilles! Vraiment mon cher oncle aeu une bonne idée de me laisser sa ferme! qui sait! Peut-être deviendrai-je tourangeau!
— Mon pauvre ami, tu as donc encore ton imagination de quinze ans! Toi! vivre en province! à la campagne! je peux t’assurer qu’une année passée dans ce beau pays te paraîtrait bien longue!
— Détrompe-toi: sans être aussi affairé que M. le notaire, j’aurais des occupations assez intéressantes pour m’aider à passer le temps, Bruxelles est un petit Paris qui n’a pas les avantages d’une grande capitale, et si ma femme partageait mes goûts, nous vivrions en province.» Cette réflexion resta sans réponse, et le silence durait depuis quelques instants lorsqu’une fermière fit signe au notaire de s’arrêter: «Monsieur, dit-elle, le mariage de ma fille Éléonore est décidé, elle épouse le maréchal de chez nous, et les parents iront vous en causer samedi.»
La ferme dont M. Varin venait d’hériter était à quatre lieues d’Amboise; c’était un joli bien, suivant l’expression du pays. Le nouveau maître fut reçu avec les honneurs que commandait la circonstance. L’enthousiasme de l’héritier excitait la gaieté de son camarade.
— Ris tant qu’il te plaira, mon cher, mes yeux se reposent avec complaisance sur ces champs dorés, ces coteaux de vignes. J’ai assez des cheminées de nos usines et de notre charbon. Je veux amener ma femme ici, je suis sûr qu’elle partagera mon admiration pour ton pays, ingrat!
La Pie étant reposée, on se hâta de se remettre en route, il ne fallait pas retarder le dîner.
La visite à la ferme fournit largement à la conversation. Mme Olivier était fière de voir son pays si bien apprécié, elle fit valoir les avantages de la petite ville d’Amboise et, profitant de l’opinion favorable que son hôte avait de la Touraine, elle dénonça, en riant, son mari qui avait parfois des boutades contre la Province. M. Olivier prit la chose en plaisantant, mais il fut d’autant plus vexé de voir sa pensée mise à jour, que son ami s’écria: «Par exemple! mon cher, serais-tu tenté d’augmenter le nombre de ces imprudents qui renoncent au bienfait d’une vie paisible pour aller se jeter dans ce gouffre qu’on appelle Paris! Ton fils fait de bonnes études, il te succédera; et, si je ne me trompe, Mlle Pauline ne songe pas plus à Paris qu’à Pondichéry!»
Le nouveau maître fut reçu avec les honneurs que commandait la circonstance.
Cette plaisanterie égaya la jeune fille, et la conversation prit un autre tour; mais lorsqu’on se fut séparé, M. Olivier reprocha doucement à sa femme d’avoir commis une indiscrétion; Louise se défendit en riant: «M. Varin te connaît assez pour ne pas prendre au sérieux mes paroles, il croirait te faire une injure en supposant que tu aies la pensée de renoncer à une position aussi honorable que la tienne.»
Mme Olivier se trompait, les paroles de son mari avaient laissé une fâcheuse impression dans l’esprit de son hôte. «Serait-il vraiment assez fou, se demandait M. Varin, pour abandonner une Étude qui lui rapporte un joli revenu et beaucoup de considération? heureusement que sa femme a du bon sens, et sa fille me paraît n’en pas manquer non plus. Cette petite Pauline est charmante. Son père pourrait-il renoncer à l’établir dans ce pays-ci? Non, non! mon camarade, comme tant de gens de province, s’est cru obligé de dire du mal de sa petite ville, voilà tout. Je ne veux pas m’arrêter plus longtemps à cette folle pensée.»
Le lendemain était un samedi; jour de marché. M. Varin ne compta pas moins d’une vingtaine de paysans et de paysannes qui entrèrent dans l’Étude de Maître Olivier. Ils y firent de longues séances qui durent certainement se terminer par l’exhibition de bonnes pièces de six francs.
Si la conversation de la veille n’eût pas eu lieu, Varin eût félicité son ami de l’emploi de sa matinée, mais il crut prudent de ne pas revenir sur une question délicate, et se borna à constater la chose.
On se quitta très satisfaits les uns des autres. M. Varin essaya, sans succès, d’obtenir la promesse d’une visite à Bruxelles. Ses amis l’engagèrent au contraire à venir surveiller sa ferme.
A la vue d’un panier de fruits, le voyageur se récria bien haut: «Y songez-vous, madame, ces abricots arriveraient en marmelade!
— Eh bien! monsieur, la besogne sera faite.
— Mais vraiment...
— Il n’y a pas de mais, monsieur, nous sommes riches en fruits, et c’est un grand plaisir pour nous d’en offrir à nos amis. Votre camarade n’aimait pas les paquets, au commencement de notre mariage; mais il s’est fait peu à peu au métier de commissionnaire, et maintenant il accepte de bonne grâce les petits embarras que nous lui créons de temps en temps. Du reste, monsieur, il ne tiendra qu’à vous de diminuer le poids du panier.
— Non pas, dit Pauline, c’est moi qui ai cueilli ces abricots, et je tiens à ce que ces dames reçoivent le panier intact.»
M. Varin s’inclina, et promit de remettre fidèlement à sa femme le dépôt qui lui était confié.
Le souvenir de ceux qui nous ont quittés ajoute au plaisir que nous a donné leur présence; mais on en veut au temps d’avoir passé si vite. C’est bien là ce qu’éprouvait la famille Olivier: «Qu’il est aimable!» disait Pauline. «Que son voisinage serait précieux pour nous!» ajoutait la mère.