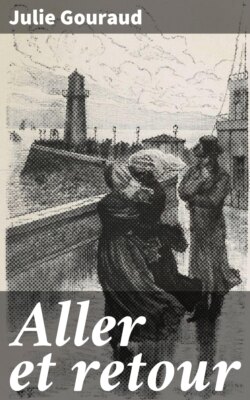Читать книгу Aller et retour - Julie Gouraud - Страница 8
Les vacances d’un rhétoricien.
ОглавлениеLe vide que fit le départ de M. Varin ne tarda pas à être comblé par la présence d’un hôte bien cher.
Les vacances approchaient: mais avant de s’échapper du collège, il faut passer par le feu du concours. Pauline a beau dire qu’elle est sûre du succès de son frère, son inquiétude est extrême: tantôt Antoine est couronné au grand concours, tantôt il a éprouvé un échec désastreux. Quinze jours s’écoulent dans des alternatives de joie et de tristesse. Pauline guette chaque matin le facteur; elle croit bonnement que les collégiens ont le temps d’écrire à la veille d’un concours général. Ce fut cependant elle qui remit à son père une lettre ainsi conçue: «Admis au grand concours.»
Cette admission est bien sans doute le commencement de la campagne, mais la victoire reste incertaine.
Pauline ne pouvait supporter l’idée que son frère n’eût pas sa part de gloire dans cette grande bataille, et lorsque, répondant à ses questions, son père lui démontre la difficulté d’obtenir un succès, Pauline déclare que le concours général est un supplice inventé pour les écoliers et leurs sœurs.
M. Olivier laissa Pauline dans l’ignorance du jour où serait livrée la bataille. Mais lorsque, quelques jours plus tard, le facteur eut déposé, avec une indifférence non coupable, la lettre qui annonçait qu’Antoine avait obtenu le premier prix de discours français, l’heureux père poussa des cris de joie qui ressemblaient tellement à des cris de détresse, que sa femme et sa fille, le voyant entrer avec une lettre à la main, ne doutèrent pas qu’Antoine eût échoué. Cette erreur fut promptement remplacée par la certitude d’un succès si vivement désiré. M. Olivier prit immédiatement son chapeau et sa canne, et alla colporter dans la ville la bonne nouvelle qu’il venait de recevoir.
Avec quelle fierté le brave homme parlait de son fils! Avec quelle complaisance il constatait la difficulté de réussir dans un concours général!
A partir de ce moment, Mme Olivier et sa fille comptèrent les jours qui les séparaient de l’arrivée du jeune lauréat. Il n’était: question que de lui, des plaisirs et des surprises dus à un si vaillant écolier. Pauline voulait faire passer son frère sous un arc de triomphe; son père avait un autre projet dont le succès n’était pas douteux.
Antoine avait témoigné le désir d’avoir un cheval, la promesse lui en avait été faite; mais la place que l’animal devait occuper restait vide: n’était-ce pas le moment de tenir parole au brave écolier?
Le conseil de famille fut unanime. Jean, le serviteur qui avait fait sauter Antoine sur ses genoux, se mit en campagne dès le lendemain pour trouver un cheval dans les conditions voulues. Trois jours plus tard, il présentait à son maître Nigra, jolie jument de taille moyenne, d’un beau noir, douce comme un agneau, d’après la chronique du pays.
M. Olivier fit acquisition de la bête, Jean la montait chaque jour, il étudiait son caractère, car il n’ignorait pas la responsabilité qui pesait sur lui.
Enfin, l’écolier part: il voyagera la nuit, pour ne pas, perdre de temps, et arrivera le lendemain à cinq heures du matin.
Les gens matineux recueillent toute leur vie le bienfait de la bonne habitude qu’ils ont contractée. Chez M. Olivier, personne n’eut à faire d’effort pour aller recevoir Antoine. Jean tenait la jument par la bride et suivait ses maîtres. A peine descendu de diligence, l’écolier, peu soucieux de la poussière dont son visage portait les traces, se jeta au cou de son père, et embrassa presque en même temps sa mère et sa sœur.
Dès qu’on fut en possession de la malle du voyageur, on se hâta de prendre le chemin de la maison. Jean, qui avait trouvé le temps bien long, ne négligea rien pour attirer l’attention de son jeune maître. Tout en disant bonjour au domestique, Antoine lui demanda en rougissant à qui était la bête qu’il tenait.
«A vous, monsieur Antoine,» répondit fièrement le bon serviteur.
L’écolier sauta au cou de son père,
«Et nous! et nous! s’il vous plaît, nous avons voté en faveur de cette jolie surprise, et j’ai obtenu de mon père que tu fasses ton entrée à cheval.»
Le héros ne s’opposa point à tant d’honneur.
Jean déclara qu’un brin de toilette était nécessaire pour faire une entrée digne de la circonstance; il brossa Antoine de la tête aux pieds, et sourit en le voyant enfourcher Nigra.
Quelques pères de famille, témoins de l’entrée triomphante du jeune homme, le saluèrent avec bienveillance, d’autres ne virent qu’un acte de vanité dans cette récompense.
Le moment où Antoine descendit de cheval ne fut pas moins solennel que celui où il en avait pris possession; il fit connaissance avec Nigra, la caressa et lui promit qu’elle n’aurait rien à envier à l’écurie du château.
Le premier repas que fait un écolier en arrivant à la maison paternelle est chose importante: tout ce qu’il aime est sur la table, et son appétit répond parfaitement à la circonstance. Manette éprouvait autant de plaisir à voir manger son jeune maître qu’un dilettante qui assiste à la première représentation d’un opéra. Elle sut gré à sa maîtresse de recommander à Antoine de manger tranquillement, et d’attendre qu’on fût au jardin pour causer; que, pour le moment, il fallait être tout aux prunes et à la crème. En voyant la docilité de son frère, Pauline en conclut que la gloire développe l’appétit.
Le déjeuner étant terminé, on alla au jardin; tout le monde parlait à la fois, et si la parole fut accordée à Antoine, c’est parce qu’il avait obtenu le premier prix de discours français au concours général.
Au récit fidèle de ce grand jour succéda celui de l’année scolaire, puis l’heureux écolier voulut revoir la maison en détail: quelques changements avaient été faits, il les approuva. Pauline ne lui fit pas grâce du plus petit coin. De la maison, ils passèrent au jardin. Antoine admira les espaliers, les roses, la clématite qui faisait l’envie des voisins; tous les habitants de la volière, jeunes et vieux, étaient en parfaite santé, et le témoignaient par leur ramage, quelque peu étourdissant; mais Antoine comprenait que la critique ne pouvait trouver place dans un si grand jour.
M. Olivier étant absent, Pauline et Antoine entrèrent dans l’étude. Un changement y avait été fait: une deuxième fenêtre s’ouvrait sur le jardin; cette pièce éclairée par le soleil levant était une des plus agréables de la maison.
«Je me sens ému, dit Antoine, à la pensée que j’occuperai un jour la place de mon père.
— Certes, tu feras de beaux discours à tes clients.
— Il me tarde de travailler sous les yeux de mon père; si vous voulez attendre, mademoiselle, c’est moi qui ferai votre contrat de mariage.
— Oui, ce sera charmant. On dira au futur, s’il vient cette année: «Monsieur, veuillez attendre; le notaire n’est pas arrivé.»
Quelques peres du famille le saluèrent avec bienveillance,
Antoine n’avait pas d’autre ambition que de succéder à son père, et il s’inquiétait de l’entendre vanter les avantages de l’industrie, depuis la visite de M. Yarin. Il aimait la petite ville d’Amboise; peut-être eût-il consenti à demeurer à Tours, s’il eût été possible d’y transporter la maison, le jardin, et tout ce qu’il aimait à voir; mais la Touraine n’a pas encore adopté la méthode des Américains qui transportent leurs maisons d’une place à l’autre.
Que de fois l’écolier ne s’était-il pas dit, en traversant Paris: «Ces beaux hôtels ne valent pas notre petite maison d’Amboise!»
Le frère et la sœur obtinrent la permission de sortir seuls; cette liberté était d’un grand charme pour le protecteur et la protégée. Ils se faisaient leurs confidences.
Jusqu’ici l’avenir avait tenu peu de place dans leurs entretiens, mais alors Antoine commençait à songer à la carrière à laquelle son père le destinait. Le jeune homme considérait le temps qu’il devait passer à Paris chez un Avoué comme un temps d’épreuve qu’il aurait voulu abréger. Mais, quoique la ville de Tours offrit assez de ressources pour qu’Antoine ne s’éloignât pas du pays, M. Olivier était inflexible sur ce point. Lorsque sa femme lui exposait les avantages de la province et les dangers de Paris, il tournait la chose en plaisanterie. Il énumérait ses qualités personnelles, et forçait sa chère Louise de convenir qu’un séjour de quatre années à Paris ne lui avait pas nui: N’était-il pas un bon Notaire et un bon mari?
Il fut décidé qu’après avoir fait sa philosophie Antoine entrerait chez maître Briant, qui avait su conserver à l’Étude de son prédécesseur la réputation qui la plaçait au-dessus de tant d’autres.
Il avait été impossible, jusqu’alors, de déterminer la mère de famille à faire connaissance avec Paris. Chaque fois que son mari lui en faisait la proposition, elle refusait, et croyait adoucir ce refus en disant: «Plus tard, mon ami.»
Plus tard arriva, et, lorsqu’il fut question d’établir Antoine à Paris, la mère ne fit plus de résistance.
D’après un renseignement venu de bonne source, Mme Olivier loua pour son fils une chambre rue de Sèvres, dans le voisinage de maître Briant. Cette chambre faisait partie de l’appartement des demoiselles Bouvry, deux sœurs âgées qui étaient bien aises de s’alléger d’une partie de leur loyer. La chambre était belle, aérée, au midi. Des meubles de bois blanc justifiaient du prix modeste de la location.
La physionomie des deux sœurs était une garantie de la paix qui régnait entre elles. Une vieille servante, coiffée du bonnet breton, acheva de séduire Mme Olivier; elle accepta les conditions des demoiselles Bouvry. La mère et le fils étaient satisfaits. On passa huit jours à Paris, ces huit jours furent employés à visiter les musées, les parcs, et, sinon toutes les merveilles de la capitale, du moins celles dont on n’ignore pas. le nom en province.
Antoine était fier de sa petite érudition; sa mère témoignait à tout ce qui passait sous ses yeux un intérêt qu’elle n’éprouvait pas. La pensée de laisser son fils à Paris jetait sur tout ce qui s’offrait à ses regards un nuage dont un beau soleil d’octobre ne pouvait triompher. Enfin, après s’être assurée qu’Antoine ne manquerait de rien, après avoir témoigné aux demoiselles Bouvry sa reconnaissance de leur bon accueil, nos Tourangeaux quittèrent Paris. Madame Olivier convint que les choses étaient aussi bien arrangées que possible; M., Briant lui inspirait de la confiance, et Antoine était aussi bien accueilli par ses collègues que par le maître.
Toutefois, en dépit de sa bonne volonté, Antoine éprouva une déception profonde lorsqu’il eut pris connaissance du programme qu’il devait remplir; il jugea sa répugnance invincible et se promit de ne pas aller jusqu’au bout. Il se trompait: L’homme laborieux, même lorsqu’il n’obéit pas à sa vocation, finit par s’attacher au travail qui lui est imposé.
Antoine finit donc par s’habituer peu à peu à sa besogne; il mettait même de l’amour-propre à se distinguer de ses condisciples par une écriture lisible. Les répugnances étant vaincues, son esprit devint apte aux affaires, et six mois plus tard, il quittait la dernière place pour monter plus haut.
Antoine passait pour un original, et si l’épithète d’ours ne lui avait pas été donnée, c’est que sa politesse n’avait rien de commun avec les façons d’un ours. Ces messieurs finirent par s’habituer à la gravité de leur camarade et le laissèrent renfermé dans sa majesté ; mais, en dédommagement de cette contrainte, ils exercèrent leur humeur railleuse sur un pauvre garçon de treize ans, auquel étaient imposées toutes les corvées de l’Étude. La maigreur de l’enfant fournissait matière à des quolibets injurieux et souvent cruels. Un de ces étourdis s’étant oublié au point de frapper l’enfant, Antoine se leva et menaça celui qui venait de commettre cette lâcheté. Antoine s’attendait à être accablé par tous les autres; mais, comme il arrive souvent en pareil cas, personne n’osa réclamer.
Le lendemain matin, le pauvre enfant attendait son protecteur dans la rue; il le remercia de l’avoir défendu: «Ils m’ont tant tourmenté !» dit-il, en faisant effort pour retenir ses larmes.
Ce n’était ni l’heure ni le lieu de faire plus ample connaissance: ce Viens chez moi dimanche, à une heure, dit Antoine, tu me conteras ton histoire.»
Si simple que soit une histoire, celui qui en est le héros ne se fait pas prier pour la raconter.
Pierre se rendit, le dimanche suivant, chez M. Antoine.
«Comment t’appelles-tu d’abord, et quel est ton pays?
— Je me nomme Pierre, vous le savez déjà, je suis le fils de Jacques Coudré, qui était marchand de toile à Angers. Mon père a fait de mauvaises affaires, il en est mort de chagrin, et ma bonne mère n’a pas tardé à le suivre dans l’autre monde. Alors mon oncle Coudré m’a envoyé à Paris, chez maître Briant. J’avais déjà fait ma cinquième au collège, et, si mes parents n’étaient pas morts, j’aurais peut-être été savant comme le colonel qui demeurait à la Pointe. Il m’aimait beaucoup, le colonel!»
Antoine fut frappé du langage simple et correct de l’enfant; il le questionna sur ce qu’il avait appris. Après avoir passé un léger examen, Pierre tira de sa poche un petit livre crasseux: «Je lis toujours dans ce petit livre, monsieur
«Antoine, parce que ma mère m’a dit un jour:
«Pierre, applique-toi bien au latin, un homme
«qui ne sait pas son latin n’arrive pas à
«grand’chose.»
Ce respect du latin, et la fidélité du souvenir de Pierre pour sa mère, touchèrent Antoine: «Tu viendras ici tous les soirs: je te donnerai un livre neuf, du papier et une plume, tu continueras le latin.»
Le visage blême de Pierre se colora légèrement, et sa timidité ne l’empêcha pas de dire: «Ah! monsieur Antoine, que vous êtes bon! tant que je vivrai, je vous aimerai.»
Il restait à éclaircir une autre question: «Que gagnes-tu? Comment vis-tu, mon pauvre enfant?
— Mon oncle m’envoie vingt-cinq francs par mois; c’est pour la cuisinière de M. Briant, une bonne femme, allez, monsieur, pour cela, elle me fait coucher dans la soupente de la cuisine, me raccommode et me blanchit, sans compter qu’elle me donne quelquefois un peu de son café au lait, à condition que je lui écrive sa dépense; et puis, j’ai quinze francs par mois pour ma nourriture et mes souliers. Avec cela je ne suis pas embarrassé pour dîner: un bon morceau de pain tendre et du fromage. Ah! monsieur, le fromage! que deviendrait-on sans fromage! Je voudrais bien savoir qui est-ce qui l’a inventé ?»
La réponse fut une pièce d’un franc pour aller manger une bonne soupe, rue des Canettes, chez une brave Tourangelle connue de la famille Olivier.
A partir de ce moment, Antoine consacra ses loisirs à donner des leçons de latin à Pierre. La concierge, après s’être étonnée des visites fréquentes du petit garçon, s’en alarma: que venait-il faire tous les soirs? Le devoir ou la curiosité lui fit même dire aux demoiselles Bouvry ce qui se passait chez leur locataire. Ces demoiselles accueillirent cette dénonciation comme elle devait l’être: elles n’y attachèrent aucune importance. Antoine avait gagné leur estime et leur affection.
Une bourriche venant d’Amboise, contenant un dindon et un lièvre, surprit agréablement ces demoiselles: «Que c’est aimable, dit Mlle Zoé ! Il y a peut-être dix ans que nous n’avons vu un lièvre sur notre table.
— Et ce ne sera probablement pas le dernier, ajouta la sœur aînée: l’amour maternel est ingénieux, Mme Olivier pense avec raison que celle bourriche nous fournira l’occasion de faire une politesse à son fils, et de l’admettre dans notre intimité. Il faut lui adresser dès aujourd’hui notre invitation.»
Mlle Zoé accueillit d’autant plus volontiers le conseil de sa sœur, qu’elle s’intéressait beaucoup au jeune locataire; elle suivait, sans indiscrétion toutefois, les faits et gestes du jeune homme; elle savait l’heure à laquelle il sortait et rentrait.
Le billet d’invitation fut déposé le même jour chez la concierge, qui ne douta pas un instant que son rapport n’eût déterminé ces demoiselles à faire des remontrances à M. Antoine. «Que deviendraient les propriétaires, se dit Mme Picard, si l’œil de la concierge ne veillait à tout!»
Antoine accepta l’invitation, et la façon cordiale dont il fut accueilli le consola d’avoir perdu la liberté de sa soirée. Et puis, la vue d’un dindon élevé par Désirée, et d’un lièvre qui avait certainement couru dans le petit bois de la ferme, lui causait une douce émotion, sans nuire à son appétit. La Touraine fut le principal sujet de la conversation. Quand on eut tout dit sur cet agréable sujet, Mlle Zoé prévint Antoine qu’elle le surveillait, et que pour répondre à la confiance de sa mère elle lui donnait le conseil de ne pas travailler le soir: «Votre lampe vous trahit, monsieur; n’avez-vous pas quelque camarade à visiter?
— J’ai un ami, mademoiselle; il vient régulièrement chez moi tous les soirs; nous travaillons ensemble.
— Travailler! toujours travailler! c’est trop de zèle, monsieur.
— Rassurez-vous, mademoiselle; mon travail du soir n’est qu’une douce distraction: j’apprends le latin à un pauvre enfant qui sent le besoin de développer son intelligence.
— Serait-ce par hasard un petit garçon que la concierge hésitait à laisser monter chez vous?
— Précisément.
— Eh bien! je ne m’en étonne pas; il a une physionomie qui prévient en sa faveur; s’il était mieux vêtu, on le prendrait pour un enfant de bonne famille.
— Il appartient effectivement à une famille de bons bourgeois d’Angers; je suis en rapport avec son oncle, qui habite Mantes. J’ai reçu ce matin la somme nécessaire pour habiller Pierre Coudré. Puisque vous lui portez de l’intérêt, lorsqu’il sera habillé de neuf, nous viendrons vous faire une petite visite.
— C’est convenu,» dirent les deux sœurs.
Quelques jours plus tard, Pierre, habillé de neuf, était présenté aux demoiselles Bouvry; elles l’invitèrent à venir dîner le dimanche suivant, jour des Rois, et ce fut lui qui eut la fève! Le pauvre garçon crut rêver en se voyant le héros de cette petite fête. «Oh! si ma mère était là, dit-il, qu’elle serait heureuse! heureuse comme je le suis, moi!»
Dorénavant, l’oncle Coudré adressa chaque mois une somme au protecteur de Pierre, et, à partir de ce moment, le Bouillon de la rue des Canettes compta un habitué de plus.
Les joues du petit garçon n’étaient plus si creuses, son œil était brillant; il entrait à l’Étude avec plus d’assurance. On le laissait tranquille.
«C’est bien cela, se disait Antoine, ils s’attaquaient à sa misère, et maintenant ils respectent sa veste neuve!»
Un an plus tard, M. Coudré ayant rappelé son neveu près de lui, Antoine remit à son élève un petit volume de Virgile, en lui faisant promettre de ne jamais passer un jour sans en lire quelques lignes.
Nous aimons ceux auxquels nous avons fait du bien: le départ de Pierre Coudré affligea Antoine. L’absence de ce gentil compagnon rendit son existence monotone. Il appelait de tous ses vœux le jour où il quitterait l’étude de maître Briant pour rentrer sous la direction de son père.