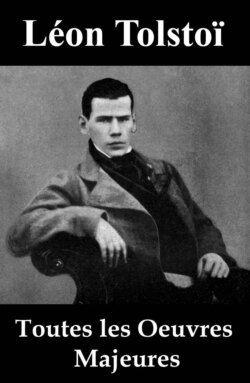Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Léon Tolstoï - León Tolstoi - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеJ’avais été très-souffrante avant notre départ, et au lieu d’aller à la campagne, nous nous étions installés dans une villa, d’où mon mari alla seul voir sa mère. Quand il partit, j’étais déjà suffisamment rétablie pour pouvoir l’accompagner; mais il m’engagea à rester, comme s’il eût craint pour ma santé. Je compris qu’au fond ce n’était pas pour ma santé qu’il craignait, mais plutôt qu’il était rempli de la pensée qu’il ne serait pas bon pour nous d’être à la campagne; je n’insistai pas beaucoup et je restai. Sans lui, je me sentis, à la vérité, dans le vide et l’isolement; mais quand il revint je m’aperçus que sa présence n’ajoutait plus à mon existence ce qu’elle y ajoutait jadis. Ces rapports d’autrefois, alors que chaque pensée, chaque sensation, si je ne les lui avais pas communiquées, m’oppressaient comme autant de crimes; alors que toutes ses actions, toutes ses paroles me paraissaient être des modèles de perfection; alors que la joie nous portait à rire de n’importe quoi, en nous regardant l’un l’autre; ces rapports s’étaient changés si insensiblement en de tout autres, que nous-mêmes nous ne nous rendions pas compte de cette métamorphose. Mais, au fond, chacun de nous avait dès lors des occupations et des intérêts séparés que nous ne cherchions plus à mettre en commun. Nous avions même cessé d’éprouver aucun trouble de vivre ainsi dans des mondes entièrement distincts, entièrement étrangers l’un à l’autre. Nous nous habituâmes à cette pensée, et au bout d’un an, tout embarras mutuel s’était évanoui quand nous venions à nous regarder l’un l’autre. Ses accès de gaîté vis-à-vis de moi, ses enfantillages avaient complètement disparu, et elle avait aussi disparu, cette indulgente indifférence à l’égard de toutes choses, qui jadis m’avait révoltée; rien non plus n’avait survécu du regard profond d’autrefois, qui me troublait et me réjouissait à la fois; plus de ces prières, de ces transports que nous aimions à partager ensemble, et nous ne nous voyions même plus que rarement; il était constamment en courses, et je ne craignais plus, je ne me plaignais plus de rester seule; j’étais perpétuellement lancée de mon côté au milieu des relations du monde, sans éprouver en rien le besoin de m’y produire avec lui.
De scènes et d’altercations entre nous, il n’était jamais question. Je m’efforçais à le satisfaire, il accomplissait tous mes désirs, et l’on eût dit que nous nous aimions toujours l’un l’autre.
Quand nous restions seuls, ce qui d’ailleurs ne nous arrivait pas souvent, je n’éprouvais auprès de lui ni joie, ni agitation, ni embarras, tout comme si je m’étais trouvée seule avec moi-même. Je savais très-bien que celui qui était la n’était pas le premier venu, quelqu’un d’inconnu, mais bien au contraire un très-excellent homme, enfin mon mari, que je connaissais aussi bien que moi-même. J’étais persuadée de savoir à l’avance tout ce qu’il ferait, ce qu’il dirait, toute sa manière de voir, et quand il faisait ou pensait autrement que je ne m’y fusse attendue, je trouvais tout simplement qu’il s’était trompé; aussi n’attendais-je précisément rien de sa part. En un mot, c’était mon mari, et rien de plus. Il me semblait que les choses étaient telles et devaient être telles, qu’il ne pouvait exister et que même il n’avait jamais existé d’autres rapports entre nous. Quand il s’absentait, surtout dans les premiers temps, j’éprouvais pourtant un terrible isolement, et c’était loin de lui que je ressentais encore avec force toute la valeur de son appui; et de même, quand il revenait, je me jetais avec joie à son cou; mais deux heures s’étaient à peine écoulées que j’avais oublié cette joie et que je ne trouvais plus rien à lui dire. Dans ces courts instants où une tendresse paisible et tempérée venait à renaître entre nous, il me semblait seulement que ce n’était plus cela, que ce n’était plus ce qui avait si puissamment rempli mon cœur, et il me semblait lire dans ses yeux la même impression. Je sentais qu’il y avait en cette tendresse une limite, qu’il ne voulait pas et que je ne voulais pas non plus franchir. Quelquefois cela me causait du chagrin, mais je n’avais plus le temps de penser sérieusement à quoi que ce fût, et je m’efforçais d’oublier ce chagrin par une variété de distractions dont je ne me rendais même pas clairement compte, mais qui s’offraient perpétuellement à moi. La vie du monde, qui, au commencement, m’avait étourdie par son éclat et la satisfaction qu’elle apportait à mon amour propre, avait bientôt entièrement dominé tous mes penchants, était devenue pour moi une habitude tout en m’asservissant, et avait occupé dans mon âme toute cette place qui y avait été destinée à abriter le sentiment. Aussi évitais-je souvent de rester seule avec moi-même dans la crainte d’approfondir ma situation. Tout mon temps, depuis l’heure la plus matinale jusqu’aux heures les plus avancées de la nuit, était pris et ne m’appartenait plus, même si je venais à ne pas sortir. Je n’y trouvais ni plaisir, ni ennui, et il me semblait qu’il en avait dû toujours être ainsi.
C’est de la sorte que trois années s’écoulèrent, et pendant leur durée nos rapports demeurèrent les mêmes, comme immobilisés, figés, et comme s’ils ne pouvaient devenir ni pires, ni meilleurs. Dans le cours de ces trois années, deux événements importants étaient survenus au sein de notre vie de famille, mais ni l’un ni l’autre n’avait apporté aucun changement dans mon existence. Ces événements avaient été la naissance de mon premier enfant et la mort de Tatiana Semenovna. Dans les premiers temps, le sentiment maternel m’avait envahi avec une telle force, et un transport si inattendu s’était emparé de moi, que j’avais pensé qu’une vie nouvelle allait commencer pour moi; mais au bout de deux mois, quand je recommençai à sortir, ce sentiment, allant toujours en décroissant, avait tourné en habitude et en froid accomplissement d’un devoir. Mon mari, au contraire, dès le moment de la naissance de ce premier fils, était redevenu l’homme du temps passé, doux, paisible et casanier, et avait reporté sur son enfant toute son ancienne tendresse et toute sa gaieté. Souvent, quand j’entrais en robe de bal dans la chambre de l’enfant pour lui donner la bénédiction du soir et que j’y trouvais mon mari, je remarquais le regard de reproche, le regard sévère et attentif qu’il semblait diriger sur moi, et j’avais honte tout à coup. J’étais terrifiée moi-même de mon indifférence envers mon enfant et je me demandais: est-ce que je serais plus mauvaise que les autres femmes? Mais qu’y faire? Pensais-je. Certes, j’aime mon fils, mais je ne peux pourtant pas demeurer assise auprès de lui des journées entières, cela m’ennuierait; quant à feindre, je ne l’aurais pas voulu pour chose au monde.
La mort de sa mère fut pour lui un très-grand chagrin; il lui devint très-pénible, disait-il, d’habiter après elle Nikolski, et bien que je l’eusse beaucoup regrettée et que je partageasse le chagrin de mon mari, il m’eût été plus agréable, à présent, et plus reposant de vivre à la campagne. Nous avions passé en ville la plus grande partie de ces trois années; je n’avais été qu’une seule fois à la campagne pendant deux mois; et la troisième année nous partîmes pour l’étranger.
Nous restâmes l’été aux eaux.
J’avais alors vingt et un ans. Notre fortune, pensais-je, était dans un état florissant; de la vie de famille je n’attendais rien de plus que ce qu’elle m’avait donné; tous ceux que je connaissais, me semblait-il, m’aimaient; ma santé était excellente, mes toilettes étaient les plus fraîches que l’on pût voir aux eaux, je savais que j’étais jolie, le temps était superbe, je ne sais quelle atmosphère de beauté et d’élégance m’enveloppait, et tout me paraissait joyeux au plus haut point. Et cependant je n’étais pas joyeuse comme je l’avais été à Nikolski, alors que je sentais que mon bonheur était en moi-même, alors que j’étais heureuse parce que je méritais de l’être; que mon bonheur était grand, mais qu’il pouvait être plus grand encore. Maintenant il en était autrement; mais cet été n’en était pas moins bon. Je n’avais rien à désirer, rien à espérer, rien à craindre; ma vie, autant qu’il me semblait, était dans tout son plein, et ma conscience, me semblait-il aussi, était tranquille.
Parmi les jeunes gens qui brillaient au sein de cette saison d’eaux, il n’y avait pas un seul homme que j’eusse, en n’importe quoi, distingué des autres, pas même du vieux prince K., notre ambassadeur, qui me faisait un peu la cour. L’un était tout jeune, un autre trop vieux, l’un était un Anglais aux boucles blondes, l’autre un Français barbu; tous m’étaient parfaitement indifférents, mais en même temps tous m’étaient indispensables. Avec leurs visages insignifiants, ils appartenaient tout de même à cette atmosphère élégante de la vie dans laquelle j’étais plongée. Cependant, il y en eut un parmi eux, le marquis italien D., qui plus que les autres attira mon attention par la façon hardie dont il avait exprimé devant moi l’enthousiasme que je lui inspirais. Il ne laissait échapper aucune occasion de se rencontrer avec moi, de danser, de monter ensemble à cheval, d’aller au casino, et il me disait sans cesse que j’étais jolie. Je le voyais quelquefois de ma fenêtre rôder autour de notre maison, et souvent l’assiduité déplaisante des regards que me lançaient ses yeux étincelants m’avait fait rougir et me détourner. Il était jeune, bien de sa personne, élégant, et ce qu’il y avait de remarquable, c’est que, dans son sourire et par certaine expression de son front, il ressemblait à mon mari, bien qu’il fût beaucoup mieux que lui. Je fus frappée de cette ressemblance, quoiqu’il en différât dans l’ensemble, dans la bouche et le regard, dans la forme allongée du menton, et qu’au lieu du charme que donnait à mon mari l’expression d’une bonté et d’un calme idéal, il y eût en lui quelque chose de grossier et presque de bestial. Là-dessus, il me vint l’idée qu’il m’aimait passionnément; je pensais quelquefois à lui avec une orgueilleuse compassion. Il m’arriva de chercher à le calmer, à le ramener aux termes d’une confiance possible et semi-amicale, mais il repoussa mes tentatives de la façon la plus tranchante et continua, à mon grand déplaisir, me troubler par les témoignages d’une passion, muette encore, mais menaçant à tout instant de faire explosion. Bien que je ne me l’avouasse pas, je craignais cet homme, et en quelque sorte contre ma propre volonté, je pensais souvent à lui. Mon mari avait fait sa connaissance, et même beaucoup plus intimement qu’avec nos autres relations, vis-à-vis desquelles il se bornait plutôt à être simplement le mari de sa femme, se montrant d’ailleurs froid et hautain.
À la fin de ma saison d’eaux je fus indisposée, et pendant deux semaines je ne quittai point la maison. Quand, pour la première fois après ma maladie, je sortis le soir pour aller à la musique, j’appris que pendant ma réclusion était arrivée lady C., qu’on attendait depuis longtemps et qui était réputée pour sa beauté. Il se forma autour de moi un cercle de personnes qui me firent joyeux accueil, mais un cercle bien plus nombreux se groupa autour de la bonne nouvelle venue. Auprès de moi tous ne parlaient que d’elle et de sa beauté. On me la montra; elle était, en effet, très-séduisante, mais néanmoins je fus désagréablement impressionnée par la suffisance peinte sur ses traits, et je le dis. Ce jour-là tout ce qui jusqu’alors m’avait paru si gai me remplit d’ennui. Le jour suivant, lady C. Organisa une excursion au château à laquelle je renonçai. Il ne resta à peu près personne avec moi, et décidément tout changea de face à mes yeux. Tout, choses et hommes, me parut en ce moment stupide et fastidieux et j’avais envie de pleurer, de terminer ma cure au plus vite et de retourner en Russie. Au fond de mon âme il s’était glissé un sentiment malsain, mais que je ne me confessais pas à moi-même. Je me dis souffrante et je cessai de me montrer dans les réunions du grand monde; je ne sortis plus que rarement, seule, et le matin, pour boire les eaux, ou bien j’allais dans les environs avec L. M., une de mes connaissances russes. Mon mari n’était pas là pendant ce temps; il était parti depuis quelques jours pour Heidelberg où il attendait la fin de ma cure, afin de repartir ensuite pour la Russie, et il ne revenait me voir que de temps à autre.
Un jour lady C. Entraîna toute la société dans une partie, et, de notre côté, L. M. Et moi, nous allâmes après dîner au château. Pendant que nous suivions, au pas de notre calèche, la chaussée sinueuse entre les rangées de châtaigniers séculaires à travers lesquels on découvrait au loin ces délicieux et élégants environs de Bade, aux derniers rayons d’un soleil couchant, nous nous mîmes à causer sérieusement, ce qui ne nous était jamais arrivé. L. M., que je connaissais depuis longtemps, m’apparut pour la première fois sous les traits d’une femme jolie et spirituelle, avec qui on pouvait parler de tout, et dont la société offrait de l’agrément. La conversation roula sur la famille, les enfants, la vie si vide qu’on menait au lieu où nous étions, notre désir de nous retrouver en Russie, à la campagne, et tout à coup je ne sais quelle impression douce et triste s’empara de nous. C’est sous l’influence de ces sentiments sérieux que nous arrivâmes au château. Derrière ses murs régnaient l’ombre et la fraîcheur, au sommet des ruines se jouaient encore les rayons du soleil, et le moindre écho de pas et de voix retentissait sous ces voûtes. À travers la porte, se déroulait comme dans un cadre le tableau de cette nature du pays de Bade, charmante et pourtant froide aux yeux de nous autres Russes.
Nous nous étions assis pour nous reposer et nous contemplions en silence le coucher du soleil. Des voix se firent entendre plus distinctes, et il me sembla que quelqu’un prononçait mon nom de famille. Je me mis à écouter et je saisis involontairement quelques mots. C’étaient des voix à moi connues, celles du marquis D. Et du Français, son ami, que je connaissais aussi. Ils parlaient de moi et de lady C. Le Français nous comparait l’une à l’autre, et analysait la beauté de chacune de nous. Il ne disait rien d’offensant, et cependant le sang me remonta au cœur quand j’entendis ses paroles. Il expliquait en détail ce qu’il trouvait de bien, soit en moi, soit en lady C. Pour moi, j’avais déjà un enfant et lady C. N’avait que dix-neuf ans; la tresse de mes cheveux était plus belle, mais en revanche celle de lady C. était plus gracieuse; lady C. était plus grande dame, tandis que la vôtre, disait-il en parlant de moi, est une de ces petites princesses russes qui, si souvent, viennent faire ici leur apparition. Il conclut en disant que je faisais très-bien en n’essayant pas de lutter contre lady C., ou que définitivement je trouverais à Bade mon tombeau.
— Cela me ferait vraiment de la peine.
— À moins qu’elle ne veuille se consoler avec vous, ajouta le Français avec un rire joyeux et cruel.
— Si elle partait, je la suivrais, dit grossièrement la voix à l’accent italien.
— Heureux mortel! Il peut encore aimer! Répondit son interlocuteur avec moquerie.
— Aimer! Reprit la voix, et elle se fut un moment. Je ne peux pas ne point aimer! Sans amour il n’y a point de vie. Faire de sa vie un roman, il n’y a que cela de bon. Et mon roman ne s’arrête jamais au milieu; celui-ci comme les autres, je le mènerai jusqu’au bout.
— Bonne chance, mon ami, poursuivit le Français.
Je n’en entendis pas davantage, parce qu’ils passèrent derrière un angle du mur et que bientôt leurs pas se perdirent d’un autre côté. Ils descendirent l’escalier, et au bout de quelques minutes ils sortirent par une porte latérale et furent très-surpris en nous voyant. Je rougis quand le marquis D. S’approcha de moi, et je fus tout effrayée quand, à la sortie du château, il m’offrit son bras. Je ne pouvais refuser, et à la suite de L. M., qui cheminait avec l’ami du marquis, nous nous dirigeâmes vers la calèche. J’étais offensée de ce que le Français avait dit de moi, bien que je reconnusse en secret qu’il s’était borné à donner un nom à ce que je sentais moi-même; mais les paroles du marquis m’avaient confondue et révoltée par leur grossièreté. J’étais torturée par la pensée d’avoir entendu ces paroles, et en même temps je n’avais plus peur de lui. J’étais dégoûtée de le sentir si près de moi; sans le regarder, sans lui répondre, et tout en m’efforçant de retenir mon bras de telle façon que je ne pusse écouter ses paroles, je marchai hâtivement derrière L. M. Et le Français. Le marquis me disait je ne sais quoi sur la beauté de la vue, sur le bonheur inattendu de m’avoir rencontrée, et je ne sais quoi encore; mais je ne l’entendais pas. Je pensais durant ce temps à mon mari, à mon fils, à la Russie; j’étais partagée entre la honte, la pitié, le désir de hâter encore plus mon retour à la maison, dans ma chambre solitaire de l’Hôtel de Bade, afin de réfléchir en liberté sur ce qui, depuis un moment, se soulevait dans mon âme. Mais L. M. Marchait doucement, il y avait encore loin jusqu’à la calèche, et il me semblait que mon cavalier ralentissait obstinément le pas, comme s’il essayait de rester seul avec moi. « Cela ne peut être pourtant! » me dis-je, et je me décidai à marcher d’une allure plus rapide. Mais il me retint positivement et il me serra même le bras; à ce moment L. M. Tourna un coin de la route et nous demeurâmes entièrement seuls. Je fus saisie de crainte.
— Excusez-moi, dis-je froidement, et je voulus retirer mon bras, mais la dentelle de ma manche s’accrocha dans un de ses boutons. Alors, se courbant vers moi, il se mit à la détacher, et ses doigts dégantés touchèrent mon bras. Un sentiment nouveau, qui n’était pas l’effroi, qui n’était pas non plus le plaisir, me fit courir dans le dos un frisson glacé. Je le regardais en même temps, pour que mon froid regard exprimât tout le mépris que je lui portais; mais ce regard, paraît-il, n’exprimait pas ce sentiment autant que celui de la frayeur et de l’agitation. Ses yeux ardents et humides, arrêtés sur moi, me fixaient avec passion, ses deux mains saisirent les miennes au-dessus du poignet, ses lèvres entr’ouvertes me murmurèrent quelque chose, me dirent qu’il m’aimait, que j’étais tout pour lui, et ses mains me pressèrent plus fortement. Je sentis du feu dans mes veines, mes yeux s’obscurcirent, je tremblai, et les paroles par lesquelles j’aurais voulu l’arrêter se desséchèrent dans mon gosier. Tout à coup je sentis un baiser sur ma joue, et alors, tremblante et glacée, je demeurai sur place et le regardai. N’ayant la force ni de parler, ni d’agir, pleine d’effroi, j’attendais et je souhaitais Dieu sait quoi.
Tout ceci eut la durée d’un instant. Mais cet instant fut terrible! Dans cet instant je le vis tout entier tel qu’il était, j’analysai son visage d’un coup d’œil: son front court et bas, son nez droit et correct, aux narines gonflées, ses moustaches et sa barbe fines et cirées en pointes aiguës, ses joues rasées avec soin, et son cou bruni. Je le haïssais, je le craignais, il était un étranger pour moi, et pourtant dans ce moment avec quelle puissance retentirent en moi le trouble et la passion de cet homme haïssable, de cet étranger!
— Je vous aime, murmura-t-il de cette voix qui était si semblable à celle de mon mari. Mon mari et mon enfant me revinrent aussitôt à la mémoire, comme des êtres chéris qui auraient existé jadis et pour qui tout eût été fini. Mais soudain, de derrière un coude du chemin, se fit entendre la voix de L. M., qui m’appelait. Je repris mes esprits, j’arrachai ma main sans le regarder, je m’enfuis à peu près pour rejoindre L. M. Nous montâmes dans la calèche et alors seulement je lui jetai un coup d’œil. Il ôta son chapeau et me dit je ne sais plus quoi en souriant. Il ne se doutait pas de l’inexprimable torture qu’il me faisait endurer en ce moment.
La vie me semblait si malheureuse, l’avenir si désespéré, le passé si sombre! L. M. Causa avec moi, mais je ne compris pas un mot de ce qu’elle me disait. Il me semblait qu’elle me parlait uniquement par compassion, pour cacher le mépris que je lui inspirais. Dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses regards je croyais saisir ce mépris et cette outrageante compassion. Ce baiser brûlait encore mes joues d’une honte cuisante, et la pensée de mon mari, celle de mon enfant, m’étaient insupportables. Restée seule dans ma chambre, j’espérais pouvoir méditer sur ma situation; mais il me parut effroyable de demeurer seule. Je ne pris pas le thé qu’on m’apporta, et sans savoir moi-même pourquoi, avec une hâte dévorante, je me décidai à partir le soir même par le train de Heidelberg et à rejoindre mon mari. Quand je fus assise avec ma femme de chambre dans le wagon désert, que la machine se mit en mouvement et que je respirai l’air frais par les glaces baissées, je commençai à revenir à moi et à me représenter d’une manière plus claire mon passé et mon avenir. Toute ma vie de mariage, à dater du jour de notre départ pour Pétersbourg, m’apparut soudain sous un jour nouveau et remplit ma conscience de reproches.
Pour la première fois je me rappelai vivement notre début d’existence à la campagne, mes plans; pour la première fois cette question me vint à l’esprit: quelles ne furent pas ses joies pendant ce temps? Et je me sentais coupable envers lui. Mais aussi pourquoi ne pas me retenir, pourquoi dissimuler devant moi, pourquoi éviter toute explication, pourquoi m’offenser? Me demandais-je. Pourquoi n’usait-il pas avec moi du pouvoir de son amour? Ou bien ne m’aimait-il plus? Mais qu’il fût coupable ou non, le baiser de cet étranger n’en demeurait pas moins empreint sur ma joue, et il me semblait le ressentir encore. Plus j’approchais de Heidelberg et plus claire s’offrait à moi l’image de mon mari, plus terrible l’attente imminente du revoir. Je lui dirai tout, tout; je noierai mes yeux des larmes du repentir, pensais-je, et il me pardonnera. Mais je ne savais pas moi-même ce qu’était ce « tout » que je lui dirais, et je n’étais pas convaincue qu’il me pardonnât.
Aussi, dès que j’entrai dans la chambre de mon mari et que je revis son visage si calme, bien qu’étonné, ne me sentis-je plus en état de lui rien dire, de rien confesser, ni de lui demander mon pardon. Une indicible affliction et un repentir profond pesaient sur moi.
— À quoi as-tu donc pensé? Me dit-il: je comptais aller te rejoindre demain. Mais, m’ayant examinée de plus près, il se montra presque effrayé. Qu’as-tu? Qu’as-tu donc? Poursuivit-il.
— Rien, répondis-je, ayant peine à retenir mes larmes… Je suis arrivée pour tout de bon. Partons, fût-ce demain, pour rentrer chez nous en Russie.
Il demeura longtemps en silence, m’observant avec attention.
— Allons, raconte-moi ce qui est arrivé? Dit-il enfin.
Je rougis involontairement et je baissai les yeux. Dans les siens brillait je ne sais quel pressentiment d’outrage et de courroux. Je redoutai la pensée qui pouvait l’assaillir, et avec une puissance de dissimulation dont je ne me serais moi-même pas crue capable, je me hâtai de lui dire:
— Il ne m’est rien arrivé, seulement l’ennui et la tristesse m’ont gagnée; j’étais seule, j’ai beaucoup pensé à notre genre de vie et à toi. Qu’il y a longtemps que je suis coupable envers toi! Après cela, tu peux bien m’emmener avec toi où tu voudras! Oui, il y a longtemps que je suis coupable envers toi, répétai-je, et de nouveau les larmes jaillirent de mes yeux. Retournons à la campagne, m’écriai-je, et pour toujours!
— Ah! Mon amie, dispense-moi de ces scènes sentimentales, dit-il froidement: que tu ailles à la campagne, c’est très-bien, parce que nous sommes un peu à court d’argent; mais que ce soit pour toujours, là est le rêve: je sais que tu ne peux pas y rester longtemps. Allons, bois une tasse de thé, ce sera mieux, conclut il en se levant pour appeler la domestique.
Je me représentai ce que sans doute il pensait de moi, et je me sentis offensée des affreuses idées que je lui attribuai en rencontrant le regard plein de méfiance et de honte, en quelque façon, qu’il dirigea sur moi. Non, il ne veut et ne peut me comprendre! Je lui dis que j’allais voir l’enfant, et je le quittai. Il me tardait d’être seule et de pouvoir pleurer, pleurer, pleurer…